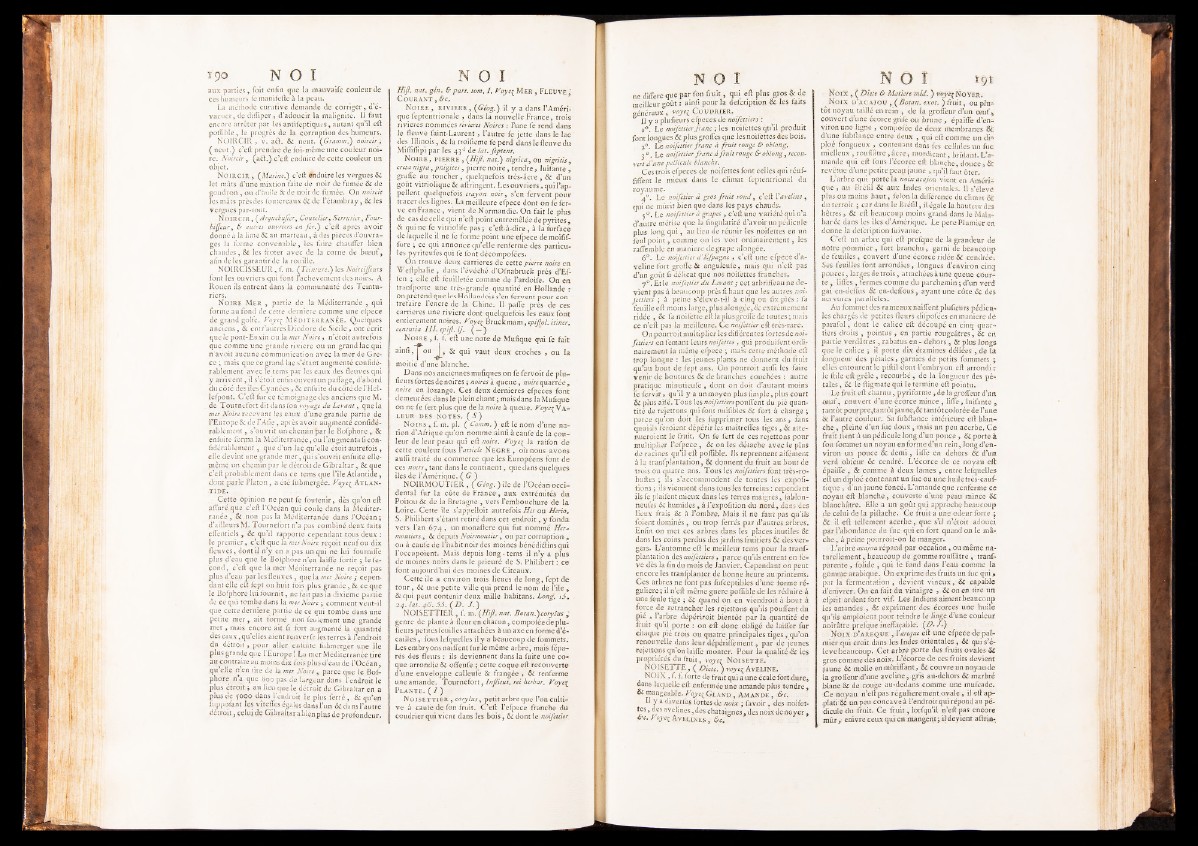
aux parties, foit enfin que la mauvaise couleur de
ces humeurs femanifefteà la peau.
La méthode curative démande de corriger, d’évacuer,
de difliper, d’adoucir la malignité. Il faut
encore arrêter par lesantifeptiques, autant qu’il eft
polîible, le progrès de la corruption des humeurs.
NOIRCIR, v. aft. 6c neut. (Gratnm.) noircir,
( ncut.) c’eft prendre de foi-même une couleur noire.
Noircir, (aft.) c’efi: enduire de cette couleur un
objet.
Noircir * (Marine.) c’efi enduire les vergues &
let mâts d’une mixtion faite de noir de fumée 6c de
goudron , ou d’huile &de noir de fumée. On noircit
les mâts prèsdes foutereaux 6c de l’étambray, 6c les
vergues par-tout.
Noircir, (Arquebufer, Coutelier, Serrurier, Four-
bifeur, & autres ouvriers en fer.') c ’efi après avoir
donné à la lime 6c au marteau, à des pièces d’ouvrages
la forme convenable, les faire chauffer bien
chaudes, 6c les froter avec de la corne de boeuf,
afin de les garantir de la rouille.
NOIRCISSEUR, f. m. (Teinture.') les NoireiJ/iurs
font les ouvriers qui font l’achevement des noirs. A
Rouen ils entrent dans la communauté des Teinturiers.
Noire Mer , partie de la Méditerranée , qui
forme au fond de cette derniere comme une efpece
de grand golfe. Voye{ Méditerranée. Quelques
anciens, & entr’autresDiodore de Sicile, ont écrit
que le pont-Euxin ou la mer Noire, n’étoit autrefois
que comme une grande riviere ou un grand lac qui
n’avoit aucune communication avec la mer de Grèce
; mais que ce grand lac s’étant augmenté confidé-
rabiement avec le tems par les eaux des fleuves qui
y arrivent, il s’étoit enfin ouvert un paflage, d’abord
du côté des îles Cyanées , 6c enfuite du côté de l’Hel-
lefpont. C ’eft fur ce témoignage des anciens que M.
de Tournefort dit dans fon voyage du Levant, que la
mer Noire recevant les eaux d’une grande partie de
l’Europe & de I’Afie , après avoir augmenté confidé-
rablement, s’ouvrit un chemin bar le Bofphore, &
enfuite forjna la Méditerranée, ou l’augmenta ficon-
fidérablemenf, que d’un lae^qu’elle étoit autrefois ,
elle devint une grande mer, qui s'ouvrit enfuite elle-
même un chemin par le détroit de Gibraltar, 6c que
c’eft probablement dans ce tems que l’île Atlantide,
dont parle Platon, a été fubmergée. Foye{ Atlantide.
Cette opinion ne peut fe foutenir, dès qu’on eft
.afluré que c’eft l’Océan qui coule dans la Méditerranée
, & non pas la Méditerranée dans l’Océan;
d’ailleurs M. Tournefort n’a pas combiné deux faits
effentiels , 6c qu’il rapporte cependant tous deux :
le premier, c’efi: que la mer Noire reçoit neuf ou dix
fleuves, dont il n’y en a pas un qui ne lui fourniffe
plus d’eau que le Bolphore n’en laiffe fortir ; le fécond
, c’eft que la mer Méditerranée ne reçoit pas
plus d’eau par les fleuves , que la mer Noire ,* cependant
elle eft fept ou huit fois plus grande, & ce que
le Bofphore lui fournit, ne fait pas la dixième partie
de ce qui tombe dans la mer Noire ; comment veut-il
que cette derniere partie de ce qui tombe dans une
petite mer, ait formé non feulement une grande
mer , mais encore ait fi fort augmenté la quantité
des eaux, qu’elles aient renverfe les terres à l’endroit
du détroit, pour aller enfuite lubmerger une île
plus grande que l'Europe ! La mer Méditerranée tire
au contraire au mpins dix fois plus d’eau de l’Océan,
qu elle n en tire de la mer Noire , parce que le Bofphore
n a que 8oo pas de largeur dans l’endroit le
plus étroit ; au lieu que le détroit de Gibraltar en a
plus ne 5000 dans l’endroit le plus ferré , 6c qu’en
fuppofant les vîteffes égales dans l’un 6c dans l’autre
détroit, celui de Gibraltar a bien plus de profondeur.
Hijl. nat, gin. & part. tom. I. Voyt{ Mer , Fleuve \
C ourant , &c.
Noire , riviere, ( Glog.) il y a dans l’Amérique
feptentrionale , dans la nouvelle France, trois
rivières nommées rivières Noires : l’une fe rend dans
le fleuve faint-Laurent, l’autre fe jette clans le lac
des Illinois, & la troifieme feperd dans le fleuve du
Mifliflipi par les 43 e1 de lat.feptent.
NoiRE, pierre , (Hijl. nat.) nigrica, Ou nigritis,
creta nigra, pnigites, pierre noire, tendre, luifante ,
grafle au toucher, quelquefois très-âcre , & d’un
goût vitriolique& aftringent. Les ouvriers, qui l’appellent
quelquefois crayon noir, s’en fervent pour
tracer des lignes. La meilleure efpece dont on fe fer-
ve en France, vient de Normandie. On fait le plus
de cas de celle qui n’eft point entremêlée de pyrites,
& qui ne fe vitriolife pas ; c ’eft-à-dire, à la furface
de laquelle il ne fe forme point une efpece demoifif-
fure ; ce qui annonce qu’elle renferme des particules
pyriteufes qui fe font décompofées;
On trouve deux carrières de cette pierre noire en
Weftphalie , dans l’évéché d’OfnabrucJc près d’Ef-
fen ; elle eft feuilletée comme de l’ardoife. On en
tranfporte une très-grande quantité en Hollande :
on prétend que les Hollandois s’en fervent pour contrefaire
l’encre de la Chine. Il paffe près de ces
carrières une riviere dont quelquefois les eaux font
entièrement noires. Foye^ Bruckmam, epijlol. itincr.
etnturia lll.ep ijl, i j . ( — )
Noire , 1. f. eft une note de Mufique qui fe fait
ainfi ,"T"ou J & qui vaut deux croches , ou la
moitié d’une blanche.
Dans nos anciennes mufiques on fe fervoit de plu-
fieurs fortes de noires ; noires à queue, noire quarrée,
noire en iozange. Ces deux dernieres efpeces font
demeurées dans lé plein chant ; mais dans la Mufique
on ne fe fert plus que de la noire à queue. FoyefW A-
LEUR DES NOTES. ( S )
Noirs , f. m. pl. ( Comm. ) eft le nom d’une nation
d’Afrique qu’on nomme ainfi à caufe de la couleur
de leur peau qui eft noire. Fyyeç la raifon de
cette couleur fous M article Negre , oii nous avons
aufli traité du commerce que les Européens font de
ces noirs, tant dans le continent, que dans quelques
îles de l’Amérique. ( G )
NOIRMOUTIER, ( Glog. ) île de l’Océan occidental
fur la côte de France, aux extrémités du
Poitou & de la Bretagne , vers l’embouchure de la
Loire. Cette île s’appelloit autrefois Her ou Herio.
S. Philibert s’étant retiré dans cet endroit, y fonda
vers l’an 674 , un monaftere qui fut nommé Her-
mçnuiers, & depuis Noirmoutier, ou par corruption ,
ou à caufe de l’habit noir des moines bénédi&ins qui
l’occupoient. Mais depuis long-tems il n’y a plus
de moines noirs dans le prieuré de S. Philibert : ce
font aujourd’hui des moines de Cîteaux.
Cette île a environ trois lieues de long, fept de
tour, 6c une petite ville qui prend le nom de l’île ,
& qui peut contenir deux mille habitans. Long. i5.
24. lat. 46 .5 6. (D . J .)
NOISETTIER, f. m. (Hijl. nat. Botan.)corylus
genre de plante à fleur en chaton, compoféedeplu-
fieurs petites feuilles attachées à un axe en forme d’é-
cailles ,, fous lefquelles il y a beaucoup de fommets.
Les embryons naiffent fur le même arbre, mais fépa-
rés des fleurs : ils deviennent dans la fuite une co»
que arrondie & offeufe ; cette coque eft recouverte
d’une enveloppe calleufe & frangée , 6c renferme
une amande. Tournefort, Injlitut. rei her bar. Foyeç
Plante. ( I )
Noisettier , corylus, petit arbre que l’on cultive
à caulè de fon fruit. C ’eft l’efpece franche du
coudrier qui vient dans les bois, 6c dont le noijeuier
tie d'i&re q«e Par f°» Ê'uit > *iui eiî pïuÿ gft» &
ïuciîïtur goût : ainfi pour la defeription & les faits
généraux > v « C o ud rier. ,
II y a plufieurs efpeces de noifettiers ;
i° . Le noifetùer franc ; les noifettes qu’il produit
font longues & plus groftes que les noifettes des bois.
2°. Le noifettier franc à fruit rouge & oblong.
3 Le noijeuier franc à fruit rouge & oblong, recouvert
d'une pellicule blanche.
Ces trois efpeces de noifettes font celles qui réuf-
fiffent le mieux dans le climat feptentrional du
royaume.
40. Le noifetier à gros fruit rohd, c’eft l’aveline ,
qui ne mûrir bien que dans les pays chauds.
Le noijeuier à grapes , c’eft une variété qui n’a
d’autre mérite que la Angularité d’avoir un pédicule
plus long q u i, au lieu de réunir les noifettes en un
feul point, comme on les voit ordinairement, les
raffemble en manière degrape alongée,
6°. Le noifettier d'Efpagne , c’eft une efpece d’aveline
fort greffe 61 anguleufe, mais qui n’eft pas
d’un goût fi délicat que nos noifettes franches,
7 0. Et le iioifejtier du Levant ; cet arbriffeaune devient
pas à beaucoup près fi haut que les autres noifettiers
; à peine s’éieve-t-il à cinq ou fix pies : fa
feuille eft moins large, plus alongée, 6ç extrêmement
ridée , 6c fa noifette eft la plus groffe de toutes ; mais j
ce n’eft pas la meilleure. C e noifettier eft très-rare.
On pourroit multiplier les différentes fortes de noifettiers
en feuiant leurs noifettes, qui produifent ordi*-
nairement la même efpece ; mais cette méthode eft
trop longue : les jeunes plants ne donnent du fruit
qu’au bout de fept ,ans. Ou pourroit aufli les faire
venir de boutures 6c de branches couchées : autre
pratique minutieufe , dont on doit d’autant moins !
fe fer-vir, qu’il y a un moyen plus fimple, plus court
6c plus aifé. Tous les noifettiers pouffent du pié quantité
de rejettons qui fpm nuifibles 6c fort à charge ;
parce qu’on doit les fupprimer tous les ans, iàns :
quoiils feroient dépérir les maîtreffes tiges , & aîte- ,
Bueroient le fruit. On fe fert de ces rejettons pour
multiplier l’efpece, & on les détache avec le plus
de racines qu’il eft polîible. Jls reprennent aifément
à la tranfplantation, 6c donnent du fruit au bout de
trois ou quatre ans. Tous les noifettiers font très-ro-
buftes ; ils s’accommodent de toutes les .expofi-
tions ; ils viennent d ans tous les terreins : cependant
ils fe plaifent mieux dans les terres maigres, fablon-
neufes 6c humides , à l’expofition du nord, dans des
lieux frais 6c à l’ombre. Mais il ne faut pas qu’ils j
foient dominés , ou trop ferrés par d’autres arbres.
Enfin on met .ces arbres dans les places inutiles 6c
dans les coins perdus des jardins fruitiers 6c des vergers.
L’automne eft le meilleur tems pour la tranfplantation
des noifettiers, parce qu’ils entrent ;en fe- j
v e dès la fin du mois de Janvier. Cependant on peut j
encore les tranfplanter de bonne heure au printems. |
Ces arbres ne font pas fufceptibles d’une forme régulière
; il n’eft même guère poflibie de les réduire à j
une feule tige ; 6c quand on en viendroit à bout à j
force de retrancher les rejettons qu’ils pouffent du j
pie , l’arbre dépériroit bientôt par la quantité de
fruit qu’il porte : on eft donc obligé de laiffer fur
chaque pié trois ou quatre principales tiges, qu’on .
renouvelle dans Jeurdépériffement, par de jeunes !
rejettons qu’on laiffe monter. Pour la qualité & les
propriétés du fruit voyeç Noisette.
NOISETTE, ( Diete. ) voyej^ Aveline.
N OIX , f. f. forte de fruit qui a une écale fortdure; ;
dans laquelle eft .enfermée une amande plus tendre,
6c mangeable. V ?j/^Gland , Amande , &c. :
Il y a diverfes fortes de noix ; fa v o ir , des noifet- !
tes, des avelines, des châtaignes, des noix de noye r,
&c. FoyetAvE/LiNES,
NOIX , ( Diete & Matière rnéd. ) voyè\_NOYER.
N o ix d’acajou , (Botan. exoi. ) fruit, ou plu*
tôt noyau taillé en rein , de la groffeur d’un oeuf ^
couvert d’une écorce grife ou brune , épaiffe d’en*
viron une ligne , compofée de deux membranes 6t
d’une fubftance entre deux , qui eft comme un di-
pipé, fongueux , contenant dans fes cellules un fue
mielleux , rouflatre, âcre, mordicant, brûlant. L’amande
qui eft fous l’écorce eft blanche douce, &
revêtue d’une petite peau jaune , qu’il faut ôter.
L’arbre qui porte la noix acajou vient en Amérique
, au Bréfil 6c aux Indes orientales. Il s’élevé
plus ou moins haut, félon la différence du climat 6c
du terroir ; car dans ie Bréfil, il égale la hauteur des
hêtres > 6c eft beaucoup moins grand dans le Mala*
b a r& dans les îles d’Amérique. Le pere Plumier en
donne la defeription luivante.
C ’eft un arbre qui eft prefque de la grandeur dé
notre pommier , fort branchu, garni de beaucoup
de feuilles , couvert d’une écorce ridée 6c cendrée;
Ses feuilles font arrondies, longues d’environ cinq
pouces, larges de trois, attachées à une queue cPur-
te , liftes , fermes comme du parchemin ; d’un verd
gai en-deffus 6c enr-deftous, ayant une côte 6c des
nervures parallèles.
Au fommet des rameaux nàiffent plufieurs pédicules
chargés de petites fleurs difpofées en maniéré dé
parafol, dont lé calice eft découpé en cinq quar*
tiers droits , poinrus, en partie rougeâtres, 6c en
partie verdâtres , rabatus en * dehors , & plus longs
que le caliçe ; il porte dix étamines déliées , de la
Longueur des pétales, garnies de petits fommets ;
elles entourent le piftil dont l’embryon eft arrondi z
le ftile eft grêle , recourbé, de la longueur des pé-,
taies, & le ftigmate qui le termine eft pointu.
Le fruit eft charnu, pyriforme, de la groffeur d’uri
oe u f , couvert d’une écorce mince , liffe, luifante ,
tantôt pourpre,tantôt jaune,& tantôt colorée de l’une
& l’autre couleur. Sa fubftance intérieure eft blanche
, pleine d’un fuc doux, mais un peu acerbe. Ce
fruit tient à un pédicule long .d’un pouce , 6c porte à
fon fommet un noyau en forme d’un rein, long d’environ
un pouce 6c d emi, liffe en dehors 6c d’un
verd obfcur 6c cendré. L ’écorce de ce noyau eft
épaiffe , & comme à deux lames , entre lefquelles
eft un diploé contenant un fuc ou une huile très-cauf-
tique, d’un jaune foncé. L’amande que renferme ce
noyau eft blanche , couverte d’une peau mince &
blanchâtre. Elle a un goût qui approche beaucoup
de celui de la piftache. Ce fruit a une odeur forte ;
6c il eft tellement acerbe, que s’il n’étoit adouci
par l’abondance du fue qui en fort quand on le mâche.,
à peine pourroit-on le manger.
L’arbre acajou, répand par occafion, ou même naturellement
, beaucoup de gomme rouffâtre , tranf-
parente, folide , qui fe fond dans l’eau comme la
gomme.arabique. On exprime des fruits un fuc qui »
par la fermentation , devient vineux, 6c capable
d’enivrer. On en fait du vinaigre , 6c on en tire un
efprit lardent fort vif. Les Indiens aiment beaucoup
les amandes , 6c expriment des écorces une huile
qu’ils emploient pour teindre le linge, d’une couleur
noirâtre prefque ineffaçable, {D .J .)
N o ix d’areque , Vareque eft une efpece de palmier
qui croît dans, les Indes orientales , & qui s’élève
beaucoup. Ce t arbre porte des fruits ovales 6c
gros comme des noix. L ’écorce de ces fruits devient
jaune & molle en mûriffant, 6c couvre un noyau de
la grofleur d’une aveline, gris au-dehors 6cmarbré
blanc. & de ronge au-dedans comme une mufoade.
C e noyau n’eft pas régulièrement,ovale, il eft ap-
plati 6c un peu concave à rendtoitquirépondau pédicule
du fruit. Ce fruit, lorfqu’il n’eft pas encore
mûr, enivre ceux qui en mangent.; il dev ienr aftrin