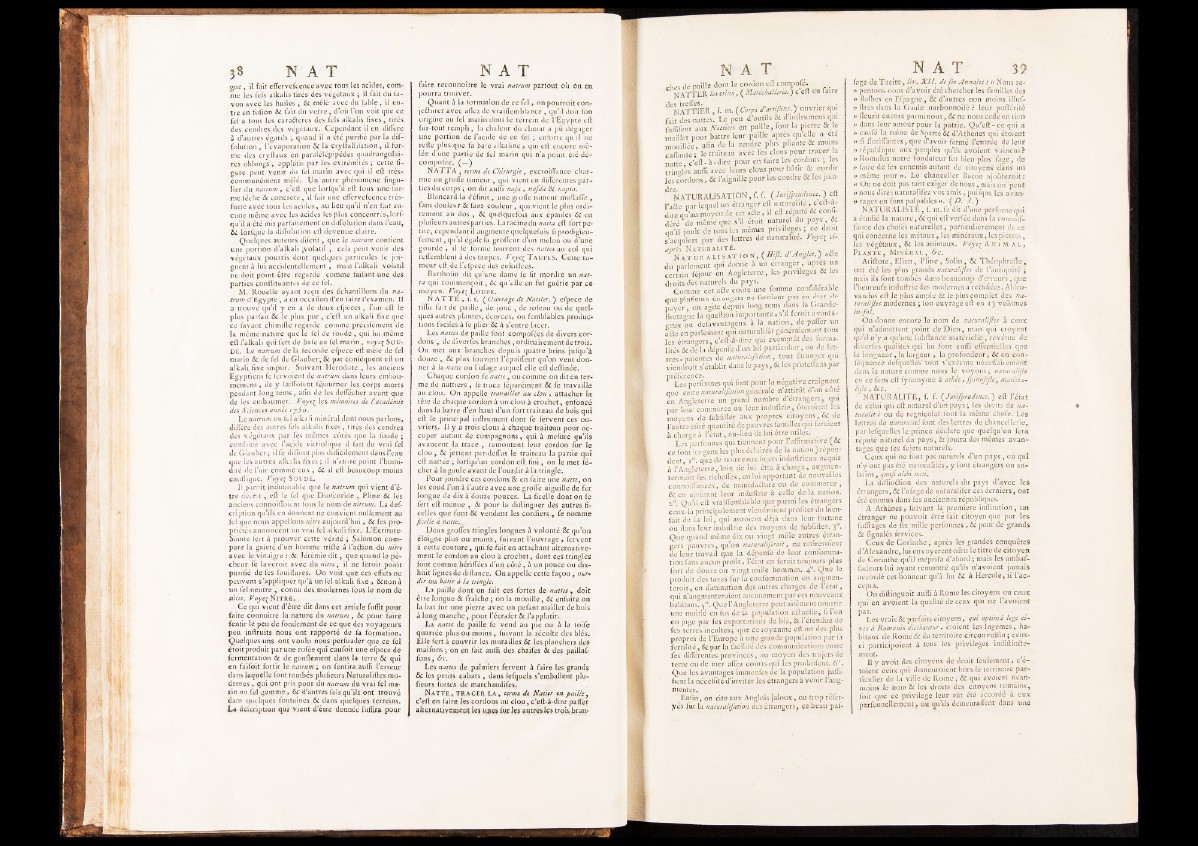
gu e , il Fait effervefcence avec tous les acides, comme
les tels alkalis tirés des végétaux ; il fait du layon
avec les huiles , 6c mêlé avec du fable, il entre
en fufion 8c fait du verre, d’où Ton voit que ce
fel a tous les caraéleres des Tels alkalis fixes, tirés
des cendres des végétaux. Cependant il en différé
à d’autres égards ; quand il a été purifié par la dif-
folution , l ’évaporation 8c la cryftallifation , il forme
des cryftaux en paralélépipédes quadrangulài-
res oblongs , applatis par les extrémités ; cette figure
peut venir du fel marin avec qui il eft très-
communément mêlé. Un autre phénomène fingu-
lier du natrum , c’eft que lorfqu’il eft fous une forme
lèche & concrète, il fait une effervefcence très-
forte avec tous les acides, au lieu qu’il n’en fait aucune
même avec les acides les plus concentrés, lorf-
ou’il a été mis parfaitement en difl’olution dans l’eau,
&. lorfque la diffolution eft devenue claire.
Quelques auteurs difent, que le natrum contient
une portion d’alkali (volatil , cela peut venir des
végétaux pourris dont quelques particules le joignent
à lui accidentellement, mais l’alkali volatil
ne doit point être regardé comme failant une des
parties conftituantes de ce fel.
M. Rouelle ayant reçu des échantillons du na-
trum d’Egypte, a eu occafion d’en faire l’examen. Il
a trouvé qu’il y en a de deux efpeces, l’un eft le
plus parfait 8c le plus pur , c’eft un alkali fixe que
ce favant chimifte regarde comme précifément de
la même nature que le fel de fonde, qui lui même
eft l’alkali qui fert de baie au fel marin, voye^ Soude.
Le natrum de la fécondé efpece eft mêlé de fel
marin 8c de fel de Glauber; 8c par conféquent eft un
alkali fixe impur. Suivant Hérodote , les anciens
Egyptiens fe fervoient de natrum dans leurs embau-
memens, ils y laiffoient fëjourner les corps morts
• pendant longtems, afin de les deffécher avant que
de les embaumer. Voyt{ les mémoires de l'académie
des Sciences année t y S o .
Le natrum ou fel alkali minéral dont nous parlons,
diffère des autres fels alkalis fixes, tirés des cendres
des végétaux par les mêmes côtés que la foude ;
combiné avec l’acide vitriolique il fait du vrai fel
de Glauber ; il fe diffout plus difficilement dans l’eau
que les autres alkalis fixes; il n’attire point l’humidité
de l’air comme eux , 8c il eft beaucoup moins
cauftique. Voye\ Soude.
Il paroît indubitable que le natrum qui vient d’être
décrit , eft le fel que Diofcoride , Pline 8c les
anciens connoiffoient fous le nom de nitrum. La def-
cription qu’ils en donnent ne.convient nullement au
fel que nous appelions nitre aujourd’hui, 8c fes propriétés
annoncent un vrai fel alkali fixe. L’Ecriture-
Sainte fert à prouver cette vérité ; Salomon compare
la gaieté d’un homme trifte à l’aélion du nitre
avec le vinaigre : & Jérémie d i t , que quand le pécheur
fe laveroit avec du nitre, il ne feroit point
purifié de fes fouillurcs. On voit que ces effets ne
peuvent s ’appliquer qu’à un fel alkali fixe , 8cnonà
un fel neutre , connu des modernes fous le nom de
nitre. Voyc{ NlTRE.
Ce qui vient d’être dit dans cet article fulfit pour
faire connoître la nature du natrum, 6c pour faire
fentir le peu de fondement de ce que des voyageurs
peu inftruits nous ont rapporté de fa formation.
Quelques-uns ont voulu nous perfuader que ce fel
étoit produit par une rofée qui caufoit une efpece de
fermentation & de gonflement dans la terre 8c qui
en faifoit fortir le natrum ; on fentira aufli l’erreur
dans laquelle font tombés plufieurs Naturaliftes modernes
, qui ont pris pour du natrum du vrai fel marin
ou fel gemme , 8c d’autres fels qu’ils ont trouvé
dans quelques fontaines & dans quelques terreins.
La delcription qui vient d’être donnée fuffir* pour
faire reconnoître le vrai natrum partout oîi on en
pourra trouver.
Quant à la formation de ce f e l, on pourroit conjecturer
avec afl'ez de vraiffemblance , quM doit fon
origine au fel marin dont le terrein de l’Egypte eft
fur-tout rempli, la chaleur du climat a pû dégager
une portion de l’acide de ce fel ; enlorte qu'il ne
refte plus que fa baie alkaline , qui eft encore mêlée
d’une partie de lel marin qui n’a point été déco
mpolêe. (—)
NATTA , terme de Chirurgie, excroiffance charnue
ou grotte tumeur , qui vient en différentes parties
du corps ; on dit aufli naja, nafda 6c napta.
Blancard la définit, une groffe tumeur mollaffe ,
fans douleur & fans couleur, qui vient le plus ordi-
rement au dos , 8c quelquefois aux épaules 8c en
plufieurs antres parties. Laracinedu natta eft fort petite,
cependant il augmente quelquefois fi piodigieu-
fement, qu’il égale la grofleur d’un melon ou d’une
gourde , il fe forme louvent des nattes au col qui
rcffemblent à des taupes. Voye[ Taupes. Cette tumeur
eft de l’efpece des enkiftées.
Bartholin dit qu’une dame fe fit mordre un natta
qui commençoit, 8c qu’elle en fut guérie par ce
moyen. Voye^ Loupe.
N A T T E , f. f. ( Ouvrage de Nattier. ) efpece de
tiffu fait de paille, de jonc , de rofeau ou de quelques
autres plantes, écorces, ou femblables productions
faciles à fe plier 6c à s’entre lacer.
Les nattes de paille font compofées de divers cordons
', de diverfes branches, ordinairement de trois.
On met aux branches depuis quatre brins jufqu’à
douze , 8c plus fouvent l’épaiffeur qu’on veut donner
à la natte ou l’ufage auquel elle eft deftinée.
Chaque cordon fe natte, ou comme on dit en terme
de nattiers , fe trace féparément 6c fe travaille
au clou. On appelle travailler au clou, attacher la
tête de chaque cordon à un clou à crochet, enfoncé
dans la barre d’en haut d’un fort traiteau de bois qui
eft le principal inftrument dont fe fervent ces ouvriers.
Il y a trois clous à chaque traiteau pour occuper
autant de compagnons, qui à mefure qu’ils
avancent la trace , remontent leur cordon fur le
clou , 8c jettent par-deffus le traiteau la partie qui
eft nattée ; lorfqu’un cordon eft fini, on le met lécher
à la gaule avant de l’ourdir à la tringle.
Pour joindre ces cordons 8c en faire une natte, on
les coud l’un à l’autre avec une groffe aiguille de fer
longue de dix à douze pouces. La ficelle dont on fe
fert eft menue , 8c pour la diftinguer des autres ficelles
que font 6c vendent les cordiers , fe nomme
ficelle a natte. t
Deux groffes tringles longues à volonté 8c qu’on
éloigne plus ou moins, fuivant l’ouvrage, fervent
à cette couture, qui fe fait en attachant alternativement
le cordon au clou à crochet, dont ces tringles
font comme hériflëes d’un cô té , à un pouce ou dix-
huit lignes dé diftance. On appelle cette façon, oui«
dir ou bâtir à la tringle.
La paille dont on fait ces fortes de nattes, doit
être longue 8c fraîche ; on la mouille, 6c enfuitç on
la bat fur une pierre avec un pefant maillet de bois
à long manche, pour l’écrafer & l’applatir.
La natte de paille fe vend au pié ou à la toifç
quarrée plus ou moins , fuivant la récolte des blés.
Elle fert à couvrir les murailles 6c les planchers des
maifons ; on en fait aufli des chaifes & des pailiaf-
fons, &c.
Les nattes de palmiers fervent à faire les grands
6c les petits cabats, dans lefquels s’emballent plu-
fieurs fortes de marchandjfes.
Natte, tracer la, terme de Natitr en paille y
c’eft en faire les cordons au clou, c’eft-à*dire palTcr
alternativement les UUCS furies autres les trois branthés
de paille dont le cordon eft compofe. H
NATTER H crins, ( Maréchallene. j e eft en faire
des trefles. .
NATTIER, f. m. ( Corps d'artifans.) Ouvrier qui
fait des nattes. Le peu d'outils & d’inftramens qui
fuffifent aiix Nattiers en paille, font la pierre & le
maillet pour battre leur paille apres qu elle a ete
mouillée, afin de la rendre plus pliante & moins
caftante; le traiteau avec fes clous pour tracer la
natte, c’eft-à-dire pour en faire les cordons ; les
tringles aufli avec leurs clous pour bâtir & ourdir
les cordons, 6c l’aiguille pour les coudre 6c les join-
^N A TU R A LISA T IO N , f. f. (Jurisprudence. ’) e f t
i’afle par lequel un étranger eft naturalifé , c’eft-à-
dire qu’au moyen de cet aefte, il eft repute & confin
é de même que s’il étoit naturel du p a y s , &
WM jouit de tous les'mêmcs privilèges ; ce droit
s’acquiert par des lettres de naturalité. yel c -
avrls Na TÜRAUTÉ. „ s i x o
N a t u r a l i s a t i o n , (N,fi. i Angle afle
du parlement qui donne à un étranger , apres un
certain féjour en Angleterre, les privilèges & les
droits des naturels du pays.
Comme cet aûc coûte une fomme conficlerable
que plufieurs étrangers ne feroient pas en état de
pa yer, on agite depuis long-tems dans la Grande-
Bretagne là queftion importante, s’il feroit avantageux
ou defavantageux à la nation , de paner un
aà e en parlement qui naturalifât généralement tous
les étrangers, c’eft-à-dire qui exemptât dés formalités
& de la dépenfe d’un bit particulier, ou de lettres
patentes de ndtumlifiation, tout étranger WM
viendrait s’établir dans le pays, & les proteftans par
préférence. • • . , , ........ ....
Les perfonnes qui font pour la négative craignent
que cette naturalifation générale n’attirât d’un côté
en Angleterre un grand nombre d’étrangers, qui
par leur commerce ou leur induftrie, ôteroient les
moyens de fubfifter aux propres citoyens, 8c de
l’autre côté quantité de pauvres familles qui feroient
à charge à l’état, au-lieu de lui être utiles.
Les perfonnes qui tiennent pour l’affirmative (6c
ce font les gens les plus éclairés de la nation ) répondent,
i°. que de nouveaux fujets induftrieux acquis
à l’Angleterre, loin de lui être à charge, augmen-
teroient fes richeffes, en lui apportant de nouvelles
connoiffances, de manufacture ou de commerce ,
6c en ajoutant leur induftrie à celle de la nation.
z°. Qu’il eft vraiffemblable que parmi les étrangers
ceux-là principalement viendroient profiter du bienfait
de la loi, qui auroient déjà dans leur fortune
ou dans leur induftrie des moyens de lubfifter. 3°.
Que quand même dix ou vingt mille autres étrangers
pauvres, qu’on naturaliferoit, ne retireroient
de leur travail que la dépenfe de leur confomma-
tion fans aucun profit, l’état en feroit toujours plus
fort de douze ou vingt mille hommes. 40. Que le
produit des taxes fur la confommation en augmen-
teroit, en diminution des autres charges de l’état,
qui n’augmenteroient aucunement par ces npuveaux
habitans. ^°. Que l’Angleterre peut aifément nourrir
une moitié en fus de la population a&uellc, fi l’on
en juge par fes exportations de blé, 8c l’etendue de
fes terres incultes; que ce royaume eft un des plus
propres de l’Europe à une grande population par fa
fertilité, 6e par la facilité des communications entre
fes différentes provinces, au moyen des trajets de
terre ou de mer affez courts qui les produifent. 6°.
Que les avantages immenfes de la population jufti-
fient la nécefîité d’inviter les étrangers à venir l’augmenter.
Enfin, on cite aux Anglois jaloux, ou trop réfer-
{âge de Tacite, liv. X I I . de fes Annales : « Nous re*
» pentons-nous d’avoir été chercher les familles des
» Balbes en Efpagne, 8c d’autres non moins illuf-
» ftres dans la Gaule narbonnoifé ? leur poftérité
» fleurit encore parmi nous, 6c ne nous cede en rien
» dans leur amour pour la patrie. Qu’eft - ce qui a
» caufé la ruine de Sparte 6c d’Athènes qui étoient
» fi floriffantes, que d’avoir fermé l’entrée de leuf
.-»république aux peuples qu’ils âvoient vaincus?
» Romulus notre fondateur fut bien plus fage, dé
» faire de fes ennemis autant de citoyens dans uri
» même jour ». Le chancelier Bacon ajoftteroit :
« On ne doit pas tant exiger de nous, mais on peut
» nous dire : naturalifez vos amis, puifque les avan-
» tages en font palpables ». ( D. J.')
NATURALISTE, f. m.fe dît d’une perfonnequi
a étudié la nature, 6c qui eft verfée dans la connoif-
fance des chofés naturelles, particulièrement de cé
qui concerne les métaux, les minéraux, les pierres,
les végétaux, 6c les animaux. V6ye{ A n 1 m a l ,
Plante, Minéral, &c.
Ariftote, Elien, Pline, Solin , 8c Théophrafte,
ont été les plus grands naturalijhs de l’antiquité ;
mais ils font tombés dans beaucoup d’erreurs , que
l’heureufe ihduftrie des modernes a re&ifiées. Aldro-
vandus eft le plus ample 6c le plus complet des na-
turalijles modernes ; fon ouvrage eft en 13 volumes
ih-fol.
On donne encore le nom de naturalises à ceux
qui n’admettent point de D ieu, mais qui croyent
qu’il n’y a qu’une fubftance matérielle, revêtue de
diverfes qualités qui lui font aufli effentielles que
la longueur, la largeur , la profondeur, & en con-
féquence defquélles toùt s’exécute néceffairement
dans la nature comme nous le voyons ; naturalise
en ce fens eft fynonyme à athée i j'pinojifle, matérialise
, 8cc.
NATURALITÉ, f. f. (^Jurifprudence.') eft l’état
de celui qui eft naturel d’un pays ; les droits de naturalité
ou de regnicolat. font la même' chofe. Les
lettres de naturalité font des lettres de chancellerie,
par lefquelles le, prince déclare que quelqu’un fera
réputé naturel du pays, & jouira des mêmes avantages
que fes fujets naturels.
Ceux qui ne font pas naturels d’un pa ys, ou qui
n’y ont pas été naturalifés > y font étrangers Ou au-
bains, qüafi alibi nati.
La diftinttion des naturels du pays d’avec les
étrangers, 6c l’ufage de naturalifer ces derniers, ont
été connus dans les anciennes républiques.
A Athènes, fuivant la première inftitution, un
étranger ne pouvoit être fait citoyen que par les
fuffrages de fix mille perfonnes, 8c pour de grands
8c fignalés fervices.
Ceux de Corinthe, après les grandes conquêtes
d’Alexandre, lui envoyèrent offrir le titre de citoyen
de Corinthe qu’il méprifa d’abord; mais les ambaf-
làdeurs lui ayant remontré qu’ils n’avoient jamais
accordé cet honneur qu’à lui 8c à Hercule, il l'accepta.
On diftinguoit aufli à Rome les citoyens ou ceux
qui en avoient la qualité de ceux qui ne l’avoient
pas.
Les vrais 6c parfaits citoyens, qui optimâ lege civesà
Romanis dicebantur, étoient les lngemes, habitans
de Rome 8c du territoire circonvoifin ; ceux-
ci participoient à tous les privilèges indiftin&e-
ment. ' }/
Il y avoit des citoyens de droit feulement, c e -
toient ceux qui demeuroient hors le territoire particulier
de la ville de Rome, 6c qui avoient néanmoins
le nom & les droits des citoyens romains,
foit que ce privilège leur eût été accordé à eux
perfonneftenjent^ ou qu’ils demeuraffent dans une