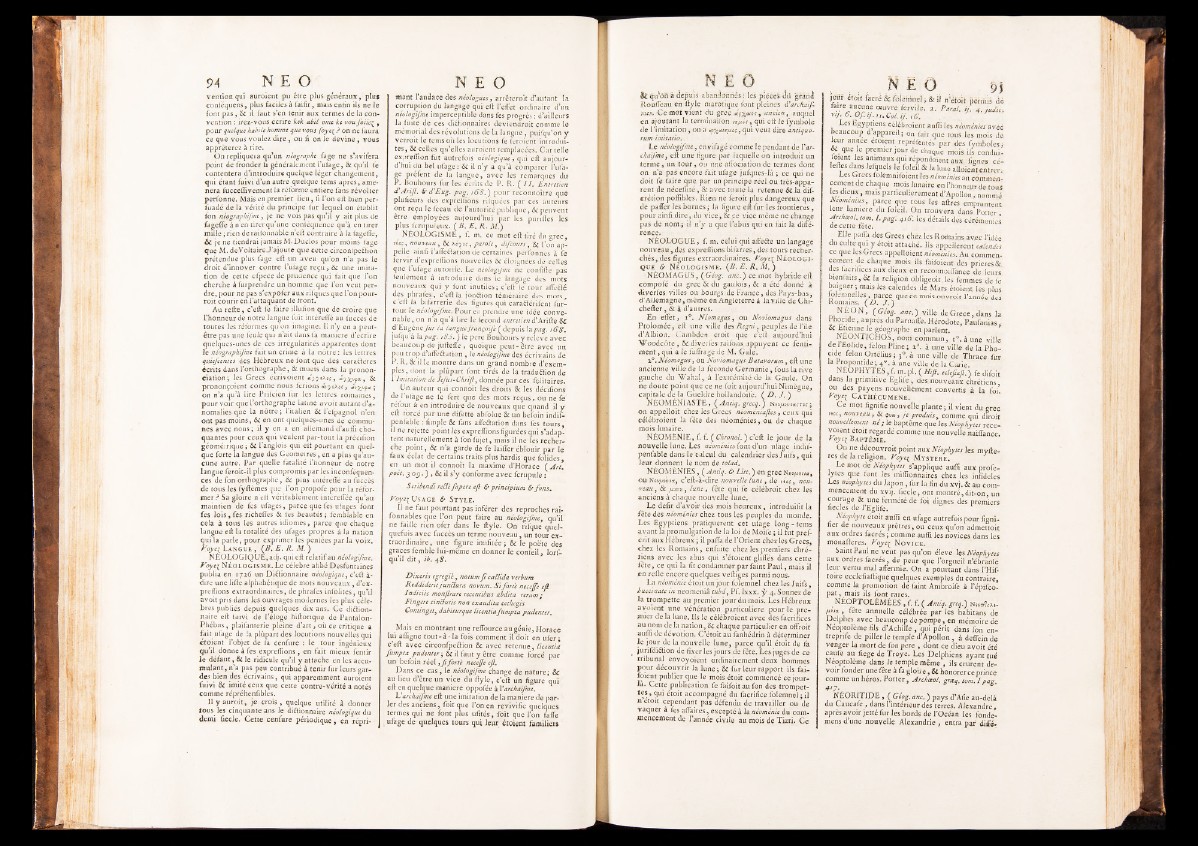
94 N E O
vention qui auroient pu être plus généraux, plus
conféquens, plus faciles à lailir, mais enfin ils ne le
font pas, 6c il faut s’en tenir aux termes de la convention
: irez-vous écrire kek abil orne ke voufoïie£ ,
pour quelque habile homrne que vous foye£ ? on ne l'aura
ce que vous voulez dire, ou fi on le devine, vous
apprêterez à rire.
On répliquera qu’un néographe fage ne s’avifera
point de fronder fi généralement l’ulage, & qu’il le
contentera d’introduire quelque léger changement,
qui étant fuivi d’un autre quelque tems apres, amènera
fucceflivement la réforme entière fans révolter
perfonne. Mais en premier lieu, fi l’on ell bien persuadé
de la vérité du principe fur lequel on établit
fon néographifme, je ne vois pas qu’il y ait plus de
fagefle à n’en tirer qu’une conléquence qu’à en tirer
mille ; rien derailonnable n’eft contraire à la fageffe,
6c je ne tiendrai jamais M.Duclos pour moins làge
que M. deVoltaire J ’ajoute que cette circonlpe&ion
prétendue plus fage eft un aveu qu’on n’a pas le
droit d’innover contre l’ufage reçu, &c une imitation
de cette efpece de prudence qui fait que l’on
cherche à furprendre un homme que l’on veut perdre,
pour ne pas s’expofer aux rifques que l’on pour-
roit courir en l’attaquant de front.
Au refie, c’efl fe faire illufion que de croire que
l’honneur de notre langue foit intéreffé au fuccès de
toutes les réformes qu’on imagine. Il n’y en a peut-
être pas une feule qui n’ait dans la manière d’ecrire
quelques-unes de ces irrégularités apparentes dont
le néographifme fait un crime à la nôtre : les lettres
quiefcentes des Hébreux ne font que des cara&eres
écrits dans l’orthographe, & muets dans la prononciation;
les Grecs écrivoient dyytXoç, *yxvp<*-, &
prononçoient comme nous ferions dvytxoç, dvxupa ;
on n’a qu’à lire Prifcien fur les lettres romaines,
pourvoir que l’orthographe latine avoit autant d’anomalies
que la nôtre; l’italien 6c l’efpagnol n’en
ont pas moins, & en ont quelques-unes de communes
avec nous; il y en a en allemand d’aufli choquantes
pour ceux qui veulent par-tout la précilion
géométrique ; 6c l’anglois qui elt pourtant en quelque
forte la langue des Géomètres, en a plus qu’aucune
autre. Par quelle fatalité l’honneur de notre
langue feroit-il plus compromis parles inconféquen-
ces de fon orthographe, 6c plus intéreffé au fuccès
de tous les fyftèmes que l’on propofe pour la réfor.
mer? Sa gloire n'elt véritablement intéreffée qu’au
maintien de fes ufages, parce que fes ufages font
fes lo is , fes richeffes & lés beautés ; femblable en
cela à tous les autres idiomes, parce que chaque
langue eft la totalité des ufages propres à la nation
qui la parle, pour exprimer les penlëes par la voix.
Voye^ Langue , (B. E. R. M. )
NÉOLOGIQUE, adj. qui eft relatif au néologifme.
Foye{ Néologisme. Le célébré abbé Desfontaines
publia en 17z6 un Dictionnaire néologique, c’eft à-
dire une lifte alphabétique de mots nouveaux d’ex-
preftions extraordinaires, de phrafes infolites, qu’il
avoit pris dans les ouvrages modernes les plus célébrés
publiés depuis quelques dix ans. Ce dictionnaire
eft iuivi de l’éloge hiftorique de Pantalon-
Phebus, plaifanterie pleine d’art, oit ce critique a
fait ufage de la plupart des locutions nouvelles qui
étoient l’objet de fa cenfure : le tour ingénieux
qu’il donne à fes expreflîons, en fait mieux fentir
le défaut, 6c le ridicule qu’il y attache en les accumulant,
n’a pas peu contribué à tenir fur leurs garder
bien des écrivains, qui apparemment auroient
fuivi 6c imité ceux que cette contre-vérité a notés
comme répréhenfibles.
Il y auroit, je crois, quelque utilité à donner
tous les cinquante ans le dictionnaire néologique du
demi fiecle. Cette cenfure périodique, en répri-
N E O
mant l’audace des néologues, arrêteroit d’autant la
corruption du langage qui eft l’effet ordinaire d’un
néologifme imperceptible dans fes progrès : d’ailleurs
la fuite de ces dictionnaires deviendroit comme le
memorial des révolutions de la langue, puifqu’ on y
verroit le tems oit les locutions fe leroient introduites,
& celles qu’elles auroient remplacées. Car telle
expreflion fut autrefois nèologique, qui eft aujourd’hui
du bel ufage : 6c il n’y a qu’à comparer l’ufa-
ge préfent de la langue, avec les remarques du
P* Bouhours fur les écrits de P. R. ( I I . E nt retien
tTArifl. & d'Eug. pag. 168.') pour reconnoître que
plufieurs des exprefîions rifquées par ces auteurs
ont reçu le fceau de l’autorité publique, 6c peuvent
être employées aujourd’hui par les puriftes les
plus l’crupuleux. (Æ. E. R. M.')
NÉOLOGISME, f. m. ce mot eft tiré du grec,
noç, nouveau , 6c Xoyoç, parole , difcoiirs , & l’on appelle
ainfi i’affeCtation de certaines perfonnes à fe
lervir d’expreftions nouvelles 6c éloignées de celles
que l’ufage autorife. Le néologifme ne confifte pas
feulement à introduire dans le langage des mots
nouveaux qui y font inutiles; c’eft le tour affeCté
des phrafes, c’eft la jonCtion téméraire des mots,
c e ft la bifarrerie des figures qui caraClérifent fur-
tout le néologifme. Pour en prendre une idée convenable
, on n a qu’à lire le fécond entretien d’Arifte &
d Eu gène/«/■ la languefrançoife ( depuis la pag. 168.
jufqu à la pag. 186. ) le pere Bouhours y releve avec
beaucoup de juftefl'e , quoique peut-être avec un
peu trop d’affeClation , le néologifme des écrivains de
P. R. & il le montre dans un grand nombre d’exemples,
dont la plûpart font tirés de la traduClion de
Y Imitation de Jefus-Chrifl, donnée par ces folitaires.
Un auteur qui connoît les droits & les décifions
de l’ufage ne fe fert que des mots reçus, ou ne fe
réfout à en introduire de nouveaux que quand il y
eft forcé par une difette abfolue & un befoin indif-
penfable : limple & fans affeClation dans fes tours,
il ne rejette point les expreflîons figurées qui s’adaptent
naturellement à fon fujet, mais il ne les recherche
point, 6c n’a garde de fe laiffer éblouir par le
faux éclat de certains traits plus hardis que folides ,
en un mot il connoît la maxime d’Horace ( A n .
poèt. j 09.. ) , 6c il s’y conforme avec fcrupule :
Scribendi reclé fapere efl <S* principium & fons.
Foye{ Usage & Style.
Il ne faut pourtant pas inférer des reproches rai-
fonnables que l’on peut faire au néologifme, qu’il
ne faille rien ofer dans le ftyle. On rifque quelquefois
avec fuccès un terme nouveau, un tour extraordinaire,
une figure inufitée ; & le poëte des
grâces femble lui-même en donner le conlëil, lorf-
qu’il dit, ib. 48.
Dixeris egregiï, notum f i callida vtrbum
Reddiderit junclura novum. Si fortï neceffe efl
Indiciis monflrare recentibus abdita rerum ;
Fingere cinclutis non exaudita cethegis
Continget, dabiturque licentiafumpta pudenter.
Mais en montrant une reffource au génie, Horace
lui afîigne tou t-à - la fois comment il doit en ufer;
c’efl: avec circonfpeôion 6c avec retenue, licentia
fumpta pudenter ; 6c il faut y être comme forcé par
un befoin rée l,Jifortï neceffe eft.
Dans ce ca s , le néologifme change de nature; 6c
au lieu d’être un vice du ftyle, c’eft un figure qui
eft en quelque maniéré oppofée à Yarchafme.
Varchaïfme eft une imitation de la maniéré de parler
des anciens, foit que l’on en revivifie quelques
termes qui ne font plus ufités, foit que l’on faffe
, ufage de quelques tours qui leur étoient familier»
NÉ O
qïi’ôh â depuis abandonnés : les pièces ait grand
Rouffeau en ftyle marotique font pleines d’archaf-
mes-. Ce mot vient du grec <épx<aoçt ancien, auquel
en ajoutant la terminailôn rapU, qui eft le fymbole
de Limitation, on à ap^cturpoç, qui veut dire àntiquô-
rum imitatio.
Le néologifme.^ envifagé comme le pendant de Yar-
chaïfmt, eft une figure par laquelle on introduit un
terme, un tour, ou «ne aftoeiation de termes dont
on n’a pas encore fait ufage jufques-Ià ; ce qui ne
doit fe faire que par un principe réel ou très-apparent
de néceflité, & avec toute la retenue 6c la dif-
erétion poflibles. Rien ne feroit plus dangereux que
de paffer les bornes ; la figure eft fur les frontières,
pour âinfi dire, du v ice , 6cge vice même ne change
pas de nom ; il n’y a que l’abus qui en fait la différence.
NÉOLOGUE, f. m. celui qui affeéle un îangage
nouveau, dés expreflîons bifarres, des tours recherchés,
des figures extraordinaires. Foye^ N é o l o g i q
u e & N ÉO LO G ISM E '. (B -, E. R. M. )
NÉOMAGUS, (Géog. aiic.') ce mot hybride eft
compofé du grec & du gaulois, & a été donné à
diverfes villes ou bourgs de France, des Pays-bas,
d’Allemagne, même en Angleterre à la ville de Chi-
chefter, & à d’autres.
En effet, i°. Néomagus, ou Noviomagus dans
Ptolomée, eft une ville des Regni, peuples de l’ile
d’Albion. Cambden croit que c’eft aujourd’hui
Woodcote , ôc diverfes raifonsjappuyent ce fenti-
nient, qui a le fuffrage de M,. Gale.
2°. Néomagus, ou Noviomagus Batavorum eft une
ancienne ville de la fécondé G ermanie, fous la rive
gauche du V a h a l, à l’extrémité de la Gaule. On
ne doute point que ce ne foit aujourd’hui Nimègue,
capitale de la Gueldre hollandoife. ( D . J.~\
NÉOMÉNIASTE, (Antiq. grecq.'j Ntu/Wictçroç;
on appelloit chez les Grecs néoméniaftes , ceux qui
célébroient la fête des néoménies, ou de chaque
mois lunaire.
NÉOMÉNIE, f. f. ( Ghronol. ) c’èft le jour de la
nouvelle lune. Les néoménies font d’un ufage indif-
penfable dans le'calcul dû. calendrier des Juifs, qui
leur donnent le nom de tolad.
NÉOMÉNIES, ( Antiq. & Litt. ) en grec
ou No^mhW , c’eft-à-dire nouvelle lune, de tios . -.nouveau,
& ju»uh , lune j fête qui fe célébroit chez les
anciens à chaque nouvelle lune.
Le defir d’avoir des mois heureux, introduifit la
fête des néoménies chez tous les peuples du monde.
Les Egyptiens pratiquèrent cet ufage long-tems
avant la promulgation de la loi de Moïfe ; il fut pref-
crit aux Hébreux ; il paffa de l’Orient chez les G recs,
chez les Romains, enfuite chez les premiers chrétiens
avec les abus qui s’étoient gliffés dans cette
fête, ce qui la fit condamner par faint Paul, mais il
en refte encore quelques veftiges parmi nous.
La néoménie étoit un jour folemnel chez les Juifs,
buccinate in neomeniâ tuba, Pf. Ixxx. ÿ 4. Sonnez de
la trompette au premier jour du mois. Les Hébreux
ayoient une vénération particulière pour le premier
de la lune. Ils le célébroient avec des facrifices
au nom de la nation, 6c chaque particulier en offroit
aufli de dévotion. C ’étoit au fanhédrin à déterminer
le jour de la nouvelle lune, parce qu’il étoit de fa
jurifdiélion de fixer les jours de fête. Les juges de ce
tribunal envoyoient ordinairement deux hommes
pour découvrir la lune ; 6c fur leur rapport ils fai-
foient publier que le mois étoit commencé ce jour-
la. Cette publication fe faifoitaufon des trompettes
, qui étoit accompagné du facrifice folemnel ; il
n etoxt cependant pas défendu de travailler ou de
Vaquer à fes affaires, excepté à la néoménie du commencement
de l’année civile au mois de Tizri. Ce
, . .N. Ë D. ........ 9]
jodr «toit lacté Si foléMnél ; & il n’éiôit péf ffiîs dè
taire aucune oeuvre feryile. i . Parai, ü. 4 juiic-.
Les Egyptiens célébroient aufli les néoménies avëû
Beaucoup d appaféilj 0:1 (ait que toits les mois dé
leur année etoiem repréfcntés par des fymiiolesj
©£. que le premier jour de .chaque môis.ils condui-
lotent lest animaux qui répondaient aux. lignes cé-
ieftes dans lesquels le foleil & la lune alloient entrer*.
Les tirées lolemmfoient les néoménies au commencement
de chaque mois lunaire en l’honnejjr dè tous
les dieux , mais particulièrement d’Apollon t nommé
Neomermïv, parce que tous les aftres empruntent
leur lumière dit foleil. Ori trouvera dans Potier j
Archoeol. iom. I. pag. 41 ff. les détails des cérémonies
de cette fete.
Elle paffa des Grecs chéz les Romains av,ec l’idéë
du culte qui y étoit attaché. Ils appeliérent calendes
ce que les Grecs appelloient néoménies.. Au commen-
cernent de chaque mois: ils faifoienf. des prières &.
des faefifiees aux dieux en reeonhoiflïnee de .lents
bienfaits, & la religion, dbligedjt.les femmes de fe
baigner; mais les calendes de Mars.étoient les pins
jolemndtlcs-, parce quece. mois ouvrôit f année dès
Romains. (Z>. /. )
N É O N , ( Géog. anc.) ville deGr,ece, dans la
Phocide, auprès du Parnaffe. Hérodote, Paufanias *
6c Etienne le géographe en parlent.
. NEONTICHDS,;.nort commun, 1°. à, une ville
de 1 Eohde, félon Pime ; i° . à une ville de la Pho*
eide félon Ortélius ; 3». à une ville de thrace fur
la Propontide; 40. à une ville de la Carie.
NÉOPHYTES , f . in.pl. ( Hift. eelefiajij).fe difoit
dans la primitive Eglife, des.nouveaux chrétiens,
ou des payens nouvellement convertis à la foi.
Foye^ CATHÉCUMENE.
Ce mot fignifie nouvelle plante; il vient du grec
noç, nouveau, & pim, je produis, comme qui diroit
nouvellement né ; le baptême que les Néophytes rece-
voient étoit regardé comme une nouvelle naiffance,
Foye^ Baptême.
On ne découvroit point aux Néophytes les myfte-
res de la religion. Foye^ Mystère.
Le mot de Néophytes s’applique aufli aux profe-
lytes que font les miflionnaires chez les infidèles
Les néophytes du Japon, fur la fin du xvj. & au commencement
du xvij. fiecle, ont montré,dit-on, un
courage & une fermété de foi dignes des premiers
fiecles de l’Eglife.
Néophyte étoit aufli en ufage autrefois pour lignifier
de nouveaux prêtres, ou ceux qu’on admettoit
aux ordres facrés ; comme aufli les novices dans les
monafteres. Foye^ Novice.
Saint Paul ne veut pas qu’on éleve les Néophytes
aux ordres facrés, de peur que l’orgueil n’ébranle
leur vertu mal affermie. On a pourtant dans l’Hif-
toire ecclefiaftique quelques exemples du contraire,
comme la promotion de faint Ambroife à l’épifco-
pat, mais ils font rares.
NÉOPTOLÉMÉES , f. f. ( Antiq. greqi) NtoTrloXt-
P-tio., fête annuelle célébrée par les habitans de
Delphes avec beaucoup de pompe, en mémoire de
Néoptolème fils d’Achille , qui périt dans fon en-
treprife de piller le temple d’Apollon, à deffein de
venger la mort de fon pere , dont ce dieu avoit été
caufe au fiege de Troye. Les Delphiens ayant tué
Néoptolème dans le temple même , ils crurent devoir
fonder une fête à fa g loire, & honorer ce prince
comme un héros. Potter, Archccol. groeq. tom. Ipag
m m n
NÊORITIDE > ( Géog. anc. ) pays d’Afie au-delà
du Caucafe , dans l’intérieur des terres. Alexandre,
après avoir jette fur les bords de l’Océan les fonde-
mens d’une nouvelle Alexandrie , entra par diffé>