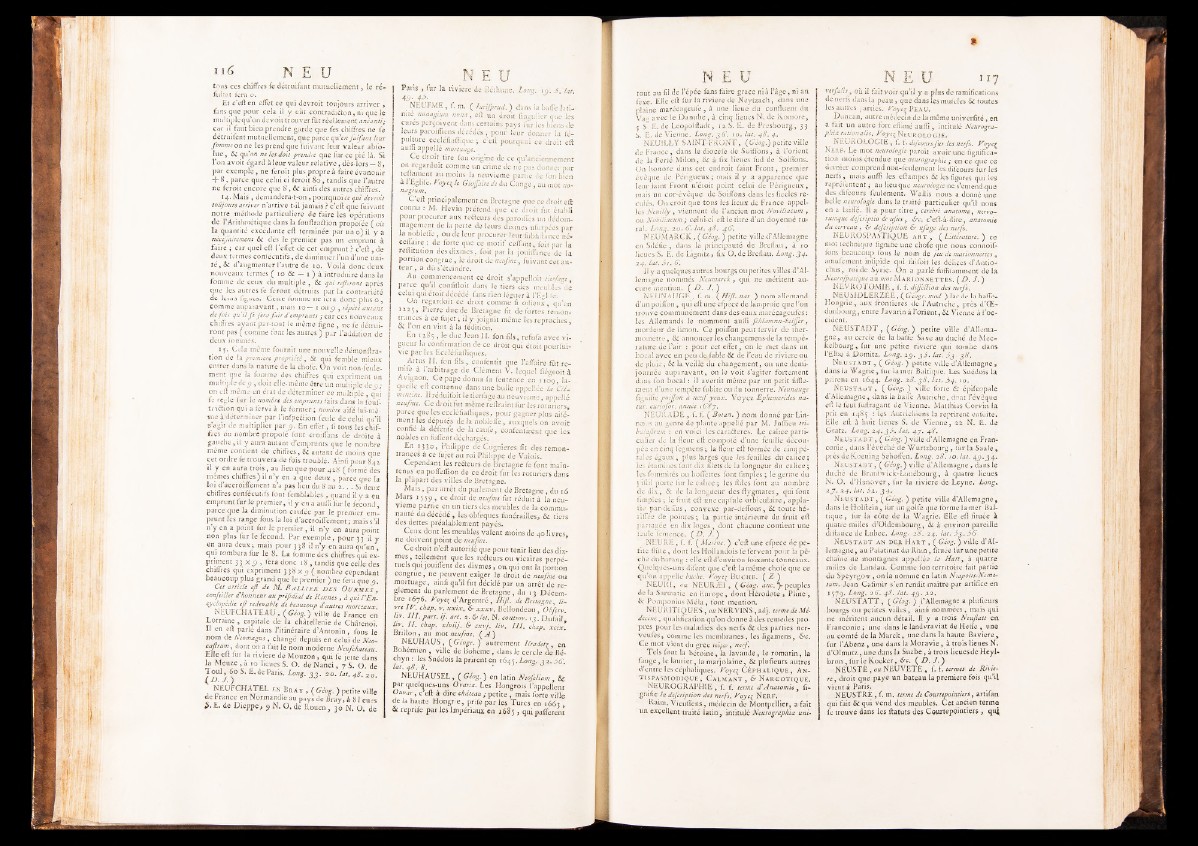
n6 N E U
tous ces chiffres fe détruifant mutuellement le ré-
iulrat fera o.
Et c’eft en effet ce qui devroit toujours arriver ,
fans que pour cela il y eût contradiûon, ni que le
multiple qu’on devoir trouver fût réellement anéanti;
car il faut bien prendre garde que fes chiffres ne fe
detruifent mutuellement, que parce qu'en faifant leur
fornme on ne les prend que l'uivant leur valeur abfo-
lu e , & qu’0/2 ne Us doit prendre que fur ce pié là. Si
l’on avoir égard à leur valeur relative, dès-lors — 8,
par exemple, ne feroit plus propre à faire évanouir
-f-8, parce que celui ci feroit 80, tandis que l’autre
ne feroit encore que 8, & ainfi des autres chiffres.
14. Mais , demandera-t-on , pourquoi ce qui devroit
toujours arriver n’arrive t-il jamais ? c’eft que fuivant
notre méthode particulière de faire les opérations
de l’Anthmetique dans la fouftraéfion propofée ( où
la quantité excédante eft terminée par un o) il y a
nécefjaire ment & dès le premier pas un emprunt à
faire ; car quel eft l ’effet de cet emprunt ? c’e ft , de
deux termes conlecutifs, de diminuer l’un d’une unité
, & d’augmenter l’autre de 10. Voilà donc deux
nouveaux termes ( 10 6c — 1 ) à introduire dans la
fornme de ceux du multiple , & qui referont après
que les autres fe feront détruits par la contrariété
de leurs fignes. Cette fornme ne fera donc plus o ,
comme auparavant, mais 10— 1 ou 3 , répété autant
de fois qu'il fe fera fuit dé emprunts ; car ces nouveaux
chiffres ayant par-tout le même ligne , ne fe détruiront
pas ( comme font les autres ) par l’addition de
deux femmes.
15. Cela même fournit une nouvelle démonftra-
tion de la première propriété, & qui femble mieux
entrer dans la nature de la chofe. On voit non-feulement
que la fornme des chiffres qui expriment un
multiple de c), doit elle-même être un multiple de3 ;
on eft même en érat de déterminer ce multiple , qui
fe réglé fur le nombre des emprunts faits dans la fouf-
Irachon qui a fervi à le former; nombre aifé lui-mê- j
me à'déterminer par l’infpeÛion feule de celui qu’il
s’agit de multiplier par 3 . En effet, fi tous les chiffres
du nombre propoiè font croiffans de droite à
gauche ,il y aura autant d’emprunts que le nombre
meme contient de chiffres, & autant de moins que
cet ordre fe trouvera de fois troublé. Ainfi pour 841
il y en aura trois, au lieu que pour 428 ( formé des
memes chiffres) il n’y en a que deux , parce que la
loi d’accroiffement n’a pas lieu du 8 au 2 . . . Si deux
chiffres confecutifs font femblables , quand il y a eu
emprunt fur le premier, il y en a aufli fur le fécond
parce que la diminution c.aufée par le premier emprunt
les range fous la loi d’accroiffement; mais s ’il
n y en a point fur le premier, il n’y en aura point
non plus fur le fécond. Par exemple, pour 33 il y
en aura deux ; mais pour 338 il n’y en aura qu’un ,
qui tombera fur le 8. La tomme des chiffres qui expriment
33 X .9 > ^era donc 18 , tandis que celle des
chiffres qui expriment 338 X ,9 ( nombre cependant
beaucoup plus grand que le premier ) ne fera que 3 .
Cet article efi de M. P a l l i e r d e s O u r m e s ,
confeiller £ honneur au préfidial de Rennes , à qui l'Encyclopédie
eft redevable de beaucoup £ autres morceaux
NEUFCHATEAU, ( Géog. ) ville de France en
Lorraine , capitale de la châtellenie de Châtenoi.
Il en eft parlé dans l’itinéraire d’Antonin, fous le
nom de Neomagus, changé depuis en celui de Neo-
caftrum, dont on a fait le nom moderne Neufchateau.
Elle eft fur la riviere de Mouzon, qui fe jette dans
la Meuze , à 10 lieues S. O. de Nanci, 7 S. O. de
T o u l, 60 S. E. de Paris. Long. 3 3 . 20. lat. 48. 20.
NEUFCHATEL en B r a y , ( Géog. ) petite ville
de France en Normandie au pays de Bray, à 81 eues
E. de Dieppe> 9 N. O, de Rouen, 30 N. O. de
NE U
Paris , fur la riviere de Bcthune. Long. 16'. S. ht.
4S>- 4-1-
NEUFME, f. m. ( ïurifprud. ) dans la baffe latinité
nonagium nona, eft un droit fingulier que les
curés perçoivent dans certains pays fur les biens de
leurs paroifficns décédés , pour leur donner la fé-
pulture eccléfiaftique ; c’eft pourquoi ce droit eft
auffi appelle mortuage.
Ce droit tire fon origine de ce qu’ancienncment
on regardoit comme un crime de ne pas donner par
teftament au moins la neuvième partie de fon bien
à 1 Eglife. Voyelle Glojfairede du Cange, au mot nonagium.
C ’eft principalement en Bretagne que ce droit eft
connu : M. Hevin prétend que ce droit fut établi
pour procurer aux reéfeurs des paroiffes un dédommagement
de la perte de leurs dixmes ufurpées par
la nobleffe, ou de leur procurer leur fubfiftance né-
ceflaire : de forte que ce motif ceftant, foit par la
reftitution des d ixm e s fo it par la jouiffance de la
portion congrue, le droit de neufme, fuivant cet auteur
, a dû s’éteindre.
Au commencement ce droit s’appelloit tierfage,
parce qu’il confiftoit dans le tiers des meubles de
celui qui etoit décédé fans rien léguer à l'Egide.
On regardoit ce droit comme fi odieux, qu’en
1225, Pierre duc de Bretagne fit de fortes remon-
trances à ce fujet ; il y joignit même les reproches,
& 1 on en vint à la fédition.
En 1285 , duc Jean II. fon fils, refufa avec vi-
! gueur la confirmation de ce droit qui étoit pourfui-
vie par les Eccléfiaftiques.
Artus II. fon fils ,. confentit que l’affaire fût re-
mife à l’arbitrage de Clément V. lequel fiégeoit à
Avignon. Ce pape donna fa fentence.en 1109 ,.la»
quelle eft contenue dans une bulle appellée la Clémentine.
Ilréduifoit le tierfage an neuvième, appellé
neufme. Ce droit fut même reftraintfur les roturiers ■
parce que les eccléfiaftiques, pour gagner plus aifé-
ment les députes de la nobleffe, auxquels on avoit
confie la défenfe de la caufe, confentirent que les
nobles en fuffent déchargés.
J33°> Philippe de Cugnieres fit des remontrances
à ce fujet au roi Philippe de Valois.
Cependant les re&eurs de Bretagne fe font maintenus
en poffeffion de ce droit fur les roturiers dans
la pîûpart des villes de Bretagne.
Mais, par arrêt du parlement de Bretagne, du 16
Mars 1559, ce droit de neufme fut réduit à la neuvième
partie en un tiers des meubles de la communauté
du décédé , les obfeques funérailles, & tiers
des dettes préalablement payés.
Ceux dont les meubles valent moins de 40 livres
ne doivent point de neufme.
Ce droit n’eft autorifé que pour tenir lieu des dixmes
, tellement que les redeurs ou vicaires perpétuels
qui jouiffent des dixmes, ou qui ont la portion
congrue, ne peuvent exiger le droit de neufme ou
mortuage, ainfi qu’il fur décidé par un arrêt de reglement
du parlement de Bretagne, du 13 Décembre
1676. Voye{ d’Argentré, Ilift. de Bretagne, livre
IV . ckap. v. x xix. & XXXV. Bellondeau , Obfery.
Ity. 111. part. ij. art. 2. & let. N. controv. 13. Du fa il
liv. 11. ckap. xlviij. & cxvj. Liv. 111. diap. xcixl
Brillon , au mot neufme. { A )
NEUHAUS , ( Géogr. ) autrement Ilradet7 , en
Bohémien , ville de Bohème, dans le cercle de Bé-
chyn : les Suédois la prirent en 164 <.Lon°. xx.SG
h t . 48. 8. * 0 J
NEÜHAUSEL, ( Géog. ) en latin Neofelium , &
par quelques-uns Ovaria. Les Hongrois l’appellent
Ouvar, c’eft à dire château; petite , mais forte ville
de la haute Hongre, prife par les Turcs en 1663 ,
& r e p r i f e p a r l e s Im p é r i a u x e n 1 6 8 5 , q u i p a f f e r e n t
*
tout au fil de l’épée fans faire grâce ni à l’âge, ni au
fexe. Elle eft fur la riviere de Neytzach, dans une
plaine marécageufe, à une lieue du confluent du
Va® avec le Danube, à cinq lieues N. de Komore,
c S- E. de Leopolftadt, 12 S. E. de Presbourg, 33
S. E. de Vienne. Long. 3 G. 10. h t. 48. 4.
NEU1LLY SAINT-FRONT , {Géog.') petite ville
de France, dans le diocèfe de Soiffons, à l’orient
de la Ferté-Milon, & à fix lieues fud de Soiffons.
On honore dans cet endroit faint Front, premier
évêque de Périgueux ; mais il y a apparence que
leur faint Front n’étoit point celui de Périgueux,
mais un cor-évêque de Soiffons dans les fiecles reculés.
O11 croit que tous les lieux de France appelles
Ncuilly , viennent de l’ancien mot Noviliacurn ,
ou Nobiliacum; celui-ci eft le titre d’un doyenné rural,
Long. 20. G. ht. 48. 4-G.
NEUMARCK., ( Géog. ) petite ville.d’Allemagne
en Siléfie , dans la principauté de Breflau, à 10
lieues S. E. de Lignitz, fix O. de Breflau. Long. 34.
24. lat. Si. G.
Il y a quelques autres bourgs ou petites villes d’Allemagne
nommés Neumarck , qui ne méritent aucune
mention. ( D . J. )
NEUNAUGE , f. m. {Hift. nat. ) nom allemand
d’un poiffon, qui eft une efpece de lamproie que l’on
trouve communément dans des eaux marécageufes :
les. Allemands le -nomment auffi fchlamnn-beiffer}
mordeur de limon. Ce poiffon peut fervir de thermomètre,
& annoncer les changemens de la température
de l’air : pour cet effet, on le met dans un
bocal avec un peu dçjable & de l’eau de riviere ou
de pluie; & la veillé du changement, ou une demi-
journée auparavant, on le voit s’agiter fortement
dans fon bocal : il avertit même par un petit fiffle-
ment d’une tempête fubite ou du tonnerre. Neunauge
figuifie poiffon à neuf yeux. Voyez Ephemerides na-
tur. curiofor. année iG8y.
NEURADE , f. f. ( Botan. ) nom donné parLin-
næus au genre de plante appellé par M. Juffieu tri-
bulaftrum : en voici les çaraéferes. Le calice particulier
de la fleur eft compote d’une feuille découpée
en cinq fegmens ; la fleur eft formée dé cinq pé-
rales égaux, plus larges que les feuilles du calice;
les étamines font dix filets de la longueur du calice ;
les fommités ou boffettes font fimples ; le germe du
piftil porte fur le calice ; les ftiles font au nombre
de dix, & de la longueur des ftygmates, qui font
fimples ; le fruit eft une capfule orbiculaire, appla-
tie par-deffus, convexe par-deffous', Sc toute hé-
1 iffée de pointes ; là partie intérieure du fruit eft
partagée en dix loges , dont chacune contient une
feule femence. ( D. J. )
NEURE, f. f. ( Marine. ) c’eft une efpece de petite
flûte, dont les Hollandois fe fervent pour la pêche
du harang : elle eftd’environ foixante tonneaux.
Quelques-uns'difent que c’eft la même chofe que ce
qu’on appelle bûche. Poye^ Bûche. ( Z )
NEURI, ou NEURÆI , {Géog. anc. *y peuples
de la Sarmatie en Europe, dont Hérodote , Pline ,
& Pomponius Mêla, font mention.
NEURIT1QUES, ou NERVINS, adj. terme de Médecine
, qualification qu’on donne à des remedes propres
pour les maladies des nerfs & des parties ner-
veufes, comme les membranes, les ligamens, &c.
Ce mot vient du grec vtZpov, nerf.
Tels font la bétoine, la lavande, le romarin, la
fauge, le laurier, la marjolaine, & plufieurs autres
d’entre les céphaliques. Foye^ C éphalique, Antispasmodique,
C almant, 6* Narcotique.
NEUROGRAPHIE , f. f. terme d'Anatomie, fi-
gnifie la defeription des nerfs. Foyer NERF.
Raim. Vieuffens, médecin de Montpellier, a fait
un excellent traité latin, intitulé Neurographia uni-
N E U u 7
verfalis, oit il fait voir qu’il y a plus de ramifications
de nerfs dans la peau, que dans les muicles 6c toutes
les autres;parties. Foye[ Peau.
Duncan, autre médecin de la même univerfité, en
a fait un autre fort eftimé auffi, intitulé Neurographia
rationalis. Foye^NEUROLOGIE.
NEUROLOGIE, f. f. dijcoursfur les nerfs. Foye£
Nerf. Le mot neurologie paroît avoir une lignification
moins etendue que neurographie ; en ce que ce
dernier comprend non-feulement les difeours fur les
nerfs, mais auffi les eftampes & les figures qui les
reprelentent ; au lieu que neurologie ne s’entend que
des difeours feulement. Wallis nous a donné une
belle neurologie dans le traité particulier qu’il nous
en a laiffe. Il a pour titre cerebri anatome, nervo-
rumque deferiptio & ufus, &c. c’eft-à-dire, anatomie
du cerveau , & defeription & ufage des nerfs.
NEUROSPASTIQUE a r t , { L ittérature. ) ce
mot technique fignifie une chofe que nous connoif-
fons beaucoup fous le nom de jeu de marionnettes,
amufement infipide qui faifoit les déliçes d’Antio-
chus, roi de Syrie. On a parlé fuffilaniment de là
Neurofpatique au mot Marionnettes. {D . J .)
NEVROTOMIE , 1. f. dijfeclion des nerfs.
NEUSIÛLERZÉE, ( Géogr. mod. ) lac de la baffe-
Hongrie, aux frontières de l’Autriche, près d’GE-
dunbourg, entre Javarin à l’orient, ôc Vienne à l’occident.
N EU STAD T , {Géog.) petite ville d’Allemagne,
au cercle de la baffe Saxe au duché de Mec-
kelbourg, fur une petite riviere qui tombe dans
l’Elbe à Domitz. Long. 2§^3 S. lat. S j . 38.
Neustadt, ( Géog. ) petite ville d’Allemagne,
dans la Wagrie, fur la mer Baltique. Les Suédois la
prirent en 1644. Long. 28.38. h t. S4. 10.
Neustadt , ( Géog. ) ville forte & épifcopale
d’Allemagne, dans la balfe Autriche, dont l’évêque
eft le feui fuffragant de Vienne. Matthias Corvin la
prit en 1485 : le$ Autrichiens la reprirent enfuite.
Elle eft à huit lieues S. de Vienne, 22 N. E. de
Gratz. Long. 2 4 .3S. h t. 4-3. 48.
Neustadt , ( Géog. ) ville d’Allemagne en Fran-
conie , dans levêché de Wurtzbourg , fur la Saale,
près deKoening Sehoffen. Long. 28. 10. lat. 4 3 .34,
Neustadt , ( Géog.) ville d’Allemagne, dans le
duché de Brunfwick-Lunébourg, à quatre lieues
N. O. d’Hanover, fur la riviere de Leyne. Long.
2 y .2 4 .h 1 . 62. 34. .
Neustadt, ( Géog. ) petite ville d’Allemagne,
dans le Holftein, fur un golfe que forme la mer Baltique,
fur la côte de la Wagrie. Elle eft fituée à
quatre milles d’Oldembourg, & à environ pareille
diftance de Lubec. Long. 28. 24. lat:63. SG. ,
Neustadt an de£ Hart , (Géog. ) ville d’Àl-
lemagne, au Palatinat du Rhin, fituée lur une petite
chaîne de montagnes appellée h Hart, à quatre
milles de Landau. Comme fon territoire' fait partie
du Speyrgow, on ia nomme en latin Neapolis-Nemt-
tum. Jean Cafimir s’en rendit maître par artifice en
1 579. Long. 2G. 48..h t ..43. 22.
N EU STA TT, ( Géog. ) l’Allemagne a plufieurs
bourgs ou petites villes, ainfi nommées, mais qui
ne méritent -aucun détail. Il y a trois Neuftatt en
Fra-nçonie ; une dans le landvraviat de Heffe , une
au comté de la Marck, une dans la haute Bavière ,
fur l’Abenz , une dans la Moravie, à trois lieues N.
d’Olmutz, une dans la Suabe, à trois lieues de HeyR
bron , fur le Kocker, &c. { D . J- )
NEUSTÉ, ou NEUVETÉ , f. f. termes de Riviere
, droit que paye un bateau la première fois qu’il
vient à Paris-,
NEUSTRÉ , f. m. terme de Courtepointiers, artifan
qui fait & qui vend des meubles. Cet ancien terme
le trouve dans les ftatuts des Courtepointiers, quj