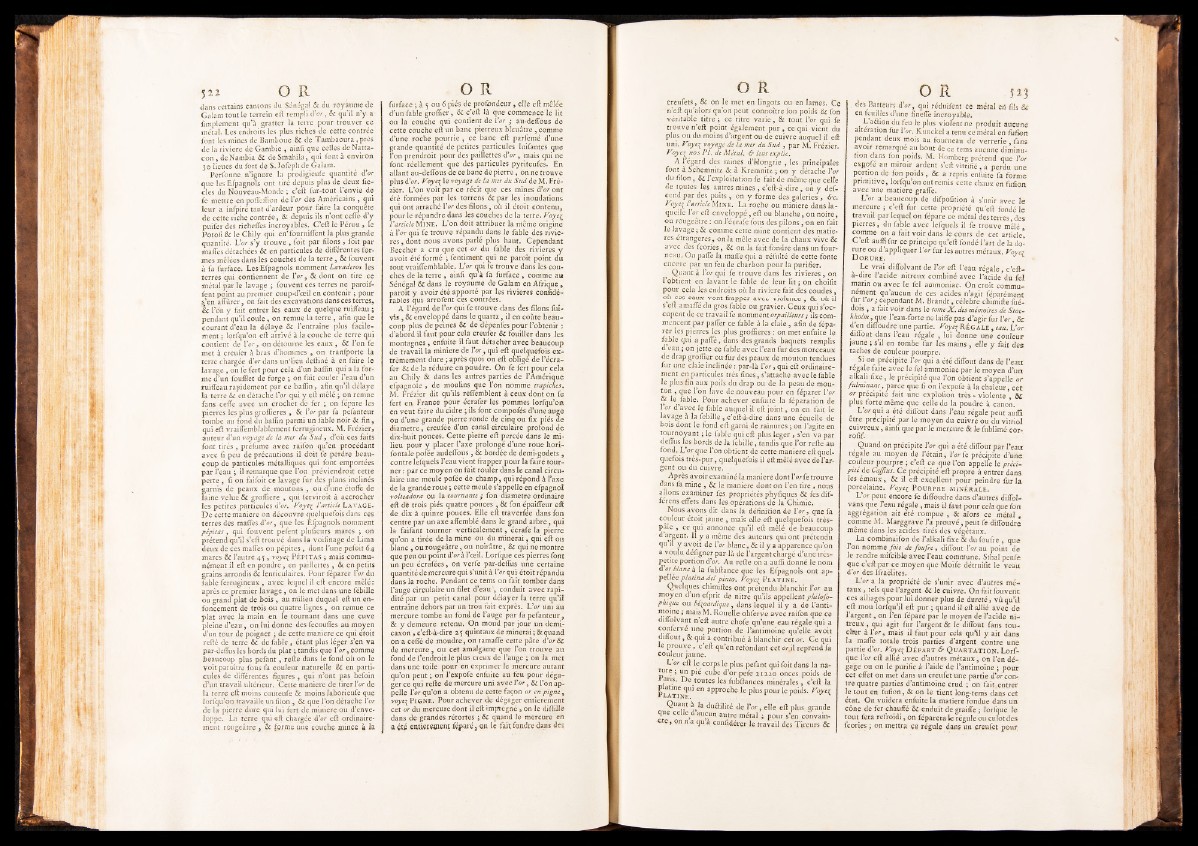
5 OR
dans certains cantons du Sénégal & du royaume de
Galam tout le terrein eft rempli d’or, 6c qu’il n’y a
Simplement qu’à gratter la terre pour trouver ce
métal. Les endroits les plus riches de cette contrée
Sont les mines de Bamboue 6c de Tambaoura , près
de la riviere de Gambie , ainfi que celles de Natta-
con , deNambia 6c deSmahila, qui font à environ
30 lieues du fort de S. Jofeph de Galam.
Perfonne n’ignore la prodigieufe quantité d’or
que les Efpagnols ont tiré depuis plus de deux Siècles
du Nouveau-Monde ; c’eft fur-tout l’envie de
fe mettre en poffefîion de l’or des Américains, qui
leur a infpiré tant d’ardeur pour faire la conquête
de cette riche contrée, & depuis ils n’ont ceffé- d’y
puifer des richeffes incroyables. C ’eft le Pérou , le
Potofr & le Chily qui en'fourniffent la plus grande
quantité. L’or s’y trouve , foit par filons , foit par
maffes détachées & en particules de différentes formes
mêlées dans les couches de la terre, 6c fouvent
à fa furface. Les-Efpagnols nomment Lavaderos les
terres qui contiennent de l’or, & dont on tire ce
métal par le lavage ; fouvent ces terres ne paroif-
fent point au premier coup-d’oeil en contenir ; pour
§’en affûrer, on fait des excavations dans ces terres,
6 l’on y fait entrer les eaux de quelque ruiffeau ;
pendant qu’il coule, on remue la terre , afin que le
courant d’eau la délaye 6c l’entraîne plus facilement
; lorfqu’on eft arrivé à la couche de terre qui
contient de l’or, on détourne les eaux, 6c l’on fe
met à creufer à bras d’hommes , on tranfporte la
terre chargée d’or dans un'lieu deftiné à en faire le
lavage , on fe fert pour cela d’un baffin qui a la forme
d’un foufflet de forge ; on fait couler l’eau d’un
ruiffeau rapidement par ce baffin, afin qu’il délaye
la terre & en détache, l’or qui y eft mêlé ; on remue
fans ceffe avec un crochet dé fer ; on fépare les
pierres les plus groffieres , & l’or par fa pefanteur
tombe au fond du baffin parmi un fable noir & fin,
qui eft vraiffemblablement ferrugineux. M. Frézier,
auteur d’un voyage de la mer du Sud, d’où ces faits
font tirés , préfume avec raifon qu’en procédant
avec fi peu de précautions il doit fe perdre beaucoup
de particules métalliques qui font emportées
par l’eau ; il remarque que l’on préviendroit cette
p er te, fi on faifoit ce lavage fur des plans inclinés
garnis de peaux de moutons , ou d’une étoffe de
laine velue 6c groffiere , qui lerviroit à accrocher
les petites particules d’or. Voyeç Varticle Lavag e.
De cette maniéré on découvre quelquefois dans ces
terres des maffesd’or, que les Efpagnols nomment
pépitas , qui fouvent pefent plufieurs marcs ; on
prétend qu’il s’eft trouvé dans lo voifinage de Lima
deux de ces maffes ou pépites , dont l ’une pefoit 64
marcs 6c l’autre 45 , voye{ Pépitas ; mais communément
il eft en poudre, en paillettes , & en petits
grains arrondis 6c lenticulaires. Pour féparer l’or du
fable ferrugineux , avec lequel il eft encore mêlé :
après ce premier lavage , on le met dans une fébille
ou grand plat de bois , au milieu duquel eft un enfoncement
de trois ou quatre lignes, on remue ce
plat avec la main en le tournant dans une cuve
pleine d’eau, on lui donne des fecouffes au moyen
d’un tour de poignet ; de cette maniéré ce qui étoit
refté de terre 6c de fable, étant plus léger s’en va
par-deffus les bords du plat ; tandis que l’or, comme
beaucoup plus pefant, refte dans le fond où on le
voit paroître fous fa couleur naturelle 6c en particules
de différentes figures , qui n’ont pas befoin
d’un travail ultérieur. Cette maniéré de tirer l’or de
la terre eft moins couteufe & moins laborieufe que
lorfqu’on travaille un filon , 6c que l’on détache l’or
de la pierre dure qui lui fert de minière ou d’enveloppe.
La terre qui eft chargée d’or eft ordinairement
rougeâtre , & fgjrme unç çouçhg nfince k la
furface ; à 5 ou 6 piés de profondeur , elle eft mêlée
d’un fable groffier, 6c c’eft là que commence lé lit
ou la couche qui contient de l’or ,* au-deffous de
cette couche eft un banc pierreux bleuâtre, comme
d’une roche pourrie , ce banc eft parfemé d’une
grande quantité de petites particules luifantes que
l’on prendroit pour des paillettes d’or , mais qui ne
font réellement que des particules pyriteufes. En
allant au-deffous de ce banc de pierre, on ne trouve
plus d’or. Voye[ le voyage de la mer du Sud de M. Fré-
zier. L’on voit par ce récit que ces mines d’or ont
été formées par les torrens 6c par les inondations
qui ont arraché l’or des filons, où il étoit contenu,
pour le répandre dans les couches de la terre. Voye1
l'article Mine. L’on doit attribuer la même origine
à l ’or qui fe trouve répandu dans le fable des rivières
, dont nous avons parlé plus haut. Cependant
Beccher a cru que cet or du fable des rivières y
a voit été formé ; fentiment qui ne paroît point du
tout vraiffemblable. L’or qui fe trouve dans les couches
de la terre , ainfi qu’à fa furface, comme au
Sénégal 6c dans le royaume de Galam en Afrique ,
paroît y avoir été apporté par les rivières confidé-
rables qui arrofent ces contrées.
A l’égard de l’or qui fe trouve dans des filons fui-
vis , 6c enveloppé dans le quartz, il en coûte beaucoup
plus de peines & de dépenfes pour l’obtenir :
d’abord il faut pour cela creufer & fouiller dans les
montagnes, enfuite il faut détacher avec beaucoup
de travail la minière de l’or, qui eft quelquefois extrêmement
dure ; après quoi on eft obligé de l’écra-
fer & de la réduire en poudre. On fe fert pour cela
au Chily & dans les autres parties de l’Amérique
efpagnole , de moulins que l’on nomme trapiches.
M. Frézier dit qu’ils reffemblent à ceux dont on fe
fert en France pour écrafer les pommes Iorfqu’on
en veut faire du cidre ; ils font compofés d’une auge
ou d’une grande pierre ronde de cinq ou fix piés de
diamètre, creufée d’un canal circulaire profond de
dix-huit pouces. Cette pierre eft percée dans le milieu
pour y placer l’axe prolongé d’une roue hori-
fontale pofée âudeffous , 6c bordée de demi-godets ,
contre lefquels l’eau vient frapper pour la faire tourner
: par ce moyen on fait rouler dans le canal circulaire
une meule pofée de champ, qui répond à l’axe
de la grande roue ; cette meule s’appelle en efpagnol
volteadora ou la tournante ; fon diamètre ordinaire
eft dé trois piés quatre pouces , 6c fon épaiffeur eft
de dix à quinze pouces. Elle eft traverfée dans fon
centre par un axe affemblé dans le grand arbre, qui
la faifant tourner verticalement, écrafe la pierre
qu’on a tirée de la mine ou du minerai, qui eft ou
blanc, ou rougeâtre, ou noirâtre, 6c qui ne montre
qUe peu ou point d’or à l’oeil. Lorfque ces pierres font
un peu écrafées, on verfe par-deffus une certaine
quantité de mercure qui s’unit à l’or qui étoit répandu
dans la roche. Pendant ce tems on fait tomber dans
l’auge circulaire un filet d’eau;, conduit avec rapidité
par un petit canal pour délayer la terre qu’il
entraîne dehors par un trou fait exprès. L’or uni au
mercure tombe au fond de l’auge par fa pefanteur ,
& y demeure retenu. On moud par jour un demi-
caxon, c’eft-à-dire 15 quintaux de minerai ; & quand
on a ceffé de moudre, on ramaffe cette pâte d’or 6c
de mercure, ou cet amalgame que l’on trouve au
fond de l’endroit le plus creux de l’auge ; on la met
dans une toile pour en exprimer le mercure autant
qu’on peut ; on l’expofe enfuite au feu pour dégager
ce qui refte de mercure uni avec l’or, 6c l’on appelle
l’or qu’on a obtenu de cette façon or en pigne ,
voye{ Pign e. Pour achever de dégager entièrement
cet or du mercure dont il eft imprégné , on le diftille
dans de grandes rétortes ; 6c quand le mercure en
a été emieresnent féj>âréa on le fait fondre dans des
creufetà, 8c on le met en lingots ou en lames.. C è
n’eft qu’alors qu’on peut connoître fon poids & fon
véritable titre ; ce ritre varie, & tout l’or qui fe
trouve n’eft point également pur , ce qui vient du
plus ou du moins d’argent ou de cuivre auquel il eft
uni. V 3yeç voyage de la mer du Sud , par M. Frézier*
Voyei nos P l. de Métal. & leurexplic.
A 1 egard des' mines d’Hongrie , les principales
font à Schemnitz & à Kremnitz ; on y détache l’or
du filon, 6c l’exploitation fe fait de même que celle
de tputes les autres mines , e’eft-à-dire, on y def-
cend par des puits , on y forme des galeries , &c%
Voye\[ L article M in e . La roche ou minière dans laquelle
1 or eft enveloppé, eft ou blanche, ou noire,
ou rougeâtre : on l’écrafe fous des pilons, on en fait
le lavage ; & comme cette mine contient des matières
étrangères, on la mêle avec de la chaux v ive 6c
avec des feories, & on la fait fondre dans un fourneau.
On paffe la maffe qui a réfulté de cette fonte
encore par un feu de charbon pour la purifier.
Quant à l’or qui fe trouve dans les rivières, on
l’obtient en lavant le fable de leur lit ; on choifit j
pour cela les endroits où la riviere fait des coudes,
où ces eaux vont frapper avec violence , & où il
s’eft amaffé du gros fable ou gravier. Ceux qui s’occupent
de ce travail fe nomment orpailleurs ; ils commencent
par paffer ce fable à la claie, afin de féparer
les pierres les plus groffieres : on met enfuite le
fable qui a paffé, dans des grands baquets remplis
d’eau ; on jette ce fable avec l’eau fur des morceaux
de drap groffier ou fur des peaux de mouton tendues
fur une claie inclinée : par-là l’or, qui eft ordinairement
en particules très fines, s’attache avec le fable
le plus fin aux poils du drap ou de la peau de mouton
, que l’on lave de nouveau pour en féparer l ’or
& le fable. Pour achever enfuite la féparation de
l ’or d’avec le fable auquel il eft joint, on en fait le
lavage à la febille , c’eft-à-dire dans une écuelle de
bois dont le fond eft garni de rainures ; on l ’agite en
tournoyant ; le fable qui eft plus leger , s’en va par
deffus les bords de la febille, tandis que l’or refte au
fond. L’or que l’on obtient de cette maniéré eft quelquefois
très-pur, quelquefois il eft mêlé avec de l’argent
ou du cuivre.
Apres avoir examiné la maniéré dont l’orfe trouve
dans fa mine , & la maniéré dont on l’en tire , nous
allons examiner fes propriétés phyfiques 6c fes dif-
ferens effets dans les opérations de la Chimie.
Nous avons dit dans la définition de l’or, que fa
couleur étoit jaune , mais elle eft quelquefois très-
pale , ce qui annonce qu’il eft mêlé de beaucoup
d’argent. Il y a même des auteurs qui ont prétendu
qu’il y avoit de l’or blanc •, & il y a apparence qu’on
a voulu défigner par-là de l’argent chargé d’une très-
petite portion d’or. Au refte on a auffi donné le nom
d’or blanc à la fubftance que les Efpagnols ont ap-
pelléc platina del pinto. Voye{ PLATINE.
Quelques chimiftes ont prétendu blanchir l’or au
moyen d un efprit de nitre qu’ils appellent philofo-
phique ou be^oardique, dans lequel il y a de l’anti-
moine ; mais M. Rouelle obferve avec raifon que ce
diffolvant n’eft autre chofe qu’une eau régale qui a
confervé une portion de l’antimoine qu’elle avoit
diffout, & qui a contribué à blanchir cet or. Ce qui
le prouve, c ’eft qu’en refondant cet orj.1 reprend fa
couleur jaune.
L ’o r e f t l e c o r p s l e p lu s p e f a n t q u i f o i t d a n s l a n a -
f r i r e ; u n p i é c u b e d ’o r p e f e 2 1 1 2 0 o n c e s p o id s d e
a n s . D e t o u t e s l e s f u b f t a n c e s m i n é r a l e s , c ’ e f t l a
Plat^ Cn aPProc^e plus pour le poids. Voyeç
Quant à la duâilité de l’or, elle eft plus grande
que ce ed aucun autre métal ; pour s’en convainc
r e , on n a qu à confidérer le travail des Tireurs 6c
des Batteurs dW, qui réduifent Ce métal fert fils 6c
en feuilles d’une fineffe incroyable*
L action du feu le plus violent ne produit aucune
alteration fur l ’or. Kunckel a tenu ce métal en fufion
pendant deux mois au fourneau de verrerie , fans
avoir remarque au bout de ce tems aucune diminution
dans fon poids. M. Homberg prétend que Yot
exRofé au miroir ardent s’eft vitrifié, a perdu une
portion de fon poids, & a repris enfuite fa forme
primitive, lorfqu’on eut remis cette chaux en fufion
avec une matière graffe.
L’or a beaucoup de difpofition à s’unir avec le
mercure ; c’eft fur cette propriété qu’eft fondé le
travail par lequel on fépare ce métal des terres des
pierres, du fable avec lefquels il fe trouve mêlé ,
comme on a fait voir dans le cours de cet article.
C ’eft auffi fur ce principe qu’eft fondé l ’art de la do*
rure ou d ’appliquer l ’or fur les autres métaux. Voyez
D orure.
Le vrai diffolvant de l’or eft l’eau régalé, c ’eft-
à-dire l’acide nitreux combiné avec l ’acide du fel
marin ou avec le fel ammoniac. On croit communément
qu’aucun de ces acides n’agit féparément
fur l’or ; cependant M. Brandt, célébré chimifte fué-
dois , a fait voir dans le tome X . des mémoires de Stockholm
, que l ’eau-forte ne laiffe pas d’agir fur l ’or, &
d’en diffoudre une partie. Voye^ R ég a le , eau. L’or
diffout dans l’eau régale , lui donne une couleur
jaune ; S’il en tombe fur les mains, elle y fait des
taches de Couleur pourpre*
, Si on précipite l’or qui a été diffout dans de l’eaii
regale faite avec le fel ammoniac par le moyen d’un
alkali fixe, le précipité que l’on obtient s’appelle ot
fulminant, parce que fi on l’expofe à la chaleur, cet
or précipité fait une explofion très - violente 6c
plus forte même que celle de la poudre à canon.
L’or qui a été diffout dans l’eau régale peut auffi
être précipité par le moyen du cuivre ou du vitriol
cuivreux, ainfi que par le mercure & le fublimé cor-
rôfif*
Quand on précipite l’or qui a été diffout par l’eau
regale au moyen de l’étain, l’orfe précipite d’une
couleur pourpre ; c’eft ce que l’on appelle le précipite
de Cafjius. Ce précipité eft propre à entrer dans
les émaux, & il eft excellent pour peindre fur la
porcelaine. Voyeç Pourpre m in éra le.
L or peut encore fe diffoudre dans d’autres diffol-
vans que 1 eau regale , mais il faut pour cela que fon
a£Srégati°n été rompue , & alors ce métal ,
comme M. Marggrave l’a prouvé, peut fe diffoudre
même dans les acides tirés des végétaux.
La combinaifon de l’alkali fixe & du foufre , que
l’on nomme foie de foufre , diffout l’or au point de
le rendre mifeible avec l’eau commune. Sthal penfe
que c’eft par ce moyen que Moïfc détruifit le veau
d’or des Ifraëlites.
L’or a la propriété de s’unir avec d’autres métaux
, tels que l’argent 6c le cuivre. On fait fouvent
ces alliages pour lui donner plus de dureté, vu qu’il
eft mou lorsqu’il eft pur ; quand il eft allié avec de
l’argent, on l’en fépare par le moyen de l’acide nitreux
, qui agit fur l’argent & le diffout fans toucher
à l’or, mais il faut pour cela qu’il y ait dans
la maffe totale trois parties d’argent contre une
partie d’or. Voye^ D épart & Q u a r t a t io n . Lorfque
l’or eft allié avec d’autres métaux, on l’en dégage
ou on le purifie à l’aide de l’antimoine ; pour
cet effet on met dans un creufetune partie d’or contre
quatre parties d’antimoine crud ; on fait, entrer
le tout en fufion, & on le tient long-tems dans cet
état. On vuidera enfuite la matière fondue dans un
cône de fer chauffé 6c enduit de graiffe ; lorfque le
tout fera refroidi, on féparera le régule ou culot des
feories ; on mettra ce régule dans un creufct pour