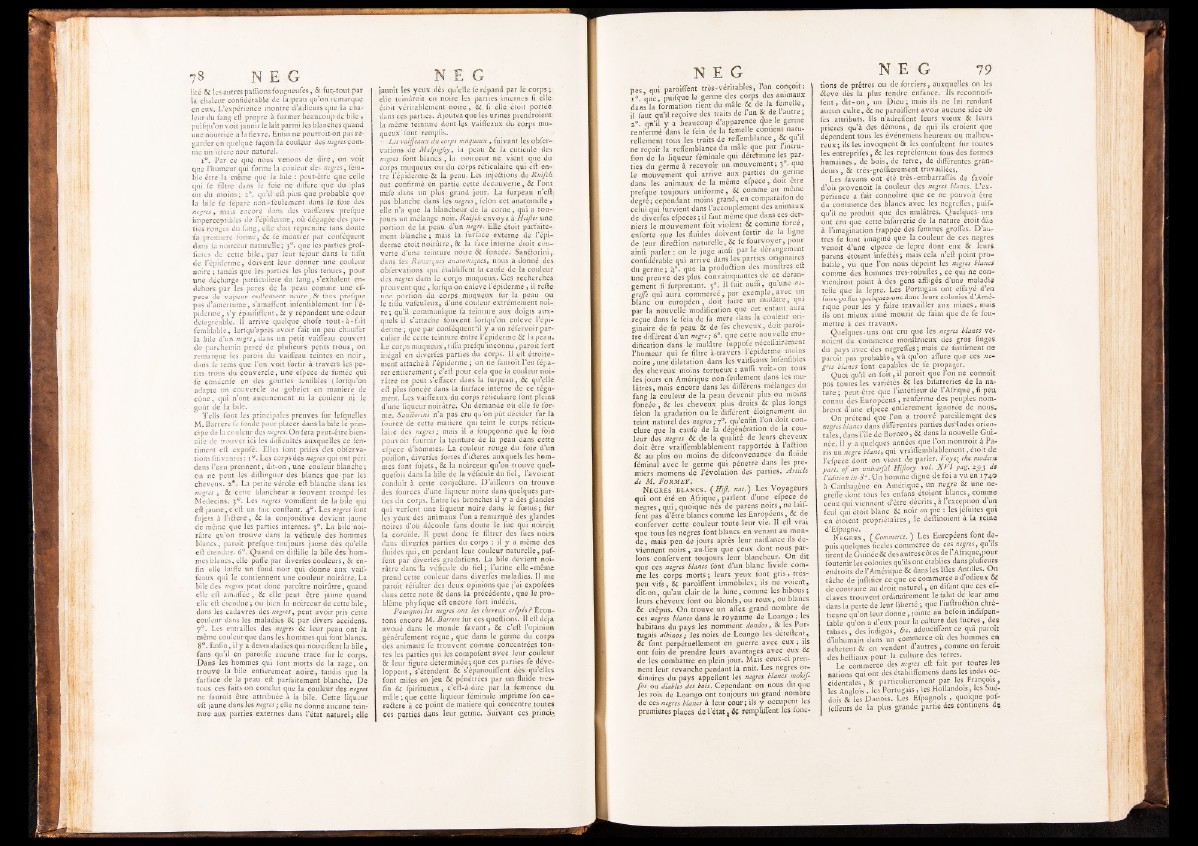
lité & les autres pallions fougueufes, & fur-tout par
la chaleur confidérable de la;peau qu’cm remarque
en eux. L’expérience montre d’ailleurs que la chaleur
du fang eft propre à former beaucoup de bile >
puifqu’on v.oit jaunir le lait parmi les blanches quand
une nourrice a la fievre. Enfin ne pourroit-on pas regarder
en quelque façon la couleur des «égrweonv-
me un i&ere noir naturel.
i°. Par ce que nous1 venons de dire, on voit
que l’humeur qui forme la couleur des negres, fem-
bleêtre.la même que la bile peut-être que celle
qui fe filtre dans le foie ne différé que du plus
ou du moins ; i° . qu’il eft plus que probable que
la bile fe fépare non» feulement dans le foie des
negres, mais encore dans des vaiffeaux prefque
imperceptibles de l’épiderme, où dégagée des parties
rouges du fang, elle doit reprendre fans doute
fa première forme, 6c fe montrer par conféquent
dans fa noirceur naturelle ; 30. que les parties grof-
fieres de cette bile, par leur léjour dans le tiffu
de l’épiderme, doivent leur donner une couleur
noire ; tandis que les parties les plus tenues, pour
une décharge particulière du fang, s’exhalent en-
dehors par les pores de la peau comme une efpece
de vapeur nullement noire, & fans prefque
pas d’amertume, s’amaffentinfenfiblement fur l’épiderme,
s’y épaifîiffent, & y répandent une odeur
défagréable. Il arrive quelque chofe tou t-à-fa it
femblable, lorlqu’après avoir fait un peu chauffer
la bile d’un negre, dans un petit vaiffeau couvert
de parchemin percé de plufieurs petits trous, on
remarque les parois du vaiffeau teintes en noir,
dans le tems que l’on voit fortir à-travers les petits
trous du couvercle, une efpece de fumée qui
fe condenfe en des gouttes fenfibles ( lorfqu’on
adapte un couvercle au gobelet en maniéré de
cône, qui n’ont aucunement ni la- coulenr ni le
goût de la bile.
Tells font les principales preuves fur lefquelles
M. Barrere fe fonde pour placer dans la bile le principe
de la couleur des negres. On fera peut-être bien-
aife de trouver ici les difficultés auxquelles ce fen-
timent eft expofé. Elles font prifes des obferva-
tions fuivantes : 1c . Les corps des negres qui ont péri
dans l’eau prennent, dit-on, une couleur blanche ;
on ne peut les diftinguer des blancs que par les
cheveux, 2®. La petite vérole eft blanche dans les
negres ; & cette blancheur a fouvent trompé les
Médecins. 3°- Les negres vomiffent de la bile qui
eft jaune , c‘eft un fait confiant. 40. Les negres font
fujets à l’iêlere, 6c la conjonftive devient jaune
de même que les parties internes. 30. La bile noirâtre
qu’on trouve dans la véficule des hommes
blancs, paroît prefque toujours jaune dès qu’elle
eft étendue. 6P. Quand on diftille la bile des hommes
blancs, elle paffe par diverfes couleurs, & enfin
elle laiffe un fond noir qui donne aux vaiffeaux
qui le contiennent une couleur noirâtre. La
bile des negres peut donc paroître noirâtre, quand
elle eft amaffée, 6c elle peut être jaune quand
elle eft étendue ; ou bien la noirceur de cette bile,
dans les cadavres des negres, peut avoir pris cette
couleur dans les maladies 6c par divers accidens.
7 0. Les entrailles des negres 6c leur peau ont la
même couleur que dans les hommes qui font blancs.,
8°. Enfin, il y a des-maladies qui noirciffent la bile,
fans qu’il en paroiffe aucune trace fur le corps.
Dans les hommes qui font morts de la rage, on
trouve la bile entièrement noire, tandis que la
furface de la peau eft parfaitement blanche. De
tous ces faits on conclut que la couleur des negres
ne fauroit être attribuée à la bile. Cette liqueur
eft jaune dans les negres ; elle ne donne aucune teinture
aux parties externes dans l’état naturel; elle
jaunit les yeux dès qu’elle fe répand par le corps ;
elle teindroit en noire les parties internes fi elle
étoit véritablement noire, 6c fi elle, étoit portée
dans ces parties. Ajoutez que les urines prendroient
la même teinture dont les vaiffeaux du corps muqueux
■ fönt remplis, .: <
• :L,es vaijfeaux du corps muqueux, fuivant les obfer-'
vations.lde Malpighy, la peau 6c la cuticule des
negres font blan'cs , la noirceur ne vient que du
corps muqueux ou du corps réticulaire qui eft entre
l’épiderme•& la peau. Les injeûions de Ruiji/i
ont confirmé en partie cette découverte, 6c l’ont
mife dans un plus grand jour. La furpeau n’eftt
pas blanche dans les negres, félon cet anatomifte,
elle n’a que la blancheur de la corne, qui a toujours
un mélange noir. Ruifch envoya à Heißer une
portion de la peau d’un negre. Elle étoit parfaitement
blanche ; mais la furface externe .de l’épiderme
étoit noirâtre, & la face interne étoit couverte
d’une teinture noire 6c foncée, Sanâorini,
dans fes Remarques anatomiques, nous a donné des
obfervations qui etabliffent la caufe de la couleur
des negres dans le corps muqueux. Ces recherches:
prouvent que , lorfqu’on enleve l’épiderme , il refte
une portion du corps muqueux fur la peau ou
le tiflu vafculeux, d’une couleur extrêmement noire;
qu’il communique fa teinture aux doigts auxquels
il s’attache fouvent lorfqu’on enleve l’épiderme
; que par conféquent *il y a un réfervoir par-
culier de cette teinture entre l’épiderme 6c la peau.
Le corps muqueux, tiffu prefqu’inconnu, paroît fort
inégal en diverfes parties du corps. .11 eft étroitement
attaché à l’épiderme ; on ne fauroit l ’en fépa-
rer entièrement ; c’eft pour cela que la couleur noirâtre
ne peut s’effacer dans la furpeau, &c qu’elle
eft plus foncée dans la furface interne de ce tégument.
Les vaiffeaux du corps réticulaire font pleins
d’une liqueur noirâtre. On demande où elle fe forme.
Sanclorini n’a pas cru qu’on pût décider fur la
fource de cette matière qui teint le corps réticulaire
des negres ; mais il a foupçonné que le foie
pouvoit fournir la teinture de la peau dans cette
efpece d’hommes. La couleur rouge du foie d’un
poiffon, diverfes fortes d’iûeres auxquels les hommes
font fujets, 6c la noirceur qu’on trouve quelquefois
dans la bile de la véficule du fiel, l’avoient
conduit à cette conje&ure. D ’ailleurs on trouve
des fources d’une liqueur noire dans quelques parties
du corps. Entre les bronches il y a des glandes
qui verfent une liqueur noire dans le' foetus ; fur
les yeux des animaux l’on a remarqué des glandes
noires d’où découle fans doute le fuc qui noircit
la coroïde. Il peut donc fe filtrer des fucs noirs
dans diverfes parties du corps : il y a même des
fluides qui, en perdant leur couleur naturelle, paf-
fent par diverfes gradations. La bile devient noirâtre
dans'la véficule du fiel; l’urine elle-même
prend cette couleur dans diverfes maladies. Il me
paroît réfulter des deux opinions que j’ai expofées
dans cette note & dans la précédente, que le problème
phyfique eft encore fort indécis.
Pourquoi les negres ont les cheveux crêpés? Ecoutons
encore M. Barrere fur ces queftions. Il eft déjà
avoué dans le monde favant, 6c c’eft l’opinion
généralement reçue, que dans le germe du corps
des animaux fe trouvent comme concentrées toutes
les parties qui les compofent avec leur couleur
& leur figure déterminée ; que ces parties fe développent,
s’étendent 6c s’épanouiflènt dès qu’elles
font mifes en jeu 6c pénétrées par un fluide très-
fin 6c fpiritueux, c’eft-à-dire par la femence du
mâle ; que cette liqueur féminale imprime fon ca-
raftere à ce point de matière qui concentre toutes
ces parties dans leur germe. Suivant ces princi-
P es oui paroiffent très-véritables, l’on conçoit:.
1°. que, puifque le germe-des corps des animaux
dans la formation tient du mâle 6 c de la femelle,
il faut qu’il reçoive des traits de l’un & de 1 autre ;
20. qn’il y a beaucoup d’apparence que le germe
renfermé dans le fein de la femelle contient naturellement
tous les traits de reffemblance, & qu n
ne reçoit la reffemblance du mâle que par iinmi-
fion de la liqueur féminale qui dét^mine les parties
du germe à recevoir un mouvement; 3 . que
le mouvement qui arrive aux parties du germe
dans les animaux de la même efpece, doit etre
prefque toujours uniforme, 6c comme au même
degré; cependant moins grand, en comparaison de
celui qui furvient dans l’accouplement des animaux,
de diverfes efpeces ; il faut même que dans ces derniers
le mouvement foit violent 6 c comme force,
enforte que les fluides doivent fortir de la ligne
de leur direftion naturelle, 6 c fe fourvoyer, pour
ainfi parler : on le juge ainfi par le dérangement
confidérable qui arrive dans les parties originaires
du germe; ’4°. que la produ&ion des monltres ett
une preuve des plus convainquantes de ce dérangement
fi furprenant. 50. Il fuit aufli, qu une n e -
g r e jfe qui aura commercé, par exemple, avec un
blanc ou européen, doit faire un mulâtre, qui
par la nouvelle modification que cet enfant aura
reçue dans le fein de fa mere dans la couleur originaire
de fa peau & de fes cheveux, doit paroi-
tre différent d’un n e g r e ; 6°. que cette nouvelle modification
dans le mulâtre luppofe neceffairement
l’humeur qui fe filtre à-travers l ’épiderme* moins
noire, une dilatation dans les vaiffeaux mfenfibles
des cheveux moins tortueux : auffi voit-on tous
les jours en Amérique non-feulement dans les mulâtres
, mais encore dans les différens mélangés du
fang la couleur de la peau devenir plus ou moins
fon cée, & les cheveux plus droits & plus longs
félon la gradation ou le different eloignement du
teint naturel des n e g r e s ; ’1] 0 . qu’enfin l’on doit conclure
que là caufe de la dégénération de la couleur
des n e g r e s 6 c de la qualité de leurs cheveux
doit être vraiffemblablement rapportée à l’aôion
6 c au plus ou moins de difconvenance du fluide
féminal avec le germe qui pénétré dans les premiers
momens de l’évolution des parties. A r t i c l e
d e M . F o r m e y .
N e g r e s b l a n c s . ( Hifi. n a t .) Les Voyageurs
qui ont été en Afrique, parlent d’une^ efpece de
negres, qui, quoique nés de parens noirs, ne laif-
fent pas d’être blancs comme les Européens, 6c de
conferver cette couleur toute leur vie. Il eft vrai
que tous les negres font blancs en venant au monde
, mais peu de jours après leur naiflance ils deviennent
noirs, au-lieu que çeux dont nous parlons
confervent toujours leur blancheur. On dit
que ces n e g r e s b la n c s font d’un blanc livide comme
les corps morts ; leurs yeux font gris, très-
peu v ifs , 6c paroiffent immobiles ; ils ne voient,
dit-on, qu’au clair de la lune, comme les hibous ;
leurs cheveux font ou blonds, ou roux, ou blancs
& crépus. On trouve un affez grand nombre de
ces neg re s b la n c s dans le royaume de Loango ; les
habitans du pays les nomment d o n d o s , & les Portugais
a lb in o s ; les noirs de Loango les détellent,-
& font perpétuellement en guerre avec eux ; ils
ont foin de prendre leurs avantages avec eux 6c
de les combattre en plein jour. Mais ceux-ci prennent
leur revanche pendant la nuit. Les negres ordinaires
du pays appellent les neg re s b la n c s rn o kif-
f o s ou d ia b le s d e s b o is . Cependant on nous dit que
les rois de Loango ont toujours un grand nombre
de ces n eg res b la n c s à leur cour ; ils y occupent les
premières plaçes de l ’état a 6t rempliffent les fonctions
de prêtres ou de forciers, auxquelles on les
éleve- dès la plus tendre enfance. Ils reconnoif-
len t , d it-o n , un Dieu; mais ils ne lui rendent
aucun culte, 6c ne paroiffent avoir aucune idée de
fes attributs. Us n’adreflent leurs voeux & leurs
prières qu’à des démons, de qui ils croient que
dépendent tous les événemens heureux ou malheureux
; ils les invoquent & les confultent fur toutes
les entreprifes, 6c les repréfentent fous des formes
humaines, de bois, de terre, de différentes grandeurs
, & très-groffierement travaillées.
Les favans ont été très-embarraffés de favoir
d’où provenoit la couleur des negres blancs. L’expérience
a fait connoître que ce ne pouvoit être
du commerce des blancs avec les negreffes, puif-
qu’il ne produit que des mulâtres. Quelques-uns
ont cru que cette bifarrerié de la nature étoit due
à l’imagination frappée des femmes groffes. D’aur
très fe font imaginé que la couleur de ces negres
venoit d’une efpece de lepre dont eux & leurs
parens étoient infeétés; mais cela n’eft point probable
, vu que l’on nous dépeint les negres blancs
comme des hommes très-robuftes, ce qui ne con-
viendroit point à des gens affligés d’une maladie
telle que la lepre. Les Portugais ont effayé d’eri
faire paffer quelques-uns dans leurs colonies d ’Amérique
pour les y faire travailler aux mines, mais
ils ont mieux aimé mourir de faim que de fe fou-
mettre à ces travaux.
Quelques-uns ont cru que les negres blancs ve-
noient du -commerce monftrueux des gros finges
du pays avec des negreffes; mais ce fenriment ne
paroît pas probable, vu qu’on affure que ces negres
blancs font capables de fe propager.
Quoi qu’il en foit, il paroît que l’on ne connaît
pas toutes les variétés 6c les bifarreries de la nature
; peut-être que l’intérieur de l’Afrique, fi peu
connu des Européens , renferme des peuples nombreux
d’une efpece entièrement ignorée de nous.
On prétend que l’on a trouvé pareillement des
negres blancs dans différentes parties desTndes orientales,
dans l’île de Bornéo, 6c dans la nouvelle Guinée.
Il y a quelques années que l’on montroxt à Paris
un negre blanc, qui vraiffemblablement, étoit de
l’efpece dont on vient de parler. Voye^ the modem
part, o f an univerfal Hifiory vol. X V I pag. 293 de
L'édition in-8*. Un homme digne de foi a vu en 1740
à Carthagène en Amérique, un negre 6c une ne-
greffe dont tous les enfans étoient blancs, comme
ceux qui viennent d’être décrits, à 1 exception d un
feul qui étoit blanc 6c noir ou pie : les jefuites qui
en étoient propriétaires, le deftinoient à la reine
d’Efpagne. ,
Negres, (Commerce.) Les Européens font depuis
quelques fiecles commerce de ces negres, qu’ils
tirent de Guinée 6c des autres côtes de l’Afrique,pour
foutenir les colonies qu’ils ont établies dans plufieurs
endroits de l’Amérique 6c dans les Ifles Antilles. On
tâche de juftifier ce que ce commerce a d’odieux 6c
de contraire au droit naturel, en difant que ces ef-
clayes trouvent ordinairement le falut de leur ame
dans la perte de leur liberté-; "que 1 inftruftion chrétienne
qu’on leur donne, jointe au befoin indifpen-
fable qu’on a d’eux pour la culture des lucres, des
tabacs, des indigos, &c. adouciffent ce qui paroît
d’inhumain dans un commerce où des hommes en
achètent & en vendent d’autres, comme on ferort
des beftiaux pour la culture des terres.
Le commerce des negres eft fait par toutes les
nations qui ont des établiffemens dans les mdes occidentales
, & particulièrement par les François,
les An«lois , les Portugais, les Hollandois, les suédois
& les Danois. Les Efpagnols , quoique pof-
feffeurs de la plus grande partie des continens d^