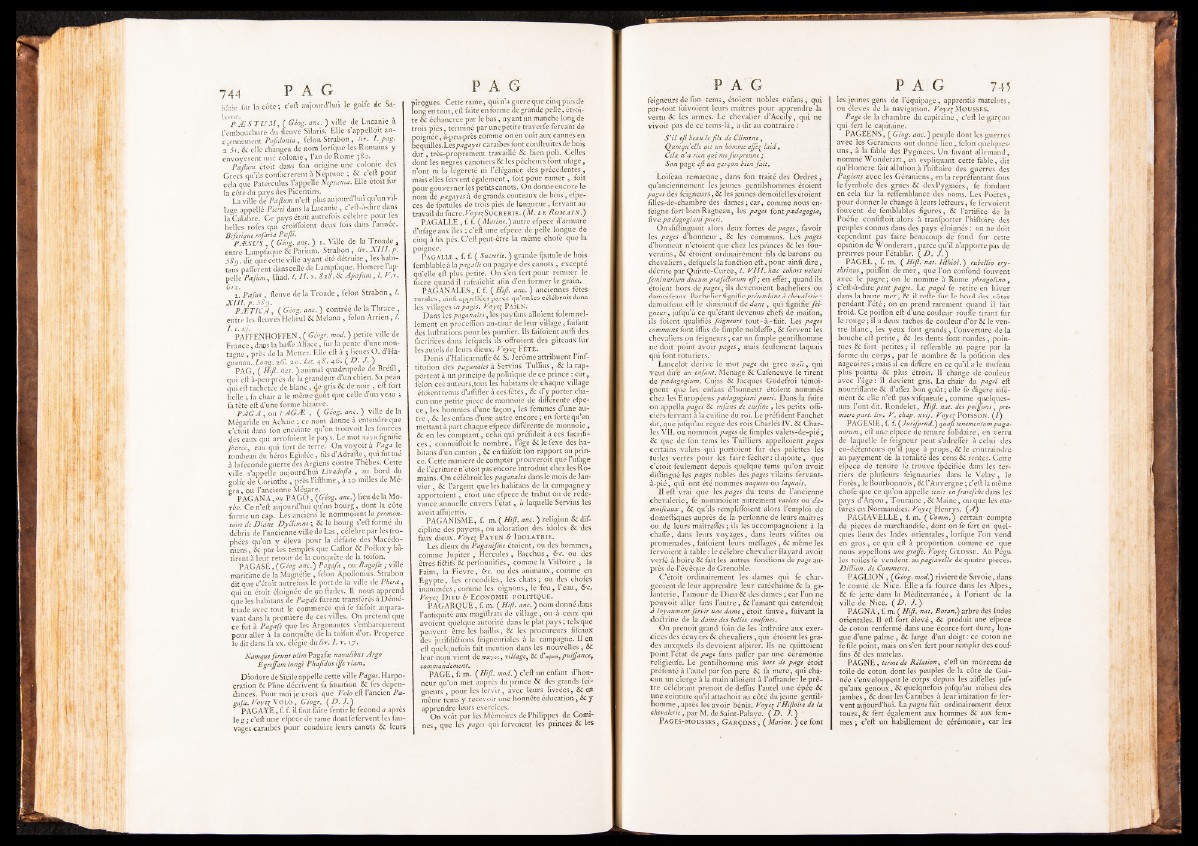
7 4 4 P A G
bâtie fur la côte ; c’ eft aujourd’hui le golfe de Sa-
^ 'p Æ S T U M , ( Géog. anc. ) ville de Lucanie à
l’embouchure du fleuve Silaris. Elle s appelloit anciennement
Pojidonia, félon Strabon, liv. I.pag.
z 3 i.&c elle changea de nom lorfque les Romains y
envoyèrent une colonie, l’an de Rome 380.
Poeflum étoit dans fon origine une colonie des
Grecs qu’ils confacrerent à Neptune ; 6c c’eft pour
cela que Paterculus l’appelle Neptunia. Elle étoit fur
la côte du pays des Picentins. ? ■
La ville de Poejîum n’eft plus aujourd’hui au un village
appellé Pierti dans la Lucanie, c’ eft-à-dire dans
la Calabre. Ce pays étoit autrefois célèbre pour les
belles rofes qui croifloient deux fois dans l’annee.
Bïferiqut roftria Poefh. , . „ ,
PÆSUS , ( Géog. anc. ) 1. Ville de la Iroade ,
entre Lampfaque 6c Parium. Strabon, liv. X I I I .p .
58g . dit que cette ville ayant été détruite, leshabi-
tans pafferent dans celle de Lampfaque. Homere l’appelle
PoeJ'um, Iliad. /. II. v. 828. 6cAptefum, /. F.v.
612.
2. P<zfus , fleuve d e laT ro ade, félon Strabon, l.
X I I I . p. 38<). '
PÆ T IC A , ( Géog. anc. ) contrée de laThrace ,
flonwpi: T-Tpbrnl &Melana . félon A rrien, l.
PAFFENHOFFEN, ( Géogr. mod. ) petite ville de
France, d'ans la baffe Alface, fur la pente d’une montagne
, près de la Metter. Elle eft à 3 lieues O. d’Ha-
guenau. Long. 2G. 20. lat. 48. 46’. ( D. •I.')
PAG, ( Hifl. nat. ) animal quadrupède de Brefil,
qui eft à-peu-près de la grandeur d’un chien. Sa peau
qui eft tachetee de blanc, ^e gris & de. noir , eft fort
belle ; fa chair a le même goût que celle d’un veau ;
fa tête eft d’une forme bizarre.
P AG A , ou FAGÆ , ( Géog. anc. ) ville de la
Mégaride en Achaïe ; ce nom donne à entendre que
c’étoit dans fon enceinte qu’on trouvoit les fources
des eaux qui arrofoient le pays. Le mot vrayn lignifie
fource, eau qui fort de terre. O n v o y o ita Paga le
tombeau du héros Egialée, fils d’Adrafte, qui fut tue
à la fécondé guerre des Argiens contre Thèbes. Cette
ville s’appelle aujourd’hui LivadoJIa , au bord du
golfe de Corinthe, près l’ifthme, à 20 milles de Mé-
g ra, ou l’ancienne Mégare.
P AG AN A , 07/ PAG O , {Géog. anc.) lieu delà Mo-
rée. Ce n’eft aujourd’hui qu’un bourg, dont la côte
forme un cap. Les anciens le nommoient le promontoire
de Diane Dyclimne ; 6c le bourg s’eft formé du
débris de l’ancienne ville de Las, célébré par les trophées
qu’on y éleva pour la défaite des Macédoniens
, 6c par les temples que Caftor 6c Pollux y bâtirent
à leur retour de la conquête de la toifon.
PAGASE , (Géog anc.) Pagafa , ou Bagafce ; ville
maritime de la Magnéfie , félon Apollonius. Strabon
dit que c’étoit autrefois le port de la ville de Pliera,
qui en étoit éloignée de 90 ftades. Il nous apprend
que les habitans de Pagajè furent transférés à Démé-
triade avec tout le commerce qui fe faifoit auparavant
dans la première de ces villes. On prétend que
ce fut à Pagafe que les Argonautes s’embarquèrent
pour aller à la conquête de la toifon d’or. Properce
le dit dans fa xx. élégie du//v. I .v . ty.
Namque ferunt olim Pagafæ navalibus Argo
Egreffam longé Phafidos ijfe viam.
Diodore de Sicile appelle cette ville Pagas. Harpo-
cration 6c Pline décrivent fa fituation 6c fes dépendances.
Pour moi je crois que Folo eft l’ancien Pa-
gaj'a. Voye£ VOLO, Géogr. (D . J .)
PAGAYE, f. f. il faut faire fentir le fécond a après
le g ; c’eft une efpece de rame dont fe fervent les fau-
vages caraïbes pour conduire leurs canots & leurs
P A G
drogues. Cette rame, qui n’a guere que cinq pies de
ong en tout, eft faite en forme de grande pelle ,'étroi- ■
te 6c échancrée par le bas, ayant un manche long de
trois piés, terminé par une petite traverfe fervant de
joignée, à-peu-près comme on en voit aux cannes en
îequilles.Lespagayes caraïbes font confinâtes de bois
dur , très-proprement travaillé 6c bien poli. Celles
dont les negres canotiers 6c les pêcheurs font ufage,
n’ont ni la légèreté ni l’élégance des précédentes,
mais elles fervent également, foit pour ramer , foit
pour gouverner les petits canots. On donne encore le
nom'de pagayes à de grands couteaux de bois, efpe-
ces de fpatules de trois piés de longueur, fervant au
travail du fucre. ^ « { S u c r e r ie . (M. l e R o m a i n . )
PAGALLE, f. f. (Marine.) autre efpece d’armure
d’ufage aux îles ; c’ eft une efpece de pelle longue de
cinq à fix pés. C’ett peut-être la même chofe que la
poignée.
P AG ALLE , f. f. ( Sucrerie. ) grande fpatule de bois
femblable à la pagalle ou pagaye des canots , excepté
qu’elle eft plus petite. On s’en fert pour remuer le
lucre quand il rafraîchit afin d’en former le grain:
P AG ANALES, f. f. ( Hifl. anc. ) anciennes fêtes,
rurales, ainfi appellées parce qu’on les célébroit dans
les villages in pagis. Voyei Païen.
Dans les paganales, les payfans alloient folemnel-
lement en proceflion au-tour de leur v illage, faifant
des luftrations pour les purifier. Ils faifoient aufli des .
facrifices dans lefquels ils offroient des gâteaux fur
les autels de leurs dieux. Foye^ Fête.
Denis d’Halicarnaffe 6c S. Jerome attribuent l’inf-
titution des paganales à Servius Tullius, 6c la rapportent
à un principe de politique de ce prince : car,
félon ces auteurs,tous les habitans de chaque village
étoient tenus d’aflifter à ces fêtes, 6c d’y porter chacun
une petite piece de monnoie de differente efpece
, les hommes d’une façon, les femmes d’une autre
, 6c les enfans d’une autre encore ; en forte qu’en
mettant à part chaque efpece différente de monnoie ,
6c en les comptant, celui qui préfidoit à ces faerifi-
ce s , connoifloit le nombre, l’âge 6c le fexe des habitans
d’un canton, & en faifoit fon rapport au prince.
Cette maniéré de compter prouveroit que l’ufage
de l’écriture n’étoit pas encore introduit chez les Romains.
On célébroit les paganales dans le mois de Janvier
, 6c l’argent que les habitans de la campaghe y
apportoient, étoit une efpece de tribut ou de redevance
annuelle envers l’état, à laquelle Servius les
avoit affujettis.
PAGANISME, f. m. ( Hifl. anc. ) religion & discipline
des payens, ou adoration des idoles 6c des
faux dieux. Foye^ Payen & Idolâtrie.
Les dieux du Paganifme étoient, ou des hommes,
comme Jupiter , Hercules, Bacchus, &c. ou des
êtres fiflifs 6c perfonnifiés, comme la Viéloire , la
Faim, la Fievre, &c. ou des animaux, comme en
Egypte, les crocodiles, les chats ; ou des chofes
inanimées, comme les oignons, le feu , l’ eau, &c.
V oye ^ D ieu & Economie politique.
PAGARQUE, f. m. (Hifl. anc. ) nom donné dans
l’antiquité aux magiftrats de village, ou à ceux qui
avoient quelque autorité dans le plat pays ; tels que
peuvent être les, baillis, 6c les procureurs fifcaux
des jurifdittions feigneuriales à la campagne. Il en
eft quelquefois fait mention dans les nouvelles, 6c
leur nom vient de vrttyoç, village, 6c d'apu», puijfancet
commandement.
PAGE, f: m, (Hifl. mod.) c’eft un enfant d’honneur
qu’on met auprès du prince 6c des grands fei-
gneurs , pour les iervir, avec leurs^ livrées, 6c en
même tems y recevoir une honnête éducation ,6 c y
apprendre leurs exercices.
On voit par les Mémoires de Philippes de Comi-
nes, que les pages qui fervoient les princes 6c les
P A G
feigneurs de fon tems, étoient nobles enfans, qui
par-tout fuivoient leurs maîtres pour apprendre la
vertu 6c les armes. Le chevalier d’Accily, qui ne
vivoit pas de ce tems-là, a dit au contraire :
S 'il efl beau le fils de Climtne ,
Qiioiquelle ait un homme ajfc%_ laid,
Cela n'a rien qui me fur prenne ;
Son page efl un garçon bien fait.
■ Loifeau remarque, dans fon traité des Ordres,
qu’anciennement les jeunes gentilshommes étoient
pages des feigneurs, 6c les jeunes demoifelles étoient
filles-de-chambre des dames;car, comme nous en-
feigne fort bien Ragtieau, les pages font padagogia,
five padagogiani pueri.
Ondiftinguoit alors deux fortes de pages, favoir
les pages d’honneur , 6c les communs. Les pages
d’honneur n’étoient que chez les princes 6c les fôu-
verains, 6c étoient ordinairement fils de barons ou
chevaliers, defquels la fon&ion e ft , pour ainfi dire,
décrite par Quinte-Curce, l. VIII. hoec cohors veluti
ferninariurn ducurn proefeclonim efl ; en effet, quand ils
étoient hors de pages, ils devenoient bacheliers ou
damoifeaux. Bachelier fignifie prétendant à chevalerie :
damoifeau eft le diminutif de dant, qui fignifie fei-
gneur, jufqu’à ce qu’étant devenus chefs de maifon,
ils foient qualifiés feigneurs tout-à-fait. Les pages
communs font ifl'us de fimple nobleffe, 6c fervent les
chevaliers ou feigneurs ; car un fimple gentilhomme
ne doit point avoir pages, mais feulement laquais
qui font roturiers.
Lancelot dérive le mot page du grec irxîc, qui
veut dirê un enfant. Ménage 6c Cafeneuve le tirent
de poedagogium. Cujas 6c Jacques Godefroi témoignent
que les- enfans d’honneur étoient nommés
chez les Européens padagogiani pueri. Dans la fuite
on appella pages 6c enfans de.cuijine , les petits officiers
fervant à la cuifine du roi. Le préfident Fauchet
dit, que jufqu’au regrie des rois Charle's IV. 6c Charles
VII. on nommoit pages de fimples valets-de-pié ;
6c que de fon tems les Tuilliers appelloient pages
certains valets qui portoient fur des palettes les
tuiles vertes pour les faire fécher : il ajoute, que
c’étoit feulement depuis quelque tems qu’on avoit
diftingué les pages nobles des pages vilains fervant-
à-pié, qui ont été nommés naquets ou laquais.
Il eft vrai que les pages du tems de l’ancienne
chevalerie, fe nommoient autrement varlets ou damoifeaux
, 6c qu’ils rempliffoient alors l’emploi de
domeftiques auprès de la perfonne de leurs maîtres
ou de leurs maîtreffes ; ils les accompagnoient à la
chaffe, dans leurs voyages, dans leurs vifites ou
promenades, faifoient leurs meffages, 6c même les
fervoient à table : le célébré chevalier Bayard avoit
verfé à boire 6c fait les autres fondions de page auprès
de l’évêque de Grenoble.
C’étoit ordinairement les dames qui fe char-
geoient de leur apprendre leur catéchifme 6c la galanterie
, l’amour de Dieu & des dames ; car l’un ne
pouvoit aller fans l’autre, 6c l’amant qui entendoit
à loyaument fervir une dame, étoit fauvé, fuivant la
dodrine de la dame des belles coufînes.
On prenoit grand foin de les inftruire aux exercices
des écuyers 6c chevaliers, qui étoient les grades
auxquels ils dévoient afpirer. Ils ne quittoient
point l’état de page fans paffer par une cérémonie
religieufe. Le gentilhomme mis hors de page étoit
prélenté à l’autel par fon pere 6c fa mere, qui chacun
un cierge à la main alloient à l’offrande: le prêtre
célébrant prenoit de deffus l’autel une épée 6c
une ceinture qu’il attachoit au côté du jeune gentilhomme
, après les avoir bénis. Voyeç l'Hifloite de la
chevalerie, par M. deSaint-Palaye. (D . J .) '
Pages-mousses , Garçons , ( Marine. ) ce font
P A G 745
les jeunes gens de l’équipage, apprentis matelots,
ou éleves de la navigation. Foye^ Mousses.
Page de la chambre du capitaine, c’eft le garçon
qui fert le capitaine.
PAGEENS, ( Géog. anc. ) peuple dont les guerres
avec les Géraniens ont donné lieu , félon quelques-
uns, à la fable des Pygmées. Un favant allemand,
nommé V onderart, en expliquant cette fable, dit
qu’Homere fait allufion à l’hiftoire des guerres des
Pagéens avec les Géraniens, en la représentant fous
Iefymbole des grues 6c des Pygmées, fe fondant
en cela fur la reffemblance des noms. Les Poètes,
pour donner le change à leurs leôeurs, fe fervoient
iouvent de femblables figures, 6c l’artifice de la
Poéfie confiftoit alors à tranfporter l’hiftoire des
peuples connus dans des pays éloignés : on ne doit
cependant pas faire beaucoup de fond fur cette
opinion de "Wonderart, parce qu’il n’apporte pas de
preuves pour l’établir. ( D . J .)
PAGEL , f. m. ( Hifl. nat. Icthiol.) rubellio ery-
thrinus., poiffon de mer, que l’on confond fouvent
avec le pagre ; on le nomme à Rome phragolino,
c’eft-à-dire petit pagre. Le pagel fe retire en hiver
dans la haute mer, & il refte fur le bord des côtes
pendant l’été ; on en prend rarement quand il fait
froid. Cé poiffon eft d’une couleur rouffe tirant fur
le rouge ; il a deux taches de couleur d’or 6c le ventre
blanc, les yeux font grands, l’ouverture de la
bouche eft petite, 6c les dents font rondes, pointues
6c fort petites ; il reffemble au pagre par la
forme du corps, par le nombre 6c la pofition des
nageoires ; mais il en différé en ce qu’il a le mufeau
plus pointu 6c plus étroit. Il change de couleur
avec l’âge : il devient gris. La chair du pagel efl:
nourriffante 6c d’affez bon goût ; elle fe digéré aifé-
ment 6c elle n’eft pas vifqueufe, comme quelques-
uns l’ont dit. Rondelet, Hifl. nat. des poißons, première
part. liv. F. chap. xvij. Foyer POISSON, (ƒ)
PAGESIE, f. f. (Jurifprud.) quafitenementumpaga-
norum, eft une efpece de tenure ïolidaire, en vertu
de laquelle le feigneur peut s’adreffer à celui des
co-détenteurs qu’il juge à props, 6c le contraindre
au payement de la totalité des cens & rentes. Cette
efpece de tenure fe trouve fpécifiée dans les terriers
de plufieurs feigneuries dans le V e la y , le
Forés, le BoUrbonnois, 6c l’Auvergne ; c’eft la même
chofe que ce qu’on appelle tenir en frarefehe dans les
pays d’Anjou, Touraine, 6c Maine, ou que les ma-
ïïires en Normandies. Foye[ Henrys. (A)
PAGIAVELLE, 1. m. (Comm.) certain compte
de pièces de marchandife, dont on fe fert en quelques
lieux des Indes orientales, lorfque l’on vend
en gros, ce qui eft à proportion comme ce que
nous appelions une grojfe. Foyeç Grosse. Au Pegu
les toiles fe vendent aupagiavelle de quatre pièces.
Diction, de Commerce.
PAGLION, (Géog. mod.) riviere de Savoie, dans
le comté de Nice. Elle a fa fource dans les Alpes,
6c fe jette dans la Méditerranée, à l’orient de la
ville de Nice. (D . J .)
PAGNA, f. m. ( Hifl. nat. Botan.) arbre des Indes
orientales. Il eft fort élev é, 6c produit une efpece
de coton' renfermé dans une écorce fort dure, longue
d’une palme, 6c large d’un doigt : ce coton ne
le file point, mais on s’en fert pour remplir des couffins
6c dès matelas.
PAGNE, terme de Relation, c’eft un morceau de
toile de coton dont les peuples de la côte de Guinée
s’enveloppent le corps depuis les aiffelles juf-
qu’aux genoux, & quelquefois jufqu’au milieu des
jambes, & dont les Caraïbes à leur imitation fe fervent
aujourd’hui. La pagne fait ordinairement deux
tours, & fert également aux hommes & aux femmes
; c’eft un habillement de cérémonie, car les