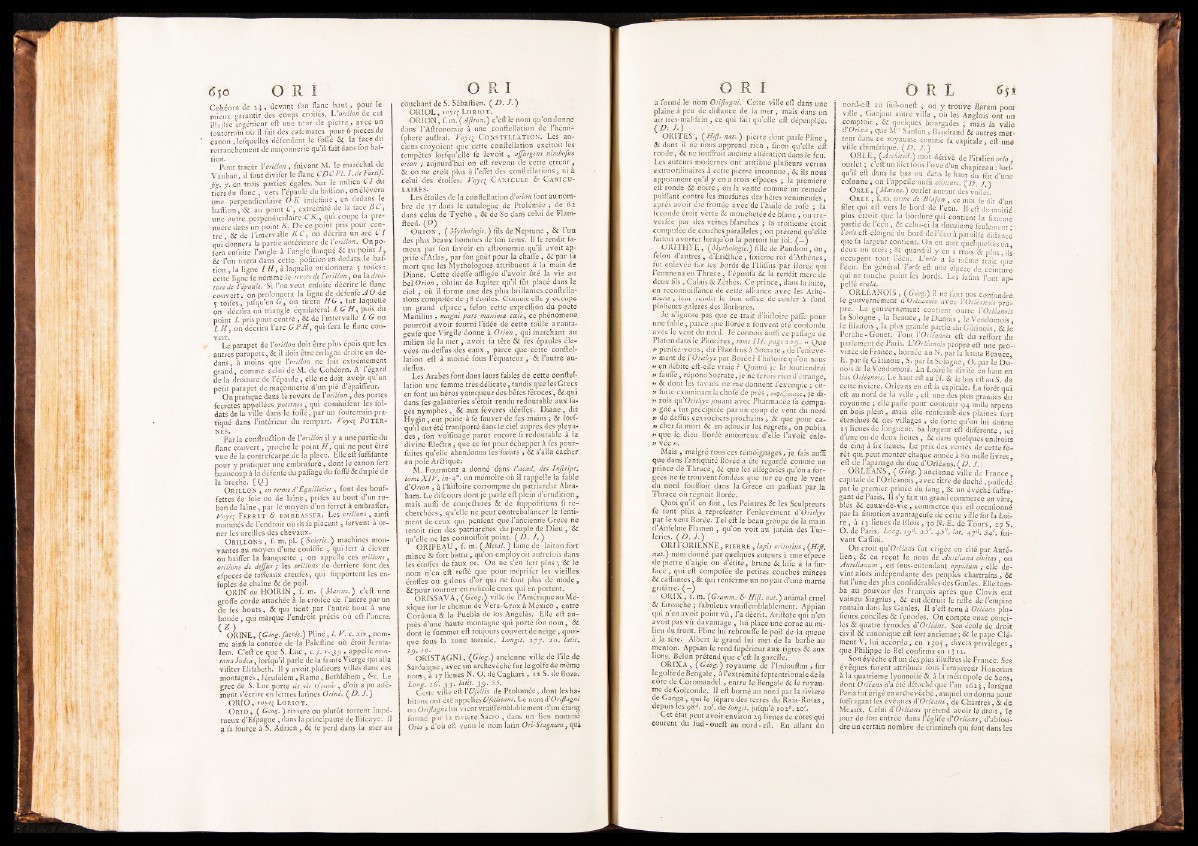
Cohéorn de 2 4 , dëvaht fon flanc haut, pour lé
mieux garantir des coups croifés. L 'orillon de cet
illuflre ingénieur eft une tour de pierre , avec un
fouterrain où il fait des cafemates pour 6 pièces de
canon, lefquelles défendent le foffé & la face du
fetranchement de maçonnerie qu’il fait dans fon balnon.
I / U 1 1
Pour tracer Yorillon , fuivant M* le maréchal de
Vauban, il faut divifer le flanc CDC PC I. de Forùf.
fig. y. en trois parties égales; Sur le milieu C I du
tiers du flanc , vers l’épaule du baflion, onelevera
une perpendiculaire O K indéfinie, en dedans le
baflion, & au point C 9 extrémité de la face B C ,
une autre perpendiculaire C K , qui coupe la première
dans un point K. De ce point pris pour centre
, & de l ’intervalle K C , on décrira un arc C I
qui donnera la partie antérieure de Morillon. On posera
ehfuite l’angle à l’angle flanqué & a u point 1 ,
& l’on tirera dans cette pofitionen dedans le baf-
tion , la ligne I H , à laquelle on donnera 5 toifes :
cette ligne fe nomme le revers de l’oriUon, ou la droiture
de L'épaule. Si l’on veut enfuite décrire le flanc
couvert, on prolongera la ligne de defenfe A O de
5 toifes, jufcju’en G , on tirera H G , fur laquelle
On décrira un triangle équilatéral L G H , puis du
point L pris pour centre , & de l’intervalle L G ou
L f f j on décrira l’arc G P H , qui fera le flanc cou-
vert. , . ,
Le parapet de Yorillon doit etre plus épais que les
autres parapets, & il doit être en ligné droite en dedans
j à moins que Yorillon ne foit extrêmement
grand, comme celui de M. de Cohéorn. A l’egard
de la droiture de l’épaule , elle ne doit avoir qu’un
petit parapet de maçonnerie d’un pié d’épaiffeur.
On pratique dans le revers de Yorillon, des portes
fecretes appellées poternes, qui conduifent les fol-
dats de la ville dans le foffé, par un fouterrain pratiqué
dans l’intérieur du rempart. Voye^ Poternes.
Par la conftru&ion de Yorillon il y a une partie dü
flanc couvert, proche le point H , qui ne peut être
vue de la contrefcarpe de la place. Elle eft fuffilante
pour y pratiquer une embrafure , dont le canon fert
beaucoup à la défenfe du paffage du foffé & du pié de
la breche. (Ç>)
Orillon , en terme d'Eguilletier , font des bouf-
fettes de foie ou de laine, prifes au bout d’un ruban
de laine, par le moyen d’un ferret à embraffer.
Voyez Ferret & embrasser. Les orillons, ainli
nommés de l’endroit où ils fe placent, fervent à orner
les oreilles des chevaux.
Orillons , f. m. pl. ( Soierie. ) machines mouvantes
au moyen d’une couliffe , qui fert à élever
ou baiffer la banquette ; on appelle ces orillons,
orillons de dejfus ; les orillons de derrière font des
efpeces de taffeaux creufés, qui fupportent les en-
fuples de chaîne & de poil.
ORIN ou HOIRIN , f. m. ( Marine. ) c’eft une
groffe corde attachée à la croilée de l’ancre par un
de fes bouts, & qui tient par l’autre bout à une
boué e, qui marque l’endroit précis où eft l’ancre.
( Z )
ORINE, (Géog.facrée.) Pline, l. V. c. x iy , nomme
ainfi la contrée de la Paleftine où étoit Jérusalem.
C’eft ce que S. Luc , c .j. v. j c ) , appelle mon-
tana Judea, lorfqu’il parle de la fainte Vierge qui alla
vifiter Elifabeth. Il y avoit plufieurs villes dans ces
montagnes , Jérufalem, R ama, Bethléhem , &c. Le
grec de S. Luc porte «Y toY o’pnwY , d’où a pu aifé-
ment s’écrire en lettres latines Oriné. (D . J.')
O R IO , voye{ Lo r io t .
O r 1 0 , ( Géog. ) riviere ou plutôt torrent impétueux
d’Efpagne , dans la principauté de Bifcaye. Il
a fa fource à S, Adrien , ôt fe perd dans la mer au
couchant de S. Sébaftien. ( D . J. )
OR IO L, voyti Loriot.
ORION, f. m. (Aflrôh.) c’eft le nom qiv’on donné
dans l ’Aftronomie à une conftellation de l’hémi*
fphere auftral. Voye( Constellation. Les anciens
croyoient que cette conftellation excitoit lés
tempêtes lorfqu’elle fe levoit , afjurgens nimbofus
orion ; aujourd’hui on eft revenu de dette erreur,
& on ne croit plus à l’effet des conftellations, ni à
celui des étoiles. Voye^ Canicule & Caniculaires.
Les étoiles de la conftellation d'orioh font au nombre
dé 37 dans le catalogue de Ptolémée de 6 i
dans celui de Tycho , & de 80 dans celui de Flam-
fteed. (O ) s
Orion , ( Mythologie.) fils de Neptune , & l’un
des plus beaux hommes de fon tems. Il fe rendit fameux
par fon favoir en aftronomie qu’il avoit ap-
prife.d’Atlas, par fon goût pour la cliaffe, & par fa
mort que les Mythologues attribuent à la main de
Diane. Cette déeffe affligée d’avoir ôté la vie au
bel Orion, obtint de Jupiter qu’il fût placé dans le
ciel , où il forme une des plus brillantés conftellations
compofée de 3 8 étoiles. Comme elle y occupé
un grand efpace , félon cette expreflion du poëté
Manilius, magni pars maxima coeli, ce phénomène
pourroit avoir fourni l’idée de cette taille avanta-
geufe que Virgile donne à Orion, qui marchant ait
milieu dé la mer , avoit fa tête & fes épaules élevées
au-deffus des eaux , parce que cétte conftellation
eft à moitié fous l’équateur , & l’autre au-
deffus.
Les Arabes font dans leurs fables de cette conftellation
une femme très-délicàte, tandis que les Grecs
en font un héros vainqueur des bêtes féroces, & qui
dans fes galanteries s’étoit rendu redoutable aux fa-
ges nymphes, & aux féveres déeffes. D iane, dit
Hygin, eut peine à fe fauver de fes mains ; & lorf-
qu’il eut été tranfporté dans le ciel auprès des pleya-
des , fon voifinage parut encore fi redoutable à la
divine Eleftra, que ce fut pour échapper à fes pour-
fuites qu’elle abandonna fes foeurs , & s’alla cachet1
au pôle Arûique.
M. Fourmont a donné dans l'acad. des Infcriptl
tome X IV . in-40. un mémoire où il rappelle la fable
à’ Orion , à l’hiftoire corrompue du patriarche Abraham.
Le difeours dont je parle eft plein d’érudition,
mais aufli de conjectures & de fuppofitions fi recherchées
, qu’elle ne peut contrebalancer le fenti-
ment de ceux qui penfent que l’ancienne Grece ne
tenoit rien des patriarches du peuple de Dieu , &
qu’elle ne les connoiffoit point. (D . J .)
ORIPEAU, f. m. ( Métal. ) lame de laiton fort
mince & fort battu , qu’on employoit autrefois dans
les étoffes de faux or. On ne s’en fert plus ; & le
nom n’en eft refté que pour méprifer les vieilles
étoffes ou galons d’or qui ne font plus de mode,
& pour tourner en ridicule ceux qui en portent.
ORISSAVA, ( Géog.) ville de l’Amcrique au Mexique
fur le chemin de Vera-Grux à México , entre
Cordoua & la Puebla de los Angelès. Elle eft auprès
d’une haute montagne qüi porte fon nom, &
dont le femmet eft toujours couvert de neige, quoi-
j que fous la zone torride. Longit. zyy. Zo. laiit,
ORISTAGNI, ( Géog.) ancienne ville de l’île de
Sardaigne, avec un archevêché fur le golfe de même
nom /à 1 7 lieues N. O. de Cagliari, 12 S. de Boza.
Long. z6 . 5 3 . latit. 3'j). 65. • '
Cette ville eft YUfellis de Ptolomée, dont lesha-
bitans ont été appellés Ufellitani. Le nom à'Oriflagni
ou Orijlàgne lui vient vraiffemblablement d’un étanj*
formé par la riviere Sacro , dans un lieu nomme
Orès , d’où eft venu le nom latin Ori-Stagnum , qui
à formé le nom Orißaghi. Ce-îte ville eft dans une
plaine à peu de diftance de la mer 9 mais dans un
air très-mal-fain , ce qui fait qu’elle eft dépeuplée.
( D . ï . )
ORITES , ( Hiß. nar. ) pierre dont parle Pline ,
Si dont il ne nous apprend rien , finon qu’elle eft
ronde & ne fouffroir aucune altération dans le feu.
Les auteurs modernes ont attribué plufieurs vertus
extraordinaires à cette pierre inconnue, & ils nous
apprennent qu’il y en a trois efpeces ; la première
eft ronde & nbire $ on la vante comme un remede
puiffant contre les morfures des bêtes venimeufes,
après avoir été frottée avec de l’huile de rofe ; la
fécondé étoit verte & mouchetée de blanc , ou tra-
verfée par des veines blanches ; la troifiemc étoit
compofée de couches paralleles ; on prétend qu’elle
faifoit avorter lorfqu’on la portoit fur foi. (—)
ORJ.THYE , (Mythologie.) fille de Pandion, ou ,
félon d’autres , d’Eri&hée , fixieme roi d’Athènes,
fut enlevée fur les' bords de l’Iliffus par Borée qui
l ’emmena en Thrace,‘ l’époufa & la rendit mere de
deux fils -, Calais & Zéthès. Ce prince, dans la fuite,
en reconnoiffance de cette alliance avec les Athéniens
, leur rendit le bon office de couler1 à fond
plufieurs galeres des Barbares.
Je n’ignore pas que ce trait d’hiftoire paffe pour
une fable, parce que Borée a fouvenr été confondu
avec le vent du nord. Je connois aufli ce paffage de
Platon dans le Phoedrus, tome I I I . page 225. « Que
» penfez-vous, dit Phoedrus à Socrate, de l’enleve-
» ment de YOrithyc par Borée? l’hiftoire qu’on nous
» en débite eft-elle vraie ? Quand je la foutiendrai
» fauffe, répond Socrate, je ne ferois rien d’étrange j
» & dont les favans ne me donnent l’exemple ; en-
» fuite examinant la chofe de près , je di-
» rois qu'Orithye jouant avec Pharmacée fa compa-
» gne, fut précipitée par un coup de vent du nord
» de deffus ces rochers prochains, & que pour ca-
» cher fa mort & en adoucir les regrets, on publia
» que le dieu Borée amoureux d’elle l’avoit enle-
>> vée ».
Mais , malgré tous ces témoignages, je fais aufli
que dans l’antiquité Borée a été regardé comme un
prince de Thrace, & que les allégories qu’on a forgées
ne fe trouvent fondées que fur ce que le vent
du nord fouffloit dans la Grece en paffant par la
Thrace oùrégnoit Borée.
Quoi qu’il en foit, les Peintres & les Sculpteurs
fe font plûs à repréfenter l’enlevement d'Orithye
par le vent Borée. Tel eft le beau groupe de la main
d’Anfelme Flamen 9 qu’on voit au jardin des Tuileries.
(D . J. )
ORITORIENNE, pierre , lapis oritorius, (Hiß.
nat.~) nom donné par quelques auteurs à une efpece
de pierre d’aigle ou d’étite, brune & lifl'e à la fur-
face , qui eft compofée de petites couches minces
& caftantes, & qui renferme un noyau d’une marne
grifâtre. (--)
OR IX , { . m. (Gramm. & Hiß. natC) animal cruel
& farouche ; fabuleux vraiffemblablement. Appian
qui n’en avoit point v û , l’a décrit. Ariftote qui n’en
a voit pas vû davantage , lui place une corne au milieu
du front. Pline lui rebrouffe le poil de la queue
à la tête. Albert le grand lui met de la barbe au
menton. Appian le rend fupérieur aux tigres & aux
lions. Belon prétend que c’eft la gazelle;
ORIXA , ( Géog. ) royaume de l’Indouftan , fur
le golfe de Bengale, à l’extrémité feptentrionale de la
•côte de Coromandel , entre le Bengale & le royaume
de-Golconde. Il eft borné au nord par la riviere
de Ganga, qui le fépare des ferres du Raia-Rotas,
depuis les 98e*. zc/. de longit. jufqu’à ro2d. 10'.
Cet état peut avoir environ 29 lieues de côtes qui
courent du fud-oueft au nord-eft. En allant du
nord-cft aii iüd-oueft , ori y trouve Garant pouf
ville j Ganjam'aiirre ville , dit les Anglois ont un
ienjptbir , & quelques bourgades ; niais la ville
d Onxà , que M" Sanlott ; Baudrand & atitres met.
tent daps-ce royaume comme fa càpitale , eft Uni
ville chimérique. (Z ) . J. )
ORGE, (Arddaa.) mot déiivë de i’itaÜeti ôïto î
ourlet ; c eft un filet tous l’ovè d’un chapiteau : lorfqu’il
eft-dans le bas ou dans le haut dit fût d’une
co!oiîiiç 5' 0ît l’appelle aufli céintüre. ( D. ƒ V
O r-l e , (Marine.)’ourlet autour des voiles.
Orx&î f. m .ternit de BUJbn , ce mot fe dit d’im
filet qui eft vers le bord de l’écu. Il eft de moitié
plus étroit que la bordure qui contient la fixiemé
partie de l’écu , & celui-ci lu douzième feulement ‘
Fro*;ëft- éloigné du bord de l’écu à pareille diftancd
qUé-fa largeur contient. On en met quelquefois un,
deux oit trois ; &-qüaiid il y en a trois & plus, ils
occupent tout' l’écu. L V lt a le même trait que
l’écu. En générai Tor/z eft une efpece de ceinturé
qui ne touche point les bords. Les latins l’ont api
pellé oYula. *
■ ORLÉANOIS , ( Gieg.) il ne faut pas Confondre
^gouvernement A’Orlianois avec VOdéànoù^rù.
pre. Le g®%vernement ..contient ; Outre ^Orléanais
la Sologne , la Beauee t le Dunoï's, le Vendojfioft.
le Blaifois , .la plus grande partie du Gâtinois, & lé
Perche.Goueti T ou tVQrUaaois eft du reffort du
parlement de Paris, l 'GrUnnais propre eft une province
de i'rance,- bornée au N. parla haute Beauee,
E. parleGâtinois, S. par laSologne, O. par le D u o
s » & io Vcndomois. La Loire le divife en haut en
bas Orlcanm. Le haut eft au Ni & le bas eft au S. dé
cette riviete, Orléans en eftia-capitafe. La forêt'qüt
eft au nord de la ville , efl une des plus grandes du
royaume ; elle paffe pour contenir 94 mille arpens
en bois plein, mais elié’ rènfernil des plaines fort
étendues & dés villages > de forte qù’ondui donne
15 lieues dt&ngueur. Sa largeur-eft différente , ici
d’une .ou: de deux lieues, St dans quelques endroits
de cinq à fix lieues. Le prix des ventes de cette forêt
qui peut monter chaque année à 80 mille livres,
eft de .l’apanage du duc d’Orléans, ( / y j t j
0 R L Ê A N S | £ a n c i e n n e ville de France,
capitale de l’Orlcanois, avec titre de duché,,poffédé
par le premier pririce du fang , 8t un évêché fuffra-
gqnt de Paris. Il s’y faitun grand commerce en vins,
blés St eaux-de-vie , commerce qui eft oeeafiomjé
par la fituatienuyantageufe de cette ville fur la Loire
, à f 3 lieues dé BÎo’îs JJp N. È. de Tours, z j S,
O. de Paris. Long. iÿ d. z P . 46": $4’. fLljvànt
Caflîni.
On croit q\i Orléans fut efigéé en cité par Auré-
lien, &C en reçut le nom de Aureliana éivitas, où
Aurclianum , eil fsus-eritendant oppidum ; elle devint
alors indépendante dés peuples chartrains, St
fut l’iuie des plus confidérables des Gaules. Élle tomba
aii pouvoir des François après que Clovis eut
vaincu Siagrius, & eut détruit le refte de l’empire
romain dans les Gaules. Il s’eft tenu à Orléans plufieurs
conciles & fynodes.' On compte onze conciles
& quatre fynodes d'Orléans., Son école de' droit
civil St canonique eft fort ancienne ; & le pape Clément
V. lui adeorda, en 1305 , divers p rivilèges,
que Philippe le Bel confirma en 13 11.
Son évêché eft un des plus illuftres de France. Ses
évêques furent attribués fous l’empereur Honorius
à la quatrième lyonnoife & à la métropole de Sens
dont Orléans n’a été détaché que l’an 1623 , lorfqué
Paris fut érigé en ardhevêché, auquel on donna pour
fuffragant les évêques 8 Orléans, de Chartres & dô
Meaux. Celui d'Orléans prétend avoir le droit, le
jour de fon entrée dans l’églife d1'Orléans, d’abfou-
dre un certain nombre de criminels qui font dans les