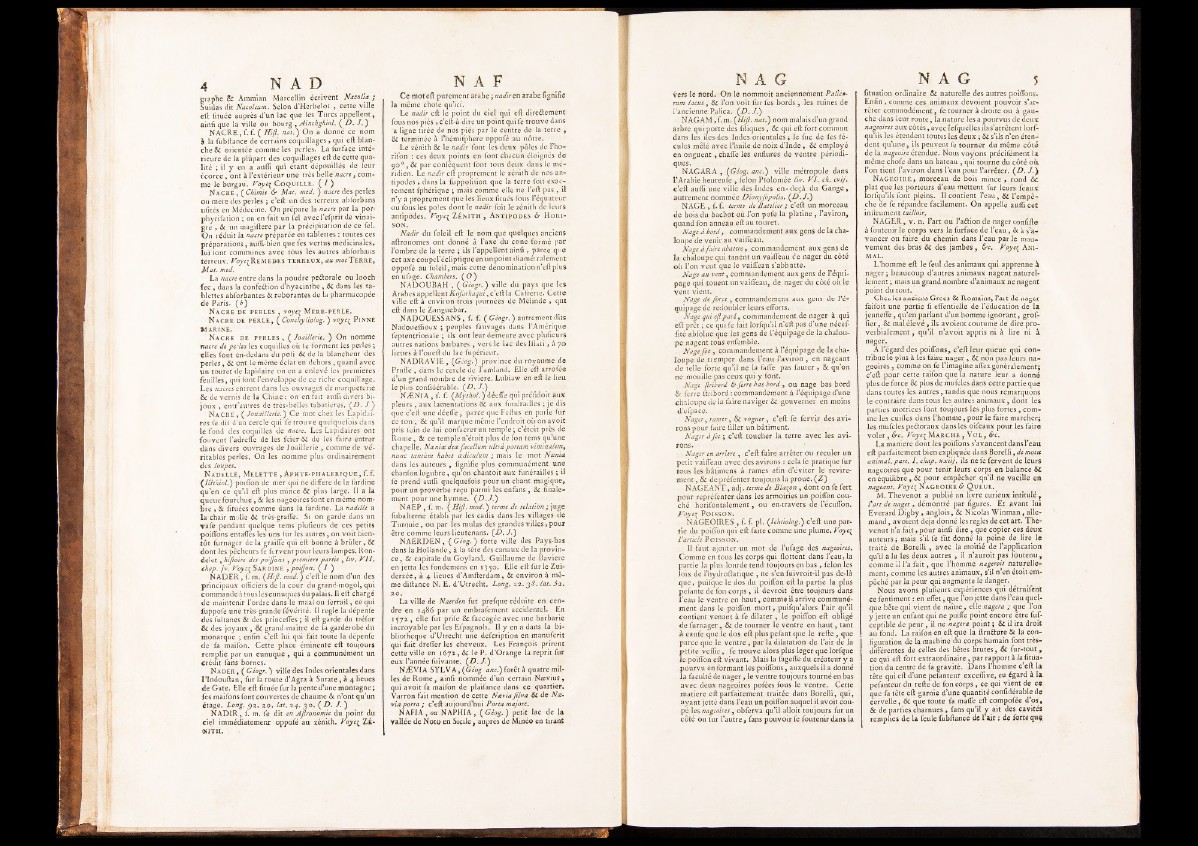
graphe & Ammian Marcellin écrivent Nacolia ;
Suidas dit Nacoleum. Selon d’Herbelot , cette ville
èft lituée auprès d’un lac que les Turcs appellent,
ainfi que la ville ou bourg , Ainchghiol. ( D . J. )
N ACRE, f. f. ( Hiß. nat.) On a donné ce nom
à la fubftance de cerrains coquillages, qui eft blanche
6c orientée comme les perles. La furface intérieure
de la plupart des coquillages eft de cette qualité
; il y en a auffi qui étant dépouillés de leur
écorce, ont à l’ extérieur une très-belle nacre , comme
le burgau. Voyt\ Coquille. ( I )
Nacre, (Chimie & Mat. mtd. ) nacre des perles
ou mere des perles ; c’eft un des terreux abforbans
ulités en Médecine. On prépare la nacre par la por-
phyrifation ; on en fait un Tel avec l’efprit de vinaigre
, & un magiftere par la précipitation de ce fel.
On réduit la nacre préparée en tablettes : toutes ces
préparations, aufti-bien quefes vertus médicinales,
lui (ont communes avec tous les autres abforbans
terreux. ^bye^REMEDES TERREUX, au mot Terre,
Mat. med.
La nacre entre dans la poudre pe&orale ou looch
f e c , dans la confection d’hyacinthe , 6c dans les tablettes
abforbantes & roborantes de la pharmacopée
de Paris. ( b)
Nacre de perles , voye^ MèRE-perLé.
N acre de perle, ( Conchyliolog. ) voye^ Pinne
J4ARINE.
Nacre de perles , ( Joaillerie. ) On nomme
fiacre de perles les coquilles oh ie forment les perles ;
elles font en-dedans du poli 6c de la blancheur des
perles, & ont le même éclat en dehors, quand avec
un touret de lapidaire on en a enlevé les premières
feuilles, qui font l’enveloppe de ce riche coquillage.
Les nacres entrent dans les ouvrages de marqueterie
& de vernis de la Chine : on en fait auflï divers bijoux
, enir’autres de très-belles tabatières. (D . J.)
Nacre, ( Jouaillerie.) Ce mot chez les Lapidaires
fe dit d'un cercle qui fe trouve quelquefois dans
le fond des coquilles de nacre. Les Lapidaires ont
fowvent l’adreffe de les fcier & de les faire entrer
dans divers ouvrages de Joaillerie , comme de v é ritables
perles. On les nomme plus ordinairement
des loupes.
Nadelle, Melette , Aphye-phalertque, f. f.
( Iclthiol.) poiffon de mer qui ne différé de la fardine
qu’en ce qu’ il eft plus mince & plus large. Il a la
queue fourchue, & les nageoires font en même nombre
, & fituées comme dans la fardine. La nadelle a
la chair molle 6c très-graffe. Si on garde dans un
vafe pendant quelque tems plufieurs de ces petits
poiflons entafles les uns fur les autres, on voit bientôt
furnager de la graiffe qui eft bonne à brûler, 6c
dont les pêcheurs fe fervent pour leurs lampes. Rondelet
, hißoire des poißons , première partie , liv. V i l .
chap. jv. Voye[ SARDINE , poiffon. ( / )
N AD ER , f. m. (Hiß. mod.) c’eft le nom d’un des
principaux officiers de la cour du grand-mogol, qui
commande à tous les eunuques dupalais.il eft chargé
de maintenir l’ordre dans le maal ou ferrail, ce qui
fuppofe une très-grande févérité. Il regle la dépenfe
dés fultanes & des princeffes ; il eft garde du tréfor
6c des joyaux, 6c grand-maître de la garderobe du
monarque ; enfin c’eft lui qui fait toute la dépenfe
de fa maifoni Cette place éminente eft toujours
remplie par un eunuque, qui a communément un
crédit fans bornes.
Na der , ( Géogr. ) ville des Indes orientales dans
l ’Indouftan, fur la route d’Agra à Surate, à 4 lieues
de Gâte. Elle eft fituée fur la pente d’une montagne;
fes maifons font couvertes de chaume & n’ont qu’un
étage. Long. g z . 20. lat. 2 4. 30. ( D . J.')
NAD IR , f. m. fe dit eh Aßronomie du point du
ciel immédiatement oppofé au zénith, Voye{ ZÉNITH.
Ce mot eft purement arabe y nadir en arabe lignifie
la même choie qu’ici.
Le nadir eft le point du ciel qui eft direôement
fous nos pies > c’eft-à-dire un point quife trouve dans
a ligne tirée de nos piés par le centre de la terre ,
6c terminée à l’hémifphere oppofé au nôtre.
Le zénith 6c le nadir font les deux pôles de l’ho-?
rifon : ces deux points en font chacun éloignés de
o o ° , & par conféquent font tous deux dans le méridien.
Le nadir eft proprement le zénith de nos antipodes
, dans la fuppofition que la terre foit exactement
fphérique ; mais comme elle ne l’eft pas , il
n’y a proprement que les lieux fitués fous l’équateur
ou fous les pôles dont le nadir foit le zénith de leurs
antipodes. Voye^ Zénith , Antipodes 6* Hori-
son.
Nadir du foleil eft le nom que quelques anciens
aftronomes ont donné à Taxe du cône formé par
l’ombre de la terre ; ils l’appellent a infi, parce que
cet axe couperécliptiqueen un point diamétralement
oppofé au foleil,mais cette dénominationn’eftplus
en ufage. Chambers. ( O )
NADOUBAH , (Géogr.') ville du pays que les
Arabes appellent Kofarhaqui, c’eft la Catrerie. Cette
ville eft à environ trois journées de Mélinde , qui
eft dans le Zanguebar.
NADOUESSANS, f. f. ( Géogr. ) autrement dits
Nadoueffioux ; peuples fauvages dans l’Amérique
feptentrionale ; ils ont leur demeure avec plufieurs
autres nations barbares , vers le lac des Iffati, à 70
lieues à l’oueft du lac fupérieur.
NADRAVIE , (Géog.) province du royaume de
Prüfte , dans le cercle de Tamland. Elle eft arrolée
d’un grand nombre de riviere. Lubiaw en eft le lieu
le plus confidérable. (D . J .)
NÆN1A , f. f. (Mythol.') déeffe «qui préfidoit aux
pleurs , aux lamentations 6c aux funérailles ; je dis
que c’eft une déefte, parce que Feftus en parle fur
ce ton| 6c qu’il marque même l’endroit oh on avoit
pris foin de lui confacrer un temple ; c’étoit près de
Rome, & ce temple rt’étoit plus de fon tems qu’une
chapelle. Neenice dece facellum ultra portam viminalem*
nunc tantum habet oediculum ; mais le mot Ncenia
dans les auteurs , lignifie plus communément une
chanfon lugubre, qu’on chantoit aux funérailles ; il
fe prend auffi quelquefois pour un chant magique,
pour un proverbe reçu parmi les enfans , 6c finalement
pour une hymne. (D . J.)
NAEP , f. m. (Hiß. mod.) terme de relation ; juge
fubalterne établi par les cadis dans les villages dé
Turquie, ou par les mulas des grandes villes, pour
être comme leurs lieutenans. (H. J .)
NAERDEN, ( Géog. ) forte ville des Pays-bas
dans la Hollande, à la rête des canaux de la provinc
e , & capitale du Goyland. Guillaume de Bavière
en jetta les fondemens en 1350. Elle eft fur le Zui-
derzée, à 4 lieues d’Amfterdam, & environ à même
diftance N. E. d’Utrecht. Long. 22 .38. lat. 62.
20.L
a ville de Naerden fut prcfque réduite en cendre
en i486 par un embrafement accidentel. En
1 5 7 1 , elle fut prife 6c faccagée avec une barbarie
incroyable par les Efpagnols. Il y en a dans la bibliothèque
d’Utrecht une defeription en manuferit
qui fait dreffer les cheveux. Les François prirent
cette ville en 1 6 7 1 ,6c le P. d’Orange la reprit fur
eux l’année fuivante. (D . J.)
NÆVIA SYLV A , (Géog anc.') forêt à quatre milles
de Rome, ainfi nommée d’un certain Naevius,
qui avoit fa maifon de plaifance dans ce quartier.
Varron fait mention de cette Nceviafilva 6c de Na-
via porta; c’eft aujourd’ hui Porta majore. .
NAFIA , ou NAPHIA , ( Géog. ) petit lac de la
vallée de Note en Sicile, auprès de Minéo en tirant
vers le nord. On le nommoit anciennement Palico-
mm lacus, 6c l’on voit fur fes bords , les ruines de
l ’ancienne Palica. (D . J.)
NAGAM, f. m. (Hiß. nat J) nom malais d’un grand
arbre qui porte des filiques, & qui eft fort commun
dans les îles des Indes orientales ; le fuc de fes fécules
mêlé avec l’huile de noix d’Inde, 6c employé
en onguent, chaffe les enflures de ventre périodiques.
N AG ARA , (Géog. anc.') ville métropole dans
l’Arabie heureufe', félon Ptolomée liv. VI. ch. evij.
c ’eft auffi une ville des Indes en-deçà du Gange,
autrement nommée Dionyfopolis. (D .J .)
NAGE , f. f. terme de Batelier ; c’eft un morceau
de bois du bachot où l’on pofe la platine , l’aviron,
quand fon anneau eft au touret.
Nage à bord, commandement aux gens de la chaloupe
de venir au vaiffeau.
Nage à faire abattre, commandement aux gens de
la chaloupe qui tanent un vaiffeau de nager du côté
oh l’on veut que le vaiffeau s’abbatte.
Nage au vent, commandement aux gens de l’équipage
qui Jouent un vaiffeau, de nager du côté où le
vent vient.
Nage de force, commandement aux gens de l’équipage
de redoubler leurs efforts.
Nage qui efiparé, commandement de nager à qui
eft prêt ; ce qui fe fait lorfqu’il n’eft pas d’une nécef-
fité abfoltfe que les gens de l’équipage de la chaloupe
nagent tous enfemble.
Nagè f e c , commandement à l’équipage de la chaloupe
de tremper dans l’eau l’aviron , en nageant
de telle forte qu’il ne la faffe pas fauter , & qu’on
ne mouille pas ceux qui y font. .
• Nage ßdbord & ferre bas bord, ou nage bas bord
& ferre ftribord : commandement à l’équipage d’une
chaloupe de la faire naviger 6c gouverner en moins
d’efpace.
Nager, ramer, 6c voguer, c’eft fe fervir des avirons
pour faire filier un bâtiment.
Nager à fec ; c’eft toucher la terre avec les avirons.
Nager en arriéré , c’ eft faire arrêter ou reculer un
petit vaiffeau avec des avirons : cela fe pratique fur
tous les bâtimens à rames afin d’éviter le revirement
, 6c de préfenter toujours la proue. (Z )
N AGEANT, adj. terme de Blason, dont on fe fert
pour repréfenter dans les armoiries un poiffon couché
horifontalement, ou en-travers de l’écuffon.
Voyeç Poisson*
NAGEOIRES , f. f. pl. (Ichtiolog.) c’eft une partie
du poiffon qui eft faite comme une plume. Voye{
l'article Poisson.
Il faut ajçuter un mot de l’ufage des nageoires.
Comme en tous les corps qui flottent dans l’eau, la
partie la plus lourde tend toujours en bas , félon les
îoix de l’hydroftatique , ne s’en fuivroit-il pas de-là
que, puifque le dos du poiffon eft la partie la plus
pefante de fon corps , il devroit être toujours dans
l’eau le ventre en haut, comme il arrive communément
dans le poiffon mort, puifqu’alors l’air qu’il
contient venant à fe dilater , le poiffon eft obligé
de furnager, & de tourner le ventre en haut, tant
à caufe que le dos eft plus pefant que le refte, que
parce que le ventre, par la dilatation de l’air de la
petite veffie, fe trouve alors plus leger que lorfque
le poiffon eft vivant. Mais la fagefle du créateur y a
pourvu en formant les poiffons, auxquels il a donné
la faculté de nager, le ventre toujours tourné en bas
avec deux nageoires pofées fous le ventre. Cette
matière eft parfaitement traitée dans Borelli, qui,
ayant .jette dans l’eau un poiffon auquel il avoit coupé,
les nageoires, obferva qu’il alloit toujours fur un
côté ou lur l’autre, fans pouvoir fe foutenir dans la
fituation ordinaire 6c naturelle des autres poiffons»
Enfin, comme ces animaux dévoient pouvoir s’arrêter
commodément, fe tourner à droite ou à gauche
dans leur route, la nature les a pourvus de deux
nageoires aux côtés, avec lefquelles ils s’arrêtent lorf-
qu’ils les étendent toutes les deux ; 6c s’ils n’en étendent
qu’une, ils peuvent fe tourner du même côté
de la nageoire étendue. Nous voyons précifément la
même chofe dans un. bateau , qui tourne du côté oh
l’on tient l’aviron dans l ’eau pour l’arrêter. (D . ƒ .)
Nageoire, morceau de bois mince , rond 6c
plat que les porteurs d’eau mettent fur leurs féaux
lorfqu’ils font pleins. Il contient l’eau, 6C l’ empêche
de fe répandre facilement. On appelle aufli cet
inftrument tailloir.
NAGER, v. n. l’art Ou l’aftion de nager confifte
à foutenir le corps vers la furface de l’eau, & à s’avancer
ou faire du chemin dans l’eau par le mouvement
des bras & des jambes, &c. Voyeç Animal.
L ’homme eft le feul des animaux qui apprenne à
nager ; beaucoup d’aiitres animaux nagent naturellement
; mais un grand nombre d’animaux ne nagent
point du tout.
Chez les anciens Grecs & Romains, l’art de nager
faifoit une partie fi effentielle de l’éducation de la
jeuneffe, qu’en parlant d’un homme ignorant, grof-
fier, 6c mal é le v é , ils avoient coutume de dire proverbialement
, qu’il n’avoit appris ni à lire ni à
nager.
A l ’égard des poiffons, c’eft leur queue qui contribue
le plus à les faire nager , 6c non pas leurs nageoires
, comme on fe l’imagine affez généralement;
c’eft pour cette raifon que la nature leur a donné
plus de force 6c plus de mufcles dans cette partie que
dans toutes les autres, tandis que nous remarquons
le contraire dans tous les autres animaux, dont les
parties motrices font toujours les plus fortes , comme
les cuiffes dans l’homme, pour le faire marcher;
les mufcles peâoraux dans les oifeaux pour les faire
v o le r , &c. Voyei Marche , V o l , &c.
La maniéré dont les poiffons s’avancent dans l’eau
eft parfaitement bien expliquée dans Borelli, de motu
animal, part. I . chap. xxiij. ils ne fe fervent de leurs
nageoires que pour tenir leurs corps en balance 6c
en équilibre, 6c pour empêcher qn’il ne vacille en
nageant. Voyt{ NAGEOIRE & Queue.
M. Thevenot a publié un livre curieux intitulé ,
tan de nager, démontré par figures. Et avant lui
Everard D igb y , anglois, 6c Nicolas W inman, allemand
, avoient déjà donné les réglés de cet art. Thevenot
h’a fait, pour ainfi dire, que copier ces deux
auteurs ; mais s’il fe fût donné la peine de lire le
traité de Borelli, avec la moitié de l’application
qu’il a lu les deux autres , il n’auroit pas loutenu ,
comme il l’a fa it , que l’homme nageroit naturellement,
comme les autres animaux, s’il n’ en étoit empêché
par la peur qui augmente le danger.
Nous avons plufieurs expériences qui détruifent
ce fentiment : en effet, que l’on jette dans l’eau quelque
bête qui vient de naître, elle nagera ; que l’on
y jette un enfant qui ne puiffe point encore etre fuf-
ceptible de peur, il ne nagera point ; & il ira droit
au fond. La raifon en eft que la ftruélure & la configuration
de la machine du corps humain font très-
différentes de celles des bêtes brutes, Sc fur-tout,
ce qui eft fort extraordinaire, par rapport à la fitùâ-
tion du centre de fa gravité. Dans l’homme c’eft la
tête qui eft d’une pelanteuf exceffive, eu égard à la
pefanteur du refte de fon corps, ce qui vient de ce
que fa tête eft garnie d’une quantité confidérable de
cervelle, 6c que toute fa maffe eft compofée d’o s ,
& de parties charnues, fans qu’il y ait dès cavités
remplies de la feule fubftance de Fair ; de forte quç