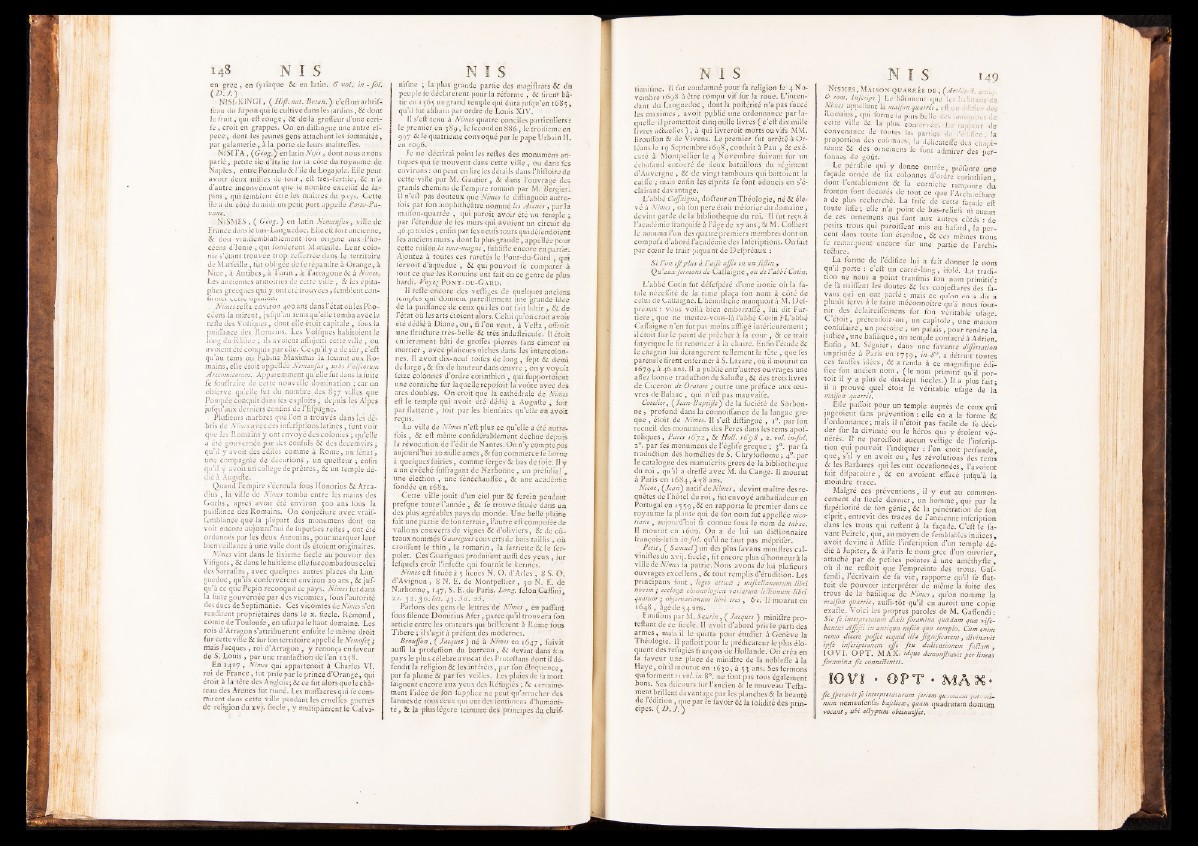
1 4 8 N I S
en g'r'ëc , en fyriaqùe 6c en latin. <f vol,, in - fol.
CD . J ' ; 1 H
NlSl-KINGI, ( Hiß. nat. Botah. )■ c’eft un arbriffe
au du Jâponquil‘ecultivedanslèsjarüins,&dont
le fruit, qui eft rouge, & de-la groffeur d’une ceri-
f e , croît en grappes. On en diftingue une autre efc
pece; dont les jeunes gens attachent les fommités,
par galanterie , à la porte de leurs maîtrefles.
•NlSITA, {Géog.yQn latin Ncfîs $ dont nous avoris
p a rlép e tite île d’Italie lur la côte du royaume de-
Naples, entre Pozzielo & l’île de Logajola. Elle peut
avoir deux milles de tour , eil très-fertile, & n’a
d’autre, inconvénient que lu nombre excciîif de. lapins
, qui ièmblenr être ie's maîues du pays. Cette
île a du côté du midi,un.petit port appelle Borto-Pa->
vont.
NlSMES -, fGcog. ) en latin Netnaufusy Vû[e de
Fra nce dans le bas- Languedoc. Elleeft fort ancienne,
& doit, vraiilemblablernent fon origine aux >Phob
céens d’Ionie , qui fondèrent Muneille. Leur colo*-
étant trouvée trop refferréedans le territoire
deMarfeille, fut obligée di; fe ré pandre à Orange-,. à,
Nice , à Antibes, à Turin ,, à T at ragone 6c à Nimes.
Les anciennes armoiries de celte ville , & les épitaphes
grecques qui y ont etci.trouv ées, lemblent confirmer
CQtte opinion.
Nîmes.relia en viron 400 ans dans l’état où les Phocéens
la mirent, jufqu’au tems qu’elle tomba avec.le
reile des Volfquqs, dont elle étoit capitale , fous la
puiflance. des Romains. Les Volfques habitoient le
long du Rhône ; ils avoient aflùjeiii cette ville , ou
avoient été conqqis par elle. Ce qu’il y a de sûr , c eil
qu’au tems où Fabius Maximus la fournit aux Romains.,
elle étoit appellée Nemaufus , urbs Koljïorum
Aruomicorutn. A pparemment quelle fut dans la fuite
fe fouiïraire de cette nouvelle'domination ; car on
obferve qu’elle fut du nombrq.des 837 villes, que
Pompée conquit dàns fes exploits, depuis les Alpes
jufqu’aux derniers confins de l’Efpàgfie.
Plufieurs marbres quél’ori'a trdüvés dans les débris
de Nîmes avec des inferiptiohs latines, font voir
que les Romains y ont envoyé des colonies ; qu’elle
a été gouvernée par.des conluls 6c des decemvirs ;
qu’il y avoit des édiles comme à Rome, un fénat,
une compagnie de décurions , un quelleur ; enfin
qu’il y avoit un college de prêtres, 6c un temple dédié
à'Augufte.
Quand l’empire s’écroula fous Hônorius & Area -
dius , la ville de Nîmes tomba entre les mains des
Goths, après avoir été environ 500 ans fous la
puiflance des Romains. On conjeêture avec vraif-
femblance que la plupart des monumens dont on
voit encore aujourd’hui de fuperbes relies , ont été
ordonnés par les deux Antonins, pour marquer leur
bienveillance à une ville dont ils étoient originaires.
Nîmes vint dans le fixieme lïecle au pouvoir des
Vifigots, &i dans le huitième elle fuccomba fous celui
des Sarrafins, avec quelques autres places du Languedoc
, qu’ils conferverent environ zo ans, 6c juf-
qu’à ce que Pépin reconquit ce pays. Nîmes fut dans
la fuite gouvernée par des vicomtes, fous l’autorité
des ducs de Sep'timanie. Ces vicomtes de Nîmes s’en
rendirent propriétaires dans le x. fiecle. Rémond,
comte de Touloufe, en ufurpa le haut domaine. Les
rois d’Arragon s’attribuèrent enfuite le même droit
fur cette ville & fur fon territoire appellé le Nemofe^ j
mais Jacques , roi d’Arragon , y renonça en faveur
de S. Louis , par une tranfaélion de l’an ia.58.
En 1 4 1 7 , Nîmes qui appartenoit à Charles VI.
roi de France, fut prife par le prince d’Orange, qui
etoit à la tête des Anglois ; & ce fut alors que le château
des Arenes fut ruiné. Les fnaffacres qui fe commirent
dans cette ville pendant les cruelles guerres
de religion du xvj. fiecle, y multiplièrent le Calvi-
N I S
nifmc ; la plus grande partie des magiftrats & du
peuple le déclarèrent pour la réforme , & firent bâtir
en 1565 un grand temple qui dura jufqu’en 1685,
qu’il fut abbaui par ordre de Louis X IV.
Il s’efl tenu à Nîmes quatre conciles particuliers':
le premier en 3 89» le fécond en 886, le troifiemeen
997 & le quatrième convoqué par le pape Urbain II.
en rô9&b zu
Je rie décrirai point les relies des monumens antiques
qui le'trouvent dans cette ville , ou dans fies
environs : on peut en lire les détails dans l’hiftoire de
cette ville par M. Gautier, & dans l'ouvragé des
grands chemins de l’empire romain par M. Bergier:
11 n’ell pas douteux que Nîmes fe diliinguôit autrefois
par fon amphithéâtre nommé les Arenes, parla
maifon-quarree , qui paroît avoir été un temple 5
par l’etendue de fes murs qui-avoient un circuit de
4640 toiles ; enfin par fes neufs tours qui défendoient
les anciens murs, dont la plus grande, appellée pour
cette raifon la tour-magne, lit b fille encore en partie.
Ajoutez à toutes ces raretés le Pont-du-Gàrd , qui
lèrvoit d’aqueduc , 6c qui pouvoit fe comparer à
tout ce que les Romains ont fait en ce genre de plus
hardi. ^ « { Po n t -du-G ard .
Il relie encore des velliges de quelques anciens
temples qui donnent pareillement une grande idée
de la puiifance de ceux qui les ont fait bâtir , 6c de
l’etat ou les arts etoient alors. Celui qu’on croit avoir
été dédié à Diane, o u , fi l’on veut, à Vella , offroiî
une llruélure très-belle & très induflrieufe. H étoit
entièrement bâti de grolfes pierres fans ciment ni
mortier , avec plufieurs niches dans les intercoloo-
nes. Il avoit dix-neuf toifes de long , fept 6c demi
de large , & fix de hauteur dans oeuvre ; Ôny voyoit
feize colonnes d’ordre corinthien , qui fupportôicrit
une corniche lùr laquellérepofoif la voûte avec des
arcs doubles. On croit que là cathédrale de Nî/nès
elt le temple qui avoit été dédié à Augulle , foit
par flatterie , foit parles bienfaits qu’elle en avoit
reçus.
La ville de Nîmes n’ell plus ce qu’elle à été autre,
fois , 6c eft même confidérablement déchue depuis
la révocation de l’édit de Nantes.On n’y compte pas
aujourd’hui zo mille amës, & fon commerce fe hoirie
à quelques'foiriés, comme ferges"&: bas defoiét II y
a un évêché fuffragant de Narbonne, un préfidia] „
une éleélion , une fénéchauflee, & une académie
fondée en i68z.
Cette ville jouit d’un ciel pur & fereiri pendant
prefque touted’année , & fe trouve fituée daris un
des plus;agréables pays du monde. Une belle plaine
fait une partie de Ion terroir, l’autre eft compofée de
vallons couverts de vignes ô^d’oiliviers, 6c de coteaux
nommés Guarigues couverts de bois taillis , où
croiflent le thin , le romarin , la farriette 6ç le fer-
polet. Ces Guarigues produifent aufli des y e u x , fur
lefquels croît l’infeéle qui fournit le kermès.
Nîmes eft fituée à 5 lieues N. O. d’Arles",'.8 $• O.
d’Avignon, 8 N. E. de Montpellier, 30 N. E. de
Narbonne, 147. S. E.de Paris. Long. felonCaflini,
2.1. 32 .30 .lat. 4,3.60.
Parlons des gens de lettres dé Nîmes , en paflant
fous filence Domitius Afer, parce qu’il trouvera fon
article entre les orateurs qui brillèrent à Roirie fous
Tibefe ; il s’agit à préfent des modernes.
Broufon, ( Jacques ) né à Nîmes en 1647, fui vît
aufli la profeflion du barreau, & devint dans1 fon
pays le plus célébré avocat des Proteftans dont il défendit
la religion 6c les intérêts, par fon éloquence ,
par fa plume & par fes veilles. Les plaies de fa riiort
laignent encore aux yeux des Réfugiés ; & certainement
l’idée de fon lupplice ne peut qu’arracher des
larmes de toits ceux qui ont des ientimens d’humanit
é , & la pins légère teinture des principes du chrif-
N I S
tianifme. Il fut condamné pour fa religion le 4 No-'
vembre 1698 à être rompu v if fur la roue. L’intendant
du Languedoc, dont la poftérité n’a pas fuccé
les maximes , avoit publié une ordonnance par laquelle
il promettoit cinq mille livres ( è ’cft dix mille
livres aéluelles ) , à qui livreroit morts ou vifs MM.
Brouflbn & de Vivens. Le premier fut arrêté à Orléans
le 19 Septembre 1698, conduit à Pau , & exécuté
à Montpellier le 4 Novembre fuivant fur un
échafaud entouré de deux bataillons du régiment
d’Auvergne , 6c de vingt tambours qui battoient la
caifle ; mais enfin les elprits fe font adoucis en s’éclairant
davantage.
L’abbé Cajfaigne, doûeur en Théologie, né & élev
é à Nîmes, où fon pere étoit trélorier du domaine,
devint garde de la bibliothèque du roi. Il fut reçu à
l’académie françoife à l’âge de zy ans, & M. Colbert
le nomma l’un des quatre premiers membres dont on
compofa d’abord l’académie des Infcriptions. On fait
par coeur le trait piquant de Defpréaux :
Si Bon ejl plus à l ’aife ajjis en un feflin ,
Qu'aux fermons de Caflaigne, ou de l'abbé Cotin.
L’abbé Cotin fut défèfpéré d’une ironie où la fatale
nécefîité de la rime plaça fon nom à côté de
celui de Caflaigne. L ’hémiiliche manquoit â M. D efpréaux
: vous voilà bien embarrafle , lui dit Fur-
tiere ; que ne mettez-vous-là l’abbé Cotin ? L’abbé
Caflaigne n’en fut pas moins affligé intérieurement ;
il étoit lùr le point de prêcher à la cour , & ce trait
fatyrique le fit renoncer à la chaire. Enfin l’étude &
le chagrin lui dérangèrent tellement la tête , que fes
parensle firent enfermer à S. Lazare, où il mourut en
1679, à 46 ans- H a publié entr’autres ouvrages une
allez bonne tradudiondeSalufte, & des trois livres
de Cicéron de Oratore ; outre une préface aux oeuvres
de Balzac , qui n’eft pas mauvaife.
Cotelier, ( Jean-Baptifie ) de la fociété de Sorbonne
, profond dans la connoiflance de la langue gre-
que , étoit de Nîmes. Il s’eft diftingué , i°. par fon
recueil des monumens des Peres dans les tems apof-
toliques, Paris /6y i , & Holl. 16^8 , 2. vol. in-fol.
z°. par fes monumens de l’églife greque ; 30. par fa
traduflion des homélies de S. Chryfoftome ; 40. par
le catalogue des manuferits grecs de la bibliothèque
du ro i, qu’il a drefle avec M. du Cange. Il mourut
à Paris en 1684, à 5 8 ans.
Nicot, (Jean) natif de Nîmes 3 devint maître des requêtes
de l’hôtel du r o i, fut envoyé ambafladeur en
Portugal en 15 5 9 , & en rapporta le premier dans ce
royaume la plante qui de fon nom fut appellée nicô-
tiane , aujourd’hui fi connue fous le nom de tabac.
Il mourut en 1600. On a de lui un diélionnaire
françôis-latin in-fol. qu’il ne faut pas méprifer.
Petit, ( Samuel) un des plus favans miniftres cal-
viniftes du xvij. fiecle, fit encore plus ^’honneur à la
ville de Nîmes fa patrie. Nous avons de lui plufieurs
ouvrages excellens, & tout remplis d’érudition. Les
principaux font , leges atticas ; mifeelianeorum libri
hovern ; eeelogee chtonologicte variarum leclionum libri
quatuor ; obfervanonum libri très , &c. 11 mourut en
1648 , âgé de 543ns.
Finiflons par M. Saurin, ( Jacques ) miniftre pro-
teftant de ce fiecle. Il avoit d’abord pris le parti des
armes, mais il le quitta pour étudier à Genève la
Théologie. Il paflbitpour le prédicateur le plus cloquent
des réfugiés François de Hollande. On créa en
fa faveur une place de miniftre de la noblefle à la
Haye, où il mourut en 1630, à 53 ans. Ses ferrinons
qui forment / / vol. in- 8°. ne font pas tous également
bons. Ses difcours lur l ’ancien & le nouveau Tefta-
ment brillent davantagepar les planches & la beauté
de l’édition , que pat le Lavoir 6c la folidité des principes.
{ D . J . ) f
N I S 149
N-ismes, Maisonquarrée de , (ArchUcH. amiq,
& rom. Injcript.) Lo' bâtimcnt que les habitans de
Nunes appellent la mai fon quarrée, eft un édifice des
Romains, qui forme la pins belle des antiquités de
eette v i l l e Si. la plus coniervoc. • Le rapport de
convenance de toutes les parties de l’édifice > la
proportion des colonnes, la délicatefle des chapiteaux
oc des orneinens le font admirer des per-
lonnes de goût.
!; Lé périftil® qui y donne emtêd, uréfenîe une
façade ornee de fix colonnes d’ordre corinthien -
dont-rfentablement & k corniche rarupante dû
fronton font décorés de tout ce que rArchiïëûure
a cte plus recherché* La frife de -àeue façade eft
toute VM ; elle n’a point de bas-reliefs ni aucun
de ces ornemens ciui font aux 'autres côtés : de
petits trous qui paroiffent mis1 au hafard, la per.
cent dans toute fon etendue, 8c ceS1 mêmes trous
fe remarquent encore fur une partie de l’archi-
teélure*
La forme de 1 édifice lui a fait donner le nom
quîil porte t c’eft un carré-long, ifolé. -La tradt-
tfoh- ne nous a point tranfmis fon nom primitif;
de là naiflent les doutes■ &> les conjeflures des fai
vanslqui en ont parlé ; mais ce qu'on en a dit a
plutôt (ervi à le faire méeonnoître qu’à nous tour-
nir_ des éclaircilTemens fur fon véritable ufàge.
C ’étôft, prétenfloir-on ; un Capitole ,-o'éne maifon
confulaire , Un prétoire a un palais, pour rendre la
juftice,une bafilique( un templeeOnfacré à Adrien.
ll-nfit] ,- M. Ségtaer, dans une lavante dijffinatioa
imprimée à Parts et: 1759, âèiiu-.l toutes
ces- tauffes idees, 6c a rendu à ce magnifique édifiée
-for. ancien nom. ( le nom primitif qu’il por-
■ toît ’il y a plus de -®x-tept fiecteS.) Il a plus fait;
il a prouvé quel -étoit le véritable ufage de la
maifon quarrée.
Elle pafloit pour un temple auprès de ceux qui
jugeoient Tans prévention : elle en a la forme &
l’ordonnance; mais il n’étoit pas facile de fe déci-
ôçr fur la divinité ou le héros qui y étoient v énérés.
Il ne paroiflbit aucun vellige de l’infcrip-
tion qui pouvoit l’indiquer : l’on étoit perfuadé,
que, s’il y en avoit e u , les révolutions des tems
& les Barbares qui les ont occafionnées, l’avoient
fait difparoître , 6c en avoient effacé jufqu’à la
moindre trace.
Malgré ces préventions, il y eut au commencement
du fiecle dernier, un homme, qui par la
fuperiorité de fon génie, 6c la pénétration de fon
efprit, entrevit des traces de l’anciennè infeription
dans les trous qui relient à la façade. C ’eft le fa-
vant Peirelc, qui, au moyen de femblables indices,
-avoit deviné à Afîtfe Binfcription d’un temple dédié
à Jupiter, & à Paris le nom grec d’un ouvrier,
attache par de petites pointes à une améthyfte,
où il ne reftoit que l’empreinte des trous. Gaf-
fendi, l’écrivain de fa v ie , rapporte qu’il fe flat-
toit de pouvoir interpréter de même la fuite des
trous de la bafiùque de Nîmes, qu’on nomme la
maifon quarrée, auflî-tôt qu’il en auroit une copie
ex a 61 e. Voici les propres paroles de M. Gaflendi :
Sic fe interpretatum dtxit foramina quCedam q-uce vife-
bantur Afjif.i in antiquo nefeio quo templo. Cùm enirn
nemo dicere poffet tcqttid ilia, fignificarent, divinavit
ipfe inferiptionem ejfe Jeu dedicationem faclam,
IO V I . O P T . M A X . idque demonflravit per lineas
foramina f c conneclentes.
IOVÎ • OPT • MAX-
-fc fperiwit fe interpretaturum feriem quamaum fôrumi-
num némaufenfis bafdicoe, quam quadratam dommxi
vacant, ubi -eclypum obùnuijfet.