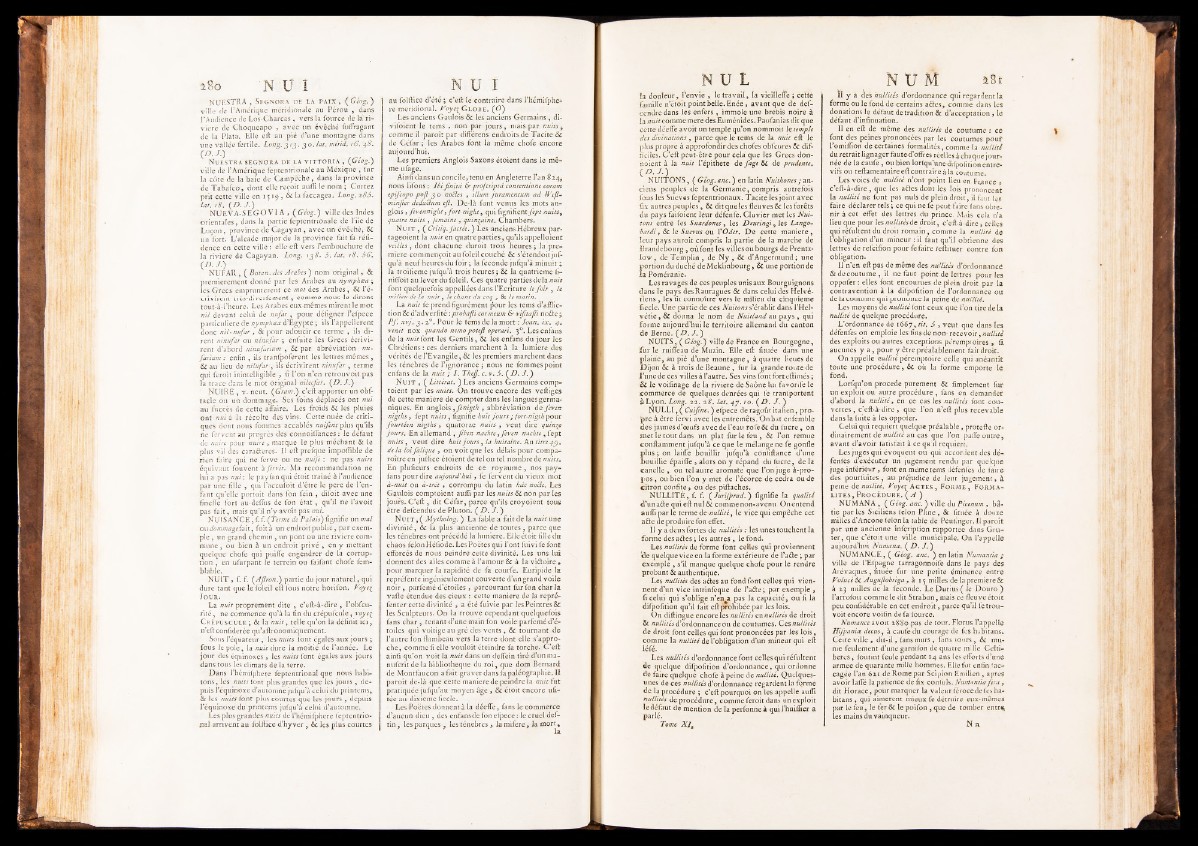
180 N U i
NUESTRA , Segnora de la p a i x , ( ô é o g . )
ville de l’Amérique méridionale au Pérou , dans
l’Audience de Los-Charcas , vers la fource de laNrivière
de Choqueapo , avec un évêché fuffragant
de la Plata. Elle eft au pié d’une montagne dans
une vallée fertile. L o n g . 3 / 3 .3 o. la t . m é r id , i G . '48.
( D . J . )
Nu estra segnora DE la v it to r ia , ( G é o g . )
ville de l’Amérique feptentrionale au Méxique , fur
la côte de la baie de Campêche, dans la province
de Tabafco, dont elle reçoit aufli le nom; Cortez
prit cette ville en 1519, & la iaccagea. L o n g . %8 5 i
l a t . 1 8 . ( D . J . )
N U E V A -SEG O V IA , (Géog.) ville des Indes
orientales, dans la partie feptentrionale de l'île de
Luçon, province de Cagayan , avec un évêché, &
un fort. L’alcade major de la province fait fa réfi-
dence en cette ville : elle eft vers l’embouchure de
la riviere de Cagayan. Long. 138. 5 . lat. 18. SG.
( D . J . )
NUFAR, ( B o ta n . des A r a b e s ) nom Original, &
premièrement donné par les Arabes au n ym p h c ta ;
les Grecs empruntèrent ce m o t des Arabes, & l’écrivirent
très-diverfement, comme nous le dirons
tout-à-Pheure. Les Arabes eux-mêmes mirent le mot
n i l devant celui de n u fa r , pour défigner l’efpece
particulière de nymphæa d’Egypte ; ils l’appellerent
donc n i l - n u fa r , & pour adoucir ce terme , ils dirent
n in u fa r ou n é n u fa r ; enfuite les Grecs écrivirent
d’abord n in u fa t iu m , Sc par abréviation n u -
f a r i u m : enfin , ils tranfpoferent les lettres mêmes ,
& au lieu de n i lu f a r , ils écrivirent n in u fa r , terme
qui feroit inintelligible , ft l ’on n’en retrouvoit pas
la trace dans le mot original n ile c fa r . ( D . J . )
NUIRE , v. neut. (Gram.) c’eft apporter un obf-
tacle ou un dommage. Ses foins déplacés ont n u i
au fuccès de cette affaire. Les froids & les pluies
ont n u i à la récolte des vins. Cette nuée de critiques
dont nous fommes accablés n u ife n t plus qu’ils
ne fervent au progrès des connoiffances : le défaut
de nuire pour n u ir e , marque le plus méchant & le
plus vil des caraûeres. Il eft prefque impoflïble de
rien faire qui ne ferve ou ne n u ife : ne pas n u ir e
équivaut fouvent k / è r v i r . Ma recommandation ne
lui a pas n u i : le payfan qui étoit traîné à l’audience
par une fille , qui l’acculbit d’être le pere de l ’enfant
qu’elle portoit dans fon fein , difoit avec une
fineffe fort au-deffus de fon é ta t , qu’il ne l’a voit
pas fa it, mais qu’il n’y avolt pas n u i.
NUISANCE, f. f. ( T e rm e de Palais) fignifîe un m a l
owdommageîàit, foità un endroit public, par exemple
, un grand chemin , un pont ou une riviere commune
, ou bien à un endroit privé , en y mettant
quelque chofe qui puiffe engendrer de la corruption
, en ufurpant le terrein ou faifant chofe fem-
blable.
N U IT , f . f. ( A j l r o n . ) partie du jour naturel, qui
dure tant que le foleil eft fous notre horifon. V o y e ç
Jo u r .
La n u i t proprement dite , c’eft-à-dire , l’obfcu-
rité, ne commence qu’à la fin du crépufcule, v o y e ^
C répuscule ; & la n u i t , telle qu’on la définit ic i,
n’eft confiderée qu’aftronomiquement.
Sous l’équateur, les n u its font égales aux jours ;
fous le pôle, la n u i t dure la moitié de l’année. Le
jour des équinoxes , les n u i t s font égales aux jours
dans tous les climats de la terre.
Dans l’hémifphere feptentrional que nous habitons,
les n u its lont plus grandes que les jpurs , depuis
l’équinoxe d’automne jufqu’à celui du printems,
& les n u i t s font plus courtes que les jours , depuis
l’équinoxe du pnntems jufqu’à celui d’automne.
Les plus grandes n u its de l’hémifphere feptentrio-
jial arrivent au foiftice d’hy ver , 5c les plus courtes
N U I
au fo i f t ic e d ’é té ; c ’e f t le c o n t r a i r e dan s l ’h ém ifp h e r
e m é r id io n a l. Voye^ G l o b e . ( O )
Les anciens Gaulois 5c les anciens Germains, di-
vifoient le tems , non par jours, mais par nuits ;
comme il paroît par différens endroits de Tacite 5c
de Céfar ; les Arabes font la même chofe encore
aujourd’hui.
Les premiers Anglois Saxons étoient dans le même
ufage.
Ainlrdansun concile, tenu en Angleterre l’an 824,
nous lifons : Ibi finitâ 6* projcriptâ contentione coram
epifcopo pojl 3 o nobles , ilium juramentum ad ff'efl-
minjler deduclum ejl. De-là font venus les mots anglois
, fevennight, fort night, qui fignifient fept nuitsÿ
quatre nuits , Jemaine , quinzaine. Chambers.
N u i t , ( Critiq, f ocrée. ) Les anciens Hébreux par-
tageoient la nuit en quatre parties, qu’ilsappelloient
veilles, dont chacune duroit trois heures ; la première
commençoit au foleil couché 5c s’étendoit jufqu’à
neuf heures du foir ; la fécondé jnfqu’à minuit ;
la troifieme jufqu’à trois heures ; ôc la quatrième fi-
nifloit au lever du foleil. Ces quatre parties de la nuit
font quelquefois appellées dans l’Ecriture le foir , le
milieu de la nuit, le chant du coq , & le matin.
La nuit fe prend figurément pour les tems d’affliction
& d’adverfité : probajli cormeum & vifîtafi tioùe ;
Pf. xvj. 3. 20. Pour le tems de la mort : Joan. ix. 4^
venu nox quando nemo potejl operari. 30. Les enfans
de la nuit font les Gentils, & les enfans du jour les
Chrétiens : ces derniers marchent à la lumière des
vérités de l’Evangile, 5c les premiers marchent dans
les ténèbres de l’ignorance ; nous ne fommes point
enfans de la nuit ; I . Thefj. c. v. S . ( D . J . )
N u i t , ( Littérat. ) Les anciens Germains comp-
toient par les nuits. On trouve encore des veftiges
de cette maniéré de compter dans les langues germaniques.
En anglois, fenigth , abbréviation de feven
nigths, fept nuits, lignifie huit jours ; fort-nigtk pour
fourtéen nigths, quatorze nuits , veut dire quinze
jours. En allemand , fiben nachte , feven riachte , fept
nuits, veut dire huit jours, la huitaine. Au titre 4c).
de la loi falique , o a voit que les délais pour compa-
roître en jultice étoient de tel ou tel nombre de nuits.
En plufieurs endroits de ce royaume, nos pay-
fans pour dire aujourd'hui, fe fervent du vieux mot
à-nuit ou à-trêt, corrompu du latin kde nocle. Les
Gaulois comptoient aufli par les nuits 5c non par les
jours.-C’eft , dit Céfar, parce qu’ils croyoient tous
être defeendus de Pluton. ( D . J. )
N u i t , ( Mytholog. ) La fable a fait de la nuit une
divinité, 5c la plus ancienne de toutes , parce que
les ténèbres ont précédé la lumière. Elle étoit fille du
chaos félon Héfxode. Les Poètes qui l’ont fuivi fe font
efforcés de nous peindre cette divinité. Les uns lui
donnent des ailes comme à l’amour & à la viftoire ,
pour marquer la rapidité de fa courfe. Euripide la
repréfente ingénieulèment couverte d’un grand voile
noir , parfemé d’étoiles , parcourant fur fon char la
vafte étendue des cieux : cette maniéré de la repré-
fenter cette divinité , a été fuivie par les Peintres 5c
les Sculpteurs. On la trouve cependant quelquefois
fans char , tenant d’une main fon voile parfemé d’étoiles
qui voltige au gré des vents, 5c tournant de
l’autre fon flambeau vers la terre dont elle s’approche,
comme fi elle vouloit éteindre fa torche. C ’eft
ainfi qu’on voit la nuit dans un deffein tiré d’un manu
ferit de la bibliothèque du roi, que dom Bernard
de Montfaucon a fait graver dans fa paléographie. Il
paroît de-là que cette maniéré de peindre la nuit fut
pratiquée jufqu’au moyen âge , 5c étoit encore ufi-
tée au dixième fiecle.
Les Poètes donnent à la déeffe, fans le commerce
d’aucun dieu , des enfans de fon efpece : le cruel def-
tin, les parques , les ténèbres, la mifere , la mort,
la
NUL
la douleur, l’envie , le travail, la vieillefîe ; céttè
famille n’étoit point belle. Enée, avant que de def-
cendre dans les enfers , immole une brebis noire à
la nuit comme mere des Euménides. Paufanias dit que
cette déeffe avoit un temple qu’on nommoit le temple
des divinations , parce que le tems de la nuit eft le
plus propre à approfondir des chofes obfcures 5c difficiles.
C ’eft peut-être pour cela que les Grecs don-
noient à la nuit l’épithete de fage ÔC de prudente.
{ D . J . )
NUITONS, ( Geog. anc. ) en latin Nuithones ; anciens
peuples de la Germanie, compris autrefois
fous les Sueves feptentrionaux. Tacite les joint avec
fix autres peuples , ôc dit que les fleuves 5c les forêts
du pays faifoient leur défenfe. Cluvier met les Militons
entre les Suardones, les Deuringi, les Lango-
'bardi, ÔC le Suevus ou l'Oder. D e cette maniéré,
leur pays aüroit compris la partie de la marche de
Brandebourg, où font les villes ou bourgs de Prentz-
low , de Templin , de Ny , 5c d’Angermund; une
portion du duché de Meklinbourg, & une portion de
la Poméranie.
Les ravages de ces peuples unis aux Bourguignons
dans le pays desRauragues & dans celui des Helvé-
tiens , les fit connoître vers le milieu du cinquième
ïiecle. Une partie de ces Nuitons s’établit dans l’Hel-
v é t ie , & donna le nom de Nuitland au pays , qui
forme aujourd’hui le territoire allemand du canton
de Berne.1 (D . J. )
NUITS, ( Géog.) ville de France en Bourgogne,
jfur le ruiffeau de Muzin. Elle eft fituée dans une
plaine, au pié d’une montagne, à quatre lieues de
Dijon 5c à trois de Beaune , fur la grande route de
l ’une de ces villes à l’autre. Ses vins font fort eftimés ;
■ & le voifinage de la riviere de Saône lui favorife le
commerce de quelques denrées qui le tranlportent
à Lyon. Long. 22. 28. lat. 4 'y. 10. (D . J. )
NULLI, ( Cuifine. ) efpece de ragoût italien, propre
à être fervi avec les entremets. On bat enfemble
des jaunes d’oeufs avec de l’eau rofe & du luc re, on
jnet le tout dans un plat fur le feu , & l’on remue
conftamment jufqu’à ce que le mélange ne fe gonfle
plus ; on laiffe bouillir jufqu’à confiftance d’une
bouillie épaiffe, alors on y répand du lucre, de la
canelle , ou tel autre aromate que l’on juge à-pro-
p o s , ou bien l’on y met de l’écorce de cedra ou de
citron confite * ou des piftaches.
NULLITÉ, f. f. ( Jurifprud. ) lignifie la qualité
d’unaéte qui eft nu l& comme non-avenu. On entend
aufii par le terme de ^nullité, le vice qui empêche cet
a&e de produire fon effet.
Il y a deux fortes de nullités : les unes touchent la
- forme des aâes ; les autres , le fond.
Les nullités de forme font celles qui proviennent
'de quelque vice en la forme extérieure de l’aûe ; par
exemple , s’il manque quelque chofe pour le rendre
probant & authentique.
Les nullités des aâes au fond font celles qui viennent
d’un vice intrinfeque de l’afte ; par exemple ,
fi celui qui s’oblige n’en^a pas la capacité, ou fi la
difpofition qu’il fait eft prohibée par les lois.
On diftingue encore les nullités en nullités de droit
& nullités d’ordonnance ou de coutumes. Ces nullités
de droit font celles qui font prononcées par les lois,
comme la nullité de l’obligation d’un mineur qui eft
léfé.
Les nullités d’ordonnance font celles qui réfultent
de quelque difpofition d’ordonnance, qui ordonne
de faire quelque chofe à peine de nullité. Quelques-
unes de ces nullités d’ordonnance regardent la forme
de la procédure ; c’eft pourquoi on les appelle aufli
nullités de procédure, comme feroit dans un exploit
le défaut de mention de la perfonneà qui Thuillier a
parlé.
Tome X j t
N U M a.St il ÿ à dés nullités d’ordonnance qui regardent là
forme ou le fond de certains aétes, comme dans les
donations le défaut de tradition & d’acceptation, le
défaut d’infinuation.
Il en eft de meme des nullités de Coutume : ce
font des peinés prononcées par les coutumes pouf
l’omillion de certaines formalités, comme la nullité
du retrait lignager fauted’offres réelles à chaque journée
de la caufe, ou bien lorlqu’une difpofition entre-
vifs ou teftamentaire eft contraire à la coutume.
Les voies de nullité n’ont point lieu en France >
c’eft-à-dire , que les aétes dont les lois prononcent
la nullité ne lont pas nuis de plein droit, il faut les
faire déclarer tels ; ce qui ne fe peut faire fans obtenir
à cet effet des lettres du prince. Mais cela n’a
lieu que pour \esnullitésàe droit, c’eft-à-dire; celles
qui réfultent du droit romain, comme la nullité de
l’obligation d’un mineur : il faut qu’il obtienne des
.lettres de refeifion pour fe faire feftituer contre fon
obligation.
Il n’en eft pas de même des nullités d*ordônnancé
& de coutume , il ne faut point de lettres pour les
oppofer : elles font encourues de plein droit par la
contravention à la difpofition de l’ordonnance ou
de la coutume qui prononce la peine de nullité.
Les moyens de nullité lont ceux que Ton tire de la
nullité de quelque procédure.
L’ordonnance de 1667, tit. S , veut que dans les
défenfes on emploie les fins de non- recevoir, nullité
des exploits ou autres exceptions péremptoires , fi.
aucunes y a , pour y être préalablement fait droit.
On appelle nullité péremptoire ce{ie qui anéantit
toute une procédure > & où la forme emporte le
fond.
Lorfqu’on procédé purement & Amplement fur
un exploit ou autre procédure , fans en demander
d’abord la nullité, en ce cas les nullités font couvertes
, c’eft-à-dire » que Ton n’eft plus recevable
dans la fuite à les oppofer.
Celui qui requiert quelque préalable, protefte ordinairement
de nullité au cas que Ton paffe outre ;
avant d’avoir latisiait à ce qu'il requiert.
Les juges qui évoquent ou qui accordent des défenfes
d’exécuter un jugement rendu par quelque
juge inférieur , font en meme tems défenfes de faire
des pourluites, au préjudice de leur jugement, à
peine d e nullité. Voye^ho. t e s , F o r m e , F o r m a l
i t é s , P r o c é d u r e . ( A )
NU MAN A , ( Géog. anc. ) ville du Picenum , bâtie
par les Siciliens lelon Pline, & fituée à douze
milles d’Ancone lèlonla table de Peutinger. Ii paroît
par une ancienne înfeription rapportée dans Gru-
ter, que c’étoit une ville municipale. On l’appelle
aujourd’hui Numana. ( D . J. )
NUMANCE, ( Géog. anc. ) en latin Numantia ;
ville de TElpagne tarragonnoife dans le pays des
Arévaqües, fituée fur une petite éminence entre
Volucé 6c Augufiobriga, à 15 milles de la première &
à 23 milles de la fécondé. Le Durius ( le Douro )
l’arrofoit comme le dit Strabon, mais ce fleuve étoit
peu confidérable en cet endroit, parce qu’il fe trou-
voit encore voifin de fa fource.
Numance a voit 18 8ô pas de tour. Florus l’appellô
Hifpania decus, à caule du courage de feS habitans*
Cette ville , dit-il, fans murs , fans lours, & munie
feulement d’une garnifon de quatre mille Celti-
beres, foutint feule pendant 14 ans les efforts d’une
armee de quarante mille hommes. Elle fut enfin iac-
cagée Tan 621 de Rome par Scipion Emilien , apres
avoir laffé la patience de fix confuls. Nurrtantia fera,
dit Horace, pour marquer la valeur féroce de fes ha-
bitans , qui aimèrent mieux fe détruire eux-mêmes
par le feu, le fer & le poifon, que de tomber entru
les mains du vainqueur.