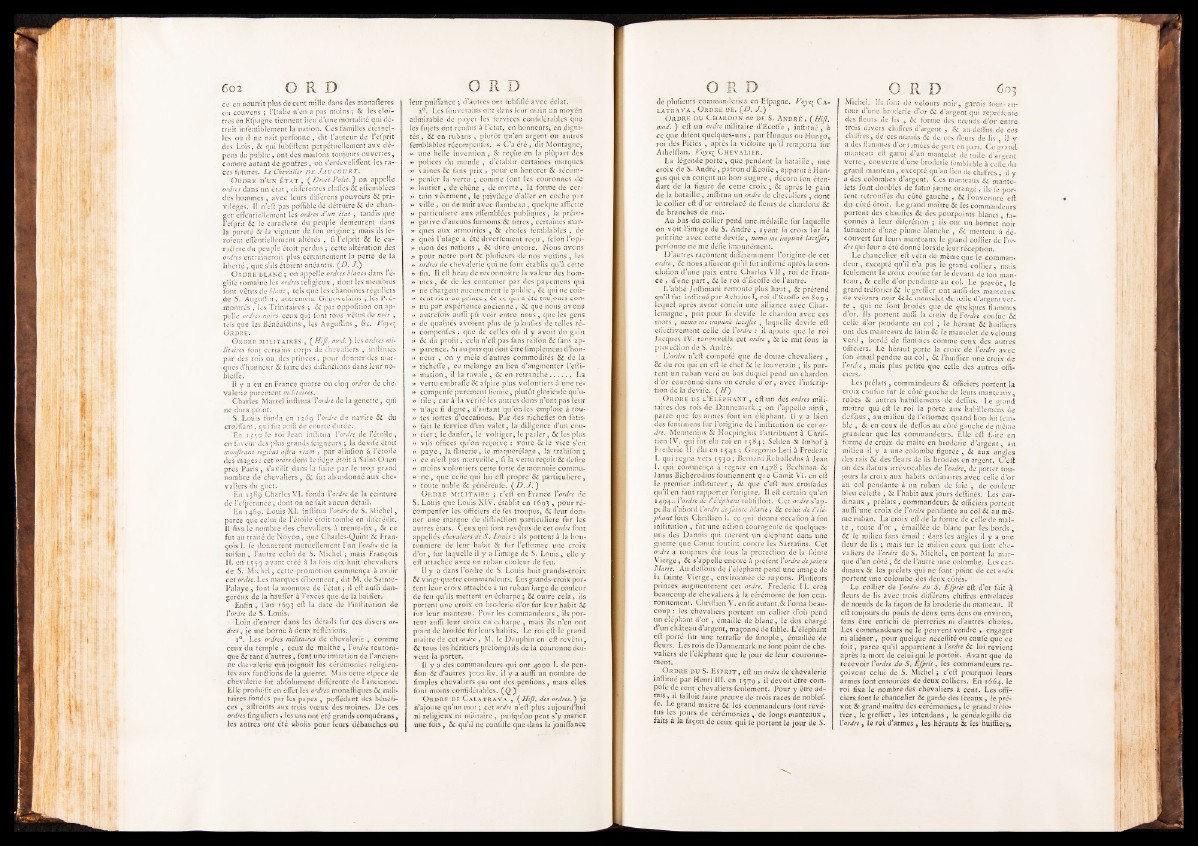
602
I
£
il
O R D O R D
ce erf ncittH’it plus de cent mille dans des monafteres
ou couve.ns ; l'Italie n’en a pas moins ; & les cloîtres
en Efpagne tiennent lieu d’une mortalité qui détruit
infenfiblèment la nation. Ces familles éternelles
où il ne naît perfonne , dit l’auteur de l’efprit
des Lois, & qui fubfiftent perpétuellement aux dépens
du public, ont des maifons toujours ouvertes,
comme autant de gouffes, oîi s’enfeveliffent les races
futures. Le Chevalier d e J au COURT.
O rdre d’un é t a t , (D ro ie P o l i t ,) on appelle
ordres dans un état, différentes claffes 6c aflemblees
des hommes , avec leurs diftérens pouvoirs & privilèges.
Il n’eft pas pofliblede détruire & de changer
effe'At'iélle'ment les ordres d 'u n état , tandis que
l’efprit 6c le caraélere du peuple demeurent dans
la pureté & la vigueur de fon origine ; mais ils fe-
roient eflèntiellement altérés , fi l’efprit 6c le ca-
raélere du peuple étoit perdus ; cette altération des
ordres enfraîneroit plus certainement la perte de la
liberté, que s’ils étoient anéantis. (.D . J . )
O rdre blanc ; on appelle ordres blancs dans l’é-
glife romaine les ordres religieux , dont les membres
font vêtus de blanc, tels que les chanoines réguliers
de S. Auguftin, autrement Génovefains , les Prémontrés
, les Trinitaires ; 6c par oppofition on appelle
ordres noirs ceux qui font tous vêtus de noir ,
tels que les Bénédictins , les Auguftins , &c. Foye%_
Ordre.
Ordre MILITAIRES , (H f i. mod.) les ordres militaires
font certains corps de chevaliers , inftirués
par des rois ou des princes, pour donner des marques
d’horinëiir & faire des diftinétions dans leur no-
bleffe. .
Il y a eu en France quatre ou cinq ordres de chevalerie
purement militaires.
Charles Martel inflitua Vordre de la genette, qui
ne dura point.
S. Louis fonda en 1269 l’ordre du navire 6c du
croiffant, qui fut aufli dé courte durée.
En 13 50 le roi Jean inflitua Y ordre de l’étoile,
en faveur des plus grands feignëurs ; la devife étoit
monfirant regibus ajlra viam , par allufion à l’étoile
des mages : cet ordre dont le fiége étoit à Saint-Ouen
près Paris , s’avilit dans la fuite par le trop grand
nombre de chevaliers , & fut abandonné aux chevaliers
du guet.
En 1389 Charles V I. fonda Y ordre de la ceinture
de l’efpérance, dont on ne fait aucun détail.
En 1469. Louis XI. inflitua Y ordre de S . Michel,
parce que celui de l’étoile étoit tombé en diferédit.
Il fixa le nombre des chevaliers à trente-fix , & ce
fut au traité de Noyon, que Charles-Quint & François
I. fe donnèrent mutuellement l’un Y ordre de la
toifon, l’autre celui de S . Michel ; mais François
II. en 1559 ayant créé à la fois dix-huit chevaliers
dè S. Michel j cette promotion commença à avilir
cet oldre. Les marques d’honneur, dit M. de Sainte-
Palaye 9 font la monnoie de l’état ; il efl aufli dangereux
de la hauffer à l’excès que de la baiffer.
Enfin , l’an 1693 efl la date de i’inflitution de
Y Ordre de S. Louis»;
• Loin d’entrer dans les détails fur ces divers ordres
, je me borne à deux réflexions.
i° . Les ordres militaires de chevalerie , comme
ceux du temple , ceux de malthe , Yordre teutoni-
que &'tant d’âütres, font lifte imitation de l’ancienne
chevalerie qui joignbit les cérémonies religieü-
fés aux fondions de la guerre. Mais-Cette efpece de
chevalerie fut abfolument différente dê l’ancienne-.'
Elle produîfit en effet les ordres monafliques & militaires
fondés par lès papes , poffédant des bénéfices
, aftreints aux trois voeux des moines. De ces
ordres fingulrers, les uns Ont été grands conquérans,
les antres ont été abolis pour leurs débauches ou
leur puiffance ; d’autres ont fubfifté avec éclat.
20. Les fouverains ont dans leur main un moyen,
admirable de payer les fervices confidérables que
les fujets ont rendus à l’état, en honneurs, en dignités
, 6c en rubans , plutôt qu’en argent ou autres
femblâbles récompenfes. « C’a é té , dit Montagne,
» une belle invention, & reçue en la plupart des
» polices du monde , d’établir certaines marques
» vaines 6c fans prix , pour en honorer & récom-
>f penfer la vertu ; comme font les couronnes de
» laurier , de’ chêne , de myrte, la forme de cer-
» tain vêtement, le privilège d’aller en coche par
» v ille , ou de nuit avec flambeau, quelque afliette
» particulière aux aflemblees publiques, la préro-
» gative d’aucuns furnoms &: titres, certaines mar-
» ques aux armoiries , & chofes femblâbles , de
» quoi l’ufage a été diverfement reçu , félon l’opi-
» nion des nations , & dure encore. Nous avons
» pour notre part 6c plufieurs de nos voifins, les
» ordres de chevalerie qui ne font établis qu’à cette
» fin. Il efl beau de reconnoître la valeur des hom-
» mes, 6c de les contenter par des payemens qui
» ne chargent aucunement le public, & qui ne coû-
» tent rien au prince , 6c ce qui a été toujours con-
» nu par expérience ancienne, & que nous avons
» autrefois aufli pû Voir entre nous, qpe les gens
» de qualités avoient plus de jaloufies de telles ré-
» compenfes, que de celles où il y avoit du gain
» & du profit, cela n’eft pas fans raifon & fans ap-
» parence. Si au prix qui doit être Amplement d’hon-
» neur , on y mêle d’autres commodités & de la
» richeffe , ce mélange au lieu d’augmenter l’efti-
» mation , il la ravale, & en retranche........... La
» vertu embraffe 6c afpire plus volontiers à une ré-
» compenfe purement fienne, plutôt glorieufe qu’u-
» tile ; car à la vérité les autres dons n’ont pas leur
» nfagefi digne, d’autant qu’on les emploie à tou-
» tes fortes d’occaftons. Par des richeffes on fatis-
» fait le fervice d’un v a le t , la diligence d’un cou-
» rier ; le danfer, le Voltiger, le parler, & les plus
>> vils offices qu’on reçoive : voire & le vice s’en
» paye , la flarerie, le maquerélage , la trahifon ;
>> ce n’efl pas merveille, fi la vertu reçoit 6c defire
» moins volontiers cette forte de monnoie commu-
» ne-, que celie qui lui efl propre 6c particulière,
» toute noble & généreufe. (D . J. )
Ordre m il it a ir e ; c’eft en France Yordre de
S. Louis que-Louis XIV. établit en 1693 , pour ré-
compenfer les officiers de fes troupes, & leur donner
une marque de diftinélion particulière fur les
autres états. Ceux qui font revêtus de cet ordre font
appellés chevaliers de S. Louis : ils portent à la boutonnière
de leur habit & fur l’eftomac une croix
d’o r , fur laquelle il y a l’image de S. Louis, elle y
efl attachée avec un ruban couleur de feu.
Il y a clans l’ordre de S. Louis huit grands-croix
6c vingt-quatre commandeurs. Les grands-croix portent
leur croix attachée à un ruban large de couleur
de feu qu’ils mettent en écharpe ; 6c outre cela, ils
portent une croix en broderie d’or fur leur habit 6c
îur leur manteau. Pour les commandeurs, ils portent
aufli leur croix en écharpe , mais ils n’en ont
point de brodée fur leurs habits. Le roi efl le grand
maître de cet ordre , M. le Dauphin en efl revêtu,
6c tous les héritiers préfomptifs de la couronne doivent
la porter.
Il y a des commandeurs qui ont 4000 1. de pen-
fion 6c d’autres 3000 liv. il y a aufli un nombre de
Amples chevaliers qui ont des penfions , mais elles
font moins confidéra b!es.-«2)
Ordre de C a l a t r a v a , ( Hifi. des ordres.) je
n’ajoute qu’un mot ; cet ordre n’efl plus aujourd’hui
ni religieux ni militaire , puifqu’on peut s’y marier
une fois , & qu’il ne confifle que dans la jouiflance
ORD
de plufieurs commanderies en Efpagne. Voye\ C al
a t r a v a , O rdre de. (JD. J.)
O rdre du C hardon ou de S. A ndré , (H fi.
mod. ) efl un ordre militaire d’Écoffe , inflirué à
ce que difent quelques-uns , par Hungus ou H un go,
roi des Piéles , après la viéloire qu’il remporta fur
Athelftan. Voyeç C h ev al ier.
La légende porte , que pendant la bataille, une
croix de S. André, patron d’Écofle , apparut à Hungus
qui en conçut un bon augure , décora fon éten-
dart de la figure de cette croix ; & après le gain
de la bataille, inflitua un ordre de chevaliers , dont
le collier efl d’or entrelacé de fleurs de chardons 6c
de branches de ruë.
Au bas du collier pend une médaille fur laquelle
on voit l’image de S. André , ayant fa croix fur la
poitrine avec cette devife, nemo me impuni lacejfet,
perfonne ne me défie impunément.
D ’autres racontent différemment l’origine de cet
ordre, 6c nous aflùrent qu’il fut inflitué après la con-
clufion d’une paix entre Charles V I I , roi de France
, d’une part, 6c le roi d’Écoffe de l’autre.
L ’abbé Juftiniani remonte plus haut, & prétend
qu’il fut inflitué par Achaiusl, roi d’Écoffe en 809 ,
lequel après avoir conclu une alliance avec Charlemagne
, prit pour fa devife le chardon avec ces
mots , nemo me impuni lacejfet , laquelle devife efl
effeâivement celle de Yordre ; il ajoute que le roi
Jacques IV. renouvella cet ordre , & le mit fous la
protection de S. André.
■ L ’ordre n’eft compofé que de douze chevaliers ,
& du roi qui en efl le chef 6c le louverain ; ils portent
un ruban verd au bas duquel pend un chardon
d ’or couronné dans un cercle d’o r , avec l’infcrip-
tion de la devife. ( H )
Ordre de l’Éléphant , efl un des ordres militaires
des rois de Dannemark ; on l’appelle ainfi,
parcë que fes armes font un éléphant. U y a bien
des fentimens fur l’origine de l’inflitution de cet ordre.
Mennenius & Hocpingins l’attribuent à Chrif-
tien IV. qui fut élu roi en 1584 ; Seiden & Imhof à
Frédéric IL élu en 1542 ; Gregorio Leti à Frédéric
I. qui régna vers 15305 Bernard ReboIIedus à Jean
I. qui commença à regner en 1478 ; Bechman 6c
lanus Bieherodius foutiennent que Camit VI. en efl
le premier inftituteur , & que c’eft aux croifades
qu’il en faut rapporter l’origine. II efl certain qu’en
1494.. Yordre de l'éléphant lubfïftoit. Cet ordre s’ap-
pella d’abord Yordre deJ'ainte Marie, 6c celui de l'éléphant
fous Chriftien I. ce qui donna occafion à fon
inftittuion , fut une aéfcion courageufe de quelques-
uns des Danois qui tuerent un éléphant dans une
guerre que Canut fou tint contre les Sarrafins. Cet
ordre a toujours été fous la protection de la faime
Vierge, 6c s’appelle encore à préfent Yordre de Jointe
Marie. Au deflous de l’éléphant pend une image de
la fainte Vierge, environnée de rayons. Plufieurs
princes augmentèrent cet ordre. Frédéric II. créa
beaucoup de chevaliers à la cérémonie de fon couronnement.
Chriftien V. en fit autant,& l’orna beaucoup
: les chevaliers portent un collier d’où pend
un éléphant d’or , émaillé de blanc, le dos chargé
d’un château d’argent, maçonné de fable. L’éléphant
eft porté fur une terraffe de finople, émaillée de
fleurs. Les rois de Dannemark ne font point de chevaliers
de l’éléphant que le jour de leur couronnement.
O rdre du S. Esprit , eft un ordre de chevalerie
inflitué par Henri III. en 1579 , il devoit être com-
pofé de cent chevaliers feulement. Pour y être ad-
niis, xl falloit faire preuve de trois races de noblef-
fe. Le grand maître 6c les commandeurs font revêtus
les jours de cérémonies , de longs manteaux ,
faits à la façon de ceux qui fe portent le jour de S.
O R D 603
Michel. Us font de velours noir, garnis tout-autour
d’une broderie d’or & d’argent qui repréfente
des fleurs de lis , 6c forme des noeuds d’or entre
trois divers chiffres d’argent , 6c au-deflùs de ces
chiffres, de ces noeuds 6c de ces fleurs de lis , il y
a des flammes d’or femées de part en part. Ce grand
manteau eft garni d’un mantelet de toile d’argent
v erte, couverte d’une broderie femblable à celle du
grand manteau, excepté qu’au lieu de chiffres, il y
a des colombes d’argent. Ces manteaux 6c mante-
lets font doublés de fatin jaune orangé, ils fe portent
retroufles du côté gauche , & l’ouverture eft
du côté droit. Le grand maître & les commandeurs
portent des chauffes 6c des pourpoints blancs façonnés
à leur diferétion ; ils ont un bonnet noir
lurmonté d’une plume blanche , & mettent à découvert
fur leurs manteaux le grand collier de Yor-
' dre qui leur a été donné lors de leur réception.
Le chancelier eft vêtu de même que le commandeur,
excepté qu’il n’a pas le grand collier, mais
feulement la croix coufuefur le devant de fon manteau
, & celle d’or pendante au col. Le prévôt, le
grand tréforier& le greffier ont aufli des manteaux
de velours noir & le mantelet de toile d’argent verte
, qui ne font brodés que de quelques flammes
d’or. Ils portent aufli la croix de Yordre coufue 6c
celle d’or pendante au col ; le héraut 6c huifliers
ont des manteaux de fatin 6c le mantelet de velours
verd , bordé de flammes comme ceux des autres
officiers. Le héraut porte la croix de Yordre avec
fon émail pendue au c o l, 6c l’huiflier une croix de
Yordre, mais plus petite que celle des autres officiers.
Les prélats , commandeurs & officiers portent la
croix coufue fur le côté gauche de leurs manteaux,
robes & autres habiilemens de deffus. Le grand
maître qui eft le roi la porte aux habiilemens de
deffous, au milieu de l’eftomac quand bon lui fem-
ble , & en ceux de deffus au côté gauche de niême
grandeur que les commandeurs. Elle eft faite en
forme de croix de malte en broderie d’argent, au
milieu il y a une colombe figurée , & aux anales
des rais & des fleurs de lis brodées en argent. C ’eft
un des ftatuts irrévocables de Yordre, de porter toujours
la croix aux habits ordinaires aVec celle d’or
au col pendante à un ruban de foie , de couleur
bleu céleftè , & l’habit aux jours deftinés. Les cardinaux
, prélats, commandeurs & officiers portent
aufli une croix de Yordre pendante au col & au même
ruban. La croix eft de la forme de celle dè malte
, toute d’or , émaillée de blanc par les bords,
6c le milieu fans émail : dans les angles il y a une
fleur de lis ; mais fur le milieu ceux qui forît chevaliers
de Yordre de S. Michel, en portent la marque
d’un côté , & de l’autre une colombe,. Les cardinaux
& les prélats qui ne font point de cet ordre
portent une colombe,dès deux côtés.-
Le collier de Yordre du S . Efprit eft d’or fait à
fleurs de lis avec trois différens chiffres entrelacés
de noeuds de la façon de la broderie du nlanteau. Il
eft toujours du poids de deux cens écus ou environ,
fans être enrichi de pierreries ni d’autres chofes.
Les commandeurs ne le peuvent vendre , - engager
ni aliéner , pour quelque néceflité ou caufe que ce
foit, parce qu’il appartient à Yordre 6c lui revient
après la mort de celui qui le portoit. Avant que de
recevoir Yordre du S . Efprit, les commandeurs reçoivent
celui de S. Michel ; c’eft pourquoi leurs
armes font entourées de deux colliers. En 1664.
roi fixa le nombre des chevaliers à cent. Les officiers
font le chancelier 6c garde des fceaux, le prévôt
& grand maître des cérémonies, le grand trélô-
r ie r , le greffier, les intendans , le généalogifte de
Yordre, le roi d’armes , les hérauts & les huifliers*