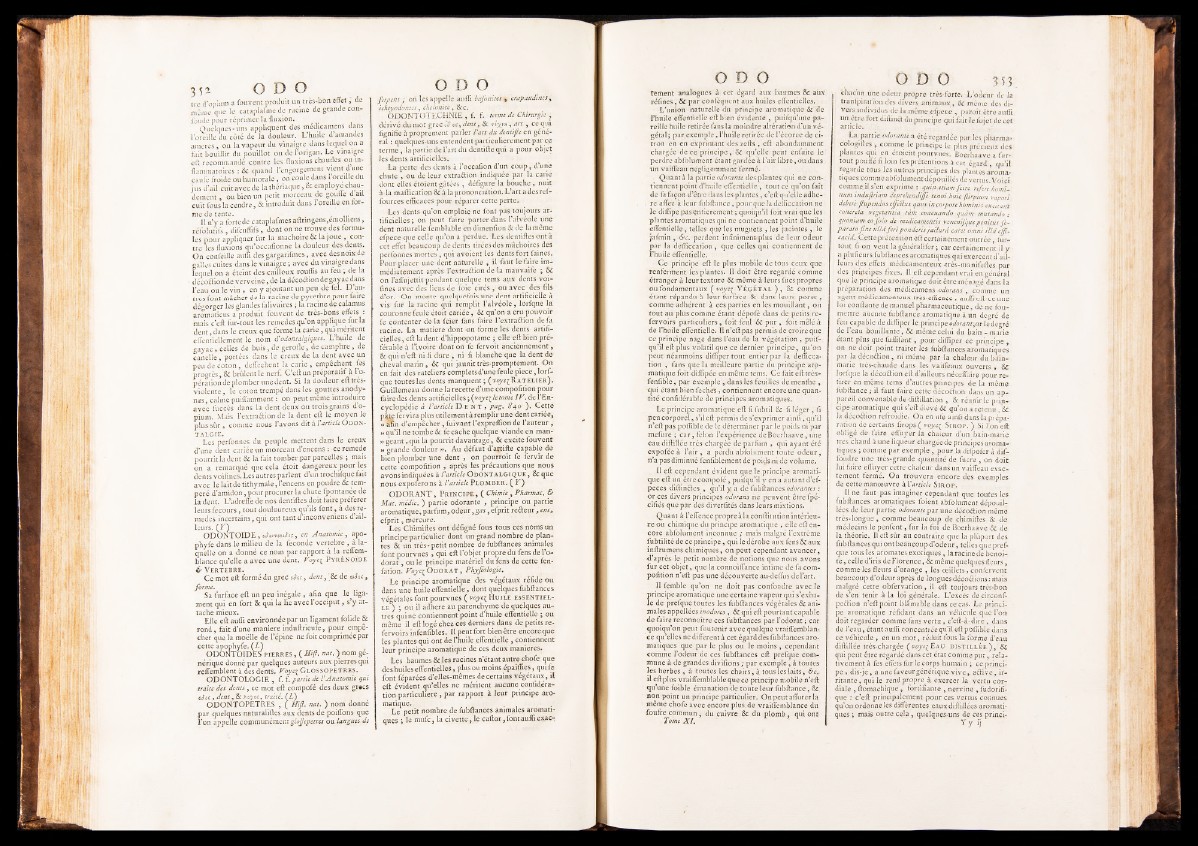
tre d’opium a fouvent produit un très-bon effet, de
mime que le cataplafme de racine de grande confonde
pour réprimer la fluxion.
Quelques-uns appliquent des medicamens dans
l’oreille du côté de la douleur. L’huile d’amandes
ameres , ou la vapeur du vinaigre dans lequel on a
fait bouillir du pouillot ou de l’origan. Le vinaigre
eft recommandé contre les fluxions chaudes ou inflammatoires
: 8c quand l’engorgement vient dune
caufe froide ou humorale, on coule dans 1 oreille du
jus d’ail cuit avec de la thériaque, & employé chaudement
, ou bien un petit morceau de goufle d ail
cuit fous la cendre, & introduit dans 1 oreille en forme
de tente. , ...
II n’y a forte de cataplafmes aftrmgens,émolliens,
réiblutifs , difeuflifs , dont on ne trouve des formules
pour appliquer fur la mâchoire 8c la joue , contre
les fluxions qu’occafionne la douleur des dents.
On confeille aulïi des gargarifmes, avec des noix de
»alles cuites dans le vinaigre ; avec du vinaigre dans
lequel on a éteint des cailloux rouffis au feu ; de la
décoûion de verveine, de la décoction de gayac dans
l’eau ou le vin , en y ajoutant un peu de fel. D ’autres
font mâcher de la racine de pyrethre pour faire
dégorger les glandes falivaires ; la racine de calamus
aromaticus a produit fou vent de très-bons effets :
mais c’eft fur-tout les remedes qu’on applique fur la
dent, dans le creux que forme la carie, qui méritent
effentiellement le nom d'odontalgiques. L huile de
gay ac, celles de buis, de gerofle, de camphre, de
canêlle, portées dans le creux de la dent avec un
peu de coton, deffcchent la carie , empêchent fes
progrès, 8c brûlent le nerf. C’eft un préparatif a .lo-
pération de plomber une dent. Si la douleur eft très-
violente , le coton trempé dans les gouttes anody-
nes, calme puiflamment : on peut meme introduire
avec fuccès dans la dent deux ou trois grains d o-
pium. Mais l’extraftion de la dent eft le moyen le
plus sûr, comme nous l’avons dit à l’article O d o n -
T A LG IE .
Les perfonnes du peuple mettent dans le creux
d’une dent cariée un morceau d’encens : ceremede
pourrit la dent 8c la fait tomber par parcelles ; mais
on a remarqué que cela étoit dangereux pour les
dents voifines. Les autres parlent d un trochifque fait
avec le lait de tithymale, l’encens en poudre & tempéré
d’amidon, pour procurer la chute fpontanée de
la dent. L’adreffe de nos dentiftes doit faire préférer
leurs fecours, tout douloureux qu’ils font, à des remedes
incertains, qui ont tantd’inconveniens d’ailleurs.
{T )
OD O NTO ÏD E, oS'ovrctiS'iç, en Anatomie , apo-
phyfe dans le milieu de la fécondé vertebre , à laquelle
on a donné ce nom par rapport à la reffem-
blance qu’elle a avec une dent. Voye{ P y r é n o ï d e
& VE RTEB RE.
Ce mot eft formé du grec oS'oe, dent, ’& de aS'oc,
forme.
Sa furface eft un peu inégale , afin que le ligament
qui en fort & qui la lie avec 1 occiput, s y attache
mieux. \
Elle eft auffi environnée par un ligament folxde &
rond, fait d’une maniéré induftrieuie, pour empêcher
que la moelle de l’épine ne foit comprimée par
cette apophyfe. (/-) r
ODONTOÏDES p i e r r e s , ( Hiß. nat. ) nom générique
donné par quelques auteurs aux pierres qui
reffemblent à des dents. Voye^ G l o s s o p e t r e s .
ODONTOLOGIE , f. f. partie de VAnatomie qui
traite des dents, ce mot eft compofé des deux grecs
ç$oç , dent, & traité. (Z,)
ODONTOPETRES , ( Hiß. nat. ) nom donné
.par quelques naturaliftes aux dents de poiffons que
l’on appelle communément gloßepetres ou Langues de
ferpefit ; on les appelle aufli bitfouïtes4 crapaudines,
ichtyodontes, chelonite , & c.
ODONTOTECHNIE , f. f. terme de Chirurgie ,
dérivé du mot grec ôiT oc, dent 3 & Ayy* ■> an > ce qui
fignifie à proprement parler L'art du dentijîe en general
: quelques-uns entendent particulièrement par ce
terme, la partie de l’art du dentifte qui a pour objet
les dents artificielles.
La perte des dents à l’occafion d’un coup, d’une
chute ou de leur extraction indiquée par la carie
dont elles étoient gâtées , défigure la bouche , nuit
àda maftication 8c àla prononciation.L’àrt.adesrei-
fources efficaces pour réparer cette perte;
Les dents qu’on emploie ne font pas.toujours artificielles
; on peut faire porter dans l’alvéole une
dent naturelle femblable en dimenfion & de la meme
efpece que celle qu’on a perdue. Les dentiftes ont à
cet effet beaucoup de dents tirées des mâchoires des
perfonnes mortes , qui avoient les dents fort faines.
Pour placer une dent naturelle , il faut le faire immédiatement
après l’extra&ion de la mauvaife ; 6C
on l’affujettit pendant quelque tems aux dents voi-
fines avec des liens de foie cirés , ou avec des fils
d’or. On monte quelquefois une dent artificielle à
vis1 fur la racine qui remplit l’alvéole, lorfque la
couronne feule étoit cariée, Sc qu’on a cru pouvoir
fe contenter de là feier fans faire l ’extraftion de fa
racine. La matière dont on forme les dents artificielles,
eft la dent d’hippopotame ; elle eft bien préférable
à l’ivoire dont on fe fervoit anciennement,
& qui n’eft ni fi dure , ni fi blanche que la dent de
cheval marin , 8c qui jaunit très-promptement. On
en fait des râteliers complets d’une feule piece, lorfque
toutesles dents manquent; (voye{R â t e l i e r ) .
Guillemeau donne la recette d’une compofition pour
faire des dents artificielles ; (voyelle tome IV . de l’Encyclopédie
à L’article D E N T , pag. 840 ). Cette
pâte fer vira plus utilement à remplir une dent cariée,
« afin d’empêcher, fuivant l’expreffionde l’auteur,
» qu’il ne tombe & fe cache quelque viande en man-
» géant, qui la pourrit davantage, & excite fouvent
» grande douleur ». Au défaut d’ajtifte capable de
bien plomber une dent , on pourroit fe fervir de
cette compofition , après les précautions que nous
avons indiquées à L'article O d o n t a l g i q u e , 8c que
nous expoferons à-/’article P l o m b e r . ( T )
OD O R AN T , P r i n c i p e , ( Chimie , Pharmac. &
Mat. médic. ) partie odorante , principe ou partie
aromatique, parfum, odeur, gas, efprit reéteur , ens9
efprit, mercure.
Les Chimiftes ont défigné fous tous ces noms un
principe particulier dont un grand nombre de plantes
& un très-petit nombre de fubftances animales
font pourvues , qui eft l’objet propre du fens de l’odorat
, ou le principe matériel du fens de cette fen-
fation. Voye{ O d o r a t , Phyjiologie.
Le principe aromatique des végétaux réfide ou
dans une huile effentielle , dont quelques fubftances
végétales font pourvues ( voye^ H u i l e e s s e n t i e l l
e ) ; o u il adhéré au parenchyme de quelques autres
qui ne contiennent point d’huile effentielle ; ou
même il eft logé chez ces derniers dans de petits re-
fervoirs infenfibles. Il peut fort bien être encore que
| les plantes qui ont de i’nuile effentielle , contiennent
leur principe aromatique de ces deux maniérés.
Les baumes 8cles racines n’étant autre chofe que
des huiles effentielles, plus ou moins épaiffies, qui fe
font féparées d’elles-mêmes de certains végétaux, il
eft évident qu’elles ne méritent aucune confidéra-
tion particulière , par rapport à leur principe aromatique.,
. • .
Le petit nombre de fubftances animales aromatiques
; le mufe, la civette, le caftor, font auffi ex,acîè
filent analogues à cet égard aux baumes 8c aux
réfines, & par conféquent aux huiles effentielles.
L’unioïi naturelle dû principe aromatique 8c dé
l’huile effentielle eft bien évidente , puifqii’une pareille
huile retirée fans la moindre altération d’un v égétal;
par exemple, l’huile retirée de l’écorce de citron
en en exprimant des zefts , eft abondamment
chargée de ce principe, 8c qu’elle, peut enfuire le
perdre abfolument étant gardée à l ’air libre, ou dans
lin vaiffeau négligemment fermé.
Quant à la partie odorante des:plantes qui ne contiennent
point d’huile effentielle", tout ce qu’on fait
de fa façon d’être dans les plantes, c’eft qu’elle adhe-
, re affez à leur fubftance, pour que la defficcation ne
le diffipe pas entièrement ; quoiqu’il foit vrai que l.es
plantes aromatiques qui ne contiennent point .d’huile
effentielle, telles que les muguets , les jacintes , le
jafmin, 6*c, perdent infiniment plus de leur odeur
par la defficcation, que celles qui contiennent de
l ’huilé effentielle.
Ce principe eft le plus mobile de tous ceux que
renferment les plantes. Il doit être regardé comme
étranger à leur texture 8c même à leurs fucs propres
ou fondamentaux ( voye^ VÉGÉTAL ) , 8c comme
étant répandu à leur furface & dans leurs pores ,
comme adhérent à ces parties eh les mouillant, ou
tout au plus comme étant dépofé dans de petits: re-
fervoirs particuliers , foit feul 8c pur , foit mêlé à
de l’huile effentielle. Il n’eft pas permis de croire que
ce principe nage dans l’eau de la végétation, puif-
qu’il eft plus volatil que ce dernier principe, qu’on
peut néanmoins diffiper tout entier par la defficcation
, fans que la meilleure partie du principe aromatique
foit diffipée en même tems. Ce fait eft très-
fenfîble, par exemple ,,dans les feuilles de menthe ,
qui étant bien feche's, contiennent encore une quantité
confidérable de principes aromatiques.
Le principe aromatique eft fi fubtil 8c fi léger , fi
peu corporel, s’il eft permis de s’exprimer ainfi, qu’il
n’eft pas poffible de le déterminer par le poids ni par
ïnefure ; ca r , félon l’expérience deBoerhaavè, une
eau diftillée très-chargée de parfum , qui ayant été
expofée à l’air , a perdu abfolument toute odeur,
n’a pas diminué fenfiblementde poids ni de volume.
II eft cependant évident que le principe aromatique
eft un êtrë compofé, puifqu’il y en a autant d’ef-
peces diftinfles , qu’il y a de fubftances odorantes :
or ces divers principes odorans ne peuvent être fpé-
cifiés que par des diverfités dans leurs mixtions.
Quant à l’effence propre à la conflit ution intérieu- '
re ou chimique du principe aromatique , elle eft encore
abfolument inconnue ; mais malgré l’extrême
fubtilité de ce principe, qui le dérobe aux fens 8c aux
inftrumens chimiques, on peut cependant avancer,
•d’après le petit nombre de notions que nous avons ,
fur cet objet, que la connoiffance intime de fa com- |
pofition n’eft pas une découverte au-deffus de l’art.
Il femble qu’on ne doit pas confondre avec le
principe aromatique une certaine vapeur qui s’exhale
de prefque toutes les fubftances végétales 8c animales
appellées inodores, 8c qui eft pourtant capable
de faire reconnoître ces fubftances par l’odorat ; car
quoiqu’on peut foutenir avec quelque vraiffemblan-
ce qu’elles ne different à cet égard des fubftances aromatiques
que par le plus ou le moins , cependant
comme l’odeur de ces fubftances eft prefque commune
à de grandes divifions ; par exemple, à toutes
les herbes , à toutes les chairs, à tous les laits, &c.
il eft plus vraiffemblableque ce principe mobile n’eft
qu’une foible émanation de toute leur fubftance, 8c
non point un principe particulier. On peut affûter la
memè chofe avec encore plus de vraisemblance du
foufre commun, du cuivre 8c du plomb, qui ont
Tome X I .
chacun une odeur propre très-forte. L ’odeur de la
•’ tranfpirafion des divers animaux, 8c même des divers
individus de la même,efpece , pa’roît être auffi
un.être fort diftinét du principe qui fait le fuiet de cet
article.
La partie, odorante a été regardée par les, pharma»
; coLogiftes , comme le principe le plus précieux des
plantes qui en étoient pourvues. Boerhaave a fur*
tout pouffé fi.loin fes prétentions à cet égard , qu’il
regarde tous les antres principes des plantes aromatiques
comme abfolument dépouillés de vertus. Voici
commejl s’en exprime : qui/i,eciam feire refert homi-
num induflriam deprehendijfe tenui huit flirpium vapori
dibcri-fliiptndos effeçlus quos incorpore hôminis excitant
concreta vtgetantia yani eyacuando quàrri mutando ;
qnoniam efi folp de medïcamentis yenenifque penitùs fe- J
parato fine ullâferïponderisjaclurâcaret omni il la effi-
caciâ. .Cette prétention eft certainement outrée, fur*
tout fi ,on veut la généralifer ; càr certainement il y
a plufiéurs fubftances. aromatiques qui exercent d’ailleurs
des effets médicamenteux .très-nianifeftes par
des principes fixes* Il eft cependant vrai en général
que le principe aromatique doit être ménagé dans la
, préparation des medicamens odorans , comme un
agent médicamenteux très-efficace : auffi eft-ceune
loi confiante de manuel pharmaceutique, de ne fou-
mettre aucune fubftance aromatique à un de<»ré de
feu capable de diffiper le principe odoranr.or le degré
de l’eau bouillante, 8c même celui du bain - marie
étant plus que fuffifant, pour diffiper ce principe ,
on né doit point traiter les fubftances aromatiques
par la déco.àion, ni même par la chaleur du bain-
marie très-chaude dans les vaiffeaux ouverts , &
lorfque la decoélion eft d ailleurs neceftaire pour retirer
en même tems d’autres principes de la même
fubftance; il faut faire cette décoâion dans un appareil
convenable de diftillation , 8t réunir le principe
aromatique qui s’eft élevé & qu’on a retenu , 8C
la déco&ion refroidie. On en ufe ainfi dans la préparation
de certains firops ( voye^ S i r o p . ) Si fon eft
obligé de faire effuyer la chaieur d’un bain-marie
très chaud à une liqueur chargée de principes aromatiques
; comme par exemple , pour la difpofer à dif-
foudre une très-grande quantité de fu,cre , on doit
lui faire effuyer cetre chaleur dans un vaiffeau exactement
fermé. On trouvera encore des exemples
de cette manoeuvre à l'article S i r o p .
Il ne faut pas imaginer cependant que toutes les
fubftances aromatiques foient abfolument dépouil-:
lées de leur partie odorante par une décoélion même
très-longue , comme beaucoup de chimiftes & de
médecins le penfent, fur la foi de Boerhaave & de
la théorie. Il eft sûr au contraire que la plûpart des
fubftances qui ont beaucoup d’odeur, telles que prefque
tous les aromates exotiques , laracine.de benoîte
, celle d’iris de Florence, & même quelques fleurs,
comme les fleurs d’orange , les oeillets, confervent
beaucoup d’odeur après de longues décodions : mais
malgré cette obfervation, il eft toujours très-bon
de s’en tenir à la loi générale. L’excès de circonf-
pettion n’eft point blâmable dans ce cas. Le principe
aromatique réfidant dans un véhicule que l’on
doit regarder comme fans vertu , c’eft-à-dire , dans
de l’eau, étant auffi concentrée qu’il eft poffible dans
ce véhicule, en un mot, réduit fous la forme d’eau
diftillée très-chargée ( voye[ E a u d i s t i l l é e ) , 8c
qui petit être regardé dans cet état comme pur, relativement
à fes effets fur le corps humain ; ce principe
, dis-je, a une faveur générique v iv e , aû iv e , irritante
, qui le rend propre à exercer la vertu cordiale
, ftomachique , fortifiante , nervine , fudorifi-
que : c’eft principalement pour ces vertus connues
qu’on ordonne les différentes eauxdiftillées aromatiques
; mais outre ce la, quelques-uns de ces princi