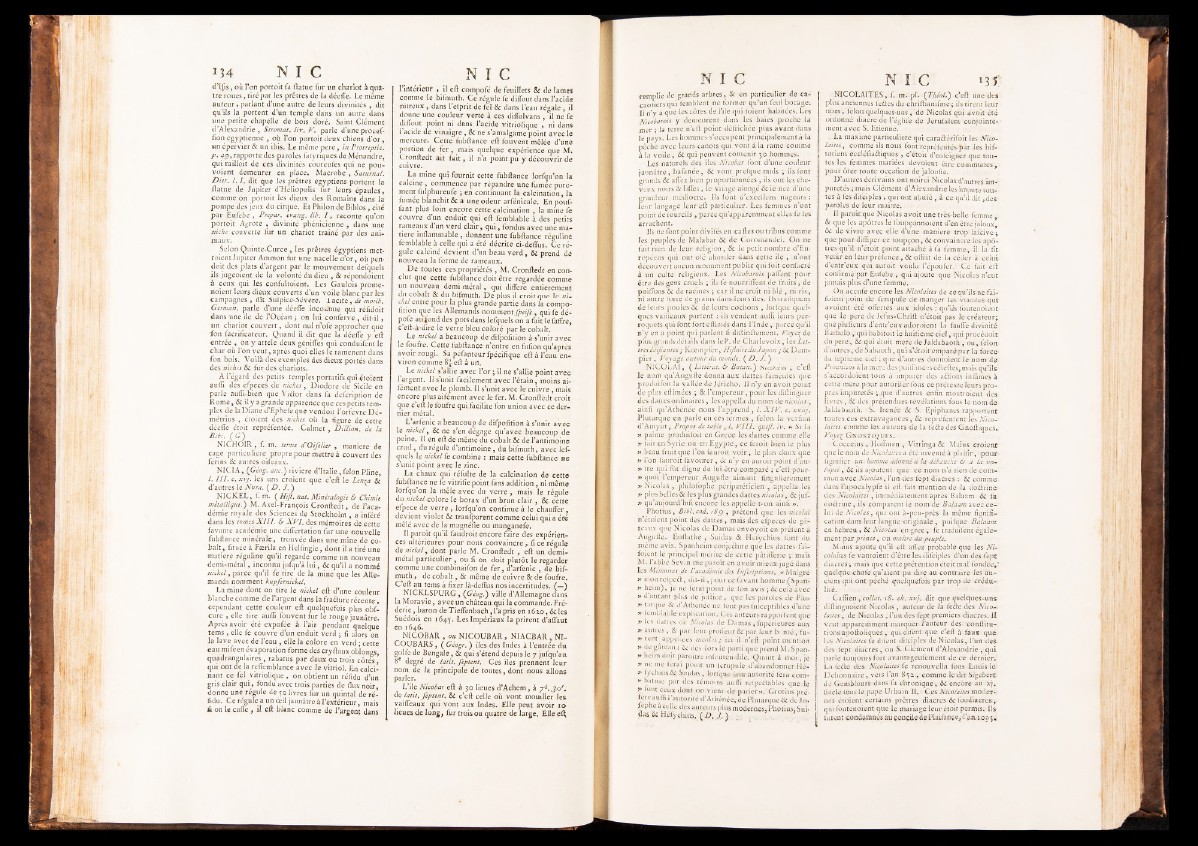
d’Ifis, où l’on portoit fa ftatue fur un chariot à quatre
roues, tiré par les prêtres de la déefl’e. Le même
auteur, parlant d’une autre de leurs divinités , dit
qu’ils la portent d’un temple dans un autre dans
une petite chapelle de bois doré. Saint Clément
d ’Alexandrie , Stromat. liv. N. parle d’une procef-
fion égyptienne , où l’on portoit deux chiens d’o r ,
un épervier & un ibis. Le même pere, in Protreptic.
P ■ 49 ■> rapporte des paroles faryriques de Ménandre,
qui railloit de ces divinités coureufes qui ne pou-
voient demeurer en place. Macrobe , Saturnal.
Dier. 1. 1. dit que les prêtres égyptiens portent la
Hatue de Jupiter d’Héliopolis fur leurs épaules,
comme on portoit les dieux des Romains dans la
pompe des jeux du cirque. Et Philon de Biblos, cité
par Eufebe , Prepar. evang. lib. I , raconte qu’on
portoit Agrote , divinité phénicienne , dans une
niche couverte fur un chariot traîné par des animaux.
Selon Quinte-Curce, les prêtres égyptiens met-
foient Jupiter Ammon fur une nacelle d’or, où pen-
doit des plats d’argent par le mouvement defquels
ils jugeoient de la volonté du dieu , & répondoient
à ceux qui les confultoient. Les Gaulois prome-
noient leurs dieux couverts d’un voile blanc par les
campagnes , dit Sulpice-Sévere. Ta c ite , de morib.
German. parle d’une déeffe incoiAuie qui réfidoit
dans une île de l’Océan ; on lui conferve , dit-il,
un chariot couvert, dont nul ri’ofe approcher que
fon facrifîcateur. Quand il dit que la déeffe y eft
entrée , on y attele deux geniffes qui conduifent le
char où l ’on veut, après quoi elles le ramènent dans
fon bois. Voilà des exemples des dieux portés dans
des niches 6c fur des chariots.
A l’égard des petits temples portatifs qui étoient
aufli des efpeces de niches, Diodore de Sicile en
parle auffi-bien que Viétor dans fa defeription de
Rome, & il y a grande apparence que ces petits temples
de la Diane d’Ephefe que vendoit l’orfevre Dé-
métrius , ctoient des niches où la figure de cette
déeffe étoit repréfentée. Calmet , Diction. de la
Bibl. (G )
NICHOIR, f. m. terme cPQifelier , maniéré de
cage particulière propre pour mettre à couvert des
férins 6c autres oifeaux.
NICIA, (Géog. anc.) riviere d’Italie, félon Pline,
l. I I I . c. xvj. les uns croient que c’eft le Len^a &
d’autres le Nura. {D . J. )
N ICK E L, f. m. ( Hijl. nat. Minéralogie & Chimie
métallique.') M. Axel-François Cronftedt, de l’académie
royale des Sciences de Stockholm , a inféré
dans les tomes X I I I . & XNI. des mémoires de cette
favante académie une differtation fur une nouvelle
fubftance minérale, trouvée dans une mine de cobalt,
fituée à Færila en Helfingie, dont il a tiré une
matière réguline qu’il regarde comme un nouveau
demi-métal, inconnu jufqu’à lu i, & qu’il a nommé
nickel, parce qu’il fe tire de la mine que les Allemands
nomment kupfrnickel.
La mine dont on tire le nickel eft d’une couleur
blanche comme de l’argent dans la fraûure récente,
cependant cette couleur eft quelquefois plus obf-
cure , elle tire auftî fouvent lur le rouge jaunâtre.
Après avoir été expofée à l’air pendant quelque
tems , elle fe couvre d’un enduit verd ; fi alors on
la lave avec de l’eau , elle la colore en verd ; cette
eau mife en évaporation forme des cryftaux oblongs,
quadrangulaires , rabattis par deux ou trois côtés i
qui ont de la reffemblance avec le vitriol. En calcinant
ce fel vitriolique , on obtient un réfidu d’un
gris clair qui, fondu avec trois parties de flux noir,
donne une régule de 50 livres fur un quintal de réfidu.
Ce régule a un oeil jaunâtre à l’extérieur, mais
û on le caffe , il eft blanc comme de l ’argent dans
Pintéfieiu* * îl eft compofé de feuillets 6c de lames
comme le bifmuth. Ce régule fe diffout dans l’acide
nitreux , dans l’efprit de fel & dans l’eau régale , il
donne une couleur verte à ces diffolvans , il ne fe
diffout point ni dans l’acide vitriolique , ni dans
l’acide de vinaigre , 6c ne s’amalgame point avec le
mercure. Cette fubftance eft fouvent mêlée d’une
portion de f e r , mais quelque expérience que M.
Cronftedt ait fa it , il n’a point pu y découvrir de
cuivre.
La mine qui fournit cette fubftance Iorfqu’on la
calcine , commence par répandre une fumee purement
fulphureufe ; en continuant la calcination, la
fumée blanchit & a une odeur arfénicale. En pouffant
plus loin encore cette calcination , la mine fe
couvre d’un enduit qui eft femblable à des petits
rameaux d’un verd clair, qui, fondus avec une matière
inflammable , donnent une fubftance régulinô
femblable à celle qui a été décrite ci-deffus. Ce régule
calciné devient d’un beau verd, & prend de
nouveau la forme de rameaux.
De toutes ces propriétés , M. Cronftedt en conclut
que cette fubftance doit être regardée comme
un nouveau demi-métal, qui différé entièrement
du cobalt & du bifmuth. De plus il croit que le nickel
entre pour la plus grande partie dans la compo-
fition ç^ue les Allemands nomment fpeifs , qui fe dé-
pofe au^ond des pots dans lefquels on a fait le faffre,
c’eft-à-dire le verre bleu coloré par le cobalt.
Le nickel a beaucoup de difpofition à s’unir avec
le foufre. Cette fubftance n’entre en fufion qu’après
avoir rougi. Sa pefanteur fpécifique eft à l’eau en^
viron comme eft à uil.
Le nickel s’allie avec l’or ; il ne s’allie point avec
l’argent. Il s’unit facilement avec l’étain, moins ai-
fement avec le plomb. Il s’unit avec le cuivre , mais
encore plus aifément avec le fer. M. Cronftedt croit
que c’eft le foufre qui facilite fon union avec ce dernier
métal.
L’arfenic a beaucoup de difpofition à s’unir avec
le nickel, & ne s’en dégage qu’avec beaucoup de
peine. Il en eft de même du cobalt 6c de l’antimoine
crud , du régule d’antimoine, du bifmuth, avec lefquels
le nickel fe combine : mais cette fubftance ne
s’unit point avec le zinc.
La chaux qui réfulte de la calcination de cette
fubftance ne le vitrifie point fans addition, ni même
lorfqu’on la mêle avec du verre , mais le régule
du nickel colore le borax d’un brun clair , 6c cette
efpece de verre , lorfqu’on continue à le chauffer,
devient violet 6c tranfparent comme celui qui a été
mêlé avec de la magnéfie ou manganefe.
Il paroît qu’il faudroit encore faire des expériences
ultérieures pour nous convaincre, fi ce régule
de nickel ^ dont parle M. Cronftedt , eft un demi-
metal particulier, ou fi on doit plutôt le regarder
comme une combinaifon de fer, d’arfenic , de bifmuth
, de cobalt, & même de cuivre & de foufre.
C’eft au tems à fixer Ià-deffus nos incertitudes. (—)
NICKLSPURG, {Géog.) ville d’Allemagne dans
la M oravie, avec un château qui la commande. Frédéric
, baron de Tieffenbach, l’a pris en 1620, & les
Suédois en 1645. Les Impériaux la prirent d’affaut
en 1646.
NICOBAR , ou NICOUBAR, NIACBAR, NI-
COUBARS, ( Gèogr. ) îles des Indes à l ’entrée du
golfe de Bengale, & qui s’étend depuis le 7 jufqu’au
8e degré de latit. feptent. Ces îles prennent leur
nom de la principale de toutes, dont nous allons
parler.
L’île Nicobar eft à 30 lieues d’Achem, à J o '.‘
de latit. feptent. 6c c’eft celle où vont mouiller les
yaiffeaux qui vont aux Indes. Elle peut avoir 10
lieues d.e long, fur trois ou quatre de large. Elle eft
remplie de grands arbres, & en particulier de cacaotiers
qui l’emblent ne former qu’un feul bocage.
Il n’y a que les côtes de l’île qui foient habitées. Les
Nicobàrois y demeurent dans les baies proche la
nier • la terre n’eft point défrichée plus avant dans
le pays. Les hommes s?occupent principalement à la
pêche avec leurs canots qui vont à la rame comme
à la v o ile , 6c qui peuvent contenir 30 hommes.
Les naturels des îles Nicobar font d’une couleur
jaunâtre, bafanée, 6c vont prefque nuds ; ils font
grands 6c allez bien proportionnées ; ils ont les cheveux
noirs & lifl'es, le vifage alongé 6c le nez d’une
grandeur médiocre. Ils font d’excellens nageurs:
leur langage leur eft particulier. Les femmes n’ont
point delourcils , parce qu’apparemment elles fe les
arrachent.
Ils ne font point divifés en caftes ou tribus comme
les peuples de Malabar 6c de Coromandel. On ne
fait rien de leur religion , 6c le petit nombre d’Européens
qui ont ofé aborder dans cette île , n’ont
découvert aucun monument public qui foit confacré
à un culte religieux. Les Nicobàrois paffent pour
être des gens cruels ; ils fe nourriffent de fruits, de
poiffons 6c de racines ; car il ne croît ni blé , ni ris,
ni autre forte de grains clans leurs îles. Us trafiquent
de leurs poules 6c de leurs cochons , lorfque quelques
vaifleaux partent : ils vendent aufli leurs perroquets
qui font fort eftimés dans l ’Inde, parce qu’il
n’y en a point qui parlent fi diftinélement. Noyé^ de
plus grands détails dans leP. de Charlevoix, les Lettres
édifiantes j Koempfer, Hijloïre du Japon ; ikDam-
pier , Noy âge autour du monde. ( D . J. ) ■
NICOLa I , ( Littérat. & Botan.) Nr/.o^àm , c’eft
le nom qu’Augufte donna aux dattes fameufes que
produifoit la vallée de Jéricho. Il n’y en a voit point
de plus eftimées ; & l’empereur, pour les diftinguer
des dattes ordinaires, les appella du nom de nicolas\
ainfi qu’Athénée nous l’apprend, l.X IN . c.xviij.
Plutarque en parle en ces termes * félon la verfion
d’Amyot, Propos de table , /. NlII. quefl. iv. « Si la
» palme produifoit en Grece les dattes comme elle
» fait en Syrie ou en.Egypte, ce feroit bieaie plus
».beau fruit que l’on fauroit voir , le. plus doux que
» l’on fauroit favourer, & n’y en auroit point d’au-
» tre qui fût digne de lui être-comparé ; c’eft po.ur-
» quoi l’empereur Augufte aimant fingulierement
»Nicolas., philofophe péripatéticien , appella les
» plus belles & les plus grandes dattes nicolas, 6c juf-
» qu’aujourcl’hifi encore les appelle t-on ainfi.».
Photius, Bibl. cod. iSc) , prétend que \esnicoldi
n’étoient point des dattes, mais des efpeces de gâ*
îeaux que Nicolas de Damas envoyoit en prélent à
Augufte. Euftathe , Suidas & HelychiusCfônt du
même avis. Spanheim conjecture que les dattes fai-
foient le principal mérite de cette pâtiflérie ; mais
M. 1 abbé Sevm me paroît en avoir mi.enx!.jugé.Üans
les Mémoires de L academie des Infçriptions, Malgré
» mon relpeft, dit-il, pour ce favant homme (Span-r
» héim), je ne ferai point de l'on avis ; 6c cela avec
» d’autant plus de jultice , que les paroles de Plu-
» tarque & d’Athénée ne lont pas tulceptib,les d’une
» femblable explication. Ces auteurs rapportent que
» les dattes de Nicolas de Damas ; fupérieures aux
» autres, & par.-leur groffeur & par, leur b- nté, fu-
» rent^ appelées nicolài ; ici il n’eft point mention
» de gateau: ik dès-lors le partique prend M.Spanr
» heim doit paroître inlouienable. Quant à moi , je
» ne me terai point un •lcrupule d’abandonner Hét
>* lÿchiiis&;: Suidas, lorfque j.eur autorité fera com-
» battue par des témoins aufli relpeftables que-Jie
£ font eeux dont on vient-de parler ».' Grotius préféré
aufli l ’autorité d’Athénée,:de Plutarque & de Jo*
lephe a celle des auteurs plus modernes, Photius, Suidas
U Hefyçhius. (D ,./ . ) . ■, - ...
NIÇOLAITES., f. m. pi. (Théol.).c’eft une des
plus anciennes feétes du chriftianifme ; ils tirent leur .
nom, lèlon quelques-uns, de Nicolas qui a voit été
ordonne diacre de l’églile de Jerufalem conjointe-'
ment avec S. Etienne.
• f-a maxime particulière qui caraélérifoit les Nico
laites t comme ils nous font repréferités-par des. historiens
eccléfiaétiques , c etoit d’enfeigner que toutes
les femmes manees dévoient être communes,:
pour ôter toute occafion de jaloufie.
D ’autres écrivains ont noirci Nicolas d’ autres impuretés
; mais Clément d’Alexandrieles impute toutes
à fes difçiples , qui ont abufé , à ce-qu’il dit, des
paroles de leur maître.
Il parôÎLque Nicolas avoit une très-belle, femme
& que les apôtres le' foupçonnoient d’en être jaloux,.
6c de vivre avec elle d’une maniéré trop lafeive;
que pour..difliper ce l’oupçon, 6c convaincre les apôtres
qu’il n’étoit point attaché à fa femme, il la fin
venir en leur préfence , & offrit de la céder àhcelui
d’entr’éux qui auroit vcûlu l’époufer.. Ce fait eft
confirmé par Eufebe., qui ajoute que Nicolas n’eut
jamais plus d’une femme.
On açcufe encore les Nicolaïtes de ce qu’ils ne fai-
foient point de fcrupule de manger les viandes qui
avoient été offertes aux idoles : qu’ils foutenoient
que le .pere de Jefus-Chrift n’étoit pas le créateur;
que plufieurs d’entr’eux adoroient la fauffe divinité
Barbelo ,;q.ui habitoit le huitième ciel, qui procédoit
du perëi, 6c qui étoit mere de Jaldabaoth , ou,-félon:
d’autres, deSabaoth, qui s’étoit emparé par la force'
du lèprieme.ciel ;.que. d’autres donnoient le nom de
Prounicos à la inercdes puiffances cëleftes, mais qu’ils-
s’accordoiënt tous à imputer des aétions infâmes à
cette mère.pour autorifer fous ce prétexte leurs propres
impuretés ;,que d’autres enfin montroient des,
livres, 6c des prétendues révélations fous le nom de
Jaldabaoth. S. Irenée 6c S. Epiphanes rapportent
toutes ces extravagances , 6c repréfentent les Nico-r
laites comme les auteurs de la feftedes Gnoftiques.
Noye{ GnOSTIQUES.
Cocceius , Hoffman , Vitringa & Mains croient
que le nom de Nicolaïtes a été inventé à plaifir:,J pour
fignifier un . homme adonné à la débauche & à La. volupté,
6c ils ajoutent que. ce nom n’a rien-de commun
avec Nicolas, l’un des fept diacres : 6c comme
dans l’apocalypfe il eft fait mention de la doélrine
des.Nicolaïtes ^ immédiatement après Balaam 6c la
doctrine, ils comparent le nomide Balaam avec celui
de Nicolas, qui ont à-peu-près- la même lignification
dans leur langue -originale, pnifque Balaam
en hebreu, 6c Nicolas e n - g r e c fe traduifent également
par.prince, ou maître dit peuple.
Maïus ajoute qu’il eft allez probable que les M-
cçldites fe vantoient d’être les difçiples d’un des fept
diacres; mais que cette prétention étoit mal fondée,’
q’uelqüeehofe qu’aient pu dire au contraire les ‘anciens
qui ont péché quelquefois par trop de crédulité
.C
afîien , collât. 18. ch. xvj.76xt que quelques-uns
diftinguoient Nicolas , auteur: de la feéte.des Nico->
loïtes, de Nicolas , l’un des fept premiers diacres. IL
veut appareriiment marquer, l'auteur des-' conftitu-
tions apoftoliques , qui-difent- que c’eft à-faux que.
les Nicolaïtes fe difent difçiples de-Nicolas, l’un des.
dés fept diacres, ou S. Clément: d’Alexandrie ,• qui
parle toujours fort avantageufement de ce dernier.'
La feéfe d es Nicolaïtes Se reriouvella fous. Louis le’
Debonnaire, vers l’an 852., comme lerdifc Si'gebert
de Gemblôufs dans fa chronique; & encore au-xj.
fiecle. tous: le pape Urbain II. • Ces Nicolaïtes modexk
nés étoient certains prêtres diacres 6c loudiacres,:
qui foutenoient que le mariage leur étoit permis.' Ils
turent -condamnés au concile de Plailance,»l’^nJïoh