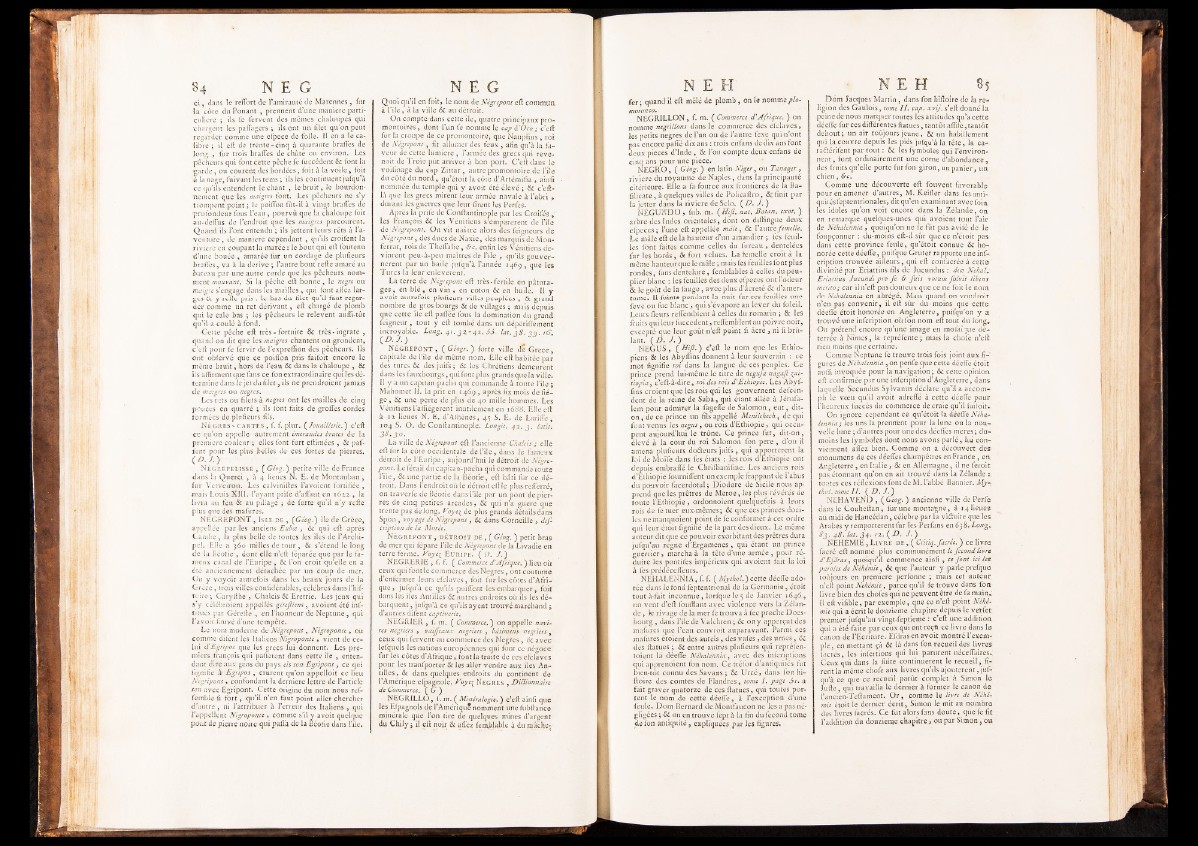
c l , dans le reïïort de l’amirauté de Marennes , fur
la côte du Ponant , prennent d’une maniéré particuliere
; ils fe fervent des mêmes chaloupes qui
•chaTgent les paffagers ; ils ont uh filet qu’on peut
regarder comme une efpece de folle. Il en a le calibre
; il eft de trente-cinq à quarante braffes de
long , fur trois braffes de chute ou environ. Les
pêcheurs qui font cette pêche fe fuccédent 6c font la
'garde, ou courent des bordées, foit à la v o ile , foit
à la nage, fuivantlestems ; ils les continuent jufqu’à
ce qu’ils entendent le chant , le bruit, le bourdonnement
que les maigres font. Les pêcheurs ne s’y
trompent point ; le poiffon fût-il à, vingt brafles de
profondeur fous l’eau, pourvu que la chaloupe foit
au-deffus de l’endroit que les maigres parcourent.
Quand ils l’ont entendu ; ils jettent leurs rêts à l’aventure,
de maniéré cependant , qu’ils croifent la
riviere en coupant la marée : le bout qui eff foutenu
d’une bouée , amarée fur un cordage de plufieurs
braffes, va à la dérivé ; l’autre bout refte amaré au
bateau par une autre corde que les pêcheurs nomment
mouvant. Si la pêche eft bonne, le negre ou
maigre s’engage dans les mailles , qui font affez larges
& y refte pris : le bas du filet qu’il faut regarder
comme un ret dérivant, eft chargé de plomb
qui le cale bas ; les pêcheurs le relevent aufli-tôt
qu’il a coulé à fond.
Cette pêche eft très - fortuite 6c très-ingrate ,
quand on dit que les maigres chantent ou grondent,
•c’eft pour fe fervir de l’expreffion des pêcheurs. Ils
ont obfervé que ce poiffon pris failoit encore le
même bruit, hors de l’eau 6c dans la chaloupe , 6c
iis affirment que fans ce fon extraordinaire qui les détermine
dans le jet du filet, ils ne prendroient jamais
de maigres ou ne gres.
Les rets ou filets à negres ont les mailles de cinq
pouces en quarré ; ils font faits de groffes cordes
formées de plufieurs fils.
NÈGRES- cartes , f. f. plur. ( Jouaillerie. ) c’eft
ce qu’on appelle autrement émeraudes brutes de la
première couleur ; elles font fort eftimées , & paf-
l'ent pour les plus belles de ces fortes de pierres.
( " • • ' • ) I I ■
Négrepelisse , ( Géog.) petite ville de France
dans la Querci , à 4 lieues N. E. de Montauban ,
fur Vetveirou. Les calviniftes l’avoient fortifiée ,
mais Louis XIII. l’ayant prife d’affaut en 1 6 1 2 , la
livra an feu & au pillage ; de forte qu’il n’y refte
plus que des mafures.
NÉGREPONT , Isle de , (Géog.') île de Grèce,
-appellée par les anciens Eubce , 6c qui eft après
Candie , la plus belle de toutes les îles de l’Archipel.
Elle a 360 milles de tour , & s’étend le long
de la Béotie , dont elle n’eft féparée que par le fameux
canal de l’Euripe, 6c l’on croit qu’elle en a
été anciennement détachée par un coup de mer.
On y voyoit autrefois clans les beaux jours de la
Grè ce, trois villes confidérables, célébrés dans l’hif-
toire ; Caryfthe , Chalcis 6c Eretrie. Les jeux qui
s’y célébroient appelles gérejiiens, avoient été inf-
îitués par Gérefte , en l’honneur de Neptune, qui
l’avoit fauve d’une tempête.
Le nom moderne de Négrepont, Négroponte, ou
comme difent les Italiens Nigroponte , vient de celui
d'Egripos que les grecs lui donnent. Les premiers
françois qui pafferent dans cette île , entendant
dire .aux gens du pays eis ton Egripont, ce qui
lignifie à Egripos , crurent qu’on appelloit ce lieu
Négripont, confondant la derniere lettre de l’article
ton avec Egripont. Cette origine du nom nous ref-
femble fi fo r t , qu’il n’en faut point aller chercher
d ’autre , ni l’attribuer à l’erreur des Italiens , qui
rappellent Nigroponte , comme s’il y avoit quelque
p oui de pierre noire qui paflà de la Béotie dans l’îie.
Quoi qu’il en foit, le nom de Négrepont eft commun
à l’île , à la ville 6c au détroit.
On compte dans cette île, quatre principaux promontoires,
dont l’un fe nomme le cap d'Oro; c’eft
fur la croupe de ce promontoire, que Nauplius , roi
de Négrepont, fit allumer des feux , afin qu’à la faveur
de cette lumière , l’armée des grecs qui reve-
noit de Troie put arriver à bon port. C ’eft dans le
voifinage du cap Zittar , autre promontoire de l’île
du côté du nord, qu’étoit la côte d’Artémifia , ainfi
nommée du temple qui y avoit été élevé ; 6c c’eft-
là que les grecs mirent leur armée navale à l’abri ,
durant les guerres que leur firent les Perfes.
Après la prife de Conftantinople par les Croifés
les François 6c les Vénitiens s’emparèrent de l’île
de Négrepont. On vit naître alors des feigneurs de
Négrepont, des ducs de Naxie, des marquis de Mon-
ferrat, rois de Theffalie, &c. enfin les Vénitiens devinrent
peu-à-peu maîtres de l’ile , qu’ils gouvernèrent
par un baile jufqu’à l’année 1469 , que les
Turcs la leur enlevèrent.
La terre de Négrepont eft très - fertile en pâturages
, en b lé , en vin , en coton 6c en huile. Il y
avoit autrefois plufieurs villes peuplées , & grand
nombre de gros bourgs & de villages ; mais depuis
que cette île eft paffée fous la domination du grand
leigneur , tout y eft tombé dans un dépériffement
incroyable. Long. 4/. 3 2 -4 2 . J i . lat. *8. 30. R mBB Négrepont , ( Géogr. ) forte ville de G rece,
capitale de l’île de même nom. Elle eft habitée par
des turcs 6c des juifs; & les Chrétiens demeurent
dans les fauxbourgs, qui font plus grands que la ville.
Il y a un capitan pacha qui commande à toute l’île ;
Mahomet IL la prit en 1469 , après fix mois defié-
g e , 6c une perte de plus de 40 mille hommes. Les
Vénitiens l’affiégerent inutilement en 1688. Elle eft
à i z lieues N. E. d’Athènes, 45 S. E. de Lariffe,
104 S. O. de Conftantinople. Longit. 42. g . Latit.
38 .30 .
La ville de Négrepont eft l’ancienne Chaleis ; elle
eftlu rla côte occidentale de l’île , dans le fameux
détroit de l'Euripe, aujourd’hui le détroit de Négrepont.
Leférail du capitan-pacha qui commande toute
l’île , 6c une partie de la Béotie, eft bâti fur ce détroit.
Dans l’endroit où le détroit eft le plusrefferré,
on traverfe de Béotie dans l’île par un pont de pierres
de cinq petires arcades, 6c qui n’a guere que
trente pas de long. Voye^ de plus grands détails dans
Spon , voyage de Négrepont, 6c dans Corneille , description
de la Morée.
Négrepont , détroit de , ( Géog. ) petit bras
de mer qui fépare l’île de Négrepont de la Livadie en
terre ferme. Voye{ Euripe. , ( L). J. )
NEGIIERIE , f. f. ( Commerce £ Afrique. ) lieu où
ceux qui font le commerce des Negres, ont coutume
d’enfermer leurs efçlaves, foit fur les côtes d’Afrique
, jufqu’à ce qu’ils puiffent les embarquer, foit
dans les îles Antilles 6c autres endroits où ils les débarquent
, jufqu’à ce qu’ils ayent trouvé marchand ;
d’autres difent captiverie.
NEGRIER, f. m. ( Commerce. ) on appelle navires
négriers , vaijfeaux négriers , bâtimens négriers,
ceux qui fervent au commerce des Negres, 6c avec
lefquels les nations européennes qui font ce négoce
fur les côtes d’Afrique, font la traite de ces efçlaves
pour les tranfporter & les aller vendre aux îles Antilles,
& dans quelques endroits du continent de
l’Amérique efpagnole, Voye{ Negres , Dictionnaire
de Commerce. ( G )
NEGRILLO, 1. m. ( Minéralogie. ) c’eft ainfi que
les Efpagnols de l’Amérique nomment une fubftance
minérale que l’on tire de quelques mines d’argent
du Chily ; il eft noir & affez fenfolable à du mâche^
fer ; quand il eft mêlé de plomb, on le nomme plomoronco.
NEGRILLON, f. m. ( Commerce d'Afrique. ) on
nomme négrillons dans le commerce des elclaves,
les petits negres de l’un ou de l’autre fexe qui n’ont
pas encore paffé dix ans : trois enfans de dix ans font
deux pièces d’Inde, & l’on compte deux enfans de
cinq ans pour une piece.
NEGRO, ( Géog, ) en latin Niger, ou Tanager ,
riviere du royaume de Naples, dans la principauté
citérieure. Elle a fa fource aux frontières de la Ba-
filicate, à quelques villes de Policaftro, & finit par.
la jetter dans la riviere de Selo. ( D . J. )
N EGUNDO, fub. m. ( Hifl..nat. Botan. exot. )
arbre des Indes orientales, dont on diftingue deux
efpeces ; l’une eft appellée mâle, 6c l’autre femelle.
Le mâle eft de la hauteur d’un amandier ; fes feuilles
font faites comme celles du fureau, dentelées
fur les bords, & fort velues. La femelle croît à la
même hauteur que le mâle ; mais fes feuilles font plus
rondes, fans dentelure, femblables à celles du peuplier
blanc : les feuilles des deux efpeces ont l’odeur
& le goût de la fauge, avec plus d’âcreté 6c d’amertume.
Il fuinte pendant la nuit fur ces feuilles une
feve'ou fuc blanc, qui s’évapore au lever du foleil.
Leurs fleurs reffemblent à celles du romarin ; & les
fruits qui leur fuccedent, reffemblent au poivre noir,
excepté que leur goût n’eft point fi âcre , ni fi brûlant.
( D . J. )
NEGUS , ( Hifl. ) c’eft le nom que les Ethiopiens
& les Abyffins donnent à leur louverain : ce
mot lignifie roi dans la langue de ces peuples. Ce
prince prend lui-même le titre de neguja nagaß {ai-
tiopia, c’eft-à-dire, roi des rois d'Ethiopie. Les Abyf-
lins croient que les rois qui les gouvernent defeen-
dent de la reine de Saba, qui étant allée à Jérufa-
Iem pour admirer la fageffe de Salomon, eu t, dit-
on , de ce prince un fils appellé Menilehech, de qui
font venus les negus, ou rois d’Ethiopie, qui occupent
aujourd’hui le trône. Ce prince fut, dit-on,
élevé à la cour du roi Salomon fon pere, d’où il
amena plufieurs do&eurs juifs, qui apportèrent la
loi de Moïfe dans fes états : les rois d’Ethiopie ont
depuis embraffé le Chriftianifme. Les anciens rois
d’Ethiopie fourniffent un exemple frappant de l’abus
du pouvoir facerdotal ; Diodore de Sicile nous apprend
que les prêtres de Meroe, les plus révérés de
toute l’Ethiopie , ordonnoient quelquefois à leurs
rois de fe tuer eux-mêmes; & que ces princes dociles
ne manquoient point de fe conformer à cet ordre
qui leur étoit fignifié de la part des dieux. Le même
auteur dit que ce pouvoir exorbitant des prêtres dura
jufqu’au regne d'Ërgamenes, qui étant un prince
guerrier, marcha à la tête d’une armée , pour réduire
les pontifes impérieux qui avoient fait la loi
à fes prédéceffeurs.
NEHALENNIA, f. f. ( Mythol.')cette déeffe adorée
dans le fond feptentrional de la G ermanie, étoit
tout à-fait inconnue, lorfque le 5 de Janvier 1646,
un vent d’eft foufllant avec violence vers la Zélande
, le rivage de la mer fe trouva à fec proche Does-
bourg , dans l’île de Valchren ; 6c on y apperçut des
mafures que l’eau couvroit auparavant. Parmi ces
mafures étoient des autels, des vafes, des urnes, 6c
des ftatues ; & entre autres plufieurs qui repréfen-
toient là déeffe Nékalennia, avec des infcriptions
qui apprenoient fon nom. Ce tréfor d’antiquités fut
bien-tôt connu des Savans ; 6c Urcé, dans fon hi-
ftoire des comtes de Flandres, tome I . page S i. a
fait graver quatorze de ces ftatues, qui toutes portent
le nom de cette déeffe, à l’exception d’une
feule. Dom Bernard de Montfaucon ne les a pas négligées
; 6c on en trouve lept à la fin du fécond tome
de fon antiquité, expliquées par les figures.
Dom Jacques Martin, dans fon hiftôîrc de la religion
des Gaulois, tome II. cap. xvij. s’eft donné la
peine de nous marquer toutes les attitudes qu’a cette
déefle fur ces différentes ftatues, tantôt affile, tantôt
debout ; un air toûjours jeune, 6c un habillement
qui la couvre depuis les piés jufqu’à la tête, la ca-
ra&érifent par tout : 6c lesfymboles qui l’environnent,
font ordinairement une corne d’abondance,
des fruits qu’elle porte fur fon giron, un panier, un
chien, &c.
Comme une découverte eft fouvent favorable
pour en amener d’autres, M. Keifler dans fes antiquités
feptentrionales, dit qu’en examinant avec foin
les idoles qu’on voit encore dans la Zélande, on
en remarque quelques-unes qui avoient tout l’air
de Nékalennia, quoiqu’on ne le fût pas avifé de le
foupçonner : du-moins eft-il sûr que ce n’étoit pas
dans cette province feule, qu’étoit connue 6c ho-,
norée cette déeffe, puifque Gruter rapporte une inf-.
cription trouvée ailleurs, qui eft conlacrée à cette
divinité par Eriattius fils de Jucundus : deoe Nehalj
Eriattius Jucundi pro fe & fuis votum folvit libens
merito; car il n’eft pas douteux que ce ne foit le nom
de Nehalennia en abrégé. Mais quand on voudroit
n’en pas convenir, il eft sûr du-moins que cette
déeffe étoit honorée en Angleterre, puifqu’on y a
trouvé une infeription où fon nom eft tout du long.
On prétend encore qu’une image en moiaï]ue déterrée
à Nîmes, la repréfente ; mais la chofe n’eft:
rien moins que certaine.
Comme Neptune fe trouve trois fois joint aux figures
de Nékalennia, on penfe que cette déeffe étoit
auffi invoquée pour la navigation; 6c cette opinion,
eft confirmée par une infeription d’Angleterre, dans
laquelle Secundus Sylvanus déclare qu’il a accompli
le voeu qu’il avoit adreffé à cette déefle pour
l’heureux fuccès du commerce de craie qu’il faifoit.,
On ignore cependant ce qu’étoit la déeffe Néha-
lennia; les uns la prennent pour la lune ou la nouvelle
lune ; d’autres pour une des déeffes meres; du-
moins les fymbetfes dont nous avons parlé, lui conviennent
affez bien. Comme on a découvert des
monumens de ces déeffes champêtres en France, en
Angleterre, en Italie, & en Allemagne, il ne feroit
pas étonnant qu’on en ait trouvé dans la Zélande
toutes ces réflexions font de M. l’abbé Bannier. My-
tkol. tome I I. ( D , J. )
NEHAVEND , ( Géog. ) ancienne ville de Perfe
dans le Couheftan, fur une montagne, à 14 lieues
au midi de Hancédan, célébré par la vidoire que les
Arabes y remportèrent fur les Perfans en 638. Long.
83. 48. lat. 34. iz . ( D . J .)
NEHÉMIE, Livre de , ( Çritiq.facrée. ) ce livre
facré eft nommé plus communément le fécond livre
d'Efdras, quoiqu’il commence ainfi , ce font ici les
paroles de Néhémie, 6c que l’auteur y parle prefque
toûjours en première perfonne ; mais cet auteur
n’eft point Nehémie, parce qu’il fe trouve dans fon
livre bien des chofes qui ne peuvent être de fa main.’
Il eft vifible, par exemple, que ce n’eft point Néké-
mie qui a écrit le douzième chapitre depuis le vetfet
premier jufqu’au vingt-feptieme : c’eft une addition
qui a été faite par ceux qui ont reçft ce livre dans le
canon de l’Ecriture. Efdras en avoit montré l’exemple,
en mettant çà 6c là dans fon recueil des livres
facrés, les infertions qui lui parurent néceffaires.;
Ceux qui dans la fuite continuèrent le recueil, firent
la même chofe aux livres qu’ils ajoutèrent, jufqu’à
ce que ce recueil parût complet à Simon le
Jufte, qui travailla le dernier à former le canon de
l’ancien-Teftament. O r , comme le livre de Néhémie
étoit le dernier écrit , .Simon le mit au nombre
des livres facrés. Ce fut alors fans doute, que fe fit
l’addition du douzième chapitre » ou par Simon, ou