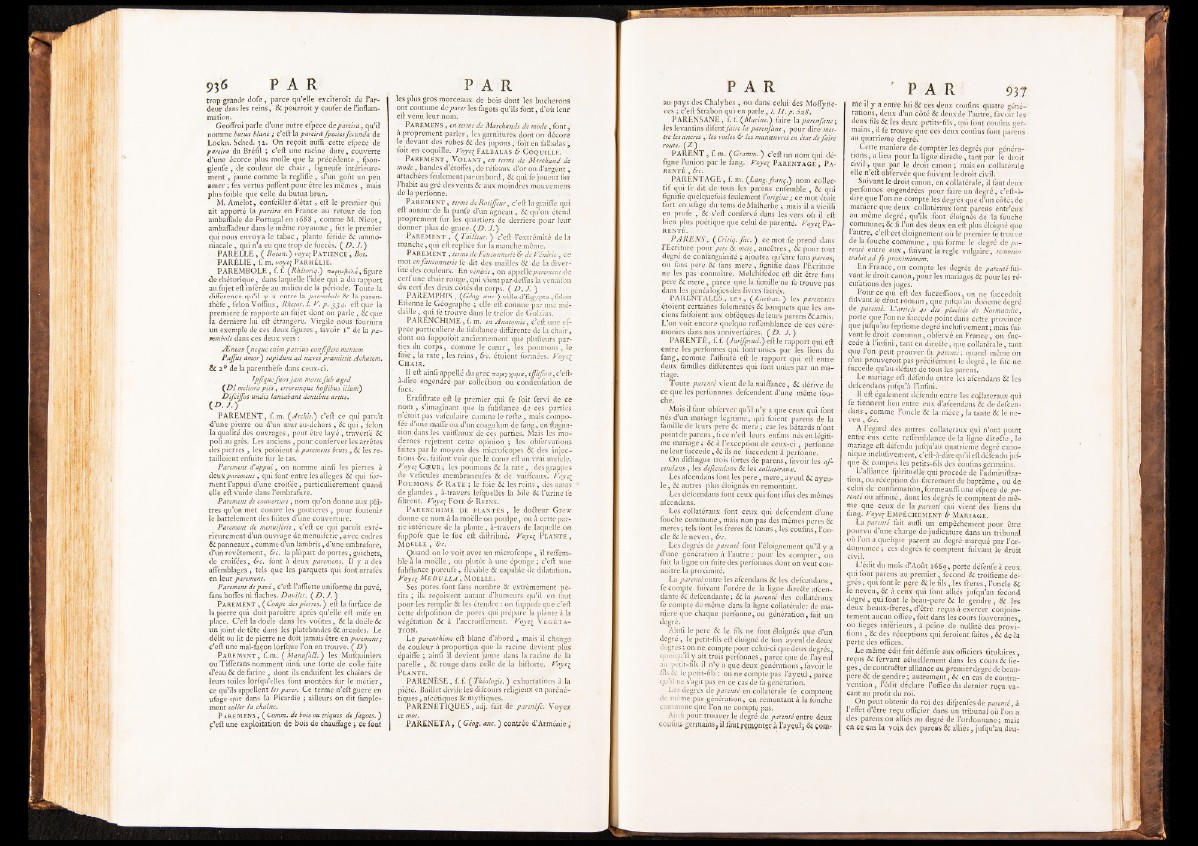
trop grande dofe, parce qu’elle exciteroit de Par-
deur dans les reins, Sc pourroit y caufer de l’inflammation.
Geoffroi parle d’une autre efpeee de partira, qu’il
nomme butna blanc ; c’eft la partirai fpeciesftcunda de
Lockn. Sched. 3Z. On reçoit auffi cette efpeee de
partira du Brélil ; c’eft une racine dure, couverte
d’une écorce plus molle que la précédente , fpon-
gieufe , de couleur de chair , ligneufe intérieurement
, jaune comme la regliflé , d’un goût un peu
amer ; fes vertus paffent pour être les mêmes , mais
plus foible que celle du butua brun.
M. Amelot, confeiller d’é ta t, eft le premier qui
ait apporté la partira en France au retour de fon
ambaffade de Portugal en 1688 , comme M. Nicot,
ambaffad'eur dans le même royaume , fut le premier
qui nous envoya le tabac, plante fétide Sc ammoniacale
, qui n’a eu que trop de fuccès. ( D . J. )
PARELLE, ( Botan.') voye£ P a t i e n c e , Bot.
PARÉLIE, f. m. voye^ P a r hélie.
PAREMBOLE, f. f. (.Rhétoriq.) , figure
de rhétorique, dans laquelle l’idee cjui a du rapport
aufujet eft inférée au milieu de la période. Toute la
différence qu’il y a entre la partmbolt Sc la paren-
thèfe, félon Vomus, Rhttor. I. V. p. 334. eft que la
première fe rapporte au fujet dont on parle , Sc que
la derniere lui eft étrangère. Virgile nous fournira
un exemple de ces deux figures , favoir i° de la pa~
rembole dans ces deux vers :
Æntas ( neque cnirn patrius conjiflere rntntem
Paffus amor) rapidum ad navts prctmitùt Achattm.
& 2° de laparenthèfe dans ceux-ci.
Jpjiquefuos m jam morte fub ægrâ meliora p iis , trroremque hoflibus ilium)
DifciJTos undis laniabant dentibus artus.
{D . J .)
PAREMENT, f. m. ( Arckit.) c’eft ce qui paroît
d ’une pierre ou d’un mur au-dehors , & q u i, félon
la qualité des ouvrages, peut être layé , traverfé &
poli au grès. Les anciens, pour conferver les arrêtes
des pierres , les pofoient à paremens bruts, Sc les re-
tailloient enfuite fur le tas.
Parement d'appui, on nomme ainfi les pierres à
deux paremens, qui font entre les allégés Sc qui forment
l’appui d’une croifée , particulièrement quand
elle eft vuide dans l’embrafûre.
Parement de couverture, nom qu’on donne aux plâtres
qu’on met contre les goutieres , pour foutenir
le battelement des fuites d’une couverture.
Parement de menuiferie, c’eft ce qui paroît extérieurement
d’un ouvrage de menuiferie, avec cadres
& panneaux, comme d’un lambris, d’une embrafure,
d’un revêtement, &c. la plupart de portes, guichets,
de croifées, &c. font à deux paremens. Il y a des
affemblages , tels que les parquets qui font arrafés
en leur parement.
Parement de pavé, c’eft l’affiette uniforme du pavé,
fans boffes ni flaches. Daviler. ( D . J. )
PAREMENT , ( Coupe des pierres. ) eft la furface de
la pierre qui doit paroître après qu’elle eft mife en
place. C ’eft la doële dans les voûtes, Sc la doële Sc
un joint de tête dans les platebandes Sc arcades. Le
délit ou lit de pierre ne doit jamais être en parement;
c’eft une mal-façon lorfque l’on en trouve. ( D )
P a r e m e n t , f.m. ( Manufacl. ) les Mufquiniers
ou Tifferans nomment ainfi une forte de colle faite
d’eau Sc de farine , dont ils enduifent les chaînes de
leurs toiles lorfqu’elles font montées fur le métier,
ce qu’ils appellent les parer. Ce terme n’eft guere en
ufage que dans la Picardie ; ailleurs on dit Amplement
coller la chaîne.
P a r e m e n s ., ( t omm.de bois ou triques de fagots. )
f ’eft une exploitation de bois de chauffage ; ce font
les plus gros morceaux de bois dont les bûcherons
ont coutume de parer les fagots qu’ ils font, d’oîi leur
eft venu leur nom.
PAREMENS , en terme de Marchands de mode , f o n t ,
à p ro p r em e n t p a r l e r , le s g a rn itu r è s d o n t o n d é c o r e
le d e v a n t d e s r o b e s Sc d e s ju p o n s , fo i t e n fa lb a la s ,
fo i t en c o q u i lle . Voye^ Fa l b a l a s 6* C o q u i l l e .
PA R EM EN T , V O L A N T , en terme de Marchand de
mode , bandes d’ étoffes, de réfeaux d’or ou d’argent ,
attachées feulement par un bord, Sc qui fe jouent fur
l’habit au gré des vents Sc aux moindres mouvemens
de la perfonne.
P a r e m e n t , terme de Rotijfeur, c’eft la graiffe qui
eft autour de la panfe d’un agneau , Sc qu’on étend
proprement fur les quartiers de derrière pour leur
donner plus de grâce. (D . J. )
P a r e m e n t , (Tailleur.') c’eft l’extrémité delà
manche, qui eft repliée fur la manche même.
P AREMENT , terme de Fauconnerie <S* de Vénerie , ce
mot en fauconnerie fe dit des mailles St de la diver-
fite des couleurs. En vénerie, on appelle parement de
cerf une chair rouge, qui vient par-defliis la venaifon
du cerf des deux côtés du corps. ( D . J . )
PAREMPHIS , (Géog. anc.) ville d’Egypte, félon
Etienne le Géographe ; elle eft connue par une médaille
, qui fe trouve dans le tréfor de Golzius.
PARENCHIME, f. m. en Anatomie, c’eft une ef-
pece particulière de fubftance différente de la chair,
dont on fuppofoit anciennement que plufieurs parties
du corps, comme le coe u r, les poumons, le
foie , la rate, les reins, &c. étoient formées. Voye^
C h a i r .
Il eft ainfi appellé du grec Traptyxvju* 5 ejfufion, c’eft-
à-dire engendre par collection ou condenfation de
fucs.
Erafiftrate eft le premier qui fe foit fefvi de ce
nom , s’imaginant que la fubftance de ces parties
n’etoit pas vafculaire comme le refte , mais compotes
d’une maffe ou d’un coagulum de fang, en ftagna-
tion dans les vaiffeaux de ces parties. Mais les modernes
rejettent cette opinion ; les obfervations
faites par le moyen des microfeopes & des injections
&c. faifant voir que le coeur eft un vrai mulcle.
Voye{ C oeur ; les poumons Sc la rate , des grappes
de veficules membraneufes & de vaiffeaux. Voyeç
P o u m o n s & R a t e ; le foie & les reins , des amas
de glandes , à-travers lefqu elles la bile Sc l’urine fe
filtrent. Voye[ F o i e & R e in s .
P a r e n c h im e d e p l a n t e s , le dofteur Gre-w
donne ce nom à la moëlle ou poulpe, ou à cette partie
intérieure de la plante, à-travers de laquelle on
fuppofe que le fuc eft diftribué. Voye^ P l a n t e ,
M o e l l e , Oc.
Quand on le voit avec un microfcope, il reffem-
ble à la moëlle , ou plutôt à une éponge ; c’eft une
fubftance poreufe, flexible & capable de dilatation.
Voye[ M E D U L L A , MOELLE.
Ses pores font fans nombre & extrêmement petits
; ils reçoivent autant d’humeurs qu’il en faut
pour les remplir & les étendre : on fuppofe que c ’eft
cette difpofition de pores qui prépare la plante à la
végétation Sc à l’accroiffement. Voye^ V é g é t a t
i o n .
Le parenchime eft blanc d’abord, mais il change
de couleur à proportion que la racine devient plus
épaiffe ; ainfi il devient jaune dans la racine de la
parelle , Sc rouge dans celle de la biftorte. Voyeç
P l a n t e .
PARENÈSE, f. f. ( Théologie. ) exhortations à la
piété. Baillet divife les difeours religieux én paréné-
tiques, afcétiques & myftiques.
PARÉNÉTIQUES, adj. fait de parenéfe. Voyez
ce mot.
PARENETA, ( Géog. anc. ) contrée d’Arménie
9
P A R
au pays des Chaiybës , ou dans celui des Moflyhe-
ces ; c’eft Strabon qui en parle , /. IL p. 6x8.
PARENSANE, f .f, (Marine.') faire la parenfane ;
les levantins difent faire la parenfane, pour dire mettre
les ancres , les voiles & les manoeuvres en état de faire
route. ( Z )
PARENT, f. m. ( Gramm. ) c’eft un nom qui dé-
figne l’union par le fang, Voye^ P a r e n t a g e , P a r
e n t é , &c.
PARENTAGE, f. m. (fang.frangé) nom collectif
qui fe dit de tous les parens enfemble , Sc qui
lignifie quelquefois feulement l’origine ; ce mot étoit
fort en ufage du tems de Malherbe ; mais il a vieilli
en profe ,S c s’eft confervé dans les vers oîi il eft
bien plus poétique que celui de parenté, Voye\ P a r
e n t é .
P A R E N S , ( Critiq. fac. ) ce mot fe prend dans
l’Ecriture pour pete & mere, ancêtres , Sc pour tout
degré de confanguinité ; ajoutez qu’être fa ns parens,
ou fans pere Sc fans mere, lignifie dans l’Ecriture
ne les pas connoître. Melchifédec eft dit être fans
pere & merë, parce que la famille ne fe trouve pas
dans les généalogies des livres facrés.
PARENTALES, LES, ( Littérat. ) les parentales
étoient certaines folemnités Sc banquets que les anciens
faifoient aux obféques de leurs parens &.amis,
L ’on voit encore quelque reffemblance de ces cérémonies
dans nosanniverfaires. ( D. J . )
PARENTÉ, f. f. (.Jurifprud.) eft le rapport qui eft
entre les perfonnes qui font unies par les liens du
làng ,, comme l’affinité eft le rapport qui eft entre
deux familles différentes qui font unies par un mariage.
Toute parenté vient de la naiffance, & dérive de
ce que les perfonnnes defeendent d’une même fou-
che.
Mais il faut obferver qu’il n’y a que ceux qui font
nés d’un mariage légitime, qui foient parens de la
famille de leurs pere & mere ; car les bâtards n’ont
point de parens, fi ce n’eft leurs enfans nés en légitime
mariage ; & à l’exception de ceux-ci , perfonne
ne leur fuccede, & ils ne fuccedent à perfonne.
On diftingue trois fortes de parens, favoir les af-
cendans , les defeendans & les collatéraux.
Les afeendans font les pere, mere, ayeul & ayeu*-
le , & autres plus éloignes en remontant.
Les defeendans font ceux qui fontiffus des mêmes
afeendans.
Les collatéraux font ceux qui defeendent d’une
fouche commune, mais non pas des mêmes peres &
meres ; tels font les freres & Iceurs, les confins, l’oncle
& le neveu, &c.
Les degrés de parenté font l’éloignement qu’il y a
d’une génération à l’autre : pour les compter, on
fuit la ligné ou fuite des perfonnes dont on veut con-
noitre la proximité.
La parenté entre les afeendans & les defeendans
fe compte fuivant l’ordre de la ligne direfte amendante
& defeendante ; Scia parenté des collatéraux
fe compte de même dans la ligne collatérale : de maniéré
que chaque perfonne, ou génération, fait un
degré.
Ainfi le pere & le fils ne font éloignés que d’un
degré , le petit-fils eft éloigné de fon ayeul de deux
degres ; on ne compte pour celui-ci que deux degrés,
quoiqu’il y ait trois perfonnes, parce que de l’ayeul
au petit-fils il n’y a que deux générations , favoir le
ms 81 le petit-fils : on ne compte pas l’ay eu l, parce
qu’il ne s’agit pas en ce cas de fa génération.
Les degrés de parenté en collatérale fe comptent
de même par génération, en remontant à la fouche
commune que l’on ne compte pas.
Ainfi pour trouver le degré de parenté entre deux
,coufius germains, il faut rçtn&ntsr à l’ayeuli & cqui-
P A R 937
lfie il y à êntre lui St ces deux coufiris quatre générations,
deux d’un côté & deux de l’autre, favoir les
deux fils & les deux petits-fils, qui font coufins germains
, il fe trouve que eës deux confins font parens
au quatrième degré.
Cette maniéré de Compter les degrés par générations
, a lieu pour la ligne dire&e, tant par le droit
civil ■, que par le droit canon ; mais en collatérale
elle n’eft obfervée que fuivant le droit civil.
Suivant le droit canon, en collatérale, il faut deux
perfonnes engendrées pour faire un degré, c’eft-à-
dire que l’on ne compté lès degrés que d’un côté; de
maniéré que deux collatéraux font parens ehtr’eux
au meme degré, qu’ils font éloignes de la fouche
commune; & fi l’un des deux en eft plus éloigné que
l’autre, c’eft cet éloignement oîi le premier fe trouve .
de la fouche commune ; qui forme le degré de parenté
entre eu x , fuivant la réglé vulgaire, remotior
trahit ad fe proximiorem.
En France, on compte les degrés de parenté fuivant
le droit canon, pour les mariages St pour les ré-
eufations des juges»
Pour ce qui eft des fuCcefliôns, On né fitecedoit
‘ fuivant le droit romain, que jufqu’au dixième degré
de parente. L!article 41 des placilés de Normandie,
porte que l’on ne fuccede point dans cette province
que jiiKju’au feptieme degré inclufivement; mais fuivant
le droit commun, obfervé en France, on fuccede
à l’infini, tant en directe, que collatérale, tant
que l’on peut prouver (a parenté ; quand même on
n’en prouveroit pas précifément le degré., le fife ne
fuccede qu’au défaut de tous les parens.
Le mariage eft défendu entre les afeendans St les
defeendans jufqu’à l’infini.
Il eft également défendu entre les collateraux qui
fe tiennent lieu entre eux d’afeendans & de defeendans,
comme l’oncle Sc la nièce, la tante St le neveu
, &c.
A l’egard des autres, collateraux qui n’ont point
entre eux cette reffemblance de la ligne direéle, le
mariage eft défendu jufqu’aü quatrième degré canonique
inclufivement, c ’eft-à-dire qu’il eft défendu juf-
que Sc compris les petits-fils des coufins germains.
L’alliance fpirituelle qui procédé de l’adminifti-a-
tien, ou réception du facrement de baptême, ou de
celui de confirmation,formeaufli une efpeee de ./>«■■»
renté ou affinité, dont les degrés fe comptent de même
que ceux de la parenté qui vient des liens du
fang. Voyei E m p ê c h e m e n t O M a r i a g e .
La parenté fait auffi un empêchement pouf être
pourvu d’une charge de judicature dans un tribunal
oii l’on a quelque parent au degré marqué par l’ordonnance
; ces degrés fe comptent fuivant le droit
civil.
L’edit du mois d’Août 1669, porte défenfe à ceux
qui font parens au premier, fécond Sc troifieme de-
gres, qui font le pgre & le fils, les freres, l’oncle Sc
le neveu, & à ceux qui font alliés jufqu’au fécond
degré, qui font le beau-pere Sc le gendre, Sc les
deux beaux-freres, d’être reçus à exercer conjoinr
tement aucun office, foit dans les cours fouveraines,
ou fieges inférieurs, à peine de nullité des provi-
fions , Sc des réceptions qui feroient faites, St de la
perte des offices.
Le même édit fait défenfe aux officiers titulaires,
reçus Sc fervant a&uellement dans les cours Sc fieges
, de contra&er alliance au premier d.egré de beau-
pere Sc de gendrè ; autrement, Sc en cas de contravention
, l’édit déclare l’office du dernier reçu vacant
au profit du roi.
On peut obtenir du roi des difpenfes de parenté, à
l’effet d’être reçu officier dans un tribunal oîi l’on a
des parens ou alliés au degré de l’ordonnane ; mais
çn ce cas la y o îx des pareas Sc alliés, jufqu’au deuil