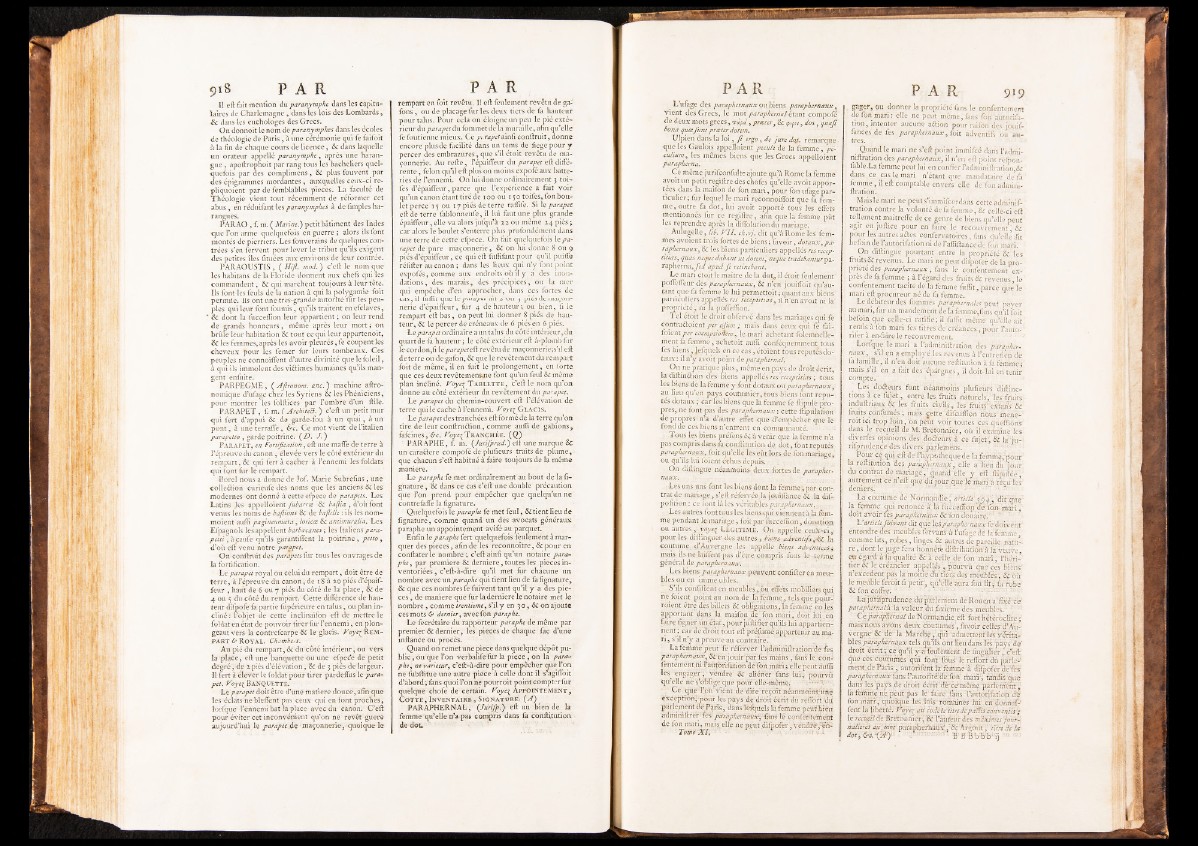
•Il eft fait mention du paranytnphe dans les capitulaires
de Charlemagne , dans les lois des Lombards,
&c dans les euchologes des Grecs.
On donnoit le nom de paranymphzs dans les écoles
de théologie de Paris, à une cérémonie qui le faifoit
à la fin de chaque cours de licence, & dans laquelle
un orateur appellé paranymphe, après une harangue
, apoftrophoit par rang tous les bacheliers quelquefois
par des complimens, & plus fouvent par
des épigrammes mordantes, auxquelles ceux-ci re-
pliquoient par de femblables pièces. La faculté de
Theologie vient tout récemment de réformer cet
abus , en réduifant les paranympkes à de fimples harangues.
PARAO, f. m. ( Marine.) petit bâtiment des Indes
que l’on arme quelquefois en guerre ; alors ils font
montés de pierriers. Les fouverains de quelques contrées
s’en fervent pour lever le tribut qu’ils exigent
des petites îles fituées aux environs de leur contrée.
PARAOUSTIS , ( Hiß. mod. ) c’eft le nom que
les habitans de la Floride donnent aux chefs qui les
commandent, & qui marchent toujours à leur tête.
Ils font les feuls de la nation qui la polygamie foit
permife. Ils ont une très-grande autorité fur les peuples
qui leur font fournis, qu’ils traitent en efclaves,
1 & dont la fucceflion leur appartient ; on leur rend
de grands honneurs, même après leur mort ; on
brûle leur habitation tout ce qui leur appartenait,
& les femmes, après les avoir pleurés, fe coupent les
cheveux f>our les feiner fur leurs tombeaux. Ces
peuples ne connoiffent d’autre divinité que le foleil,.
à qui ils immolent des viûimes humaines qu’ils mangent
enfuite.
PARPEGME, ( Aflronom. anc. ) machine agronomique
dTifage chez les Syriens & les Phéniciens,
pour montrer les folftices par l’ombre d’u q ftile.
PARAPET , f. m. ( Architecl. ) c’ eft un petit mur
qui fert d’appui & de garde-fou à un quai, à un
pont, à une terraffe, &c. Ce mot vient de l’italien
parapetto , garde poitrine. (Z>. /. )
Parapet, en Fortification, eft une mafle de terre à
l’épreuve du canon, élevée vers le côte extérieur du
rempart, & qui fert à cacher à l’ennemi les foldats
qui font fur le rempart.
Borel nous a donné de Jof. Marie Subrefius, une
collection curieufe des noms que les anciens & les
modernes Ont donné à cette efpece de parapets. Les
Latins Jes appelloient fubarroe & baßice , d’ohfont
venus les noms de baflions & de baßillc : ils les nom-
moient auffi pagineumatoe ; loricce & antimuralia. Les
Efpagnols les appellent barba canes ; les Italiens para-
peui , àcaufe qu’ils gàrantiffent la poitrine , petto ,
d’oii eft venu notre parapet.
On conftruit des parapets fur tous les ouvrages de
la fortification.
Le parapet royal ou celui du rempart, doit être de
terre, à l’épreuve du canon,- de 18à 20 piés d’épaif-
feur , haut de 6 ou 7 piés du côté de la place, & de
4 ou 5 du côté du rempart. Cette différence de hauteur
difpofe fa partie fupérieure en talus, ou plan incliné:
l?obj et de cette inçlinaifon eft de mettre le
foldat en état de pouvoir tirer fur l’ennemi, en plongeant
vers la contrefearpe & le- glacis. Voye^ R e m p
a r t & R o y a l . Chambers.
Aù-pié du rempart, & du côté intérieur, ou vers
la place , eft une banquette ou une efpec'e de petit
degré, de 2 piés d’élévation, & de 3 piés de largeur.
Il fert à élever le foldat pour tirer pardëffus le parapet.
Voye%_ Banquette.
Le parapet doit être d’une matière douce, afin que
les’ éclats ne bleffent pas ceux qui en font proches,
lorfque -l’ennemi bat la place avec du càhori. C’eft
pour éviter cet inconvénient qu’on ne revêt guere
aujourd’hui le parapet.de • maçonnerie,quoiq‘ue le
rempart en foit revêtu. Il eft feulement revêtu de ga-
fons, ou de placage fur les deux tiers de fa hauteur
pour talus. Pour cela on éloigne un peu le pié extérieur
du parapet du fommet de la muraille, afin qu’elle
fefoutienne mieux. Ce parapetainfi conftruit, donne
encore plus de facilité dans un tems de fiege pour y
percer des embrazures, que s’il étoit revêtu de maçonnerie.
Au refte, l’épaiffeur du parapet eft différente
, félon qu’il eft plus ou moins expofé aux batteries
de l’ennemi. On lui donne ordinairement 3 toi-
fes d’épaiffeur, parce que l’expérience a fait voir
qu’un canon étant tiré de 100 ou 150 toifes, fon boulet
perce 15 ou 17 piés de terre raflife. Si le parapet
eft de terre fablonneufe, il lui faut une plus grande
épaiffeur, elle va alors jufqu’à 22 ou même 24 piés ;
car alors le boulet s’enterre plus profondément dans
une terre de cette efpece. On fait quelquefois le parapet
de pure maçonnerie, & on lui donne 8 ou 9
piés d’épaiffeur, ce quiëft fuffifant pour qu’il puiffe
réfifter au canon ; dans les lieux qui n’y font point
expofés, comme aux endroits oh il y a des inondations,
des marais, des précipices, ou la mer
qui empêche d’en approcher,, dans ces fortes de
cas, il fuffit que le parapet ait 2 ou 3 piés de maçonnerie
d’épaifleur, fur 4 de hauteur; ou bien, fi le
rempart eft bas, on peut lui donner 8 piés de hauteur,
& le percer de créneaux de 6 piés en 6 piés.
Le parapet ordinaire a un talus du côté intérieur, du
quart de fa hauteur ; le côté extérieur eft à-plomb fur
le cordon,fi le parapeteft. revêtu de maçonnerie;s’il eft
de terre ou de gafon, & que le revêtement du rempart
foit de même, il en fuit le prolongement, en forte
que ces deux revêtemens.ne font qu’un feul & même
plan incliné. Voye{ T a b l e t t e , c’eft le nom qu’on
donne au côté extérieur du revêtement du parapet.
Le parapet du chemin-couvert eft l’élévation de
terre qui le cache à l’énnemi. Voye^ Glacis.
Le parapet des tranchées eft formé de la terre qu’on
tire de leur conftrucHon, comme auffi de gabions ,
fafcines, &c. Voye^T r a n c h é e . ( Q )
PARAPHE, f. m. (Jurifprud.) elf une marque &
un cara&ere compofé de plufieurs traits de plume, •
que chacun s’eft habitué à faire toujours de la même
manière.
Le paraphe fe met ordinairement au bout de la fila
t u r e , & dans ce cas C’ëft une double précaution
que l’on prend pour empêcher que quelqu’un ne
contrefaffe la fignature. ■
Quelquefois le paraphe fe met feul, & tient lieu de
fignature, comme quand un des avocats généraux
paraphe un appointement àvifé au parquet.
Enfin le paraphe fert quelquefois feulement à marquer
des pièces, afin de lès reconnoître, & pour en
conftater le nombre ; c’eft ainfi qu’un notaire paraphe,
par première & derniere, toutes les pièces inventoriées
, c’eft-à-dire qu’il met fur chacune un
nombre avec un paraphe qui tient lieu de fa fignature,
& que ces nombres fe fuiventtânt qu’il y a des pièces
, de maniéré que fur la derniere le notaire met le
nombre, comme trentième, s’il y en 30, & on ajoute
ces mots & dernier, avec fon paraphe.
Le fecrétaire du rapporteur paraphe de même par
premier & dernier, les pièces de chaque fac d’une
inftance ou procès. ’
Quand on remet une piece dans quelque dépôt pub
lic, ou que l’on verbalife fur la piece , on la paraphe,
ne varietur, c’eft-à-dire pour empêcher que l’on
nè fubft-itue une autre pièce à celle dont il s’âgiffoit
d’abord; fans quoi l’on nepôurroit point compter fur
quelque'chofe de-certain, Voye^ A p p o in t e m e n t ,
C O t t ë , In v e n t a i r e , 'S i g n a t u r e - ( A )
PARAPHERNAL, (fiurijp.') eft un bien de la
femme qu’elle n’a pas compris dans fa conftitution
de dot.
L ’ufage des paraphernaux pu bie ns paraphera aux,
vient des Grecs, le mot paraphernalèt&nt compofé
de deux mots grecs , tràpà, preeter, & <ptpv/,dos, qùafi
bona quoefunt proeter dotent.
Ulpien dans la lo i, f i ergo, de jure doj.. remarque •
que les Gaulois appelaient pécule de la femme, pï-
culium, les mêmes biens que les Grecs appelloient
parapherna.
Ce même jurifconfulte ajoute qu’à Rome la femme
avoitun petit regiftre des chofes qu’elle avôit apportées
dans la mailon de fon mari, pour fon ufage particulier;
fur lequel le mari reconnoiffoit que la femme,
outre^ fa dot, lui avoit apporté tous les effets
mentionnes fur ce regiftre, afin que la femme pût
les reprendre apres la diffolutiondu mariage. - - -
Aulugelle , lib. VII. ch.vj. dit qu’à Rome les femmes
avoient trois fortes de biens; faveir, dotaux,pâ-
raphernaux,&c les biens particuliers appellés res recep- .
tüias, quas neqtte dabant ut dotent, neque tradebantur pa-
raphèrn2i,fed àpudfie relinebant.
Le mari étoit le maître de la dot,, il étoit feulement'
poffeffeiir des paraphernaux, & ri’én jouiffôit qu’au-
tant que fa femme lë lui permettent ; quant aux biens'
particuliers appellés res receptitias, il n’en avoit ni la
propriété , ni la poffelfion.
Tel etoit le droit obfervé dans'lès mariages qui fe
contraôoient per tifum ; mais dans ceux qui fe fai-
foient per coentptiorfem, le. mari achetant folemnellè-
ment fa femme, achetoit auffi conféquemment tous
fes biens, lefqüels èn ce cas, étoient tous réputés do-;
taux : il n’y avoit point de paràpliernal.
On ne pratique plus, même en pays de droit écrit,
la diftinftiôn dès* biens appellés res receptitias ; toiis
les biens de la femme y font dotaux ou paraphernaux,
au lieu qu’en pays coutumier , tous biens font repu- ,
tes dotaux ; caries biens que la femme fe ftipulè propres,
ne font pas des paraphernaux : cette ftipùlation
de propres^ n’a d’âutrê effet que "d’empêcher que lè
fond de ces biens n’entrent en communauté.
Tous les biens préfens & rà venir que la femme n’a
pas compris dans fa conftitution dé. dot, font réputés-
paraphernaux, foit qu’elle lés eût lors de fon mariage,
ou qu’ils lui foient échus depuis-..- i l
, On diftingire néanmoins- deux fortes de paraphernaux.
.
: Les uns lins, font les biens dont la fe’mnie ‘,- p.ar contrat
de mariage, s’éft réfervéè,la jouiffance & , la di£d
pofition : ce font là les véritables paraphernaux,y, ■
Les autres; font tous les biensvqiii' viennent à. la femme
pendant le mariage, foitp.ar .fiiçceffion, dpnatiOn;
pu autres,: yoyeç Lég it im é. On appelle .eeu^rei j
pour les diftinguer des mîres^b^st-pdftent^s.-^c la.
coutume, d Auvergne les Jappellé biens adventices;&
mais ils nelaiffent pas d’être, compris fous’ T^- ternie
général de paraphernaux. •
Les bieiis paraphernaux peuWept: confifter en meur
blés ou en imme ubles.. (i
S’ils confiftent en meublés,, ,où effets mobiliers qui.
ne foient point au nom de Ta femme., tels que paiir-
rôient être des billets & obliga'tipn.s, la femme en les
apportant dans, la maifon',âé,*lfen’mâri^piîJ füi .en
faire figner un.'état, pour jji^fier.^u’ilsiùTappar^
rient; car dé droit tout eft prefume appartenir au mar
i, s’il n’y a preuve au contraire.
La femme peut fé réfefyér l’a.dminiftration'dé'iès,
paraphernaux, ’& ën.joujr^ p'af ‘fes! mains ,' fanS le. cpii--
fentemcnt.ni. l’atitorilatioh dé fon ma'ri ; elle peiit aiiffi
les engager;'-Véiïdfê' &. aliénef fans lui;, ppiirvû
‘qu’elle në s’'ôi6îi'ge que pour èlle-mêmé. . A-'.-y
’ | Ce que l’on vient de Ære reçoit néanmôihs.'iinè
ëxceptibn^poûr lés pays de'droit écrit du reflbft-’du'
pàrle.merit dé Paris , dans léèpiels la femme nefif bien
àdminiftfèrTèS pdrnpkerhdùxij farts le confèhte‘fAenit
de fon mari, mais elle ne p.eut difpofèr,' véhdfê‘,^èm
Tomi’IXr. ■ ' ■■ cri b J.
. p p f> «» donner la propriété fans le confente ment
de fon mari: elle ne peut même,fans fonaütôrifa-
tion, intenter aucune ariion pour raifôn des jpuif-
fances de fes paraphernaux, loit adventifs'ôtî au-
• très.
Quaftd le mari ne s’eft point imrnifcé dans l’admi-
niftration des paraphernaux, il n’en eft point réfpôn-
; fable.La femme peut lui en confier l’adminiftration &
dans^çe. cas le mari n’étant que mandataire deVa
femme, il eft comptable envers elle déïonadmini-
' ftration.
Mais le mari ne peut s’immxfcer dans cette adminif-
tration contre la volonté de fa femme, & celle-ci eft
tellement maîtreffe de ce genre de biens qu’élie peut
, agir en jliftice pour en faire le recouvrement, &
pour les autres attes confervatoires, fans qu’elle àit
befôirt dë l’autôrifation ni de l’affiftarice dé fon mari.
On diftingue pourtant entre la propriété & les
fruits & revenus. Le mari ne peut diipoler de la propriété
des paraphernaux, fans le confentement exprès
de fâ femme ; à l’égard des fruits & revenus, le
confentement tacite.dê'là femme fuffit, parce que le
mari eft procureur né de fa femme.
Le débiteur des fommés paraphernales peut payer
au mari, fur un mandement de la femme,fans qu’il foit
befoin que celle-ci ratifie ; il fuffit même qu’ellé ait
r ènîirà foh mari fes titresJJde'Créances, pour l’auto-1
nfçr à enéairele recouvrement.
Lorfqué; lè mari a l’adminiftration des parapher-
naux ’>. s’il en a employé,1eS revenus à Pentretien de
fa famille, il n’èn doit aucune reftitution à fa.femmëj'
mais s’il en a fait dés épargnes, il doit.'lui en tenir
comp'te."
Les dbâeurs font' néânmôiris plufieufs diftinc-
tionâ àceTûjet., entréllês 'fruits naturelsy Les'fruits
induftriauxfie -les' fruits'civils, les fruits°e^taiVs' &
fruits' confùmés; ; mais cette ‘diicuffioii :nbus: hienè- ‘
roitici trop loin,Jèn peut voir toutes ces:queftibhs'
dans le recueil de; M. Bretonnièr, oh il e^ànjine les
diverfes opinions dèsÿàbîfteûrÿ. à ce fujët ' & la ju-
r^Pru4e.nf^e'-dë's diverVjparlemëris.
Cè; qiii eft de''ïf’b y,pôtheque de la femme^our
la rèftitiition 'de? parchernatix, elle aniiéq du jour
du contrâtdë'niariagé,1 quand' elle y eft .ftipulée,
autriàne'fit ceft’ëft que dh'jôufiqûe le marra teçu'les
deniers.' y
La coutume de■ Norîritirtdiè' * ' i â r ' t i c h ïdît'divè"
la femme qui renonéé^iâ fücceffiô'n;d^loir m à i ,
doit avôir ïes parâfikAn'aux &rJfori douaire!''1 5
L 'articleJuivant dit t^el^'pafàphbrnàùjpLë^d^iit
ént&udre dè's'meublés l’ulagé àê la'Femme
c.0ï^™e .^*.K9^?s > bnges & autres de pareille nattl-
re j.dontLe.jU^efera honnêfe'diftributiôn'à la Veuve,
eu égard' à fà qualité J8t.'à Celle' de; Ton ifiàri, l’héritier
& le créancier appelles :,.pburvû quir ces Biens"
ri’excedent pâs la moitié dif tiérs des' meublés.; ôé'Ôit
le meiible fërôjt fi petit, iqitéflë’anra fôn'litç’fe^fbbê'
& foii coftre. '
La.jûtifprudence dupTlléhient dé Roûeii a ‘fixéfee
pardpherfiàlà ià valeur,dii Tixïemebes méûbles.'' '
; Ç ^ l t ÿ ^ z ^ d e ' l o|ma^Üiè(ë i ' fort hétéroclite ;
maisnous avons deux t?6utlimes', fayoir celles'd’Aii-:
!a Marche ,;qin-,:âdmëtténf-les véritables
p a ra p h e m a u x tels qu’ils ont lieu dans lés pays de'
droit écrit ; ce <^nl y^ù'Tëulëmènt de fingqjier'^ cfeft
qiié- cès CoutUirtès' qui fon r^ h i' le réffotrclû pafle-*
ment; dé Pàris ,: a'utorifeht fa’ femniê,'à di’fpôfef déTèt'
p a r à p h è r t iu u x 'ïà n g Taufont^tf^foh’ xhâriq tandis que
dans les pa^s ,de droit écrit ’dè'ëe'inême parlement,
la femme né. pèitt'.pàs- lë faire !ïans: Ldutpriïaïiôfi de
fon inàtfiqtioiqijë ■ les Tçis ‘ rb'liiMn'és lui en Jorinal-'
fent la JibettéVV è y t ^ a ü c:o d ê l e l î t r e d t p d ï ï i s c d n v c n ït s 'y
l e r e c i t e i i de Brëtdnniér, :&rTàtiteùr des m d x f a i i s f y i i r A
nàtieies âjtfirhqt pàtâpffièi‘’nâuè',"Sc ATgOut''titré dé la
■ * ¥ 8 0® ^ 13-B'BVbffirij "r‘