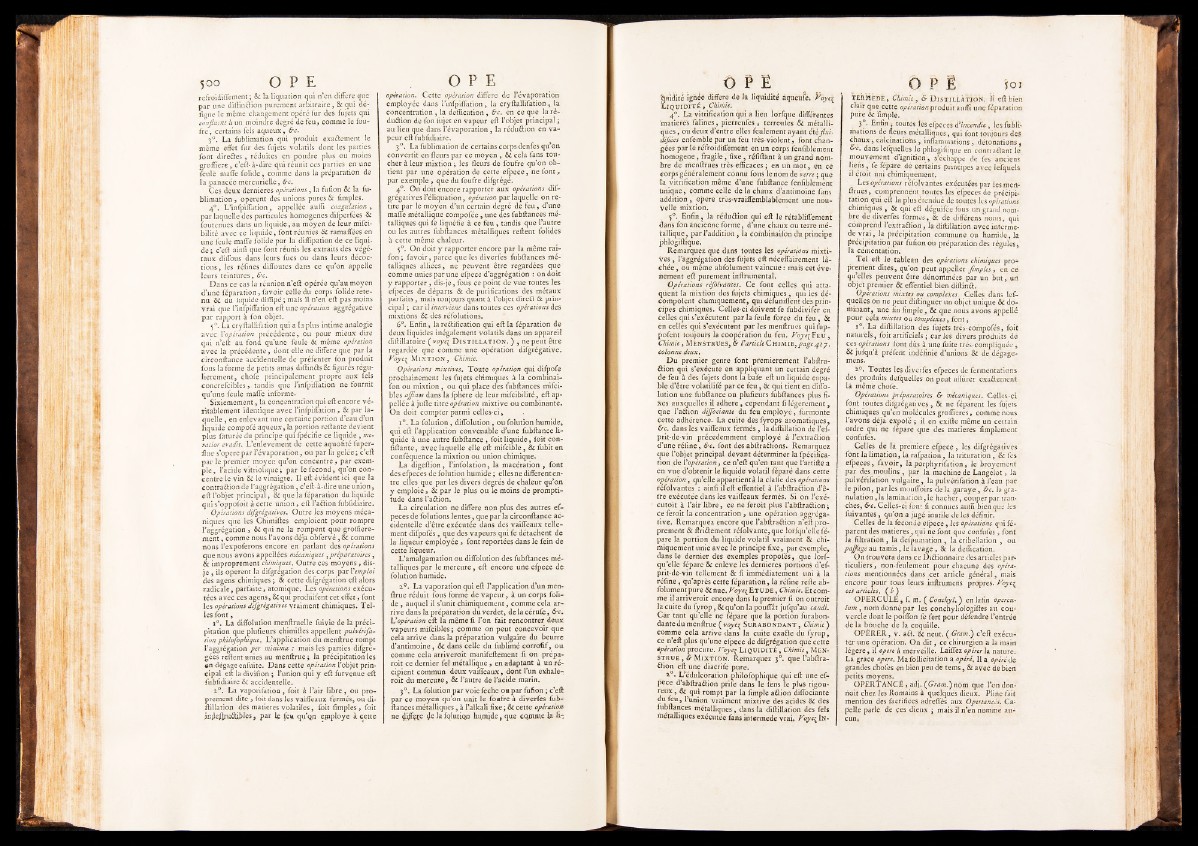
refroidiffement ; & la liquation qui n’en différé que
par une diftinCtion purement arbitraire, & qui désigne
le même changement opéré fur des fujets qui
confluent à un moindre degré de feu, comme le foutre,
certains fels aqueux, &c.
3°. La fublimation qui produit exactement le
même effet fur des fujets volatils dont les parties
font directes , réduites en poudre plus ou moins
grofïiere, c’eft- à-dire qui réunit ces parties en une
feulé maffe folide, comme dans la préparation de
la panacée mercurielle, &c.
Ces deux dernieres opérations, la fufion & la fublimation,
opèrent des unions pures & fimples.
4°. L ’infpiffation, appellée auffi coagulation,
par laquelle des particules homogènes difperfées &
foutenues dans un liquide, au moyen de leur mifci-
bilité avec ce liquide, font réunies & ramaffées en
une feule maffe folide par la diflipation de ce liquide
; c’eft ainfi que font réunis les extraits des végétaux
diffous dans leurs fucs ou dans leurs décoctions,
les refînes diffoutes dans ce qu’on appelle
leurs teintures, &c.
Dans ce cas la réunion n’eft opérée qu’au moyen
d’une féparation, favoir celle du corps folide retenu
& du liquide diflipé ; mais il n’en eft pas moins
vrai que l’infpiffation eft une opération aggrégative
par rapport à fon objet.
5°. La cryftallifation qui a la plus intime analogie
avec l’opération précédente, ou pour mieux dire
qui n’eft au fond qu’une feule & même opération
avec la précédente, dont elle ne différé que par la
circonftance accidentelle de préfenter fon produit
fous la forme de petits amas diftin&s figurés régulièrement,
chofe principalement propre aux fels
concrefcibles >. tandis que l’infpiffation ne fournit
qu’une feule maffe informe.
Sixièmement, la concentration qui eft encore v é ritablement
identique avec l’infpiffation , & par laquelle
, en enlevant une certaine portion d’eau d’un
liquide compofé aqueux, la portion reliante devient
plus faturée du principe qui fpécifie ce liquide , me-
racior evadit. L’enlevement de cette aquofité fuper-
flue s’opère par l’évaporation, ou par la gelée ; c’eft
par le premier moyen qu’on concentre , par exemple
, l’acide vitriolique ; par le fécond, qu’on concentre
le vin & le vinaigre. Il eft évident ici que la
contraction dé l’aggrégation, c’eft-à-dire une union,
eft l’objet principal, & que la féparation du liquide
qui s’oppofoit à cette union, eft l’aCtion fubfidiaire.
Opérations difgrègatives. Outre les moyens mécaniques
que les Chimiftes emploient pour rompre
l’aggrégation , & qui ne la rompent que grofliere-
ment, comme nous l’avons déjà obfervé, & comme
nous l’expoferons encore en parlant des opérations
que nous avons appellées mécaniques , préparatoires,
& improprement chimiques. Outre ces moyens, dis-
je , ils opèrent la difgrégation des corps par l’emploi
des agens chimiques ; & cette difgrégation eft alors
radicale, parfaite, atomique. Les opérations exécutées
avec ces agens, & qui produifent cet effet, font
les opérations difgrègatives vraiment chimiques. Telles
fon t ,
i° . La diffolution menftruelle fuivie de la précipitation
que plufieurs chimiftes appellent pulvérifa-
tion philofophique. L’application du menftrue rompt
l’aggrégation per minima : mais les parties difgré-
gées relient unies au menftrue ; la précipitation les
en dégage enfuite. Dans cette opération l’objet principal
eft la divifion ; l’union qui y eft furvenue eft
fubfidiaire & accidentelle.
2°. La vaporifation, foit à l’air libre, ou proprement
dite , foit dans les vaiffeaux fermés, ou di-
llillation des matières volatiles, foit fimples, foit
iudeitriiÉÜbles, par fo feu qu’qn ejnploye à cette
opération. Cette opération différé de l’évaporation
employée dans l ’infpiffation, la cryftallifation^ la
concentration , la déification , &c. en ce que la réduction
de fon fujet en vapeur eft l’objet principal ;
au lieu que dans l’évaporation, la réduction en vapeur
eft fubfidiaire.
3°. La fublimation de certains corps denfes qu’on
convertit en fleurs par ce moyen , & cela fans toucher
à leur mixtion ; les fleurs de foufre qu’on obtient
par une opération de cette efpece, ne font ,
par exemple, que du foufre difgrégé.
4°. On doit encore rapporter aux opérations dif-
grégatives l’éliquation, opération par laquelle on retire
par le moyen d’un certain degré de feu , d’une
maffe métallique eompofée , une des fubftances métalliques
qui fe liquéfie à ce feu , tandis que l’autre
ou les autres fubftances métalliques reftent folides
à cette même chaleur.
5°. On doit y rapporter encore par la même rai-
fon ; favoir, parce que les diverfes fubftances métalliques
alliées, ne peuvent être regardées que
comme unies par une efpece d’aggrégation : on doit
y rapporter, dis-je, fous ce point de vue toutes les
efpeces de départs & de purifications des métaux
parfaits, mais toujours quant à l’objet dire# & principal
; car il intervient dans toutes ces opérations des
mixtions & des réfolutions.
6°. Enfin, la rectification qui eft la féparation de
deux liquides inégalement volatils dans un appareil
diftillatoire ( voye[ D is t il l a t io n . ) , ne peut être
regardée que comme une opération difgrégative.
Voye^ Mix t io n , Chimie.
Opérations mixtives. Toute opération qui difpofe
prochainement les fujets chimiques à la combinai-
fon ou mixtion, ou qui place des fubftances mifci-
bles affinas dans la fphere de leur mifcibilité, eft appellée
à jufte titre opération mixtive ou combinante.
On doit compter parmi celles-ci,
i°. La folution, diffolution, ou folution humide,
qui eft l’application convenable d’une fubftance liquide
à une autre fubftance, foit liquide, foit con-
fiftante, avec laquelle elle eft mifcible, & fubit en
confcquence la mixtion ou union chimique.
La digeftion, l’infolation, la macération , font
des efpeces de folution humide ; elles ne different entre
elles que par les divers degrés de chaleur qu’on
y emploie, & par le plus ou le moins de promptitude
dans l’aCtion.
La circulation ne différé non plus des autres efpeces
de folutions lentes, que par la circonftance accidentelle
d’être exécutée dans des vaiffeaux tellement
difpofés , que des vapeurs qui fe détachent de
la liqueur employée , font reportées dans le fein de
cette liqueur.
L’amalgamation ou diffolution des fubftances métalliques
par le mercure, eft encore une efpece de
folution humide.
2°. La vaporation qui eft l’application d’un menftrue
réduit fous forme de vapeur, à un corps folide
, auquel il s’unit chimiquement, comme cela arrive
dans la préparation duverdet, de la cérule, &c.
Vopération eft la même fi l’on fait rencontrer deux
vapeurs mifcibles ; comme on peut concevoir que
cela arrive dans la préparation vulgaire du beurre
d’antimoine, & dans celle du fublimé corrofif, ou
comme cela arriveroit manifeftement fi on prépa-
i roit ce dernier fel métallique , en adaptant à un ré-
j cipient commun deux vaiffeaux, dont l’un exhale-,
roit du mercure, & l’autre de l’acide marin.
3°. La folution par voie feche ou par fufion ; c’eft
par ce moyen qu’on unit le foufre à diverfes fubftances
métalliques, à l’alkali fixe ; & cette opération
ne 4e la folution humj.de, que comme la h-.
tjwidité ighêè différé de là liquidité àqueiifé. 'Fàyt\
Liquidité, Chimie.
4°. La vitrification qui à lieu lorfque différentes
matières félines, pierreufes ± terreufes & métalliques
, ou deux d’entre elles feulement ayant é\éfluidifiées
enfemble par un feu très-violent j font changées
par lé réfroidiflement en un corps fenfiblément
homogène, fragile, fixe, réfiftànt à un grand nombre
dé menftrues très-efficaces ; en un mot, en ce
corps généralement connu fous le nom de verre ; que
la vitrification même d’une fubftance fenfiblement
Unique, comme celle de la chaux d’antimoine fans
addition 9 opéré très-vraiffemblablement une nouvelle
mixtion.
5°. Enfin, la réduction qui eft le rétabliffement
dans fon ancienne forme, d’une chaux ou terre métallique,
par l’addition, la combiriaifon du principe
phlogiftique.
Remarquez que dans toutes les opérations rtiixti-
v e s , l ’aggrégatiori des fiijets eft néceffairement lâchée
, ou même abfôlument vaincue : mais cet événement
eft purement inftrumental.
Opérations rèfolvàntes. Cé font celles qui attaquent
la mixtion des fujets chimiques , qui les dé-
compofent chimiquement, qui défuniffent des principes
chimiques. Celles-ci doivent fe fubdivifer en
celles qui s’exécutent par la feule force du feu , &
en celles qui s’exécutent par les menftrues qui fup-
pofeiit toujours la coopération du feu. Foye{ Feu ,
Chimie, MènstrüeS, & l'article Chimie, page41 y.
colonne deux.
Du premier genre font premièrement l’abftra-
Ction qui s’exécute en appliquant un certain degré
de feu à des fujets dont la bafe eft un liquide capable
d’être volatilifé par ce feu, & qui tient en diffolution
une fubftance ou plufieurs fubftances plus fixes
auxquelles il adhéré, cependant fi légèrement,
que l’aCtion diffiociante du feu employé, furmonte
cette adhérence. La cuite des fyrops aromatiques,
&c. dans les vaiffeaux fermés, la diftillation de l’ef-
prit-de vin précédemment employé à l’extraCtion
d’une réfine, &c. font des abllraCtions. Remarquez
que l’objet principal devant déterminer la fpécifica-
tion de Vopération , ce n’eft qu’en tant que l’artifte a
en vue d’obtenir le liquide volatil féparé dans cette
opération, qu’elle appartient à la claflè des opérations
r'ëfolvantes : ainfi il eft effeiitiel à l’abftraétion d’être
exécutée dans les vaiffeaux fermés. Si on l’exé-
cutoit à l’air libre, ce ne feroit plus l’abftraCtion;
Ce feroit la concentration , une opération aggrégative.
Remarquez encore que l’abftrariion n’ell proprement
& ftririement réfolvante, que lorfqu’elle fé-
pare lâ portion du liquide volatil vraiment & chi-
liiiquement unie avec le principe fixe, par exemple,
dans le dernier des exemples propofés, que lorfqu’elle
fépare & enleve les dernieres portions d’ef-
prit-de-vin tellement & fi imtiiédiatement uni à la
réfine, qu’àprès cette féparation, la réfine refte ab-
folument pure & nue. Etude , Chimie. Et comme
il arriveroit encore dans le premier fi on oiitroit
la cuite du fyrop, & qu’on la pouffât jufqu’au candi.
Car tant qu’elle ne lépàre que la portion furabon-
dante du menftrue ( voye{ Suit ABONDANT, Chimie )
comme' cela arrive dans la cuite exaCte du fyrop,
ce n’eft plus qu’une efpece de difgrégation que cette
Opération procure. Foye^ LIQUIDITÉ, Chimie, MENSTRUE
, & Mixtion. Remarquez 30. que l’abftra-
âion eft une diacrife pure.
a°. L’édulcoration philofophique qui eft une efpece
d’abftrariion prife dans le fens le plus rigoureux
, & qui rompt par la fimple adion diffociante
» l’union vraiment mixtive des acides & des
fubftances métalliques, dans la diftillation des fels
métalliques exécutée fans intermède vrai, Foye\ In-
TERMEDE, Chimie , & DISTILLATION; Il cftbïetî
clair que cette opération produit auflî une féparation
pure & fimple.
ipl Enfin y toutes les efpeces d’Incendie , tes fubli*
mations de fleurs métalliques, qui font toujours des
chaux $ eàlcinatibns -9 inflammations j détonations j
&c. dans iefquelles le phlogiftique en contrariant le
mouvement d’ignition , s’échappe de fes anciens
liens, fe féjjare de certains principes avec lefquelâ
il étoit uni chimiquement.
.. Les opérations rèfolvàntes exécutées par les mert-
ftrueSj comprennent toutes les efpeces cle précipitation
qui eft la plus étendue de toutes les opérations
chimiques , & qui eft déguifee fous uii grand nombre
de diverfes formes, & de différens noms, qui
comprend l’extrariioh, la diftillation avec interme-
de vrai, la précipitation commune ou humide, la
précipitation par fufion ou préparation des régules j
la cémentation.
Tel eft le tableau des opérations chimiques proprement
dites, qu’on peut appeller fimples y en cé
qu’elles peuvent être dénommées par un but, un
objet premier & effentiel bien diftinri.
Opérations mixtes ou complexes. Celles dans lefquelles
on ne peut diftinguer un objet unique & déminant
, une fin fimple, & que nous avons appelle
pour cela mixtes ou complexes, font j
iQ. Là diftillation des fujets trés-cômpofés j foit
naturels, foit artificiels ; car les divers produits dé
ces opérations font dûs à une fuite très-compliquée,
& jufqu’à préferit indéfinié d’unions & de dégagement.
izb. Toutes lés diverfes efpeces de fermentations
ftes produits defquelies on peut aiïùrer exactement
là même chofe.
Opérations préparatoires 6* 'mécaniques. Celles-ci
font toutes dilgrégatives, & ne féparent les fujets
chimiques qu’en molécules groflieres, comme nous
l’avons déjà expolé ; il en exifte même un certain
ordre qui ne féparé que des matières Amplement
cônfufes.
Celles de là première efpece y les difgrègatives
font la limation, la rafpation, la trituration, & fes
efpeces y favoir, là porphyrifation, le broyement
par des moulins , par la machine de Langelot, la
pülvérifation vulgaire, la pulvérifation à l’eau par
le pilon, par les mouffoirs delà garaye , &c. la granulation,^
Iamination,le hacher, couper par tranches,
&c. Celles-ci font fi connues aufli bien que les
fuivantes, qu’on a jugé inutile de les définir.
Celles de la fécondé efpece, les opérations qui féparent
des matières, qui ne font que cônfufes > font
la filtration, la defpumation , la eribellation , ou
pajfage au tamis, lé lavage, & la déification.
On trouvera dans ce Dictionnaire des articles pai>
ticuliers, non-feulement pour chacune des Opérations
mentionnées dans cet article général, mais
encore poitr tous leurs inftrumeiis propres. Foye^
ces articles. ( b )
OPERCULE j f. m. ( Conchyl. ) en latin opercu-
lum , nom donné par les eonchyiiologiftes au couvercle
dont le poiffon fe fert pour défendre l’entréé
de la bouche de la coquille.
OPÉRER, v . aô. & neuf. ( Gram.) c’ëft exécuter
une opération. On d it , ce chirurgien a la hiairt
légère, il opéré à merveille. Laiffez opérer la nature;
La grâce opéré. Ma follieitation a opéré. Il a. opéré de
grandes chofes en bien peu dé tems, & avec de bien
petits moyens.
OPERTANCÊ ; àdj. (Gram.) nom que l’on don-
rioit chez les Romains à quelques dieux. Pline fait
rhention des facrifices adreffés aux Opertancés. Ca;
pelle parle de ces dieux ; mais il n’en nomme aucun
«