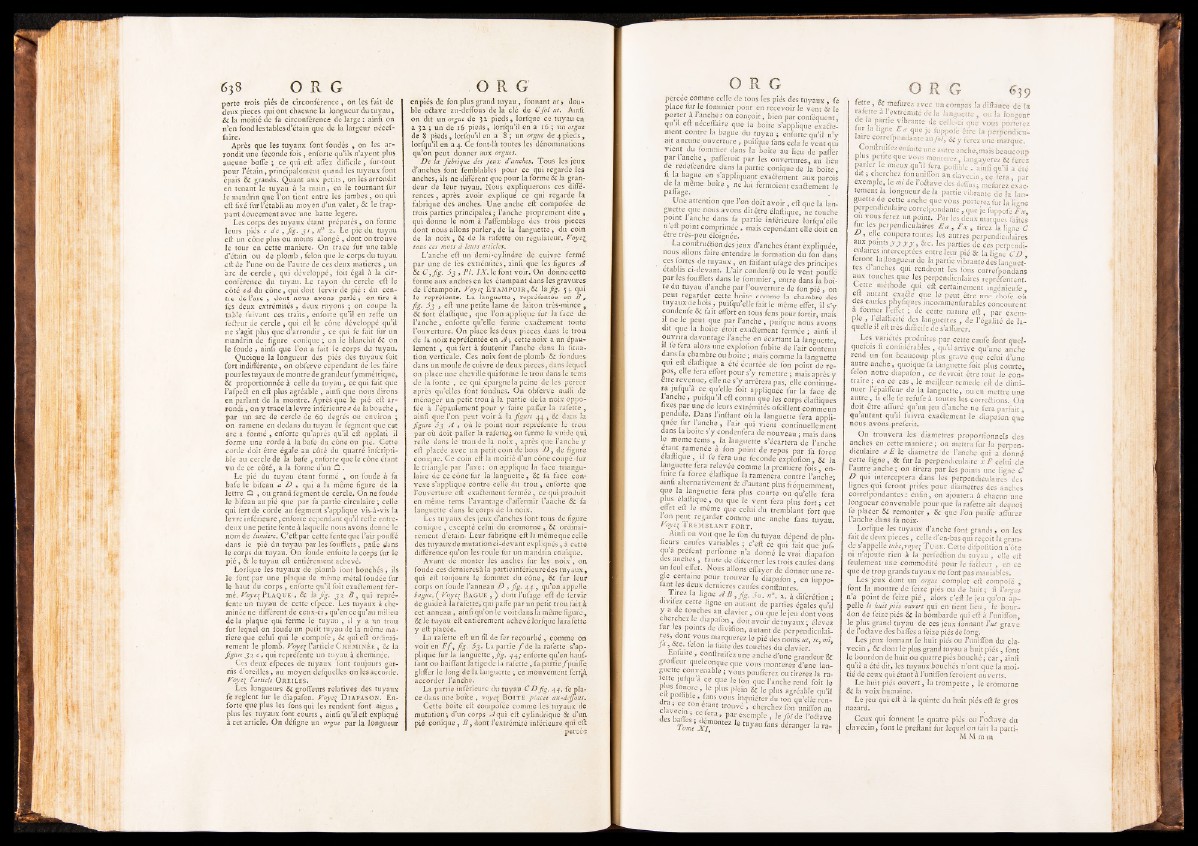
porte trois pies de circonférence, on les fait de
deux pièces qui ont chacune la longueur du tuyau,
& la moitié de fa circonférence de large : ainli on
n’en fond les tables d’étain que de la largeur nécef-
faire.
Après que les tuyaux font foudés , on les arrondit
une fécondé fois, enforte qu’ils n’ayent plus
aucune boffe ; ce qui eft affez difficile, fur-tout
pour l’étain, principalement quand les tuyaux font
épais & grands. Quant aux petits, on les arrondit
en tenant le tuyau à la main, en le tournant fur
le mandrin que l’on tient entre les jambes, ou qui
eft fixé fur l’établi au moyen d’un v alet, & le frappant
doucement avec une batte Iegere.
Les corps des tuyaux étant préparés , on forme
leurs pies c de , fig. 3 1 , n° 2. Le pié du tuyau
eft un cône plus ou moins alongé , dont on trouve
le tour en cette maniéré. On trace fur une table
d’étain ou de plomb , félon que le corps du tuyau
■ eft de l’une ou de l’autre de ces deux matières , un
arc de ce rc le , qui développé, foit égal à la circonférence
du tuyau. Le rayon du cercle eft le
côté ed du cône, qui doit fervir de pié : du centre
de l’arc , dont nous avons parlé, on tire à
fes deux extrémités, deux rayons ; on coupe la
table fuivant ces traits, enforte qu’il en refte un
fedeur de cercle , qui eft le cône développé qu’il
ne s’agit plus que d’arrondir , ce qui fe fait fur un
mandrin de figure conique ; on le blanchit & on
le foude , ainfi que l’on a fait le corps du 'tuyau.
Quoique la longueur des pies des tuyaux foit
fort indifférente, on obferve cependant de les faire
pour les tuyaux de montre de grandeur fy mmétrique,
& proportionnée à celle du tuyau, ce qui fait que
l ’afped en eft plus agréable , ainfi que nous dirons
en parlant de la montre. Après que le pié eft arrondi
, .on y trace la levre inférieure a de la bouche,
par un arc de cercle de 60 degrés ou environ ;
on ramene en dedans du tuyau le fegment que cet
arc a formé , enforte qu’après qu’il eft applati il
forme une corde à la bafe du cône ou pié. Cette
corde doit être égale au côté du quarré infcripri-
ble au cercle de la bafe , enforte que le cône étant
vu de ce côté, a la forme d’un û .
Le pié du tuyau étant formé , on foude à fa
bafe le bifeau a D , qui a la même figure de la
lettre û , ou grand fegment de cercle. On ne foude
le bifeau au pié que par fa partie circulaire ; celle
qui fert de corde au fegment s’applique vis-à-vis la
levre inférieure, enforte cependant qu’il refte entredeux
une petite fente à laquelle nous avons donné le
nom de lumière. C’eftpar cette fente que l’air pouffé
dans le pié du tuyau par les foufflets , paffe dans
le corps du tuyau. On foude enfuite le corps fur le
p ié , & le tuyau eft entièrement achevé.
Lorfque les tuyaux de plomb font bouchés , ils
le font par une plaque de même métal foudée fur
le haut du corps , enforte qu’il.foit exactement fermé.
Voye{ Plaque , & la fig. 32 B , qui repréfente
un tuyau de cette efpece. Les tuyaux à cheminée
ne différent de ceux-ci, qu’en ce qu’au milieu
de la plaque qui ferme le tuyau , il y a un trou
fur lequel on foude un petit tuyau de la même matière
que celui qui le compofe, ôc qui eft ordinairement
le plomb. Voye^ l’article Cheminée , & la
figure 32 c , qui repréfente un tuyau à cheminée.
Ces deux efpeces de tuyaux font toujours garnis
d’oreilles, au moyen defquelles on les accorde.
Voyi{ Ü article OREILES.
Les longueurs & groffeurs relatives des tuyaux
fe règlent fur le diapafon. Voye{ D ia paso n . En-
forte que plus les fons qui les rendent font aigus ,
plus les tuyaux font courts , ainfi qu’il eft expliqué
à cet article. On défigne un orgue par la longueur
enpiés de fon plus grand tuyau, fonnant ut, double
odave au-deffous de la clé de Cfol ut. Ainfi
on dit un orgue de 31 pieds, lorfque ce tuyau en
a 32 ; un de 16 pieds, lorfqu’il en a 16 ; un orgue
de 8 pieds, lorfqu’il en a 8 ; un orgue de 4 pieds,
lorfqu’il en a 4. Ce font-là toutes les dénominations
qu’on peut donner aux orgues.
De la fabrique des jeux d'anches. Tous les jeux
d’anches font femblables pour ce qui regarde les
anches, ils ne différent que pour la forme & la grandeur
de leur tuyau. Nous expliquerons ces différences
, après avoir expliqué ce qui regarde la
fabrique des anches. Une anche eft compofée de
trois parties principales ; l’anche proprement dite ,
qui donne le nom à l’affemblage des trois pièces
dont nous allons parler, de la languette, du coin
de la noix, & de la rafette ou régulateur. Voye
tous ces mots à leurs articles.
L ’anche eft un demi-cylindre de cuivre fermé
par une de fes extrémités, ainli que les figures A
& C , fig. 63 , PI. IX . le font voir. On donne cette
forme aux anches en les étampant dans les gravures
de l’étampoir. Voye{ Ét am p o ir ,& la fig. 5 f qui
le repréfente. La languette, repréfentée en B ,
fig. 63 , eft une petite lame de laiton très-mince >
& fort élaftique, que l’on applique fur la face de
l’anche, enforte qu’elle ferme exactement toute
l’ouverture. On place les deux pièces dans le trou
de la noix repréfentée en A ; cette noix a un épau*
lement , qui fert à foutenir l’anche dans la fitua-
tion verticale. Ces noix font de plomb & fondues
dans un moule de cuivre de deux pièces, dans lequel
on place une cheville qui forme le trou dans le tems
de la fonte , ce qui épargne la peine de les percer
après qu’elles font fondues. On obferve auffi de
ménager un petit trou à la partie de la noix oppo-
fée à l’épaulement pour y faire paffer la rafette ,
ainfi que l’on peut voir à la figure 44 , & dans la
figure 63 A , où le point noir repréfente le trou
par où doit pafiér la rafette* ou ferme le vuide qui
refte dans le trou de la noix , après que l’anche y
eft placée avec un petit coin de bois D y de figure
conique. Ce coin eft la moitié d’un cône coupé 'fur
le triangle par l’axe : 011 applique la face triangulaire
de ce cône fur la languette, & fa face convexe
s’applique contre celle du trou , enforte que
l’ouverture eft exactement fermée, ce qui produit
en même tems l’avantage d’affermir l’anche & fa
languette dans le corps de la noix.
Les tuyaux des jeux d’anches font tous de figure
conique , excepté celui du cromorne , & ordinairement
d’étain. Leur fabrique eft la même que celle
des tuyaux de mutation ci-devant expliqués, à cette
différence qu’on les roule fur un mandrin conique.
Avant de monter les anches fur les noix , on
foude cesdernieresàla partie inférieure des tuyaux,
qui eft toujours le fomrnet du cône, & fur leur
corps on foude l’anneau D , fig. 44 , qu’on appelle
bague. ( Voye^ Bague , ) dont l’ufage eft de fervir
de guide à la rafette, qui paffe par un petit trou fait à
cet anneau, ainfi qu’on le voit dans la même figure ,
& le tuyau eft entièrement achevé lorfque la rafette
y eft placée.
La rafette eft un fil de fer recourbé, comme on
voit en F f , fig. 63. La partie ƒ de la rafette s’applique
fur la languette, fig. 44; enforte qu’en hauf-
iant ou baiffant la tige de la rafette , fa partie/puiffe
gliffer le long de la languette ; ce mouvement fertjà
accorder l’anche.
La partie inférieure du tuyau C D fig, 44. fe place
dans une boîte , voye^ Boite placée au~dejfous.
Cette boîte eft compofée comme les tuyaux de
mutation; d’un corps -^qui eft cylindrique & d’un
pié conique, B , dont l’extrémité inférieure qui eft
percée
percée comme celle de tous les pies des tuyaux , fe
place fur le fommier pour en recevoir le vent & le
porter à l’anche: on conçoit, bien par conféquent,
qu il eft neceffaire que la boîte s’applique exade-
ment contre la bague du tuyau ; enforte qu’il n’y
ait aucune ouverture , puifque fans cela le vent qui
vient du fommier dans la boîte au lieu de paffer
par 1 anche , pafferoit par les ouvertures, au lieu
de redefeendre dans la partie conique de la boîte,
fi la bague en s’appliquant exadement aux parois
de la meme boite , ne lui fermoient exadement le
paffage.
Unè attention que l’on doit avoir, eft que la lan^
guette que nous avons dit être élaftique, ne touche
point anche dans fa partie inférieure lorfqu’elle
n eft point comprimée, mais cependant elle doit en
etre tres-peu éloignée.
La conftrudion des jeux d’anches étant èxpliquée,
nous allons faire entendre la formation du fon dans
ces fortes de tuyaux, en faifant ufage des principes
établis ci-devant. L ’air condenfé ou le vent pouffé
par les foufflets dans le fommier, entre dans la boîte
du tuyau d’anche par l’ouverture de fon pié , on
peut regarder cette boîte comme la chambre des
tuyaux de bois, puifqu’elle fait le même effet, il s’v
condenfe & fait effort en tous fens pour fortir, mais
il ne le peut que par l’anche , puifque nous avons
dit que la boîte étoit exactement fermée ; ainfi il
ouvrira davantage l’anche en écartant la languette,
il fe fera alors une explofion fubite de l’air contenu
dans la chambre ou boîte ; mais comme la languette
qui eft elaftique a été écartée de fon point de repos,
elle fera effort pour s’y remettre ; mais après y
etre revenue, elle ne s’y arrêtera pas, elle continuera
julqu a ce qu’elle foit appliquée fur la face de
1 anche, puifqu’il eft connu que les corps élaftiques
fixes par une de leurs extrémités ofcillent comme un
pendule. Dans l’inftant où la languette fera appliquée
fur l’anche , l’air qui vient continuellement
dans la boite s y condenfera de nouveau ; mais dans
le meme tems , la languette s’écartera de l’anche
étant ramenée à fon point de repos par fa force
elaftique , il fe fera une fécondé explofion, & la
languette fera relevée comme la première fois en-
fuite fa force élaftique la ramènera contre l’anche1
ainfi alternativement & d’autant plus fréquemment’
que la languette fera plus courte ou qu’elle fera
plus elaftique, ou que le vent fera plus fort ; cet
effet eft le meme que celui du tremblant fort que
i on peut regarder comme une anche fans tuyau.
' T r em b lan t f o r t . .
Ainfi on voit que le fon du tuyau dépend de plu-
fieurs caufes variables ; c’eft ce qui fait que W -
qu a prêtent perfonne n’a donné le vrai diapafon
des anch« , faute de difeerner les trois caufes dans
un feul effet. Nous allons effayer de donner une re-
gle certaine pour trouver le diapafon , en fuppo-
iant les deux dernieres caufes confiantes.
Tirez la ligne A B , f i g . ÿj>. n°. x. à ciiforëtion ;
divilez cette ligne en autant de parties égales qu’il
a 1 tollcl]ps au. clavier, ou que le jeu dont vous
cherchez le diapafon , doit a vow de tuyaux; élevez
lur les points de divifion, autant de perpendiculaires,
dont vous marquerez le pié des noms m, rc, mi,
f a , &.c. telon la fuite des touches du clavier.
tnlulte , confirmiez une anche d’une gratideur&
„rolleur quelconque que vous monterez d’une languette
convenable ; vous poufferez ou tirerez la ra-
tette julqt, a ce que le fon que l’anche rend foit le
Ü W ’ ,le Plus P‘? n i 'c plus agréable qu’il
■ H E fons vous inquiéter du ton qu’elle ren-
HW H — B H B trOL1v é', cherchez (an uniffoii au
des baffes - U 3> Pa; exe">ple, !e/i.'<ie l’oBave
T om lÿ imWtez B tU* * u 6ns dW r la rafette,
& mefurez avec un compas la diftance de la
rafette à l’extrémité de la languette , ou la longeur
de la partie vibrante de celle-ci que vous porterez
ur la ligne E u que je fuppofe être la perpendiculaire
correfpondante au fol, & y ferez une marque.
Confirmiez enfuite une autre anche,mais beaucoup
plus petite que vous monterez i langayerez & ferez
parler le mieux qu il fera poffible , ainfi qu’il a été
dit; cherchez fon ùniffon au clavecin cë fera par
exemple, le mi de l’oftave des deffus; mefurez exactement
la longueur de la partie vibrante de la languette
de cette anche que vous porterez fur [a ligne
perpendiculaire correfpondante, que je fuppofe F x
D y “ ferez ■ point. Par les deux marques faites
(ur les perpendiculaires E a , F x , tirez la ligne C
, elle coupera toutes les autres perpendiculaires
aux points j y y y c , &c. les parties de ces perpendiculaires
interceptées entre leur pié & la ligne CZ>
feront lajlqngueur de la partie vibrante dés languet-’
tes d’anches qui rendront les fons correfpondans
aux touches que les perpendiculaires représentent.
Cette méthode qui. eft certainement ingénieufe,
elt autant exafle que le peut être une chofc où
des cailles phyfiques incommenfurables concourent
a former l ’effet ; de cette nature eft , par exemple
, 1 elafticité des languettes , de l’égalité de laquelle
il eft très-difficile de s’affurer.
Les variétés produites par cette caufe font quelquefois
fi confidérables , qu’il arrive qu’une anche
rend un fon beaucoup plus grave que celui d’une
autre anche, quoique fa languette foit plus courte,
félon notre diapafon, ce devroit être tout le contraire
; en ce cas , le meilleur, remede eft de diminuer
1 epaiffeur de la languette, ou en mettre une
autre^, fi elle fe refufe à toutes les correâions. On
doit être affuré qu’un jeu d’anche ne fera parfait,
qu’autant qu’il fuivra exactement le diapafon que
nous avons preferit.
On trouvera les diamètres proportionnels des
anches en cette maniéré ; on mettra fur la perpendiculaire
a E le diamètre de l’anche qui a donné
cette ligne , & fur la perpendiculaire # F celui de
l’autre anche ; on tirera par les points une ligne C
D qui interceptera dans les perpendiculaires des
lignes qui feront prifes pour diamètres des anches
correfpondantes: enfin, on ajoutera à chacun une
longueur convenable pour que la rafette ait dequoi
fe placer & remonter , & que l’on puiffe afîiirer
l’anche dans fa noix.
Lorfque les tuyaux d’anche font grands, on les
fait de deux pièces, celle d’en-bas qui reçoit la grande
s’appelle tube^oyei T ube. Cette difpofition n’ôte
ni n’ajoute rien à la perfeftion du tuyau, elle eft
feulement une commodité pour le fadeur , en ce
que de trop grands tuyaux ne font pas maniables.
Les jeux dont un orgue complet eft compofe
font la montre de feize pies ou de huit ; fi l'orgue
n’a point de feize pié , alors c ’eft le jeu qu’on appelle
le huit pies ouvert qui en tient lieu , le bourdon
de feize pies &c la bombarde qui eft à l’uniffon,
le plus grand tuyau de ces jeux fonnant l'ut grave
de l’odave des baffes a feize pies de long.
Les jeux fonnant le huit pies ou l’uniflbn du clavecin
, & dont le plus grand tuyau a huit pies , font
le bourdon de huit ou quatre pies bouché ; car ainfi
qu’il a été dit, les tuyaux bouchés n’ont que la moitié
de ceux qui étant à l ’uniffon feroient ouverts.
Le huit piés ouvert, la trompette , le cromorne
& la voix humaine.
Le jeu qui eft à la quinte du huit piés eft le gros
nazard.
Ceux qui fonnent le quatre piés ou l’o&ave du
clavecin, font le preftant fur lequel on fait la parti-
M M m m