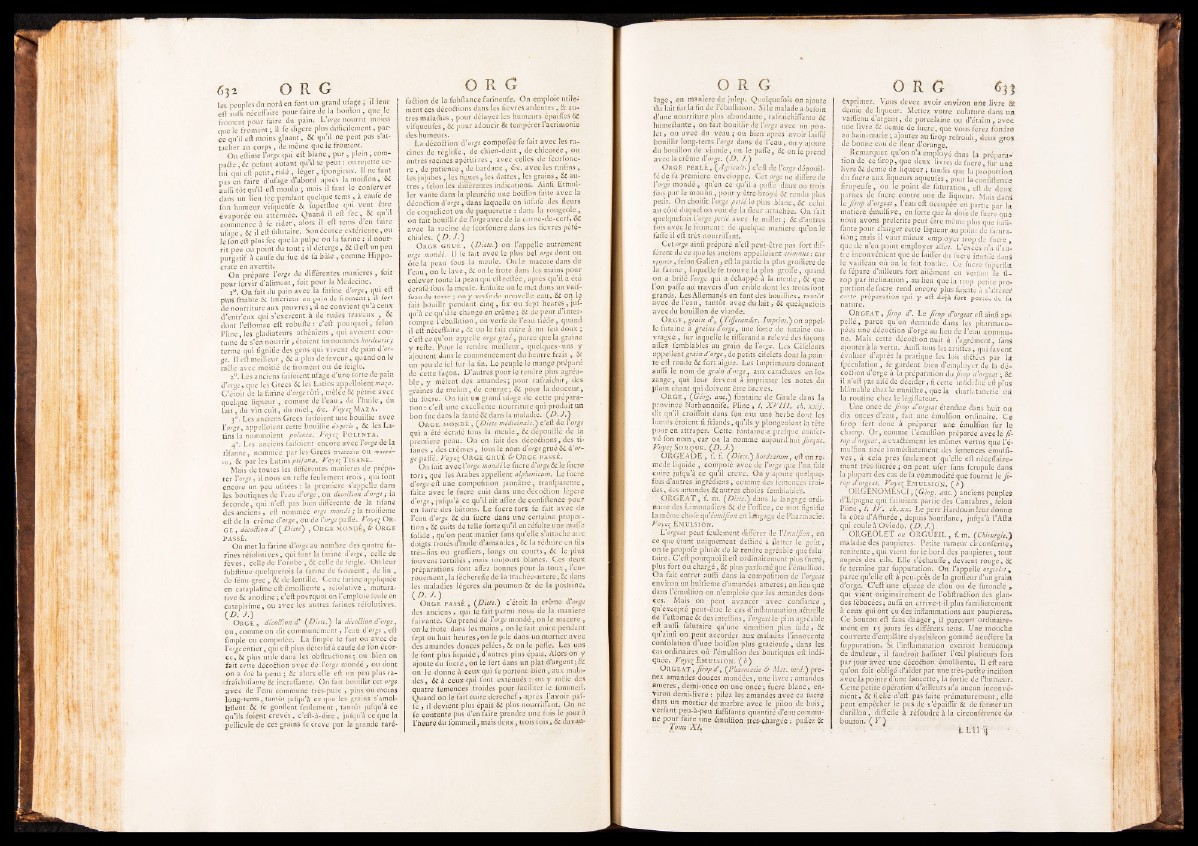
les peuples du nord en font un grand ufage ; il leur
eft auffi néceffaire pour faire de la boiflon, que le
froment pour faire du pain. L’orge nourrit moins
que le froment ; il fe digéré plus difficilement, parce
qu’il eft moins gluant, 6c qu il ne peut pas s attacher
au corps , de même que le froment.
On eftime l’orge qui eft blanc , pur, plein, corn-
patte , 6c pefant autant qu’il le peut : on rejette celui
qui eft petit, ridé , léger, fpongieux. 11 ne faut
pas en faire d’ufage d’abord apres la moiflon, 6C
auffi-tôt qu’il eft moulu ; mais il faut le coni'erver
dans un lieu (èc pendant quelque tems, à caufe de
fon humeur vifqueàfe & (uperflue qui veut etre
évaporée ou atténuée. Quand il eft le c , 6c qu n
commence à fe rider, alors il eft tems d en faire
ufage, 6c il eft falutaire. Son écorce extérieure, ou
le fon eft plus fec que la pulpe ou la farine : il nourrit
peu ou point du tout ; il déterge, 6c il eft un peu
purgatif à caufe du fuc de fa bâle , comme Hippocrate
en avertit.
On prépare l’orge de différentes maniérés, foit
pour fervir d’aliment, foit pour la Médecine. ^
i°. On fait du pain avec la farine d’orge, qui eft
plus friable 6c inférieur au pain de froment ^ il fert
de nourriture aux pauvres ; il ne convient qu’à ceux
d’entr’eux qui s’exercent à de rudes travaux , 6c
dont l’eftomac eft robufte : c’eft pourquoi, félon
Pline, les gladiateurs athéniens , qui a voient coutume
de s’en nourrir, étoient furnommés hordearii;
terme qui fignifie des gens qui vivent de pain d'or-
oe. Il eft meilleur , 6c a plus de faveur, quand on le
mêle avec moitié de froment ou de feigle.
i° . Les anciens faifoient ufage d’une forte de pain
d’orge, que les Grecs 6c les Latins appelloient maça.
C ’étoit de la farine d’orge rô ti, mêlée 6c petrie avec
quelque liqueur , comme de l’ea u , de l’huile, du
la it , du vin cuit, du miel, &c. Voye[ Ma z a .
3°. Les anciens Grecs faifoient une bouillie avec
Yorge, appelloient cette bouillie dxçnov, & les Latins
la nommoient polenta. Voye£ POLENTA.
4°. Les anciens faifoient encore avec Yorge de la
tifanne, nommée par les Grecs •x-ri&eàvn ou <snW-
v», 6c par les Latinsptijana. Voyt{T isan e.
Mais de toutes les différentes maniérés de préparer
Yorge, il nous en refte feulement trois, qui font
encore un peu ufitées : la première s’appelle dans
les boutiques de Y eau d’orge, ou décoction d’orge • la
fécondé, qui n’eft pas bien différente de la tifane
des anciens, eft nommée orge mondé; la troiiieme
eft de la crème d’orge, ou de Yorge paffé. Voye{ Orge
, décoction d’ ( Diete) , ORGE MONDE, & ORGE
PASSÉ.
On met la farine d’orge au nombre des quatre farines
réfolutives, qui (ont la farine d’orge, celle de
fè v e s , celle de l’orobe , 6c celle de feigle. On leur
fubftitue quelquefois la farine de froment, de lin ,
de fénu-grec , 6c de lentille. Cette farine appliquée
en cataplafme eft émolliente , réfolutive , matura-
tive 6c anodine ; c’ eft pourquoi on l’emploie feule en
cataplafme, ou avec les autres farines réfolutives.
(D . J.)
Or g e , décoction cf (Diete.) la décoction d'orge,
o u , comme on dit communément, l’eau d’orge, eft
iimple ou compofée. La (impie fe fait ou avec de
l’orge entier, qui eft plus déterfifà caufe de fon écorce
, 6c plus utile dans les obftruttions; ou bien on
fait cette décoôion avec de l’orge mondé , ou dont
on a ôté la peau ; 6c alors elle eft un peu plus ra-
-fraîchifl'ante & incraffante. On fait bouillir cet orge
avec de l’eau commune très-pure , plus ou moins
long-tems, tantôt jufqn’à ce que les grains s’amol-
ïiflent 6c fe gonflent feulement, tantôt jufqu’ à ce
qu’ils foient crevés , c’eft-à-dire , jufqu’à ce que la
pellicule de ces grains fe.creve par la grande raréfattion
de la fubftance farineufe. On emploie utilement
ces décodions dans les fièvres ardentes , & autres
maladies , pour délayer les humeurs épaiffes 6c
vifqueufes, 6c pour adoucir & tempérer l’acrimonie
des humeurs.
La décottion d’ orge compofée fe fait avec les racines
de régliffe, de chien-dent, de chicorée, ou
autres racines apéritives , avec celles de feorfone-
re , de patience , de bardane , &c. avec les raifins ,
les jujubes, les figues, les dattes , les grains, 6c autres
, félon les différentes indications. Ainfi Etmul-
ler vante dans la pleuréfie une boiflon faite avec la
décottion d’orge, dans laquelle on infufe des fleurs
de coquelicot ou de pâquerette : dans la rougeole,
on fait bouillir de l’orge ayec de la corne-de-cerf, 8c
avec la racine de feorfonere dans les fievres pétéchiales.
( D . J . )
Orge grué , (Diete.) on l’appelle autrement
orge mondé. U fe fait avec le plus bel orge dont on
ôte la peau fous la mèule. On le macéré dans de
l’eau on le lave, 6c on le frote dans les mains pour
enlever toute la peau qui eftreftée, après qu’il a été
écraféfous la meule. Enfuite on le met dans un vaif-
feau de terre ; on y verfe de nouvelle eau, 6c on le
fait bduillr pendant cinq, fix ou fept heures, jufqu’à
ce qu’il 1e change en crème ; 6c de peur d’interrompre
l’ébullition, on verfe de l’eau tiède, quand
il eft néceffaire, 6c on le fait cuire à un feu doux ;
c’eft ce qu’on appelle orge grué, parce que la graine
y refte. Pour le rendre meilleur, quelques-uns y
ajoutent dans le commencement du beurre frais ,
un peu de fel fur la fin. Le peuple le mange préparé
de cette façon. D ’autres pout le rendre plus agréable,
y mêlent des amandes; pour rafraîchir, des
araines de melon, de courge ; 6c pour la douceur ,
du fucre. On fait u* grand ufage de cette préparation
: c’eft une excellente nourriture qui produit un
bon fuc dans la fanté 6c dans la maladie. (D .J .)
Orge mondé , (Diete médicinale.) c’eft de Yorge
qui a été éerafé fous la meule, 6c dépouillé de fa
première peau. On en-fait des décoftions, des ti-
fanes , des crèmes, fous le nom d’orge grué 6c d’orge
paffé. Foye{ Orge grué & Orge passé.
On fait avec l’orge mondé le fucre d’orge & le fucre
tors, que les Arabes appellent alphenicum. Le fucre
d’orge eft une compofition jaunâtre, tranfparente,
faite avec le fucre cuit dans une décottion légère"
d’orge, jufqu’à ce qu’il ait affez de confidence pour
en faire des bâtons. Le fucre tors fe. fait avec de
l’eau d’orge 6c du fucre dans une certàine proportion
, 6c cuits de telle forte qu’il en réfulte une malle
folide , qu’on peut manier fans qu’elle s’attache aux
doigts frotés d’huile d’amandes, 6c la réduire en fils
très-fins ou groffiers, longs ou courts, 6c le plus
fouvent tortillés , mais toujours blancs. Ces deux
préparations font affez bonnes pour la tou x, l’enrouement,
la féchereffe de la trachée-artere, 6c dans
les maladies légères du poumon & de la poitrine.
( D . J . )
Orge passé , (Diete.) c’étoit la crème d’orge
des anciens, qui fie fait parmi nous de la maniéré
fuivante. On prend de Yorge mondé, on le macéré ,
on le frote dans les mains, on le fait cuire pendant
fept ou huit heures, on le pile dans un mortier avec
des amandes douces pelées, & on le paffe. Les uns
le font plus liquide, d’autres plus épais. Alors on y
ajoute du fucre, on le fert dans un plat d’argent ;6c
on le donne à ceux qui fe portent bien , aux malades
, & à ceux qui font exténués : on y mêle des
quatre femences .froides pour faciliter le lommeil.
Quand on le fait cuire derechef, après l’avoir paffé
, il devient plus épais 6c plus nourriffant. On ne
fe contente pas d’en faire prendre une fois le jour à
l’heure du fommeil, mais deux, trois fois, 6c dayan-
'tage, en maniéré de julep. Quelquefois on ajoute
du lait fur la fin de l’ébullition. Si le malade a befoin
d’une nourriture plus abondante, rafraichiffanre 6c
humettante , on fait bouillir de Y Orge avec un poule
t , ou avec du veau; ou bien après avoir laide
bouillir long-tems Yorge dans de l’eau , on y ajoute
du bouillon de viande , on le paffe, & on le prend
avec la crème d'orge. (D . J.)
Orge perlé , ( Agricult.) c’eft de Yorge dépouillé
de fa première enveloppe. Cet orge ne différé de
Yorge monde , quen ce qu’il a paffé deux ou trois
fois par le moulin, pour y être broyé 6c rendu plus
petit. On choifit Yorge perlé le plus blanc, 6c celui
au côté duquel on voit de la fleur attachée. On fait
quelquefois l ’orge perlé avec le millet; & d’autres
fois avec le froment :, de quelque maniéré qu’on le
faflè il eft très-nourriflant.
Cet orge ainfi préparé n’éft peut-être pas fort différent
de ce que les anciens appelloient crirnnus : car
xpifxvov, félon Galien, eft la partie la plus groffiere de
la farine, laquelle fe trouve la plus groffe, quand
on a brifé Yorge qui a échappé à la meule, & que
l’on paffe aii travers d’un crible dont les trous font
grands. Les Allemands en font des bouillies, tantôt
avec de l’eau, tantôt avec du lait, 6c quelquefois
avec du bouillon de viande.
Orge, grain dYy (TiJJerander. Imprimé) on appelle
futaine à grains d’orge, une forte d,e futaine ouvragée
, fur laquelle le tifferanda relevé des façons
affez femblables au grain de Yorge. Les Cifeleurs
appellent grain d'orge, de petits cilelets dont la pointe
eft ronde 6c fort aigue. Les Imprimeurs donnent
auffi le nom de grain d'orge, aux caratteres en lo-
zange-, qui leur fervent à imprimer les notes .du
piain chant qui doivent être brèves.
Orge ,, (Géog. anc.) fontaine de Gaule dans la
province Narbonnoife. Pline , l. X V I I I . ch. xxij.
dit qu’il croiffoit dans fon eau une herbe dont les
boeufs étoient fi friands, qu’ils y plongeoient la tête
pour en attraper. Cette fontaine a prefque confer-
v é fon nom , car on la nomme aujourd’hui forque.
Voye{ SORQUE. (D. J.)
ORGEADE , f. f. (Dicte.) kordeatum, eft un te-
mede liquide , compole avec de l’orge que l’on fait
cuire jufqü’à ce qu’il creve. On y ajoute quelquefois
d’autres ingrédiens, comme des femences froides,
des atnandes 6c autres chofes femblables.
• OR GEA T, f. m. (Diete.) dans le langage ordinaire
des Limonadiers 6c de l’office, ce mot fignifie
la même chofe qu’ émuljion en langage de Pharmacie.
Voye{ Émulsion.
L’orgeat peut feulement différer de Y émulfion, en
ce que étant uniquement deftiné à flatter le goût,
on fe propofe plutôt de le rendre agréable que falutaire.
C ’eft pourquoi il eft ordinairement plusfucré,
plus fort ou chargé, & plus parfumé que l’émulfion.
On fait entrer auffi dans la compofition de l’orgeat
environ un huitième d’amandes ameres; au lieu que
dans l’émulfion on n’emploie que les amandes douces.
Mais on peut avancer avec confiance ,
qu’excepté peut-être le cas d’inflamma'tion attuelle
de l’eftomac & des inteftins, l’orgeat le plus agréable
eft auffi falutaire qu’une émulfion plus fade, 6c
qu’ainfi on peut accorder aux malades l’innocente
confolation d’une boiflon plus gracieufe, dans les.
cas ordinaires où l’émulfion des boutiques eft indiquée.
Voye^ Émulsion, '(b)
Orgeat ,firopd', (Pharmacie & Mat. med.) prenez
amandes douces mondées, une livre ; amandes
ameres, demi-oncé ou une once; fucre blanc, environ
demi-livre : pilez les amandes avec ce fucre
dans un mortier de marbre avec le pilon de bois,'
verfant peu-à-peu fuffifante quantité d’eau commune
pour faire une émulfion très-chargée ; paffez &
Totne XI,
exprimez. Vpus devez avoir environ une livre &
demie de liqueur. Mettez votre colature dans un
vaiffeau d’argent, de porcelaine ou d’étaim, avec
une livre & demie de fucre, que vous ferez fondre
au bain-marie ; ajoutez au firop refroidi, deux gros
de bonne eau de fleur d’orange.
Remarquez qu’on n’a employé dans la prépara-"
hon de ce firop, que deux livres de fucre, fur une
livre & demie de liqueur ; tandis que la proportion
du fucre aux liqueurs aqueufes, pour la confidence
firupeufe, ou le point de faturation, eft.de deux
parties de fucre contre une de liqueur. Mais danà
le firop d'orgeat, l’eau eft occupée en partie par la
matière émulfive, en forte que la dofe de fucrë que
nous avons preferite peut être même plus que fuflb
fante pour charger cette liqueur au point de faturation
; mais il vaut mieux employer trop de fucre
que de n’en point employer affez. L’excès n’a d’autre
inconvénient que de laiffer du fucre inutile danà
le vaiffeau où on le fait fondre. Ce fucre fuperflii
fe fépare d’ailleurs fort aifément en verfant le firop
par inclination, au lieu que la trop petite proportion
de fucre rend encore plus fujette à s ’altérer1
cette préparation qui y eft déjà fort portée de fâ
nature.
Orgeat , firop d'. Le firop d’orgeat eft ainfi appelle
, parce qu on demande dans les pharmacopées
une décoftion d’orge au lieu de l ’eau commune.
Mais cette decoélion nuit à l’agrément, fans
ajouter à la vertu. Auffi tous les arciftes, qui favent
évaluer d’après la pratique les lois diétées par la
fpéculation , fe gardent bien d’employer de la dé-
coûion d’orge à la préparation du firop d'orgeat ; 6t
il n’eft pas aifé de décider, fi cette infidélité eft plus
blâmable chez le miniftre, que la charlatanerie oit
la routine chez le légiflateur.
Une once de firop d’orgeat étendue dans huit où
dix onces d’eau, fait une émulfion ordinaire. Ce
firop fert donc à préparer une émulfion fur le
champ. O r, comme l ’émulfion préparée avec le
rop d'orgeàt, a exa&ement les mêmes vertus que l’é-
mulfion tirée immédiatement des femences émulfi-
v e s , à cela près feulement quelle eft néceffaire-
ment très-fucrée ; on peut ufer fans fcrupule dans
la plupart des cas de la commodité que fournit le f i rop
d’orgeat. Voye%_ Émulsion, (h )
î ORGÉNOMESCI, (Géog. ancé) anciens peuples
d’Efpagne qui faifoient partie des Cantabres, feloii
Pline , /. IV . ch. xx. Le pere Hardouin leur donne
la côte d’Afturée , depuis Santilane, jufqu’à l’Afta
qui coule à Oviedo. (D. J.)
ORGEOLET ou ORGUEIL, f. m. ÇChirurgie.)
maladie des paupières. Petite tumeur circonfcrite,
renitente, qui vient furie bord des paupières j tout
auprès des cils. Elle s’échauffe , devient rouge, &
fe termine par fuppuration. On l’appelle orgeolit,
parce, qu’elle eft à-peu-près de la grofl'eur d’un grain
d’orge. C ’eft une efpece de clou ou de furoncle »
qui vient originairement de l’obftruftion des glandes
fébacées ; auffi en arrive-t-il plus familièrement
à ceux qui ont eu des inflammations aux paupières.
Ce bouton eft fans danger, il parcourt ordinairement
en 15 jours fes différens tems. Une mouche
couverte d’emplâtre dyachileon gommé accéléré la
fuppuration. Si l’inflammation excitoit beaucoup
de douleur, il faudrôit badiner l’oeil plufieûrs fois
par jour avec une décoéhon émolliente. Il eft rare
qu’on foit obligé d’aider par une très-petite incifion
avec,fa pointe d’une lancette, la fortie de l’hiimeur.
Cette petite opération d’ailleurs n’a aucun inconvénient,
& fi elle n’eft pas faite prématurément, elle
peut empêcher le pu s de s ’épaiffir & de former un
durillon, difficile à réfoudre à la circonférence du
bouton, ( T )