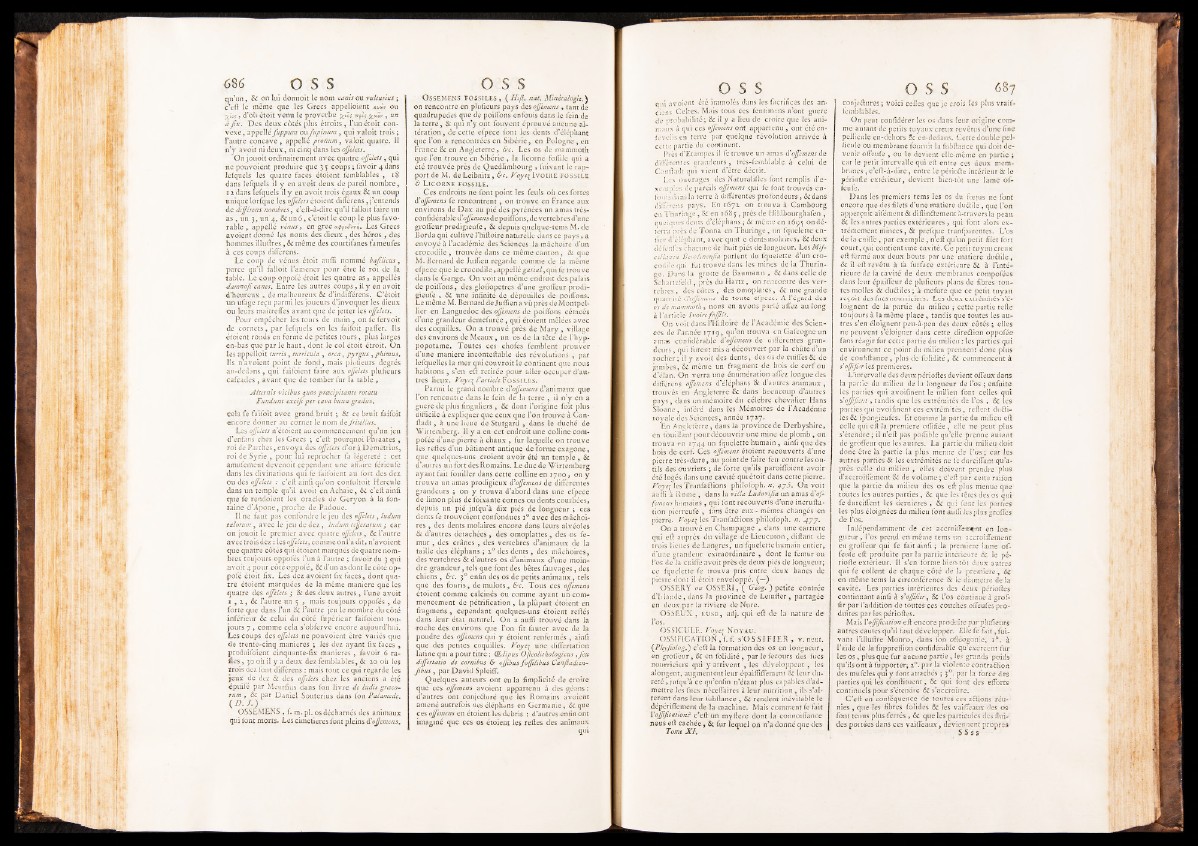
686 O S S
qu’un, & on lui donnoit le nom canîs ou vulturius ;
c’eft le même que les Grecs appelaient xuùv ou
%7o( , d’oii étoit venu le proverbe xioç vpcç %aov, un
à fix. Des deux côtés plus étroits , l’un étoit conv
e xe , appelle J'uppum ou fupinum , qui valoit trois ;
l’autre concave, appellé protium, valait quatre. Il
n’y avoit ni deux, ni cinq dans les ojfdets.
On jouoit ordinairement avec quatre ojfelets , qui
ne pouvoient produire que 3 5 coups ; (avoir 4 dans
lelquels les quatre faces étoient (èmblables , 18
dans lefquels il y en avoit deux de pareil nombre,
1 1 dans lefquels il y en avoit trois égaux & un coup
unique lorfque les ojfelets étoient différens, j’entends
de différens nombres, c’eft-à-dire qu’il falloit faire un
as , un 3, un'4, & u n 6 , c’étoit le coup le plus favorable
, appellé venus, en grec utppoéYr». Les Grecs
avoient donné les noms des dieux , des héros , des
hommes illuftres, & même des courtifanes fameufes
à ces coups différens.
Le coup de vénus étoit auffi nommé bajilicus,
parce qu’il falloit l’amener pour être le roi de la
table. Le coup oppofé étoit les quatre a s , appellés
damnoji canes. Entre les autres coups, il y en avoit
d’heureux , de malheureux & d’indifférens. C’étoit
un ufage reçu parmi les joueurs d’invoquer les dieux
ou leurs maîtrefles avant que de jetter les ojfdets.
Pour empêcher les tours de main , on fe fervoit
de cornets , par lefquels on les faifoit paffer. Ils
étoient ronds en forme de petites tours, plus larges
en-bas que par le haut, dont le col étoit étroit. On
les appelloit turris, turricula , orca, pyrgus , phimus.
Ils n’avoient point de fond, mais plufieurs degrés
au-dedans, qui faifoient faire aux ojfelets plulieurs
oafcades , avant que de tomber fur la table ,
Alternis vicibus quos prcecipiiante rotatu
Fundunt exciji per cava buxa gradus,
cela fe faifoit avec grand bruit ; & ce bruit faifoit
encore donner au cornet le nom de Jritellus.
Les ojfdets n’éioient au commencement qu’un jeu
d’enfans chez les Grecs ; c’eft pourquoi Phraates ,
roi de Parthes, envoya des ojfdets d’or à Démétrius,
roi de Syrie , pour lui reprocher fa légèreté : cet
amufement devenoit cependant une affaire férieufe
dans les divinations qui fe faifoient au fort des dez
ou des ojjelets : c’eft ainfi qu’on confultoit Hercule
dans un temple qu’il avoit en A chaïe, & c’eft ainfi
que fe rendoient les oracles de Geryon à la fontaine
d’Àpone, proche de Padoue.
Il ne faut pas confondre le jeu des ojfelets, ludum
talorum , avec le jeu de de z, Ludum tejjerarum • car
on jouoit le premier avec quatre ojfelas, & l’autre
avec trois dez : les ojfelets, comme on l’a dit, n’avoient
que quatre côtés qui étoient marqués de quatre nombres
toujours oppofés l’un à l’autre ; favoir du 3 qui
avoit 4 pour côté oppofé, & d’un as dont le côté oppofé
étoit (ix. Les dez avoient fix faces, dont quatre
étoient marquées de la même maniéré que les
quatre des ojfdets ; & des deux autres , l’une avoit
1 , 2 , & l’autre un 5 , mais toujours oppofés , de
forte que dans l’un & l ’autre jeu le nombre du côté
inférieur & celui du côté fupérieur faifoient toujours
7 , comme cela s’obferve encore aujourd’hui.
Les coups des ojfelets ne pouvoient être variés que
de trente-cinq maniérés ; les dez ayant (ix faces ,
produifoient cinquante-(ix maniérés , favoir 6 rafles
, 30 où il y a deux dez femblables, & 20 où les
trois dez font différens : mais tout ce qui regarde les
jeux de dez & des ojfdets chez les anciens a été
épuifé par Meurfius dans fon livre de ludis grceco-
rum , & par Daniel Soutenus dans fon Palamede.
m m I
OSSEMENS, f. m. pl. os décharnés des animaux
qui font morts. Les cimetières font pleins d’ojjemens.
O S S
OSSEMENS FOSSILES , ( Hifl. nat. Minéralogie. )
on rencontre en plufieurs pays des ojfemens , tant de
quadrupèdes que de poiffons enfouis dans le fein de
la terre, & qui n’y ont fouvent éprouvé aucune altération
, de cette efpece font les dents d’éléphant
que l’on a rencontrées en Sibérie, en Pologne , en
France & en Angleterre, &c. .Les os de mammoth
que l’on trouve en Sibérie , la licorne fofîiie qui a
été trouvée près de Quedlimbourg , fuivant le rapport
de M. de Leibnitz, &c. Voyer^ Ivoire fossile
& Licorne fossile.
Ces endroits ne font point les feuls où ces fortes
d'ojfemens fe rencontrent, on trouve en France aux
environs de Dax au pié des pyrénées un amas très-
confidérable d ojfemens de poiffons, de vertebres d’une
groffeur prodigieufe, & depuis quelque-tems M. de
Borda qui cultive l’hiftoire naturelle dans ce pays, a
envoyé à l’académie' des Sciences la mâchoire d’un
crocodile, trouvée dans ce même canton, & que
M. Bernard de Juffieu regarde comme de la même
efpece que le crocodile, appellé garni f qui fe trouve
dans le Gange. On voit au même endroit des palais
de poiffons, des gloffopetres d’une groffeur prodigieufe
, & une infinité de dépouilles de poiffons»
Le même M. Bernard deJuffiena vu près de Montpellier
en Languedoc des ojfemens de poiffons cétacés
d’une grandeur demefurée, qui étoient mêlées avec
des coquilles. On a trouvé près de Mary , village
des environs de Meaux, un os de la tête de l’hyp-
popotame. Toutes ces chofes femblent prouver
d’une maniéré inconteftable des révolutions , par
lefquelles la mer qui couvroit le continent que nous
habitons , s’en eft retirée pour ailer occuper d’autres
lieux. Voye^ Vartide FOSSILES.
Parmi le grand nombre à!ojfemens d’animaux que
l’on rencontre dans le fein de la terre , il n’y en a
guere de plus (inguliers , & dont l’origine foit plus
difficile à expliquer que ceux que l’on trouve à Can-
ftadt, à une lieue de Stutgard , dans le duché de
Virtemberg. Il y a en cet endroit une colline com-
pofée d’une pierre à chaux , fur laquelle on trouve
les reftes d’un bâtiment antique de forme exagone,
que quelques-uns croient avoir été un temple , &
d’autres un fort des Romains. Le duc de "Wirtemberg
ayant fait fouiller dans cette colline en 1700, on y
trouva un amas prodigieux d'ojfemens de différentes
grandeurs ; on y trouva d’abord dans une efpece
de limon plus de foixante cornes ou dents courbées,
depuis un pié jufqu’à dix pies de longueur ; ces
dents fe trouvoient confondues i° avec des mâchoires
, des dents molaires encore dans leurs alvéoles
& d’autres détachées , des omoplattes, des os fémur
, des crânes , des vertebres d’animaux de la
taille des éléphans ; 20 des dents , des mâchoires,
des vertebres & d’autres os d’animaux d’une moindre
grandeur, tels que font des bêtes fauvages, des
chiens , &c. 30 enfin des os de petits animaux, tels
que des fouris, de mulots, &c. Tous ces ojfemens
étoient comme calcinés ou comme ayant un commencement
de pétrification , la plupart étoient en
fragmens , cependant quelques-uns étoient reftés
dans leur état naturel. On a auffi trouvé dans la
-roche des environs que l’on fit fauter avec de la
poudre des ojfemens qui y étoient renfermés , ainfi
que des petites coquilles. Voyé^ une differtation
latine qui a pour titre : (Edipus Ofleolithologicus ,feu
dijfertatio de cornibus & offîbus foffilibus Canjladien-
Jibus, par David Spleiff.
Quelques auteurs ont eu la fimplicité de croire
que ces ojfemens avoient appartenu à des géans :
d’autres ont conje&uré que les Romains avoient
amené autrefois des éléphans en Germanie, & que
ces ojfemens en étoient les débris : d’autres enfin ont
imaginé que ces os étoient les reftes des animau.%
O S S
qm avoient été immolés dans les facrifices des anciens
Celtes. Mais tous ces fentimens n’ont guere
de probabilité; & il y a lieu de créire que les animaux
à qui ces ojfemens ont appartenu , ont été en*
fevelis en terre par quelque révolution arrivée à
Ci te partie du continent.
Près d’Etanupes il fe trouve un ama;> d!ojfemens de
dl entes suandeurs, très-femblabl e. à celui de
C anff:adt qui1 vient d’être décrit.
Le s ouvr;âges des Naturaiiftcs font: remplis d’ex<
les de 1pareils ojfemens qui le fon t trouvés en-
(c dans la terre à différentes profoncIcurs, &danS
di ens pa;ys. En 1672 on trouva à Cambourg
et) T lniringe , & en 1685 , près de HikIbourghafen ,
CM.U-ic,'ues derîts d’éléphans ; & même en 1695 ondéterra
orès de: Tonna en Thuringe, un fquelette entier
d ciépha nt, avec ciuat e dents mol;rires, &dei:x
de fes cha cime de huit piés de longueur. LesMifce
■ f« Bac.•linenjia parlent du fqueie tte d’un cro-
Cl " qu> ftu trouvé dans les mines 1de la Thurin-
S4î. D'ans la grotte de Baümann , & dans celle de
Sc:hartzfeld , près du Hartz, on rencontre des verte
bres;, des côtes , des omoplates, & une grande
fl1tan*ité tVoj,Temens de toute efpece. .A 1 egard des
de /narnrnothf nous en avons parlé affez au long
à l’an:icie lv *■ <ƒ#*-.
On voit d;ans l’Hiftoirè de I’Acadeirfie des Sciences
de l’année 17 19 , qu’on trouva cnGafcogne un
amas confidérable d'ojfemens de différentes grandeurs
, qui furent mis à découvert par la chute d’un
rocher; il y avoit des dents, des os de cuiffes& de
jambes., & même un fragment de bois de cerf ou
d’élan. On verra une énumération affez longue des
différens ojfemens d’éléphans & d’autres animaux ,
trouvés en Angleterre & dans beeucoup d’autres
pa ys, dans un mémoire du célébré chevalier Hans
Sloane, inféré dans les Mémoires de l’Académie
royale des Sciences; année 1727.
En Angleterre, dans la province de Derbyshire,
en fouillant pour découvrir une mine de plomb , on
trouva en 1744 un fquclette humain , ainfi que des
bois de cerf. CeS ojfemens étoient recouverts d’une
pierre très-dure, au point de faire feu contre les outils
des ouvriers ; de forte qu’ils paroifloient avoir
été logés dans une cavité qui étoit dans cette pierre.
Foye{ les Tranfa&ions philofoph. n. 475. On voit
aufli à R'ome , dans la villa Ludovijîa un amas dof-
fimens humains , qui font recouverts d’une inerufta-
tion pierreufe , (ans être eux - mêmes changés en
pierre. Voye^ les Tranfattions philofoph. n. 4yy.
On a trouvé en Champagne , dans une carrière
qui eft auprès du village de Lieucoton, diftant de
trois lieues de Langres, un fquelette humain entier,
d’une grandeur extraordinaire , dont le fémur ou
l’os de la cuiffe avoit près de deux pies de longueur;
ce fquelette fe trouva pris entre deux bancs de
pierre dont il étoit enveloppé. (—)
OSSERY ou OSSERI, ( Géog. ) petite contrée
d’Irlande, dans la province de Leinfter, partagée
en deux par la riviere de Nure.
OSSEUX, eu se , adj. qui eft de la nature de
l’os.
OSSICULE. Voyei No y a u .
O S SIFIC ATION,f.f. S’O S S IF IE R , v. neuf.
( Phyjiolog.) c’eft la formation des os en longueur,
en groffeur, & en folidité , parle fecours des lues
nourriciers qui y arrivent , les développent, les
alongent, augmentent leur épaiffiffemsnt & leur dureté
, jufqû’à ce qu’enfin n’étant plus capables d’admettre
les fucs néceffaires à leur nutrition, ils s’altèrent
dans leur fubftance , & rendent inévitable le
dépériffement de la machine. Mais comment fe fait
Vojjîfication? c’eft un myftere dont la connoiffance
nous eft cachée, &; fur lequel on n’a donné que des
Tome X L
O S S 687
conjectures ; voici celles que je crois les plus vraif-
fcmblïrbles.
On peut confidérer les os dans leur origine comme
autant de petits tuyaux creux revêtus d’une fine
pellicule en-dehors & en-dedans. Cette double pel*
licule ou membrane fournit la fubftance qui doit devenir
offeufe , ou le devient elle-même en partie ;
car le petit intervalle qui eft entre ces deux membranes
, c’eft-à-dire, entre le période intérieur & le
période extérieur, devient bien-tôt une lame of-
fèufe.
Dans les premiers tems les os du fcepis ne font
encore que des filets d’une matière du cille , que l’on
apperçoit aifément & diftinclement à-travers la peau
& les autres parties extérieures, qui font alors extrêmement
minces, & prefque tranfparentes. L’os
de la cuiffe , par exemple, n’eft qu’un petit filet fort
court, qui contient une cavité. Ce petit tuyau creux
eft fermé aux deux bouts par une matière duflile,
& il eft revêtu à fa (urface extérieure & à l’intérieure
de fa cavité de deux membranes cOmpofées
dans leur épaiffeur de plufieurs plans de fibres toutes
molles & dudiles ; à mefure que ce petit tuyau
reçoit des fîtes nourriciet's. Les deux extrémités s’éloignent
de la partie du milieu ; cette partie refte
toujours à la même place, tandis que toutes les autres
s’en éloignent peu-à-peu des deux côtés ; elles
ne peuvent s’éloigner dans cette diredion oppofée
fans réagir fur cette partie du milieu : les parties qui
environnent ce point du milieu prennent donc plus
de confiftance , plus de folidité , & commencent à
s ojjijier les premières.
L’intervalle des deux périodes devient offeux dans
la partie du milieu dé la longueur de l’os ; enfuite
les parties qui avoifinent le milieu font celles qui
s'ojffent, tandis que les extrémités de l’os , & les
parties qui avoifinent ces extrémités, reftent dnfti-
ies & fpongieufes. Et comme la partie du milieu eft
celle qui eft la première offifiée, elle ne peut plus
. s?étendre ; il n?eft pas poffible qu’elle prenne autant
de groffeur que les autres. La partie du milieu doit
donc être la partie la plus menue de l ’os ; car les
autres parties & les extrémités ne fe durciffant qu’a-
près celle du milieu , elles doivent prendre plus
d’accroifi’ement & de volume ; c ’eft par cette raifort
que la partie du milieu des os eft plus menue que
toutes les autres parties , & que les têtes des’os qui
fe durciffent les dernieres , & qui font lés parties
les plus éloignées du milieu font auffi les plus greffes
de l’os.
Indépendamment de cét accroiffemçnt en longueur,
Tos prend en même tems un accroiffement
en groffeur qui fe fait ainfi ; la première lame offeufe
eft produite par la partie intérieure le période
extérieur. Il s’en formé bien-tôt deux autres
qui fe collent de chaque côté de la première-, &
en même tems la circonférence & le diamètre delà
cavité. Les parties intérieures des deux périodes
continuant ainfi à s'ojjifier, & l’os continue à grof-
fir par l’addition de toutes ces couches offeufes produites
par les périodes.
Mais YoJJîJication eft encore produite par plufieurs
autres cautès qu’il faut développer. Elle fé fait, fuivant
l’illuftre Monro, dans Ton oftéogonie, i° . à
l’aide de la fuppreffion confidérable qu’exercent fur
les o s , plus que fur aucune partie, les grands poids
qu’ils ont à fupporter; i° . par la violente contraûion
des miifcles qui y font attachés ; 3°. par la forcé des
parties qui les conftituent, & qui font des efforts
continuels pour s’étendre & s’accroître.
C ’eft en conféquence de toutes ces aûions réu--
nies , que les fibres folides & les vaiffeaux des os
font tenus plus ferrés , & que les particules des fluides
portées dans ces vaiffeaux, deviennent propres
S S s s