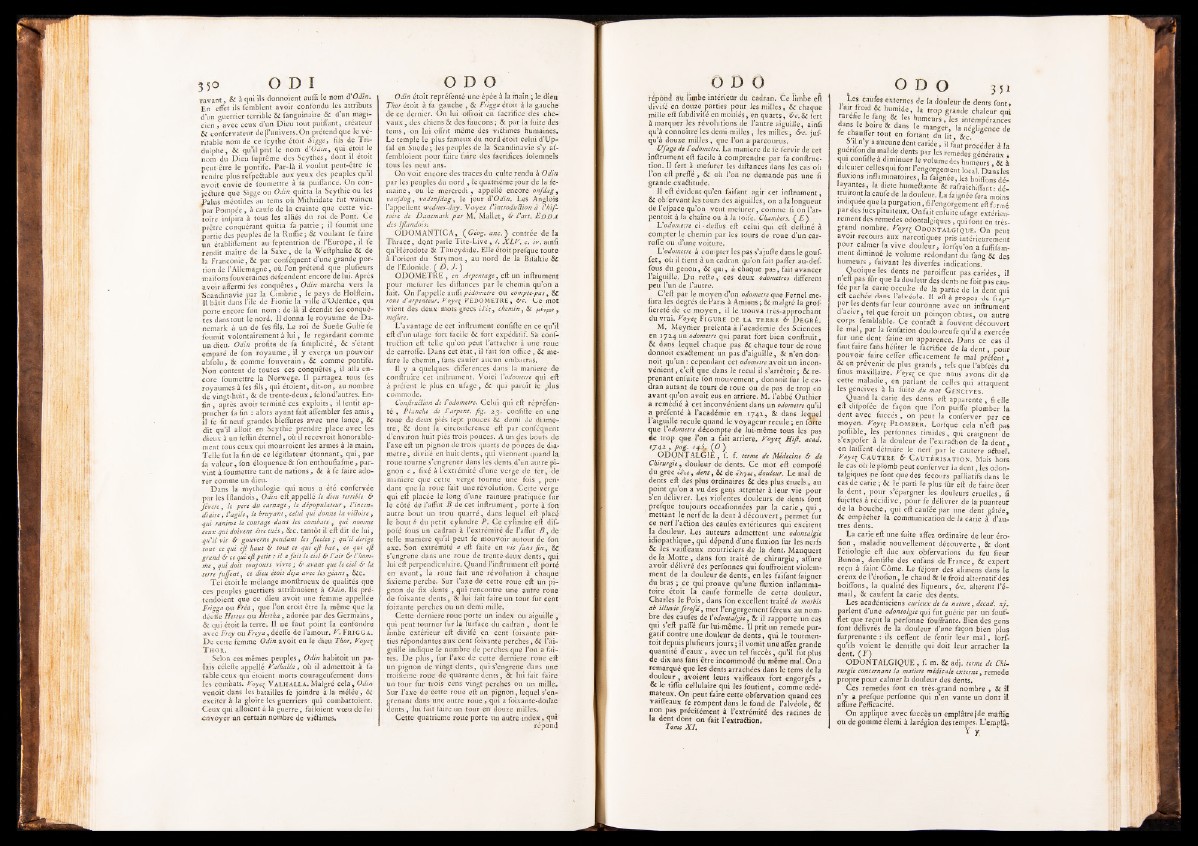
350 O D I
ravant, & à qui ils donnoient aulii le nom d’Odin.
En effet ils femblent avoir confondu les attributs
d’un guerrier terrible 6c fanguinaire & d’un magicien
, avec ceux d’un Dieu tout puiffant, créateur
& conservateur deJl’univers.On prétend que le véritable
nom de ce fcythe étoit &iggç> fils de Tri-
duiphe, 6c qu’il prit le nom d’Odiny qui étoit le
nom du Dieu fuprême des Scythes, dont il étoit
peut être le pontife. Par-là il voulut peut-etre fe
rendre plus refpeftable aux yeux des peuples qu il
a voit envie de foumettre à la puiffance. On con-
jeaure que Sigge ou Odin quitta la Scythie ou les
Palus méotides au tems où Mithridate fut vaincu
par Pompée , à caufe de la crainte que cette victoire
infpira à tous les alliés du roi de Pont. Ce
prêtre conquérant quitta fa patrie ; il fournit une
partie des peuples de la Ruflie ; & voulant fe faire
un établiffement au feptentrion de l’Europe, il fe
rendit maître de la Saxe, de la Weftphalie 6c de
la Franconie, 6c par conféquent d’une grande portion
de l’Allemagne, où l’on prétend que plufieurs
maifons fouveraines defcendent encore de lui. Après
avoir affermi fes conquêtes, Odin marcha vers la
Scandinavie par la Cimbrie, le pays de Holftein.
Il bâtit dans l’île de Fionie la ville d’Odenfée, qui
porte encore fon nom : de-là il étendit fes conquêtes
dans tout le nord. Il donna le royaume de Danemark
à un de fes fils. Le roi de Suede Gulfe fe
■ fournit volontairement à lu i, le regardant comme
un dieu. Odin profita de fa fimplicité, 6c s’étant
emparé de fon royaume, il y exerça un, pouvoir
abfolu, & comme fouverain, 6c comme pontife.
Non content de toutes ces conquêtes, il alla encore
foumettre la Norwege. Il partagea tous fes
royaumes à fes fils, qui étoient, dit-on, au nombre
de vinot-huit, & de trente-deux, félon d’autres. Enfin
, après avoir terminé ces exploits, il fentit approcher
fa fin : alors ayant fait affembler fes amis,
il fe fit neuf grandes bleffures avec une lance, 6c
dit qu’il alloit en Scythie prendre place avec les
dieux à un feftin éternel, où il recevroit honorablement
tous ceux qui mourroient les armes à la main.
Telle fut la fin de ce Iégiflateur étonnant, qui, par
1a valeur, fon éloquence & fon enthoufiafme, parvint
à foumettre tant de nations , & à fe faire adorer
comme un dieu.
Dans la mythologie qui nous a été confervée
par les Iflandois, Odin eft appellé le dieu terrible &
févcre, le pere du carnage, le dépopulateur, l'incendiaire
, l’a°ile y le bruyant, celui qui donne la victoire ,
qui ranime le courage dans les combats , qui nomme
ceux qui doivent être tues, &c. tantôt il eft dit de lui,
qu il vit & gouverne pendant les Jîecles ; qu’il dirige
tout ce qui eji haut & tout ce qui eji bas, ce qui eft
grand & ce qui eji petit : il a fait le ciel & l ’air & L'homme
y qui doit toujours vivre ; & avant que le ciel & la
■ terre juffent, ce dieu étoit déjà avec les géans, & c .
Tel étoit le mélange monftrueux de qualités que
ces peuples guerriers attribuoient à Odin. Us pré-
tendoient que ce dieu avoit une femme appellée
Frigga ou Frèa, que l’on croit être la même que la
déelfe Hertus ou Hertha, adorée par des Germains,
& qui étoit la terre. Il ne faut point la confondre
avec Frey ou Freya, déeffe de l’amour. V. Fr i g g a .
De cette femme Odin avoit eu le dieu Thor. Voyeç
T h o r .
Selon ces mêmes peuples, Odin habitoit un palais
célefte appellé Valhalla , où il admettoit à fa
table ceux qui étoient morts courageufement dans
les combats. Voyez V a l h a l l a . Malgré cela , Odin
venoit dans les batailles fe joindre à la mélée, 6c
exciter à la gloire les guerriers qui combattoient.
Ceux qui alloient à la guerre, faifoient voeu de lui
envoyer un certain nombre de viérimes.
O D O
Odin étoit repréfenté une épée à la filain ; le dieu
Thor étoit à fa gauche , & Frigga étoit à la gauche
de ce dernier. On lui offroit en facrifice des chevaux
, des chiens & des faucons; & par la fuite des
tems, on lui offrit même des viûimes humaines.
Le temple le plus fameux du nord étoit celui d’Up-
fal en Suede; les peuples de la Scandinavie s’y a1-
fembloient pour faire faire des facrifices folemnels
tous les neuf ans.
On voit encore des traces du culte rendu à Odin
par les peuples du nord , le quatrième jour de la fe-
naaine, ou le mercredi , appellé encoré onfdag 9
vonfdog, vodenfdag, le jour (Y Odin. Les Anglois
l’appellent wednes-day. Voyez l ’introduction à l’hif-
toirt de Danemark par M. Mallet, & l ’art. E d d a
des JJldndoiSx
ODOMANTICA, ( Géog. anc.') contrée de la
Thrace, dqnt parle Tite-L ive, l. XLV. d iv. ainfi
qu’Hérodote & Thucydide. Elle étoit prefque toute
à l’orient du Strymon, au nord de la Bilahie 6c
de l’Edonide. ( D . J. )
ODOMETRE , en Arpentage, eft un inftrument
pour melurer les diftances pâr le chemin qu’on a
fait. On l’appelle aufli pédometre ou compte-pas y 6c
roue d’arpenteur. Voyez P ÉD OM E TR E , &c. Ce mot
vient des deux mots grecs ôS'èç, chemin, & pirpov ,
mefure.
L’avantage de cet inftrument confifte en ce qu’il
eft d’un ufage fort facile 6c fort expéditif. Sa conf-
truûion eft telle qu’on peut l’attacher à une roue
de carroffe. Dans cet état, il fait fon office , 6c mefure
le chemin, fans caufer aucun embarras.
Il y a quelques différences dans la maniéré de
conftruire cet inftrument. Voici Yodometre qui eft
à prêtent le plus en ufage, 6c qui paroît le plus
commode.
Conjlruction de Vodometre. Celui qui eft répréfen-
té , Planche de l'arpent, fig. 23. confifte en une
roue de deux piés fept pouces 6c demi de diamètre,
6c dont la circonférence eft par conféquent
d’environ huit piés trois pouces. A un des bouts de
l’axe eft un pignon de trois quarts de pouces de diamètre,
divilé en huit dents, qui viennent quand la
roue tourne s’engrener dans les dents d’un autre pignon
c f fixé à l’extrémité d’une verge de fer, de
maniéré que cette verge tourne une fois , pendant
que la roue fait une révolution. Cette verge
qui eft placée le long d’une rainure pratiquée fur
le côté de l’affût B de cet inftrument, porte à fon
autre bout un trou quarré, dans lequel eft placé
le bout b du petit cylindre P. Ce cylindre eft dif-
pofé fous un cadran à l’extrémité de l’affût B y de
telle maniéré qu’il peut fe mouvoir autour de fon
axe. Son extrémité a eft faite en vis fans fin y 6c
s’engrene dans une roue de trente^deux dents, qui
lui eft perpendiculaire. Quand rinftrument eft porté
en avant, la roue fait une révolution à chaque
fixieme perche. Sur l’axe de cette roue eft un pignon
de fix dents , qui rencontre une autre roue
de foixante dents, & lui fait faire un tour fur cent
foixante perches ou un demi mille.
Cette derniere roue porte un index ou aiguille ,
qui peut tourner fur la furface du cadran , dont le
limbe extérieur eft divifé en cent foixante parties
répondantes aux cent foixante perches, 6c l’aiguille
indique le nombre de perches que l’on a faites.
De plus, fur l’axe de cette derniere roue eft
un pignon de vingt dents, qui s’engrene dans une
troifieme roue dé quarante dents, & lui fait faire
un tour fur trois cens vingt perches ou un mille.
Sur l’axe de cette roue eft un pignon,lequel s’engrenant
dans une autre roue, qui’ a foixante-doiîze
dents , lui fait taire un tour en douze milles.
Cette quatrième roue porte un autre index, qui
répond
O D O
frépôiid au limbe intérieur dit cadran. Ce limbe eft
divifé en douze parties pour les milles, & chaque
mille eft fubdivifé en moitiés, en quarts, &c. 6c 1er t
à marquer les révolutions de l’autre aiguille, ainfi
qu’à connoîtré les demi-milles , les milles f &c. juf-
qu’à douze milles, que l’on a parcourus.
Ufage de Codometre. La maniéré de fe fervir de cet
inftrument eft facile à comprendre par fa conftruc-
tion. Il fert à mefurer les diftances dans lés cas où
l’on eft preffé , & où l’on ne demande pas une fi
grande exaûitude.'
Il eft évident qu’en faifant agir cet inftrument,
& obfervant les tours des aiguilles, on a la longueur
de l’efpace qu’on veut melurer, comme fi on l’ar-
pentoit à la chaîne ou à la toi (c. Chambers. ( £ )
L ’odometre ci - deflùs eft celui qui eft defliné à
compter le chemin par les tours de roue d’un carroffe
ou d’une voiture.
L’odometre à compter les pas s’ajufte dans le gouf-
fe t, où il tient à un cadran qu’on fait paffer au-defi
fous du genou, & qui, à chaque pas, fait avancer
l’aiguille. Du ref teces deux odornetres different
peu l’un de l’autre.
C ’eft par le moyen d’un odometre que Fernel me-
fura les degrés de Paris à Amiens ; & malgré la grof-
fiereté de ce moyen, il le trouva très-approchant
du vrai.Voyez F i g u r e d e l a t e r r e & D e g r é .
M. Meynier préfenta à l’académie des Sciences
en 1724 un odometre qui parut fort bien conftruit,
& dans lequel chaque pas 6c chaque tour de roue
donnoit exa&ement un pas d’aiguille, & n’en don-
noit qu’un : cependant cet odometre avoit un inconvénient
, c’eft que dans le recul il s’arrêtoit ; & reprenant
enfuite fon mouvement, donnoit fur le cadran
autant de tours de roue ou de pas de trop en
avant qu’on avoit eus en arriéré. M. l’abbé Outhier
a remédié à cet inconvénient dans un odometre qu’il
a préfenté à l'académie en 1742, & dans lequel
l ’aiguille recule quand le voy ageur recule ; en fwte
que Yodometre décompte de lui-même tous les pas
de trop que l’on a fait arriéré, Voyez Hift. acad.
17qz , pag. 14& (O )
O D O N T A LG IE , f. f. terme de Médecine & de
Chirurgie, douleur de dents. Ce mot eft compofé
du grec ôS'çc, dent t 6c de d^yogy douleur. Le mal de
dents eft des plus ordinaires & des plus cruels., au
point cju’on a vu des geqs attenter à leur vie pour
s’en délivrer. Les violentes douleurs de dents font
prefque toujours occafionnées par la carie, q u i,
mettant le nerf de la dent à découvert, permet fur
ce nerf l’aélion des caufes extérieures qui excitent
la douleur. Les auteurs admettent une odontalgie
idiopathique, qui dépend d’une fluxion fur les nerfs
6c les vaiffeaux nourriciers de la dent. Mauquert
de la Motte, dans fon traité de chirurgie, affure
avoir délivré des perfonnes qui fouffroient violemment
de la douleur de dents, en les faifant faigner
du bras ; ce qui prouve qu’une fluxion inflammatoire
étoit la caufe formelle de cette douleur.
Charles le Pois, dans fon excellent traité de rnorbis
ab illuvie ferofâ, met l’engorgement féreux au nombre
des caufes de Yodontalgie, & il rapporte un cas
qui s eft paffe fur lui-même. Il prit un remede purgatif
contre une douleur de dents, qui le tourmen-
toit depuis plufieurs jours ; il vomit une affez grande
quantité d’eaux , avec un tel fuccès, qu’il nit plus
ce dix ans fans être incommodé du même mal.On a
remarqué que les dents arrachées dans le tems de la
douleur , avoient leurs vaiffeaux fort engorgés ,
61 le tiffu cellulaire qui les foutient, comme oedé-
mateux. O n peut faire cette obfervation quand ces
vaiffeaux fe rompent dans le fond de l’alvéole, 6c
non pas précifément à l’extrémité des racines de
la dent dont on fait l’extra&ion,
Tome X I ,
O D O
P ^a} ’ fes b e rn e s de là douleur de dents font»
la ir froid & hunude, la trop grande chaleur qui
raréfié le faug & les humeurs » les intempérances
dans le boire & dans le manger, la négligence de
fe chauffer tout en fartant du lit &c ° “
S bU V a aucune dent cariée, il faut procéder à ht
guehfondu mal de dents par les remèdes généraltx 4
qui confifte à diminuer le volume des humeurs & à
dilcmer cellèsqui font l’engorgement local. Dansles
fluxions inflammatoires, la faignée, les boiffons délayantes,
la diète humeéiante & rafràichiffante détruiront
la caufe de la douleur. La faignée fera moins
indiquée que la purgation, fi l’engorgement eft formé
par dès fucs pituiteux. Onfait enfuite ufage extérieur
remen t des remedes odontalgiques, qui (Ont en très-
grand nombre. Voyt^ O d o n t a l g i q u e . On peut
avoir recours aux narcotiques pris intérieurement
pour calmer la vive douleur, Iorfqu’on a fuffifam-
; ment diminué le volume redondant du fang 6c des
humeurs , fuivant les diverfes indications
, § UOJ^ e ,es dents ne paroiffent pas cariées, il
n eft pas fur que la douleur des dents ne foitpas cau-
fee par la carie occulte de la partie de la dent qui
elt cachee dans l’alvéole. Il eft à propos de frapper
les dents fur leur couronne avec un inftrument
d acier, tel que féroit un poinçon obtus, ou autre
corps femblable. Ce contaél a fouvent découvert
le mal, par la fenfation douloureufe qu’il a exercée
fur une dent faine en apparence. Dans ce cas il
faut faire fans héfiter le facrifice de la dent, pour
pouvoir faire ceffer efficacement le mal préfent,
Ôc en prévenir de plus grands , tels que l’abfcès du
finus maxillaire. Voyc{ ce que nous avons dit de
cette maladie, en parlant de celles qui attaquent
les gencives à la fuite du mot G e n c i v e s .
i Quand la carie des dents eft apparente , fi elle
eft difpofee de façon que l’on puiffe plomber la
dent avec fucces , on peut la conferver par ce
moyen. Voye{ P l o m b e r . Lorlque cela n’eft pas
poflible, les perfonnes timides., qui craignent de
s expofer à la douleur de l’exira&ion de la dent,
en laiffent détruire le nerf par le cautere aÔuel.
Voye^ G a u t e r e & C a u t é r i s a t i o n . Mais hors
le cas où le pliomb peut conferver la dent, les odontalgiques
ne font que des fecoors palliatifs dans le
cas de carie ; 6c le parti le plus fur eft de faire ôter
la dent, pour s’épargner les douleurs cruelles, fi
fujettes à récidive, pour fe délivrer de la puanteur
de la bouche, qui eft caufeepar une dent gâtée,
6c empêcher la communication de la carie à d'autres
dents.
La carie eft une fuite affez ordinaire de leur ér.o-
fion , maladie nouvellement découverte , & dont
l’étiologie eft due aux obfervations du feu fieur
Bunon, dentifte des enfans de France, 6c expert
reçu à faint Corne. Le féjour des alimens dans le
creux de l’érofion, le chaud & le froid alternatif des
boiffons, la qualité des liqueurs, &c. altèrent l’émail
, & caulent la carie des dents.
Les académiciens curieux de la nature, decad. xj.
parlent d’une odontolgie qui fut.guérie par un fouf-
flet que reçut la perfonne fouffrante. Bien des gens
font délivrés de la douleur d’une façon bien plus
furprenante : ils ceffent de fentir leur mal, lorf-
qu’ils voient le dentifte qui doit leur arracher la
dent. (T )
ODONTALGIQUE , f. m. & adj. terme de Chirurgie
concernant la matière médicale externe, remede
propre pour calmer la douleur des dents.
Ces remedes font en très-grand nombre , & îl
n’y a prefque perfonne qui n’en vante un dont il
affure l’efficacité.
On applique avec fuccès un emplâtre jde maftic
ou de-gomme élemi à la région des tempes. L’emplâ-
Y y.
!