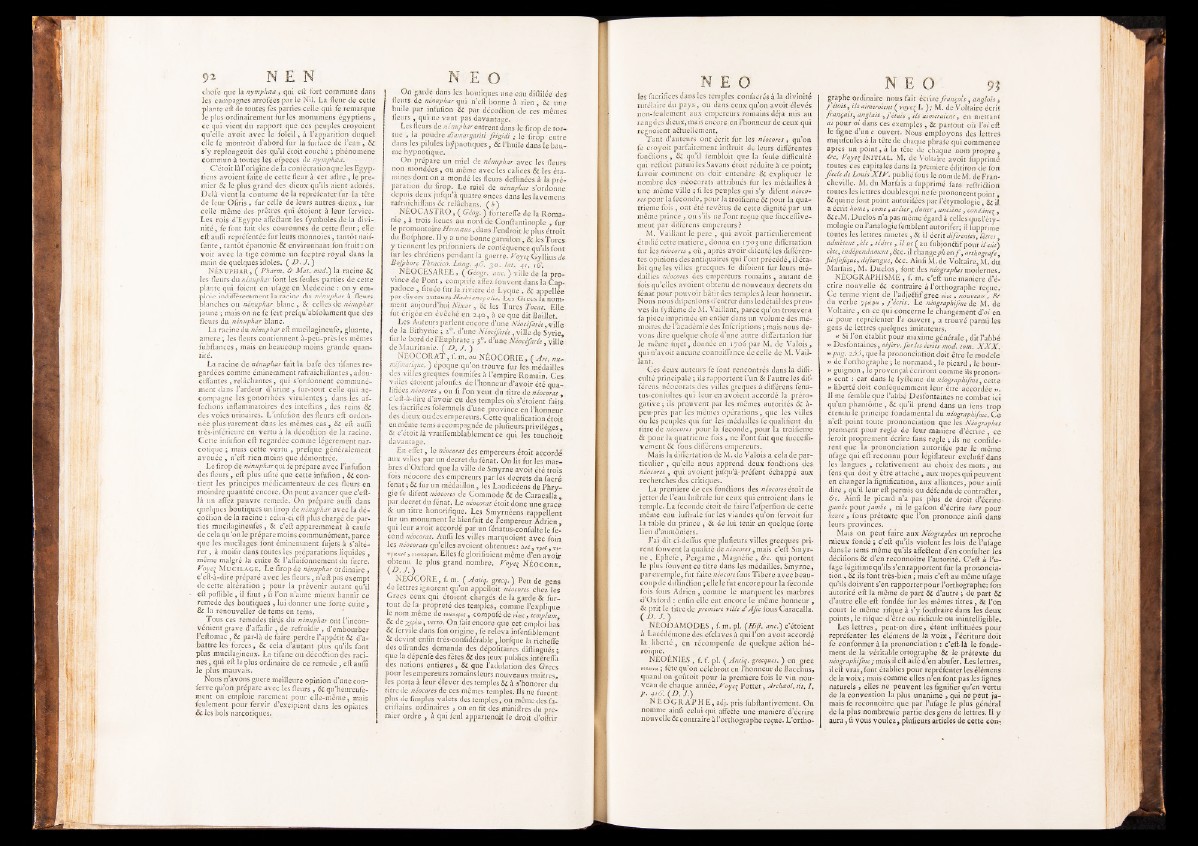
92 N E N
c h o f e q u e l a nymphcea . , q u i e f t f o r t c o m m u n e d a n s
l e s c a m p a g n e s a r r o f é e s p a r l e N i l . L a f l e u r d e c e t t e
p l a n t e e f t d e t o u t e s f e s p a r t i e s c e l l e q u i f e r em a r q u e
l e p lu s o r d in a i r e m e n t f u r l e s m o n u m e n s é g y p t i e n s ,
c e q u i v i e n t d u r a p p o r t q u e c e s p e u p l e s c r o . y o i e n t
q u ’ e l l e a v o i t a v e c l e f o l e i l , à l ’ a p p a r i t i o n d u q u e l
e l l e f e m o n t r o i t d ’ a b o r d f u r l a f u r f a c e d e l ’e a u , 6c
s ’ y r e p l o n g e o i t d è s q u ’ i l é t o i t c o u c h é ; p h é n o m è n e
c o m m u n à t o u t e s l e s e f p e c e s d e nymphcea.
C ’é t o i t l à l ’o r i g i n e d e l a c o n s é c r a t i o n q u e l e s E g y p *
t i e n s a v o i e n t f a i t e d e c e t t e f l e u r à c e t a f t r e , l e p r e m
i e r 6 c l e p l u s g r a n d d e s d i e u x q u ’ i l s a i e n t a d o r é s .
D e l à v i e n t l a c o u t u m e d e l a r e p r é f e n t e r f u r l a t ê t e
d e l e u r O f i r i s , f u r c e l l e d e l e u r s a u t r e s d i e u x , f u r
c e l l e m ê m e d e s p r ê t r e s q u i é t o i e n t à l e u r f e r v i c e .
L e s r o i s d ’E g y p t e a f f e â a n t l e s S y m b o l e s d e l a d i v i n
i t é , f e f o n t f a i t d e s c o u r o n n e s d e c e t t e f l e u r ; e l l e
e f t a u f f i r e p r é f e n t é e f u r ' l e ü t s m o n n o i e s , t a n t ô t n a i f -
f a n t e , t a n t ô t é p a n o u i e 6 c e n v i r o n n a n t f o n f r u i t : o n
v o i t a v e c l a t i g e c o m m e u n f c e p t r e r o y a l d a n s l a
m a in d e q u e l q u e s id o l e s . ( D . J. )
Nénuphar , ( Pharm. & Mat. tned.) l a r a c i n e 6c
l e s f l e u r s d u nénuphar f o n t l e s f e u l e s p a r t i e s d e c e t t e
p l a n t e q u i f o i e n t e n u f a g e e n M e d e c i n e : o n y e m p
l o i e in d i f f é r em m e n t l a r a c i n e d u nénuphar à f l e u r s
b l a n c h e s o u nénuphar b l a n c , & c e l l e s d e nénuphar
j a u n e ; m a i s o n n e f e f e r t p r e f q u ’ a b f o l u m e n t q u e d e s
f l e u r s d u nénuphar b l a n c .
L a r a c i n e d u n é n u p h a r eft. m u c i l a g i n e u f e , g l u a n t e ,
a m e r e ; l e s f l e u r s c o n t i e n n e n t à - p e u - p r è s l e s m ê m e s
f u b f t a n c e s , m a i s e n b e a u c o u p m o in s g r a n d e q u a n t
i t é .
L a r a c i n e d e nénuphar f a i t l a b a f e d e s t i f a n e s r e g
a r d é e s c o m m e ém i n e m m e n t r a f r a î c h i f f a n t e s , a d o u -
c i f f a n t e s , r e l â c h a n t e s , q u i s ’o r d o n n e n t c o m m u n é m
e n t d a n s l ’ a r d e u r d ’ u r i n e , f u r - t o u t c e l l e q u i a c c
o m p a g n e l e s g o n o r r h é e s v i r u l e n t e s ; d a n s l e s a f -
f e & i o n s i n f l a m m a t o i r e s d e s i n t e f t in s , d e s r e i n s 6c
d e s v o i e s u r in a i r e s . L ’ in f u f i o n d e s f l e u r s e f t o r d o n n
é e p lu s r a r e m e n t d a n s l e s m ê m e s c a s , & e f t a u f l i
t r è s - in f é r i e u r e e n v e r t u à l a d é c o â i o n d e l a r a c i n e .
C e t t e in f u f i o n e f t r e g a r d é e c o m m e l é g è r e m e n t n a r c
o t i q u e ; m a i s c e t t e v e r t u , p r e f q u e g é n é r a l e m e n t
a v o u é e , n ’ e f t r i e n m o in s q u e d é m o n t r é e .
L e f i r o p d e n é n u p h a r q u i l e p r é p a r e a v e c l ’in f u f i o n
d e s f l e u r s , e f t p lu s u f i t é q u e c e t t e i n f u f i o n , 6c c o n t
i e n t l e s p r i n c i p e s m é d i c a m e n t e u x d e c e s f l e u r s e n
m o in d r e q u a n t i t é e n c o r e . O n p e u t a v a n c e r q u e c ’ e f t -
l à u n a f f e z p a u v r e r em e d e . O n p r é p a r e a u f f i d a n s
q u e l q u e s b o u t iq u e s u n f i r o p d e n é n u p h a r a v e c l a d é -
c o f î i o n d e l a r a c i n e : c e l u i - c i e f t p lu s c h a r g é d e p a r t
i e s m u c i l a g i n e u f e s , & c ’ e f t a p p a r em m e n t à c a u f e
d e c e l a q u ’o n l e p r é p a r e m o in s c o m m u n é m e n t , p a r c e
q u e l e s m u c i l a g e s f o n t ém i n e m m e n t f u j e t s à s ’ a l t é r
e r , à m o i f i r d a n s t o u t e s l e s p r é p a r a t i o n s l iq u i d e s ,
m ê m e m a l g r é l a c u i t e & l ’ a f f a i f o n n em e n t d u f u c r e .
V o y e ^ M u c i l a g e . L e f i r o p d e n é n u p h a r o r d i n a i r e ,
c ’e f t - à - d i r e p r é p a r é a v e c l e s f l e u r s , n ’ e f t p a s e x e m p t
d e c e t t e a l t é r a t i o n ; p o u r l a p r é v e n i r a u t a n t q u ’ i l
e f t p o f f i b l e , i l f a u t , f i l ’o n n ’a im e m i e u x b a n n i r c e
r em e d e d e s b o u t i q u e s , l u i d o n n e r u n e f o r t e c u i t e ,
6c l a r e n o u v e l l e r d e t em s e n t em s .
T o u s c e s r e m e d e s t i r é s d u n é n u p h a r o n t l ’i n c o n v
é n i e n t g r a v e d ’ a f f a d i r , d e r e f r o i d i r , d ’ e m b o u r b e r
l ’ e f t o m a c , 6 c p a r - l à d e f a i r e p e r d r e l ’ a p p é t i t & d ’ a b
a t t r e l e s f o r c e s , 6 c c e l a d ’ a u t a n t p lu s q u ’ i l s f o n t
p l u s m u c i l a g i n e u x . L a t i f a n e o u d é c o f t i o n d e s r a c i n
e s , q u i e f t l e p lu s o r d in a i r e d e c e r e m e d e , e f t a u f f i
l e p lu s m a u v a i s .
N o u s n ’ a v o n s g u e r e m e i l l e u r e o p i n i o n d ’ u n e c o n -
f e r v e q u ’ o n p r é p a r e a v e c l e s f l e u r s , & q u ’h e u r e u f e -
m e n t o n e m p l o i e r a r e m e n t p o u r e l l e - m ê m e ; m a i s
f e u l e m e n t p o u r S e r v i r d ’ e x c i p i e n t d a n s l e s o p i a t e s
6 c l e s b o l s n a r c o t i q u e s .
N E O
J On gardé dans les boutiques une eau diftiléé des
fleurs de nénuphar qui n’eft bonne à rien , 6c une
huile par infufion 6c par décoftion de ces mêmes
fleurs , qui ne vaut pas davantage.
Les fleurs de nénuphar entrent dans le firop de tortue
, la poudre diamargariti frigidi ; le firop entre
dans les pilules hypnotiques, 6c l’huile dans le baume
hypnotique.
On préparé un miel de nénuphar avec les fleurs
non mondées , ou même avec les calices 6c les étamines
dont on a mondé les fleurs deftinées à la préparation
du firop. Le miel de nénuphar s’ordonne
depuis deux jufqu’à quatre ©nces dans les lavemens
rafraîchiffans 6c relâchans. Ch)
N ÉOCASTRO, ( G é o g . ) fortereffe de la Roma-
me , à trois lieues au nord de Conftantinople , fur
le promontoire H e rm oe u s , dans l’endroit le plus étroit
du Bofphore. Il y a une bonne garnifon , 6c les Turcs
y tiennent les prifonniers de conféquence qu’ils font
fur les chrétiens pendant la guerre. V o y e ^ Gyllius d e
B o fp h o r e T h ra c ic o . L o n g . j S . 30. l a t . a i . ,G ,
NÉOCESARÉE, ( Géogr. anc. ) ville de la province
de Pont, comprife affez fouvent dans la Cap-
padoce , fituée fur la riviere de Lyque, 6c appellée
par divers auteurs Hadrianopolis. Les Grecs la nom-
ment aujourd'hui Nixar, 6c les Turcs Tocat. Elle
fut érigée en évêché en 240, à ce que dit Baillet.
Les Auteurs parlent encore d’une Néocéfarée, ville
de la Bithynie ; 20. d une Néocéfarée, ville de Syrie,
fur le bord de l’Euphrate ; 30. d’une Néocéfarée, ville
de Mauritanie, (-£>.ƒ .)
N ÉOCOR A T , f. m. ou NÉOCORIE, ( Art. nu-
mifmatique. ) époque qu’on trouve fur les médailles
des villes greques foumifes à l’empire Romain. Ces
yilles etoient jaloufes de l’honneur d’avoir été qualifiées
néocores , ou fi l’on veut du titre de néocorat,
c ’eft-à-dire d’avoir eu des temples où s’étoient faits
les. facrifices folemnels d’une province en l’honneur
des djeux ou des empereurs. Cette qualification étoit
en même tems accompagnée de plufieurs privilèges,
& c etoit là vraiffemblablement ce qui les touchoit
davantage.
En effet, le néocorat des empereurs étoit accordé
aux villes par un decret du fénat. On lit fur les mar-
bres d Oxford que la ville de Smyrne avoit été trois
fois néocore des empereurs par les decrets du facré
fenat ; 6c fur un médaillon, les Laodicéens de Phry-
gie fe difent néocores de Commode 6c de Caracalla
par decret du fenat. Le néocorat étoit donc une grâce
& un titre honorifique. Les Smyrnéens rappellent
fur un monument le bienfait de l’empereur Adrien 1
qui leur avoit accordé par un fénatus-confulte le fécond
néocorat. Auffi les villes marquoient avec foin
les néocorats qu’elles avoient obtenues : A/c, Tpic, re-
Tp*y./c3 vtwzopuv. Elles fe glorifioient même d’en avoir
obtenu le plus grand nombre. Voye^ Néocore.
NÉOCORE, f. m. ( Antiq. grecq. ) Peu de gens
de lettres ignorent qu’on appelloit néocores chez les
Grecs ceux qui étoient chargés de la garde & fur-
tout de la- propreté de.s temples, comme l’explique
le nom même de nàxcpoç, compofé de nuç, templum
6c de £opf'w, verro. On fait encore que cet emploi bas
& fervile dans fon origine, fe releva infenfiblement
& devint enfin très-confidérable, lorfque la richeffe
des offrandes demanda des dépofitaires diftingués ;
que la dépenfe des fêtes 6c des jeux publics intéreffa
des nations entières, 6c que l’adulation des Grecs
pour les empereurs romains leurs nouveaux maîtres,
les porta à leur élever des temples 6c à s’honorer du
titre de néocores de ces mêmes temples. Ils ne forent
plus de fimples valets des temples, ou même des fa-
criftains ordinaires , on en fit des miniftres du premier
ordre , à qui feul appartenait le droit d’offrir
N E O
les facrifices dans les temples confaCrés à la divinité
tutélaire du pays , ou dans ceux qu’on avoit élevés
non-feulement aux empereurs romains déjà mis au
rangées dieux, mais encore en l’honneur de ceux qui
regnoient aêluellement.
Tant d’auteurs ont écrit fur les néocorts, qu’on
fe croyoit parfaitement inftruit de leurs différentes
fondions , 6c qu’il fembloit que la feule difficulté
qui reftoit parmi les Sâvans étoit réduite à ce point;
lavoir comment on doit entendre 6c expliquer le
nombre des néocorats attribués fur les médailles à
une même ville ; fi les peuples qui s’y difent néocores
pour la fécondé, pour la troifieme 6c pour la quatrième
fois , ont été revêtus de cette dignité par un
même prince , ou s’ils ne l’ont reçue que fucceffive-
meut par différens empereurs ?
M. Vaillant le pere , qui avoit particulièrement
étudié cette matière, donna en 1703 une differtation
fur les néocores, o ù , après avoir difeuté les différentes
opinions des antiquaires qui l’ont précédé, il éta-
bit que les villes grecques fe difoient fur leurs médailles
néocores des empereurs romains, autant de
fois qu’elles avoient obtenu de nouveaux decrets du
fénat pour pouvoir bâtir des temples à leur honneur.
Nous nous difpenfons d’entrer dans le détail des preuves
du fyftème de M. Vaillant, parce qu’on trouvera
1a piece imprimée en entier dans un volume des mémoires
de l’académie des Infcriptions ; mais nous devons
dire quelque chofe d’une autre differtation fur
le même Sujet, donnée en 1706 par M. de Valois,
qui n’avoit aucune connoiffance de celle de M. Vaillant.
Ces deux auteurs fe font rencontrés dans la difficulté
principale ; ils rapportent l’un & l’autre les différens
néocorats des villes greques à différens fena-
tus-confultes qui leur en avoient accordé la prérogative;
ils prouvent par les mêmes autorités 6c à-
peu-près par les mêmes opérations, que les villes
ôu les peuples qui fur les médailles fe qualifient du
titre de néocores pour la fécondé, pour la troifieme
& pour la quatrième fois, ne l’ont fait que fucceffi-
vem.ent 6c fous différens empereurs.
Mais la differtation de M. de Valois a cela de particulier
, qu’elle nous apprend deux fondions des
néocores , qui avoient jufqu’à- préfent échappé aux
recherches des critiques.
La première de ces. fondions des néocores étoit de
jetter de l’eau luftrale fur ceux qui entroient dans le
temple. La fécondé étoit de faire l’afperfion de cette
même eau luftrale fur les viandes qu’on fervoit fur
la table du prince , & de lui tenir en quelque forte
lieu d’aumôniers.
J’ai dit ci-deffus que plufieurs villes grecques prirent
fouvent la qualité de néocorts, mais c’eft Smyrne
, Ephefe, Pergame , Magnéfie , &c. qui portent
le plus fouvent ce titre dans les médailles. Smyrne,
par exemple, fut faite néocore fous Tibere avec beaucoup
de diftin&ion ; elle le fut encore pour la fécondé
fois fous Adrien , comme le marquent les marbres
d’Oxford : enfin elle eut encore le même honneur ,
& prit le titre de première ville d'Afie fous Caracalla. HjSM
NÉODAMODES , f. m. pl. (Hijl. anc.) c’étoient
à Lacédémone des efclaves à qui l’on avoit accordé
la liberté, en récompenfe de quelque aâion héroïque.
NÉOÉNIES , f. f. pl. ( Antiq. grecques. ) en grec
vtoivia. ; fête qu’on célébroit en l’honneur de Bacchus,
quand on goutoit pour la première fois le vin nouveau
de chaque année. Foyer Potter, Archceol.tit. 1.
P. 4 /Ç {D . J.)
N É O G R A P H E , adj. pris fubftantivement. On
nomme ainfi celui qui affeéte une maniéré d’écrire
nouvelle 6c contraire à l’orthographe reçue. L ’ortho-
N E O 93
graphe ordinaire nous fait écrire françols, anglois *
fé to is , ils aimer oient ( voyeç I. ) ; M. de Voltaire écrit
français y anglais y fêtais , ils aimer aient, en mettant
ai pour oï dans ces exemples , & partout oit Voi eft
le ligne d’un e ouvert. Nous employons des lettres
majufcules à la tete de chaque phrafe qui commence
après un point, à la tête de chaque nom propre ;
&c. Voye1 Initial. M. de Voltaire avoit fupprimé.
toutes ces capitales dans la première édititon de fort
fiecle de Louis X I F . publié fous le nom de M. de Fran-
cheville. M. du Mariais a fupprimé fans reftriâiort
toutes les lettres doubles qui nefe prononcent poinr,
& qui ne font point autorilées par l’étymologie, 6c il
a écrit homet corne , arêter y douer , anciènc , condâne£ ,
&c.M. Duclos n’a pas même égard à celles opiel’étymologie
ou l’analogie femblent autorifer; il fupprimé
toutes les lettres muetes , & il écrit diférentesy lé très ,
admet eut, èle , teatre , il ut (au fubjonélif pour il eût)
c'eiey indépendament ,& c . il change ph en ƒ , orthografe,
filofofique, diftonguty 6cc. Ainfi M. de Voltaire, M. du
Marfais, M. Duclos, font des héograplus modernes.'
NÉOGRAPHISME, f. m. c’eft une maniéré d’écrire
nouvelle 6c contraire à l’orthographe reçue.
Ce terme vient de 1 adje&if grec vîoç, nouveau , 6t
du verbe ypatpa , j ’écris. Le néographifme de M. de
Voltaire , en ce qui concerne le changement d’oi en
ai pour reprefenter l’e ouvert, a trouvé parmi les
gens de lettres quelques imitateurs.
« Si l’on établit pour maxime générale, dit l’abbé
» Desfontaines, obferv. furies écrits mod. tom. X X X .
» pag. 2.53, que la prononciation doit être le modèle
» de l’orthographe ; le normand, le picard, le bour-
w guignon, le provençal écriront comme ils pronon-
» cent : car dans le fyftème du néographifme cette
» liberté doit conféquemment leur être accordée ».
Il me femble que l’abbé Desfontaines ne combat ici
qu’un phantôme, 6c qu’il prend dans un fens trop
étendu le principe fondamental du néographifme. Ce
n’eft point toute prononciation que les Néographes
prennent pour réglé de leur maniéré d’écrire , ce
feroit proprement écrire fans réglé ; ils ne confide-
rent que la prononciation autorifée par le même
ufage qui eft reconnu pour légiflateur exclufif dans
les langues , relativement au choix des mots , au
fens qui doit y être attaché, aux tropes qui peuvent
en changer la fignification, aux alliances, pour ainfi
dire, qu’il leur eft permis ou défendu de contra&er,
&c. Ainfi le picard n’a pas plus de droit d’écrire-
gambe pour jambe , ni le gafeon d’écrire hure pour
heure, fous prétexte que l’on prononce ainfi dans
leurs provinces.
Mais on peut faire aux Néographes un reproche
mieux fondé ; c’eft; qu’ils violent les lois de l’ufage
dans le tems même qu’ils affe&ent d’en confulter les
décifions 6c d’en reconnoître l ’autorité. C ’eft à l’ufage
légitime qu’ils s’en rapportent fur la prononciation
, 6c ils font très-bien ; mais c’eft au même ufage
qu’ils doivent s’en rapporter pour l’orthographe: fon
autorité eft la même de part 6c d’autre ; de part 6c
d’autre elle eft fondée fur les mêmes titres, & l’on
court le même rifque à s’y fouftraire dans les deux
points, le rifque d’être ou ridicule ou inintelligible.
Les lettres, peut-on dire, étant inftituées pour
repréfenter les élémens de la v o ix , récriture doit
fe conformer à la prononciation : c’eft-là le fondement
de la véritable ortographe 6c le prétexte du
néographifme ; mais il eft aile d’en abufer. Les lettres,
il eft v rai, font établies pour repréfenter les élémens
de la voix ; mais comme elles n’en font pas les lignes
naturels , elles ne peuvent les lignifier qu’en vertu
de la convention la plus unanime , qui ne peut jamais
fe reconnoître que par l’ufage le plus général
de la plus nombreufe partie des gens de lettres. Il y
aura, fi vous voulez, plufieurs articles de cette con