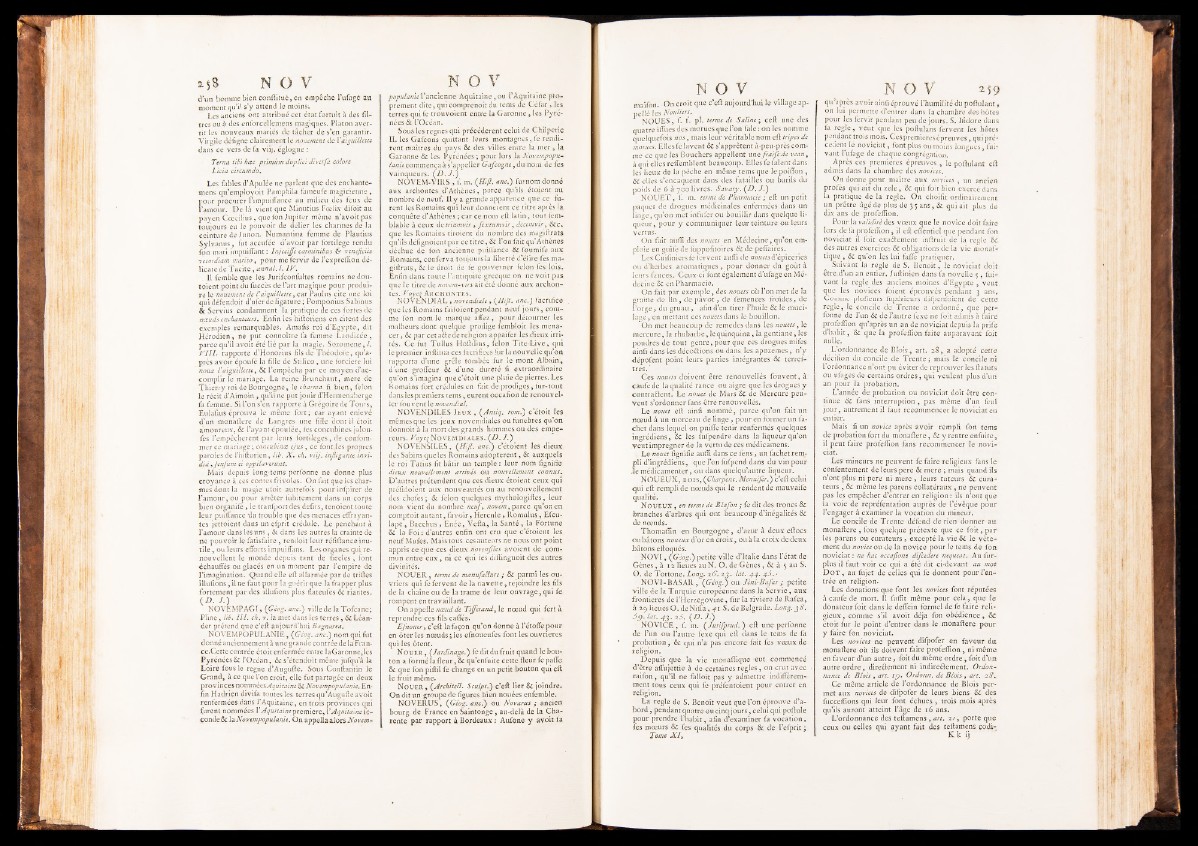
d'un homme bien conftitué, en empêche l’ufage au
moment qu’R s’y attend le moins;
Les anciens ont attribué cet état fortuit à des filtres
ou à des enforcellemens magiques. Platon avertit
les nouveaux mariés de tâcher de s’en garantir.
Virgile défigne clairement 1 enouement de Vaiguillette
dans ce vers de fa viij. églqgue :
Terna tibi htzc primàtn duplici diverfa colore
Licia circumdo.
Les fables d’Apulée ne parlent que des enchante-
mens qu’employoit Pamphila fameufe magicienne ,
pour procurer l’impuiflance au milieu des feux de
l’amour. De là vient que Minutius Fçelix difoit au
payen Coecilius, que fon Jupiter même n’avoit pas
toujours eu le pouvoir de délier les charmes de la
ceinture de Junon. Numantina femme de Plautius
Sjylvanus , fut accufée d’avoir par fonilege rendu
fon mari impuiffant : In/ecijfc carminibus & veneficiis
vccordiam rnarito, pour me iervir de l’expreflion délicate
de T a c ite, annal. I. IV.
Il femble que les Jurifconfultes romains ne clou-
tôient point du fuccès de l’art magique pour produire
le nouemene de Vaiguillette, car Paitlus cite une loi
quidéfendoit d’ufer de ligature » Pomponius Sabinus
& Servius condamnent la pratique de ces fortes de
noeuds enchanteurs. Enfin les hiftoriens en citent des
exemples remarquables. Amafis roi d’Egypte, dit
Hérodien, ne put connoître fa femme Laodicée,
parce qu’il avoit été lié par la magie. Sozomene, l.
V I I I . rapporte d’Honorius fils de Théodofe, qu’a-
près avoir époufé la fille de Stilico, une forciere lui
noua l'aiguillette, 8c l’empêcha par ce moyen d’accomplir
le mariage. La reine Brunehaut, mere de
Thierry roi de Bourgogne, le charma fi bien, félon
le récit d’Aimoin , qu’il ne put jouir d’Hermenaberge
fa femme. Si l’on s’en rapporte à Grégoire de Tours,
Éulafius éprouva le même fort; car ayant enievé
d'un monaftere de Langres une fille dont il étoit
amoureux, 8c l’ayant époufée, fes concubines jalou-
fes l’empêcherent par leurs fortileges, de confom-
nier ce mariage ; concubince ejus, ce font.les propres
paroles de l’hiftorien, lib. X . ch. viij,. injligante invi~
diti,Jenfum ei oppilaverunt.
Mais depuis long-tems perfonne ne donne plus
croyance à ces contes frivoles. On fait que les charmes
dont la magie uioit autrefois pour infpirer de
l’amour, ou pour arrêter lubitement dans un corps
bien organifé, le tranfport des defirs, tenoient toute
leur puiffance tlu trouble que des menaces effrayantes
jettoient dans un efprit crédule. Le penchant à
l’amour dans les uns, & dans les autres la crainte de
ne pouvoir le fatisfaire , rendoit leur réfiftance inutile
, ou leurs efforts impuiffans. Les organes qui renouvellent
le monde depuis tant de fiecles , font
échauffés ou glacés en un moment par l’empire de
l’imagination. Quand elle eft allarmée par de trilles
illufions, il ne faut pour la guérir que la frapper plus
fortement par des illufions plus flateufes 8c riantes. SH ES I I NOVEMPAGI, (Géog. anc.') villedelaTofcane;
Pline, lib. II I . ch. v. la met dans les terres, 8c Léan-
der prétend que c’ell aujourd’hui Bagnarea.
NOVEMPOPULANIE, (Géog. anc.) nom qui fut
donné anciennement à une grande contrée de la Fran-
ce.Cette contrée étoit enfermée entre laGaronne,!es
Pyrénées & l’Océan, 8c s’étendoit même jufqu’à la
Loire fous le régné d’Augufte. Sous Conftantin le
Grand, à ce que l’on croit, elle fut partagée en deux
provinces nomméets Aquitaine 8c Novernpopulanie. Enfin
Hadrien divifa toutes les terres qu’Augulle avoit
renfermées dans l’Aquitaine, en trois provinces qui
furent nommées Y Aquitaine première, Y Aquitaine fe-
(Çondeôc la Novcrnpopulanie. On appella alors Novempopulanie
l’ancienne Aquitaine,ou l’Aquitaine proprement
dite, qui comprenoit du tems de Cé fa r , les
terres qui fe trouvoient entre la Garonne, les Pyrénées
& l’Océan.
Sous les régnés qui précédèrent celui de Chilperic
II. les Gafcons quittant leurs montagnes, fe rendirent
maîtres du pays 8c des villes entre la mer, la
Garonne 8c les Pyrénées ; pour lors la Xovempopu-
lanie commença à s’appeller Gafcogne, du nom de fes
vainqueurs. (D .J . )
NOVEM-VIRS , f. m. (Hiß. anc.) furnom donné
aux archontes d’Athènes, parce qu’ils étojent au
nombre de neuf. Il y a grande apparence que ce furent
les Romains qui leur donnèrent ce titre après la
conquête cl’Athènes ; car ce nom eft latin, tour fem-
blable à ceux de triumvir , fextumvir, decetnvir, ,&c.
que les Romains tiroient du nombre des magiftrats
qu’ils défignoient par ce titre, 8c l’on fait qu’Athènes
déchue de fon ancienne puiffance 8c foumife aux
Romains, conferva toujours la liberté d’élire fes magiftrats,
8c le droit de le gouverner félon fes lois.
Enfin dans toute l ’antiquité grecque on ne voit pas
que le titre de novem-virs ait été donné aux archontes.
h 'o y e ^ Ar ch o n te s .
NOVENDIAL, novendiale, (Hiß. anc.) facrifice
que les Romains faifoient pendant neuf jours, comme
fon nom le marque affez, pour détourner les
malheurs dont quelque prodige fembloit les menacer
, 8c par cet afte de religion appaifer les dieux irrités.
Ce fut Tullus Hoftilius, félon Tite-Live, qui
le premier inftiiua ces facrifices fur la nouvelle qu’on
rapporta d’une grêle tombée fur le mont Albain,
d’une groffeur 8c d’une dureté fi extraordinaire
qu’on s ’imagina quec’étoit une pluie de pierres. Les
Romains fort crédules en fait de prodiges, fur-tout
dans les premiers tems, eurent o.ccafion de renouvel-
ler fou vent le novendial.
NOVENDILES Jeux , (Antiq: rom?) c ’étoit les
mêmes que les jeux novemdiales ou funèbres qu’on
donnoit à la mort des grands hommes ou des empereurs.
Voyc{Novemd iale s. (D .J .)
NOVENSILES, (Hiß. anc?) c’étoient les dieux
desSabins que les Romains adoptèrent, & auxquels
le roi Tatius fit bâtir un temple : leur nom fignifie
dieux nouvellement arrivés ou nouvellement connus.
D ’autres prétendent que ces dieux étoient ceux qui
préfidoient aux nouveautés ou au renouvellement
des chofes; & félon quelques mythologiftes, leur
nom vient du nombre neuf, novem, parce qu’on en
comptoit autant, favoir, Hercule, Romulus, Efcu-
lape, Bacchus, Enée, Vefta, la Santé , la Fortune
8c la Foi : d’autres enfin ont cru que c ’étoient les
neufMufes. Mais tous ces auteursne nous ont point
appris ce que ces dieux novenßles avoient de commun
entre eu x, ni ce qui ies diftinguoit des autres
divinités.
NOUER, terme de manufacture ; & parmi les ouvriers
qui fe fervent de la navetre, rejoindre les fils
de la chaîne ou de la trame de leur ouvrage, qui fe
rompent en travaillant.
On appelle noeud de Tifferand, le noeud qui fert à
reprendre ces fils caftes.
Efnouer, c’eft la façon qu’on donne à l’étoffe pour
en ôter les noeuds ; les efnoueufes font les ouvrières
qui les ôtent.
Nouer , ( Jardinage.) fe dit du fruit quand le bouton
a formé la fleur, 8c qu’enfuite cette fleur fe paffe
8c que fon piftil fe change en un petit bouton qui eft
le fruit même. .
Nouer , (Architecl. Sculpt.) c’eft lier & joindre.
On dit un groupe de figures bien nouées enfemble.
NOVERUS, (Géog. anc.) ou Novarus ; ancien
bourg de France en Saintonge, au-delà de la Charente
par rapport à Bordeaux : Aufone y avoit ia
maifôn. On croit que c’eft aujourd’hui le village ap-
pellé les Nouliers.
NOUES, f. f- pl. terme de Saline ; ceft une des
quatre ifliies des morues que l’on fale : on les nomme
quelquefois dos, mais leur véritable nom eft tripes de
morues. Elles fe lavent 8 c s’apprêtent à-peu-près comme
ce que les Bouchers appellent une fraife de veau,
à qui elles reffemblent beaucoup. Elles fe falent dans
les lieux de la pêche en même tems que le poiflon ,
8 c elles s’encaquent dans des futailles ou barils du
poids de 6 à 700 livres. Savary. (D . J .)
NOUET , f. m. terme de Pharmacie ; eft un petit
paquet de drogues médicinales enfermées dans un
linge, qu’on met infufer ou bouillir dans quelque liqueur,
pour y communiquer leur teinture ou leurs
vertus.
On fait aufli des nouets en Médecine, qu’on emploie
en guife de fuppofitoires 8 c de peffaires.
Les Cuifiniersfe fervent aufli de nouets d’épiceries
ou d’herbes aromatiques , pour donner du goût à
leurs fauces. Ceux-ci font également d’ufage en Médecine
8c en Pharmacie.
On fait par exemple, des nouets oit l’on met de la
graine de lin , de p a vo t , de femences froides , de
l’orge ; du gruau, afin d’en tirer l’huile 8c le mucilage,
en mettant ces nouets dans le bouillon.
On met beaucoup de remedes dans 1 es nouets, le
mercure, la rhubarbe, le quinquina, la gentiane, les
poudres de tout genre, pour que ces drogues mifes
ainfi dans les décodions ou dans les apozeraes, n’y
dépofent point leurs parties intégrantes 8c terref-
îres.
Ces nouets doivent être renouvellés fou vent, à
caufede la qualité rance ou aigre que les drogues y
contra&ent. Le nouet de Mars & de Mercure peuvent
s’ordonner fans être renouvellés.
Le nouet eft ainfi nommé, parce qu’on fait un
noeud à un morceau de linge , pour en former un fa-
chet dans lequel on puiffe tenir renfermés quelques
ingrédiens, 8 c les fufpendre dans la liqueur qu’on
veut imprégner de la vertu de ces médicamens.
Le nouet fignifie aufli dans ce fens, un fachet rempli
d’ingrédiens, que l’on fufpend dans du vin pour
J e médicamenter, ou dans quelqu’autre liqueur.
NOUEUX, BOIS, (Charpent. Menuifer.) c’eft celui
qui eft rempli de noeuds qui le rendent de mauvaife
qualité.
Noueux , en terme de Blafon ; fe dit des troncs 8 c
branches d’arbres qui ont beaucoup d’inégalités 8 c
de noeuds.
Thomaflin en Bourgogne, d’azur à deux eftocs
ou bâtons noueux d’or en croix, ou à la croix de deux
bâtons eftoqués.
N O V I , {Géog.) petite ville d’Italie dans l’état de
Gènes, à 12 lieues au N. O. de Gènes, 8 c à 5 au S.
O. de Tortone. Long. 26. 23. lat. 44. 46. ■
N OVI-BASAR, (Géog.) ou Jéni-Bafar ; petite
ville de la Turquie européenne dans la Servie, aux
frontières de l’Herzegovine, fur la riviere de Rafca,
à 29 lieues O. deNiffa, 41 S. de Belgrade. Long. 38.
5 c). lat. 43. 26. (D .J .)
N O V IC E , f. m. (Jurijprud.) eft une perfonne
de l’un ou l’autre fexe qui eft dans le tems de fa
probation, 8 c qui n’a pas encore fait fes voeux de
religion.
Depuis que la vie monaftique ‘eut commencé
d ’être affujettie à de certaines réglés, on crut avec
raifon, qu’il ne falloit pas y admettre indifféremment
tous ceux qui fe préfentoient pour entrer en
religion.
La réglé de S. Benoît veut que l’on éprouve d’abord
, pendant quatre ou cinq jours, celui qui poftule
pour prendre l’habit, afin d’examiner fa vocation-,
fes moeurs 8c fes qualités du corps & de l’efprit i
Tome X I .
qu’après avoir ainfi éprouvé l’humilité du poftulant,
on lui permette d’entrer dans la chambre des hôtes
pour les fervir pendant peu de jours. S. Ifidore. dans
fa réglé, veut que les poftulans fervent les hôtes
pendant trois mois. Ces premières épreuves, qui precedent
le noviciat, font plus bu moins longues, fui*
vant l’ufage de chaque congrégation.
Après ces premières épreuves , le poftulant eft
admis dans la chambre des novices.
On donne pour maître aux novices j un ancien
profès qui ait du ze le, 8c qui foit bien exercé dans
la pratique de la réglé. On choifit ordinairement
un prêtre âgé de plus de 35 ans, & qui ait plus d©
dix ans de profeflion.
Pour la validité des voeux que le novice doit faire
lors de fa profeflion, il eft eflentiel que pendant fon
noviciat il foit exaélément inftruit de la réglé 8c
des autres exercices 8c obligations de la vie monaft
tique , 8c qu’on les lui faffe pratiquer.
Suivant la réglé de S. Benoît, le noviciat doit
être.d’un an entier» Juftinien dans fa novelle 5 , fui-'
vant la réglé des anciens moines d’Egypte , veut
que les novices foient éprouvés pendant 3 ans*
Comme plufieurs fupérieurs difpenfoient de cette
réglé, le concile de Trente a ordonné, que perfonne
de l’un 8c de l’autre fexe ne foit admis à faire
profeflion qu’après un an de noviciat depuis la prife
d’habit, 8c que la profeflion faite auparavant foit
nulle.
L’ordonnance de Blois, art. 28, a adopté cette
décifion du concile de Trente; mais le concile ni
l’ordonnance n’ont pu éviter de reprouver les ftatuts
ou ufages de certains ordres, qui veulent plus d’un
an pour la probation.
L’année de probatiofi ou noviciat doit être continue
8c fans interruption, pas même d’un feul
jour, autrement il faut recommencer le noviciat en
entier.
Mais fi un novice après avoir rempli fon tems
de probation fort du monaftere, 8c y rentre enfuite,
il peut faire profeflion fans recommencer le noviciat.
Les mineurs ne peuvent fe faire religieux fans le
confentement de leurs pere & mere ; mais quand ils
n’ont plus ni pere ni mere, leurs tuteurs 8c curateurs
, 8c même les parens collatéraux , ne peuvent
pas les empêcher d’entrer en religion : ils n’ont que
la voie de repréfentation auprès de l’évêque pour
l’engager à examiner la vocation du mineur.
Le concile de Trente défend de rien donner au
monaftere , fous quelque prétexte que ce foit, par
les parens ou curateurs, excepté la vie 8c le vêtement
du novice ou de la novice pour le tems de fon
noviciat : ne hac occajione difeedere nequeat. Au fur-
plus il faut voir ce qui a été dit ci-devant au mot.
D ot , au fujet de celles qui fe donnent pour l ’entrée
en religion.
Les donations que font les novices font réputées
à caufe de mort. II fuflit même pour cela, que le
donateur foit dans le deffein formel de fe faire religieux
, comme s’il avoit déjà fon obédience, 8c
étoit fur le point d’entrer dans le monaftere pour
y faire fon noviciat.
Les novices ne peuvent dilpofer en faveur du
monaftere où ils doivent faire profeflion, ni même
en faveur d’un autre, foit du même o rdre, foit d’un
autre ordre, dire&ement ni indire&ement. Ordonnance
de Blois, art. ic). Ordonn. de Blois, art. 28.
Ce même article de l’ordonnance de Blois permet
aux novices de difpoler de leurs biens 8c des
fucceflions qui leur font échues , trois mois après
qu’ils auront atteint l’âge de 16 ans.
L’ordonnance des teftamens , art. 2 1 , porte que
ceux ou celles qui ayant fait des teftamens çodi-
K k ij