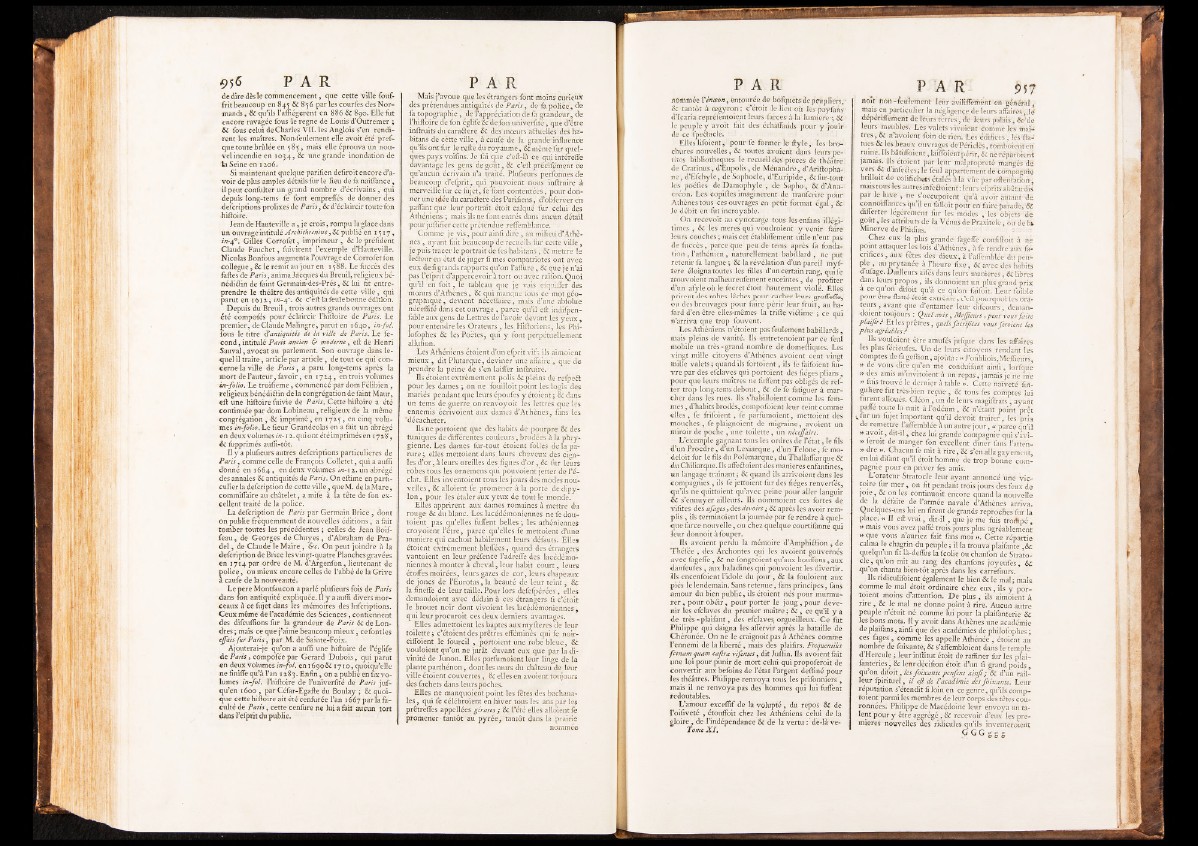
I l
de dire dès le commencement, que cette ville fouf-
frit beaucoup en 845 & 856 par les courfes des Normands
, & qu’ils l’afllégerent en 886 & 890. Elle fut
encore ravagée fous le régné de Louis d’Outremer ;
& fous celui de Charles VII. les Anglois s’en rendirent
les maîtres. Non-feulement elle avoit été pref-
que toute brûlée en 585, mais elle éprouva un nouvel
incendie en 1034, & une grande inondation de
la Seine en 1 206.
Si maintenant quelque parifien defiroit encore d’avoir
de plus amples détails fur le lieu de fa naiffance,
il peut confulter un grand nombre d’écrivains ., qui
depuis long-tèms fe font empreffés de donner des
deicriptions prolixes de Paris, & d’éclaircir toute fon
'hiftoire.
Jean de Hauteville a , je crois, rompu la glace dans
un ouvrage intitulé Archithtenius, & publié en 15 17 ,
i/z-40. Gilles Corrofet, imprimeur , & le préfident
Claude Fauchet, fuivirent l’exemple d’Haùteville.
Nicolas Bonfous augmenta l’ouvrage de Corrofet fon
collègue, & le remit au jour en 1588. Le fuecès des
faites de Paris, anima Jacques du Breuil, religieux bénédictin
de faint Germain-des-Prés, S c lui fit entreprendre
le théâtre des antiquités de cette ville , qui
parut en 1612, in-40. Sc c’eft la feule bonne édition.
Depuis du Breuil, trois autres grands ouvrages ont
été compofés pour éclaircir l’hiftoire de Paris. Le
premier, de Claude Malingre, parut en 1640, in-fol.
fous le titre d’antiquités de la ville de Paris. Le fécond
, intitulé Paris ancien & moderne, efl de Henri
Sauvai, avocat au parlement. Son ouvrage dans lequel
il traite, article par article, de tout ce qui concerne
la ville de Paris, a paru long-tems après la
mort de l’auteur, favoir, en 1724, en trois volumes
in-folio. Le troifieme, commencé par dom Félibien ,
religieux bénédiôin de la congrégation de faint Maur,
efl une hiftoirefuivie de Paris..Cette hiftoire a;été
continuée par dom Lôbineau, religieux de la même
congrégation , S c imprimé, en 1725, en cinq volumes
in-folio. Le fieur Grandcolas en a fait un abrégé
en deux volumes in-12. qui ont été imprimés en 17 28,
S c fiipprimés auflî-tôt.
Il y a plufieurs autres deferiptions particulières de
Paris, comme celle de François Colletet, qui a aufli
donné en 1664, en deux volumes in-ix. un abrégé !
des annales S c antiquités de Paris. On eftime en particulier
la defeription de cette ville, queM. de la Mare,
commiffaire au Châtelet, a mife à la tête de fon excellent
traité de la police.
La defeription de Paris par Germain Brice, dont
on publie fréquemment de nouvelles éditions, a fait
tomber toutes les précédentes ; celles de Jean Boif-
feau, de Georges de Chuyes , d’Abraham de Pradel
, de Claude le Maire , &c. On peut joindre à la
defeription de Brice les vingt-quatre Planches gravées ’
en 1714 par ordre de M. d’Argenfon, lieutenant de ’
police, ou mieux encore celles de l’abbé de la Grive ;
à caufe de la nouveauté.
Le pere Montfaucon a parlé plufieurs fois de P a r i s \
dans Ion antiquité expliquée. Il y a aufli divers mor- :
ceaux à ce fujet dans les- mémoires des Inferiptions. :
Ceux même de l’académie des Sciences, contiennent
des difcufîions fur la grandeur de P a r i s S c de Londres
; mais ce que j’aime beaucoup mieux, ce fbntles ;
e j fa i s fur P a r i s , par M. de Saihte-Foix.
Ajouterai-je qu’on a aufli une hiftoire de l’églife !
de Paris, compofée par Gérard Dubois, qui parut !
en deux volumes in-fol. en 1690 & 1710, quoiqu’elle j
ne finiffe qu’à l’an 1283. Enfin, on a publie en fix vo- j
lûmes in-fol. l’hiftoire de Puniverfité de Paris juf- :
qu’en 1600 , par Céfar-Egafte du Boulay ; & quoi- I
que cette hiftoire ait été cenfurée l’an 1667 par la fa- :
culté de Paris, cette cenfure ne lui a fait aucun tort
dans l’efptit du public.
Mais j’avoue que les étrangers font moins curieux
des prétendues antiquités de Paris, de fa police', de
fa topographie, . de l’appréciation de fa grandeur , d'e
l ’hiftoire de fon églife Ce de fon univerfité, que d’être
inftruits du caraûere & des moeurs aétueMés des habitons
de cètte v ille , à caufe de la'grande'influence
qu’ils ont fur le refte du royaume , Sc même fur quelques
pays voifins. Je fai que c’eft-là ce qui intéreffe
davantage les gens dégoût, & c’eft précifément ce
qu’aucun écrivain n’a traité. Plufieurs personnes de
beaucoup d’efprit, qui pouvoient nous inftmire à
merveille fur ce fujet, fe font contentées, pour donner
une idée du caraftere des Parifiens, d’obferver en
paffant que leur portrait étoit calqué fur. celui des
Athéniens ; mais ils ne font entrés dans aucun détail
pour juftifier cette prétendue reffemblance. -
Gomme je vis, pour ainfi dire , an milieu d’Athènes
, ayant fait beaucoup de recueils .fur cette ville,,
je puis tracer le portrait de fes habitans , & mettre le
lefr eur en état déjuger fi mes compatriotes ont avec
eux défi grands rapports qu’on l’aflure, Sc que je n’ai
pas l’efprit d’appercevoir, à tort ou avec raifon. Quoi
qu’il en fo i t , le tableau que je vais efquifler des
moeurs d’Athènes, Sc qui manque lous ce mot géographique,
devient néceffairej mais d’une abfolue
néeeflité dans cet ouvrage , parce qu’il eft indifpen-
fable aux gens de Lettres de l’avoir devant les yeux ,
pour entendre les Orateurs , les Hiftoriens. les Phi-
lofophes Sc les Poètes, qui y font perpétuellement
allpfiqn.
Les Athéniens étoient d’un efprit vif; ils aimoient
mieux , dit Plutarque, deviner une affaire', que de
prendre la peine de s’en laiffer inftruirè.
Ils étoient extrêmement polis Sc pleins de r.efpeft
pour les dames ; on ne fouilloit point les logis des
mariés pendant que leurs époufes y étoient ; Sc dans
un tems de guerre^ on renvoyoit les lettres que les
ennemis écrivoient aux dames d’Athènes, fans les
'décacheter.
Ils ne portoient que des habits de pourpre Sc des
tuniques de différentes couleurs, brodées à la phrygienne.
Les dames fur-tout étoient folles de la parure
; .elles mettoient dans leurs cheveux des cigales
d’o r , à leurs oreilles des figues d’o r , Sc fur leurs
robes tous les ornemens qui pouvoient jetter de l’éclat.
Elles inventoient tous les jours des modes nouvelles
, & alloient fe promener à la porté de dipy-
lon , pour les étaler aux yeux de tout le monde.
Elles apprirent aux dames romaines à mettre du
rouge Sc du blanc. Les lacédémoniennes ne fe dou-
toient pas qu’elles fuffent belles; les athéniennes
croyoient l’être, parce qu’elles fe mettoient d’une
maniéré qui cachoit habilement leurs défauts. Elles
étoient extrêmement bleffées, quand des étrangers
vantoiént en leur préfence l’adreffe des lacédémoniennes
à monter à cheval, leur habit court, leurs
étoffes moirées, leurs gazes de cor, leurs chapeaux
de joncs de l’Eurotas, la beauté de leur teint, Sc
la fineffe de leur taille. Pour lors defefpérées , elles
demandoient avec dédain à ces étrangers fi c’étoit
le brouet noir dont vivoient les lacédémoniennes,
qui leur procuroit ces deux derniers avantages.
Elles admettoient les baptes aux myfteres de leur
toilette ; c’étoient des prêtres efféminés qui fe noir-
ciffoient le fourcil , portoient une robe bleue, Sc
vou'loient qu’on ne jurât duvant eux qtie par la divinité
de Junon. Elles parfumoient leur linge de la
plante patihénon, dont les murs du château de leur
ville étoient couvertes, Sc elles en avoiont toujours
des fachets dans leurs poches.
Elles ne manquoient point les fêtes des bachana-
le s , qui fe célébroient en hiver tous les ans par les
prêtreffes appellées gérares j Sc l’été elles alloient fe
promener tantôt au pyrée, tantôt dans la prairie
nommée
P A R
nommée Ÿénoeon, entourée de bo’fquéls; cle peâp 1 ler s
Sc tantôt à oegyron: c’ëtoit le lieu ©ù lés-payfans"
d’Icaria repréfentoient leurs farces' à la lumière*; Sc
le peuple y avoit fait desr échàffaftds pour y j jouir
de ce fpe&acle.
Elles lifoient, pour fe former- le f ty le , les brochures
nouvelles , & toutes avaient dans leurspe-^
tites bibliothèques le recueil des pièces de théâtre"
de Cratinusy d’Eupolis, de Ménandre, d’Ariftophâ-
n e , d’Efchyle, de Sophocle-, d’Euripide, & fur-tout
les poéfies de Damophyle , de Sapho , & d’Ana-;
créon. Les copiftes imaginèrent de tranferire pdur
.Athènes tons ces ouvrages en petit format éga l, &
le débit en frit incroyable.
On recêvoit au cyriotarge tous les enfans illégitimes
,- & leS meres qui voudroient y venir faire
leurs couches ; mais cet établiffement utile n’eut pas
de fuccès , parce que peu de teins après fa fonda-,
tion , l’ athéniert, naturellement babillard , ne ptit
retenir fa langue ; & la révélation d’un pareil myf-
tere éloigna toutes les filles d’un certain rang, qiiife
îrouvoient malheureufement enceintes, de profiter
d’un afyle où le fecret étoit hautement violé. Elles
prirent des robes lâches pour cacher leurs grofleffe,
ou des breuvages pour faire périr leur fruit, au ha-
fard d’en être elles-mêmes la trifte viélime ; ce- qui
n’arriva que trop fou vent.
Les Athéniens n’étoient pas feulement babillards,
mais pleins de vanité. Ils entretenoient par ce feul-
mobile un très - grand nombre de domeftiquès. Les
vingt mille citoyens d’Athènes avoient cent vingt
mille valets ; quand ils fortôient, ils fe faifoient fui-
vre par des efclaves qui portoient des fiégës plians,
pour que leurs maîtres ne fuffent pas obligés de refiler
trop long-tems debout, & de fe fatiguer à marcher
dans les rues. Ils s’habilloient comme les femmes
, d’habits brodés, compofoient leur teint comme
elles, fe frifoient, fe parfumoient, mettoient des
mouches , fe plaignoient de migraine, avoient un
miroir de poche , une toilette, un nécejfaire.
L ’exemple gagnant tous les ordres de l’état, le fils
d’un Proëdre, d’un Lexiarque, d’un Telone, fe mo-
deloit fur le fils du Polémarque, du Thallafliarque &
duChiliarque. Ils affe-éloient des maniérés énfantines,
un langage traînant ; & quand ils arrivoient dans les
compagnies , ils fé jettoient fur des fiéges renverfés,
qu’ils ne quittoient qu’avec peine pour aller languir
& s’ennuyer ailleurs. Ils nommoient ces fortes de
vifites des ufages, des devoirs ; & après les avoir remplis
, ils terminoient la journée par fe rendre à quelque
farce nouvelle, ou chez quelque courtifanne qui
leur dônhoit à fouper.
Ils avoient perdu la mémoire d’Amphifrion $ de
Théfée j des Archontes qui les avoient gouvernés
avec fageffe, & ne fongeoient qu’aux bouffons, aux
danfeufes, aux baladin es qui pouvoient les divertir.
Ils encenfoient l’idole du jou r , & la fouloient aux
piés le lendemain. Sans retenue, fans principes, fans,
amour du bien public, ils étoient nés pour murmurer
, pour obéir, pour porter le joug , pour devenir
les efclaves du premier maître ; & , ce qu’il y a
de très-plaifant, des efclaves. orgueilleux. G e frit
Philippe qui daigna les affervir après la bataille dè
Chéronée. On ne le craignoit pas à Athènes comme
l’ennemi de la liberté, mais des plaifirs. Frequentius
feenam quam caflra vifentes, dit Juftin. Ils avoient fait
une loi pour punir de mort celui qui propoferoit de
convertir aux befoins de l’état l’argent deftiné pour
les théâtres. Philippe renvoya tous les prifonniers ,
mais il ne renvoya pas des hommes qui lui friffent
redoutables.
L’amour exceflif de la volupté, du repos St de
l’oifiveté , étouffoit chez les Athéniens celui de la
gloire, de l’indépendance Sc dé la vertu dè-là Ÿè-
Tomc X I ,
P A R <M7
noit fiôii -feulement! leur avüiffémënt éri génétal,
r mais en particulier la négligence.de leurs affairés ,;ld
| dépériffement de leurs ferresyde leiirs palais, «ÿde
leurs meublés;. Lès valets vivoient Comme res tnai^
très, & n’àvoient foin de rien. Les édifices , les ffta-*'
tues & les beaux ouvrages d ePéridês, tombaient eh
ruine. Ils bâtiffoient, làiflbiènt périr, & heréparbient
jamais. Ils étaient par leur malpropreté màrig'és'd'ë
vers & d’infedes; le feul appartement de Compagnie
brilloit de colifichets étalés à la vue par dftentâtibir,
mais tous les autres infeétoient : leurs efprits alrâtardis
par le luxé j ne ?’océupoieht qii’à avoir alitant; de
connoiflanCes qu’il en falloit pour en faireparadej &:
differter légèrement fur les modes , les'objets "de
goût, les attributs de la Vénus de Praxitèle, ou de la-
Minerve de Phidias.
Chez eux la plus grande fageffe confiftoit à ne
point attaquer les lois d’Athènes-, à fe rendre'aux fa-
crifices, aux fetes des dieux', à l’affemblée du péü^
pie , au prytanée à l’heure fixe, & avec des habits
d ufage. Dailleurs àifés dans leurs maniérés, & libres
dans leurs propos, ils donnoient un. plus grand prix
a ce qu’on diloit qu’à Ce qu’on faifoit. Leur foible
pour etre flatte etoit extrême; c’eft pourquoi les orateurs
, avant que d’entamer leur difeours, démàn-
dotent toujours : Quel avis, Méfjîeurs, peut vous faire
plaifir? Et les prêtres, quelsfacrifices vous feraient Les
plus agréables ?
Ils vouloiènt être amufés jufque dans les affaires
les plus ferieufes. Un de leurs citoyens rendant les
comptes de fa geftion, ajouta : « J’oubliois,Mefîiéurs,
» de vous dire qu’en me. conduifant ainfi, lorfque
>> dès amis ni’invitoient à un-repas,-jamais jën e me
» fuis trouvé le dernier à table ».. C.ette naïveté firî-
guliere frit très-bien reçue , Si tous fes comptes lui
frirent alloues. Cléon, un de leurs magiftrats, ayarit
paffé toute la nuit à l’odéum, & n’étant point prêt
k fur un fujet important qu’il de voit traiter, les pria
de remettre l’affembîée à un autre jour, « parce qu’il
» avoit, dit-il, chez lui grande ^compagnie qui s’avi-
» feroit de manger fon excellent dîner fans l’atten-
» dre ». Chacun fe mit à rire, & s’en alla gayement,
en lui difant qu’il étoit homme de trop bonne com-
pagnie pour en priver fes amis.
L’orateur Stratocle leur ayant annoncé une victoire
fur mer , on fit pendant trois jours des feux de
jo ie , & on les continuoit encore quand la nouvelle
de la défaite de l’armée navale d’Athènes arriva.
Quelques-uns lui en firent de grands reproches fur la
place. « Il eft v ra i, dit-il , que je me fuis troiftpé ,
» mais vous avez paffé trois joins plus agréablement
»que vous n’aiiriez fait fans moi». Cette répartie
calma le chagrin du peuple ; il la trouva plaifante ,&
quelqu’un fit [à-deffus la feolie ou chanfon de Stratoc
le , qu’on mit au rang des chanfons joyeufes, Sc
qu’on chanta bien-tôt après dans les carrefours.
. Ils ridiculifoient également le bien & le mal; mais
comme le mal étoit ordinaire chez eux, ils y portaient
moins d’attention. De plus , ils aimoient à
rire , & le mal ne donne poirit à rire. Aucun autre
peuple n’étoit né comme lui pour la plaifanterie Sc
les bons mots, il y avoit dans Athènes une académie
de plaifans, ainfi que des académies de philofophes ;
ces fages , comme les appelle Athénée , étoient au
nombre de foixante, & s’alfembloient dans le temple
d’Hercule ; leur inftitut étoit de raffiner fur les plal-
fanteries, & leur décifion étoit d’un fi grand poids
qu’on difoit., les foixante penfent àinji; Sc d’un railleur
fpirituel, il efl de Üacadémie des foixante. Leur
réputation s’étendit fi loin en ce genre, qu’ils comp-
toient parmi les membres de leur corps des têtes couronnées.
Philippe de Macédoine leur envoya un talent
pour y être aggrégé , & recevoir d’eux les premières
nouvelles des ridicules qu’ils inventeroienç
G G G g g g