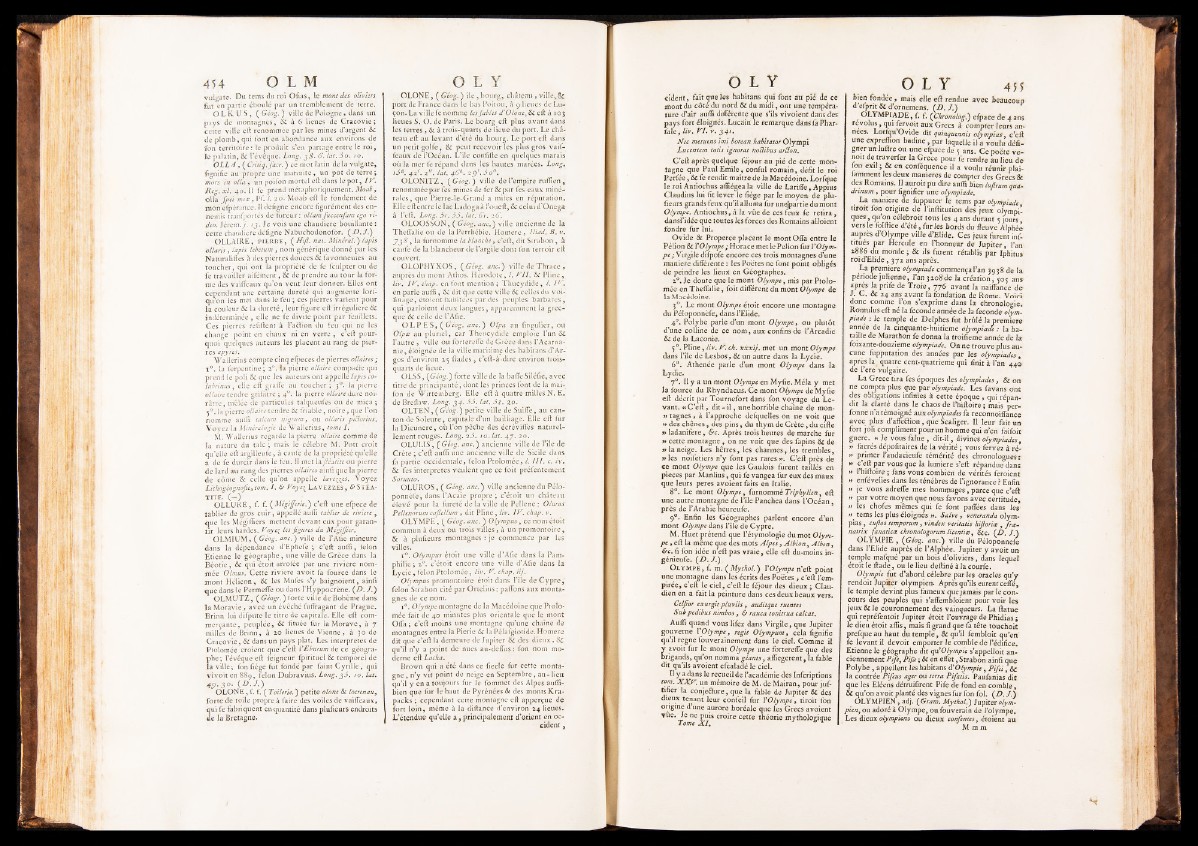
vulgàte. Du tems du roi Ofias, le m o n t d e s o liv ie r s
fut en partie éboulé par un tremblement de terre.
O L K. U S , ( Géog. ) ville de Pologne, dans un
pays de montagnes, & à 6 lieues de Cracovie ;
cette ville eft renommée par les mines d’argent 6c
de plomb, qui l'ont en abondance aux environs de
fon territoire : le produit s’en partage entre le roi,
le palatin, 6c l’évêque. Long. 38. G. lat. 5 o. 10.
O L L A , ( Critiq.facr.) ce mot latin delà vulgate,
lignifie au propre une marmite, un pot de terre;
mors in olla, un poifon mortel eft dans le pot, I V .
Reg. xl. 40. Il fe prend métaphoriquement. Moab,
olla Jpei mtce, Pf. l. ho. Moab eft le fondement de
mon efpérance. Il defigne encore figurément des ennemis
tranfportés de fureur : o/Az/re fuccenfam ego video.
lèvera, i. 13. Je vois une chaudière bouillante:
cette chaudière defigne Nabuehodonofor. (D.'J .)
OLLAIRE , PIERRE, ( Hifl. nai. Minéral.) lapis
ellaris, lapis lebetum , nom générique donné par les
Naturaliftes à des pierres douces 6c favonneufes au
toucher, qui ont la propriété de fe fculpter ou de
fe travailler aifément, & de prendre au tour la forme
des vaiffeaux qu’on veut leur donner. Elles ont
cependant une certaine dureté qui augmente lorl-
qu’on les met dans le feu ; ces pierres varient pour
la couleur 6c la dureté, leur figure eft irrégulière 6c
indéterminée, elle ne fe divile point par feuillets.
Ces pierres refiftent à l’aftion du feu qui ne les
change point en chaux ni en verre , c’eft pourquoi
quelques auteurs les placent au rang de pierres
apyres.
Wallerius compte cinqefpeces de pierres o l la i r e s ;
i ° . la ferpentine; 20. la pierre o lla ir e compafte qui
prend le poli 6c que les auteurs ont appellé l a p i s co -
l u b r in u s , elle eft grafle au toucher ; 30. la pierre
o l la i r e tendre grifâtre ; 40. la pierre o lla ir e dure noirâtre
, mêlée de particules talqueufes ou de mica ;
y°. la pierre o l la i r e tendre 6c friable, noire, que l’on
nomme aufti ta lc um n ïg r u m , ou o l la r i s p i c lo r iu s .
Voyez la M in é r a lo g ie de Wallerius, tom e I .
■ M. Wallerius regarde la pierre o lla ir e comme de
la nature du talc ; mais le célébré M. Pott croit
qu’elle eft argiileufe, à caufe de la propriété qu’elle
a de fe durcir d’ans le feu. Il met laJ lé a t it e ou pierre
de lard au rang des pierres o l la ir e s ainfi que la pierre
de côme & celle qu’on appelle la v e ^ e s . Voyez
L ith o g é o g n o f ie y tom . /. & V o y e ^ L a v e z z e s , <S* S t ÉA-
T IT E . (—)
OLLURE, f. f. ( MégiJjerie.) c’eft une efpece de
tablier de gros cuir, appellé aufti tablier de rivière ,
que les Még'ifliers mettent devant eux pour garantir
leurs hardes. Voye{ les figures du Mégifiîer.
OLMIUM, ( Géog. anc.) ville de l’Afie mineure
dans la dépendance d'Ephefe ; c’eft aufti, lelon
Etienne le géographe, une ville de Grèce dans la
Béotie, 6c qui étoit arrofée par une riviere nommée
Olmus. Cette riviere avoit fa fource dans le
mont Hélicon, 6c les Mufes s’y baignoient, ainfi
que dans le Permeffe ou dans l’Hyppocrène. (D. /.)
OLMUTZ, ( Géogr. ) forte ville de Bohème dans
la Moravie, avec un évêché fufffagant de Prague.
Brinn lui difpute le titre de capitale. Elle eft commerçante,
peuplée, & fituée fur laMorave, à 7
milles de Brinn, à 20 lieues de Vienne, à 30 de
Cracovie, & dans un pays plat. Les interprètes de
Ptolomée croient que c’eft VEburum de ce géographe;
l’évêque eft feigneur fpirituel 6c temporel de
la ville; fon fiége fut fondé par faint Cyrille, qui
vivoiten 889, félon Dubravius. Long. 30. 10. lat.
49--3 ° W L :d - J - ' )
OLONE, f. f. ( Toilerie. ) petite olone & locrenau,
forte de toile propre à faire des voiles de vaiffeaux,
iqui fe fabriquent en quantité dans plufieurs endroits
de la Bretagne.
OLONE, ( G é o g .) î le , bourg, château, ville ,&
port de France dans le bas Poitou, à 9 lieues de Lu-
çon. La ville fe nomme le s J a b le s d 'O lo n e } & eft à 103
lieues S. O. de Paris. Le bourg eft plus avant dans
les terres, & à trois-quarts de lieue du port. Le château
eft au levant d’été du bourg. Le port eft dans
un petit golfe, 6c peut recevoir les plus gros vaiffeaux
de l’Océan. L’île confifte en quelques marais
oü la mer fe répand dans les hautes marées. L o n g .
) i d . 4 2 ' . 2 " . l a t . q G A. 2 9 ' . 6 0
OLON IT Z, ( G é o g . ) ville de l’empire ruflien
renommée par fes mines de fer & par fes eaux minérales,
que Pierre-le-Grand a miles en réputation.
Elle eft entre le lac Ladoga à l’oueft, 6c celui d’Onega
à i’eft. L o n g . 5 1 .55. l a t . G 1. 2 6 " . ■
OLOOSSON, ( G é o g . a n c . ) ville ancienne de la
Theffalie ou de la Perrhébie. Homere, I l i a d . B . v .
y 3 8 , la furnomme l a b la n c h e , c’eft, dit Strabon , à
caufe de la blancheur de l’argile dont fon terroir eft
couvert.
. OLOPHYXOS, ( :G é o g . a n c : ) ville de Thrace ,
auprès du mont Athos. Hérodote, Z. V I I . 6 c Pline,
l i v . I V . c h a p . en font mention ; Thucydide, l . I V .
en parle aufti, 6c dit que cette ville 6c celles du voi-
finage, étoient habitées par des peuplés barbares,
qui parloient deux langues, apparemment la grecque
6c celle de l’Afie.
O L P E S , ( G é o g . a n c . ) O lp a au fingulier, ou
O lp oe au pluriel, car Theucydide emploie l’un 6 c
l’autre, ville ou fortereffe de Grèce dans l’Acarna-
nie, éloignée de la ville maritime des habitans d’Ar-
gos d’environ 25 ftades , c’eft-à -dire environ trois-
quarts de lieue.
OLSS, ( G é o g . ) forte ville de la baffe Siléfie, avec
titre de principauté, dont les princes font de la mai-
fon de Wirtemberg. Elle eft à quatre milles N. E.
de Breflaw. L o n g . 3 4 . 55. l a t . 5i . 2 0 .
OLTEN, ( G é o g . ) petite ville de Suiffe, au canton
de Soleure, capitale d’un bailliage. Elle eft fur
la Dieunere, oti l’on pêche des écréviffes naturellement
rouges. L o n g . 2 5. 1 0 . la t . 47. 2 0 .
OLULIS, ( G é o g . a n c . ) ancienne ville de l’île de
Crète ; c’eft aufti une ancienne ville de Sicile dans
fa partie occidentale, félon Ptolomée , l . I I I . c . i v .
6c fes interprètes veulent que ce foit préfentement
S o r u u to .
OLUROS, ( G é o g . a n c . ) ville ancienne du Pélo-
p o n n è f e , dans l’Acaïe propre; c’étoit un château
élevé pour la fureté de la ville de Pellene; O lu r o s
P e lle n o r u r n c a f ie llum , dit Pline , l i v . I V . c h a p . v .
OLYMPE, f G é o g . a n c . ) O l y m p u s , ce nom étoit
commun à deux ou trois villes, à un promontoire ,
& à plufieurs montagnes : je commence par les
villes.
i° . O ly m p u s étoit une ville d’Afie dans la Pam-
philie ; 20. c’étoit encore une ville d’Afie dans la
L y cie , félon Ptolomée, l i v . V . ch a p . ü j .
O ly m p u s promontoire étoit dans l’île deCypre,'
félon Strabon cité par Ortelius : paffons aux montagnes
de ce nom.
i°. O ly m p e montagne de la Macédoine que Ptolo-
mée fait de 40 minutes plus orientale que le mont
Offa ; c’eft moins une montagne qu’une chaîne de
montagnes entre la Pierie 6c la Pélalgiotide. Homere
dit que c’eft la demeure de Jupiter 6c des dieux, 6c
qu’il n’y a point de nues au-deffus : fon nom moderne
eft L a c h a .
Brown qui a été dans ce fiecle fur cette montagne
, n’y vit point de neige en Septembre, au - lieu
qu’il y en a toujours fur le fommet des Alpes aufli-
bien que fur le haut de Pyrénées & des monts Kra-
packs ; cependant cette montagne eft apperçue de
fort loin, même à la diftance d’environ 24 lieues.
L ’étendue qu’elle a , principalement d’orient en occident
,
O L Y
cîdent, fait que les habitans qui font au pié de ce
mont du côté du nord 6c du midi, ont une température
d’air aufti différente' que s’ils vivüienf dans des
pays fort éloignés. Lucain le remarque danslaPhar-
la le , liv. VI. v. 3 4 1 •
Nec metuenS imi borean habitator Olympi
Lucentem totis ignorât fioclibus arcton.
C ’eft après quelque féjour au pié de cette montagne
que Paul Emile, conful romain, défit le rot
Perfée, 6c fe rendit maître de la Macédoine. Lorfque
le roi Antiôchus afliégea la ville de Lariffe , Appius
Claudius lui fit lever le fiége par le moyen de plufieurs
grands feux qu’il alluma fur unejpartie du mont
Olympe. Antiôchus, à la vue de ces feux fe retira,
dansl’idée que toutes les forces des Romains àlloient
fondre fur lui.
Ovide & Properee placent le mont Offa entre le
Pélion 6c l’Olympe; Horace met le Pelion fur YOLym-
p i ; Virgile difpofe encore ces trois montagnes d’une
maniéré différente : les Poètes ne font point obligés
de peindre les lieux en Géographes.
2°. Je doute que le mont Olympe , mis par Ptolomée
en Theffalie, foit différent du mont Olympe de
la Macédoine.
30. Le mont Olympe étoit encore une montagne
du Péloponnèfe, dans l’Elide.
40. Polybe parle d’un mont Olympe, ou plutôt
d’une colline de ce nom, aux confins de l’Arcadie
6c de la Laconie.
ç°. Pline, liv. V. ch. xlcxij. met un mont Olympe
dans l’île de LesboS , 6c un autre dans la Lycie.
6°. Athenée parle d’un mont Olympe dans la
Lydie.
70. Il y a un mont Olympe en Myfie. Mêla y met
la fource du Rhyndacus. C e mont Olympe de Myfie
eft décrit par Tournefort dans fon voyage du Levant.
« C ’eft , d i t - i l , une horrible chaîne de mon-
» tagnes, à l’approche defquelles on ne voit que
» des chênes, des pins, du thym de C rè te, du cifte
» ladanifere, &c. Après trois heures de marche fur
» cette montagne , on ne voit que des fapins 6c de
»laneige. Les hêtres, les charmes, les trembles,
» les noifetiers n’y font pas rares ». C ’eft près de
ce mont Olympe que les Gaulois furent taillés en
pièces par Manlius, qui fe vangea fur eux des maux
que leurs peres avoient faits en Italie.
8°. Le mont Olympe, furnommé Triphylien, eft
une autre montagne de 111e Panchea dans l ’O céan,
près de l’Arabie heureufe.
90. Enfin les Géographes parlent encore d’un
mont Olympe dans l’île de Cypre.
M. Huet prétend que l’étymologie du mot Olympe
, eft la même que des mots Alpes, Albion, Alben,
ùc.fx fon idée n’eft pas vraie, elle eft du-moins in-
génieufe. (D. J.)
Ol ym p e , f. m. (Mythol.) Y Olympe n’eft point
une montagne dans les écrits des Poètes, c ’eft l’em-
pirée, c’eft le c iel, c’eft le féjour des dieux ; Clau-
dien en a fait la peinture dans ces deux beaux vers.
Celfior exurgit pluviis , auditque ruentes
Sub pedibus nimbos , & rauca tonitrua calcat.
Aufti quand vous lifez dans Virgile, que Jupiter
gouverne l’Olympe, régit Olympum, cela fignifte
qu’il régné fouverainemem dans le ciel. Comme il
y avoit fur le mont Olympe une fortereffe que des
brigands, qu’on nomma géants, aftiegerent, la fable
dit qu’ils avoient efcaladé le ciel.
Il y a dans le recueil de l’académie des Infcriptions
«m lfi un mémoire de M. de Mairan, pour juf-
tifier la conjeélure, que la fable de Jupiter 6c des
dieux tenant leur confeil fur YOlympe, tiroit fon
origine d’une aurore boréale que les Grecs avoient
v^ie* j [ e ne Puis croire cette théorie mythologique
Tome X I .
O L Y 45*
bien fondée, mais elle eft rendue avec beaucoup
u’efprit & d’ornemens. (D . J.)
, OLYMPIADE, f. f. (Chronolog.) efpace de 4 ans
révolus, qui fer voit aux Grecs à compter leurs an»
! nees. Lorlqu’Ovide dit quinquennis olympias, c’eft
une expreffion badine, par laquelle il a voulu défî-
gner un-luftre ou une efpace de 5 ans. Ce poète ve-
noit de traverfer la Grece pour fe rendre au lieu de
fon exil ; & en conféquence il a voulu réunir plai-
fa'mment les deux maniérés de compter des Grecs 8c
des Romains. II auroit pu dire aufti bien lufirum quel*
drinum, pour fignifier une olympiade.
La maniéré de fupputer le tems par olynipiade
tiroit fon origine de l’inftitution des jeux olympiques,
qu’on célebroit tous les 4 ans durant 5 jours
vers le fblftice d’é té , fur les bords du fleuve Alphée
auprès d’Olympe ville d’EIide. Ces jeux furent inf-
titués par Hercule en l’honneur de Jupiter, l’an
2886 du monde ; 6c ils furent rétablis par Iphitus
roid’Elide, 372 ans après.
La première olympiade commença l’an 3938 de la.
période julienne, l’an3208de la création, 505 ans
après la prife de Troie , 776 avant la nailïance de
J. C. & 24 ans avant la fondation de Rome. Voici
donc comme Yon s’exprime dans la chronologie,
Romulus eft né la fécondé année de la fécondé olympiade
: le temple de Delphes fut brûlé la première
année de la cinquante-huitieme olympiade: la bataille
de Marathon fe donna la troifieme année de la
foixante-douzieme olympiade. On ne trouve plus aucune
fupputation des années par les olympiades,
après la quatre cent-quatrieme qui finit à l’an 440
de l’ere vulgaire.
La Grece tira fes époques des olympiades, & on
ne compta plus que pur olympiade. Les favans ont
des obligations infinies à cette époque, qui répandit
la clarté dans le chaos de l’hiftoire ; mais per-
fonne n’a témoigné aux olympiades fa reconnoiffance
avec plus d’afle&ion, que Scaliger. II leur fait un
fort joli compliment pour un homme qui n’en faifoit
guère. « Je vous falue , dit-il, divines olympiades.
» facrés dépofitaires de la vérité ; vous fervez à ré-
» primer l’audacieufe témérité des chronologues :
» c’eft par vous que la lumière s’eft répandue dans
» l’hiftoire ; fans vous combien de vérités feroient
» enfévelies dans les ténèbres de l’ignorance ? Enfin
» je vous adreffe mes hommages, parce que c’eft
» par votre moyen que nous favons avec certitude,
» les chofes mêmes qui fe font paffées dans lés
» tems les plus éloignes ». Salve , veneranda olympias
, cujlos temporum , vindex veritatis hifiorice , free-
natrix fanaticct chronologorum liuntia, &c. (D . J.)
OLYMPIE , (Géog. anc.) ville du Péloponnèfe
dans l’Elide auprès de l’Alphée. Jupiter y avoit un
temple mafqué par un bois d’oliviers, dans lequel
étoit le ftade, ou le lieu deftiné à la courfe.
Olympie fut d’abord célébré par les oracles qu’y
rendoit Jupiter olympien. Après qu’ils eurent ceffe,
le temple devint plus fameux que jamais par le concours
des peuples qui s’affembloient pour voir les
jeux & le couronnement des vainqueurs. La ftatue
qui repréfentoit Jupiter étoit l’ouvrage de Phidias ;
le dieu étoit aflis, mais fi grand que fa tête touchoit
prefque au haut du temple, & qu’il fembloit qu’en
fe levant il devoit emporter le comble de l’édifice.
Etienne le géographe dit qu’Olympie s’appelloit anciennement
Pife, Pifia ; & en effet, Strabon ainfi que
Polybe , appellent les habitans G!Olympie, Pifei, 6c
la contrée Pifeus ager ou terra Pifatis. Paufanias dit
que les Eléens détruifirent Pife de fond en comble ,
& qu’on avoit planté des vignes fur fon fol. (D. J .)
OLYMPIEN , adj. (Gram. Mythol.) Jupiter olym-
pieny ou adoré à Olympe, ou fouverain de l’olympe.
Les dieux olympiens ou dieux confentes, étoient au
M m m