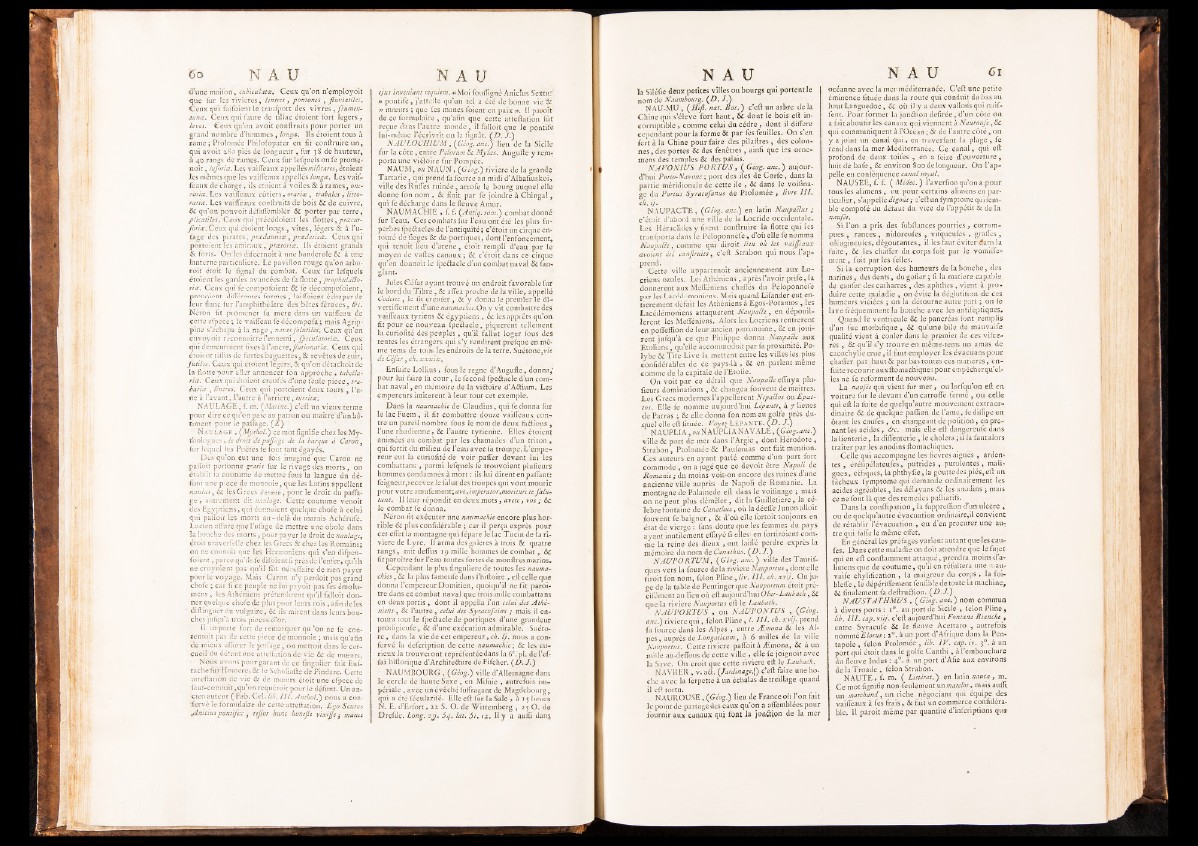
6° N A U N A U
■ d’une maifon, cubiculatce. Ceux qu’on n’employolt
-que fur les rivières, lentres, pontones , fiuviatiles.
Ceux qui faifoient le tranfport des vivres ,frumen-
oeanoe. Ceux qui faute de tillac étoient fort légers ,
Jeves. Ceux qu’on avoit conftruits pour porter lin
grand nombre d’hommes , longoe. Ils étoient tous à
rame; Ptôlomée Philofopater en fit conftrtiire un,
■ qui avoit 280 pies de longueur , fur 38 de hauteur,
à 40 rangs de rames. Ceux fur lefquels on fe prOme-
nô it, luforioe. Le§ vaifleaux appelles militares, étoient
les mêmes que les vaifleaux appelles longoe. Les vaif-
feaux de charge, ils etoient à voiles & à rames, one-
rarioe. Les vaiffcaux côtiers, or aria , trabalcs, litto-
■ rarioe, Le.s vaifleaux conflruits de'bois & de cuivre,
& qu’on pouvoit défaflembler & porter par terre,
plicatiles, Ceux qui précédoient les flottes, proecur-
forioe. Ceux qui étoient longs , vîtes, légers & à l’u-
fage des pirates, proeddtorioe , proedaticoe. Ceuxqui
pôrtoient les amiraux, proetorioe. Ils étoient grands
& forts. On les difcernoit à une banderole & à une
lanterne particulière. Le pavillon rouge qu’on arbo-
roit étoit le lignai du combat. Ceux fur lefquels
étoient les gardes avancées de fa flotte, prophulado*
rioe. Ceux qui le comp’ofoient & fc décompofoient,
prenoient différentes formes, laifloient échaperde
leur flanc fur l’amphithéâtre des bêtes féroces, &c.
Néron fit promener fa mere dans un vailfeau de
cette efpece ; le vailfeau fe décompofa ; mais Agrippine
s’échapa à la nage , navesfolutiles'. Ceux qit’ôn
envoyoit reconnoître l’en n em ifpeculàtorioe. Ceux
qui demeuroient fixes àTancre,ftationarioe. Ceux qui
étoient tiffus de fort'es baguettes, & revêtus de cuir,
faciles. Ceux qui étoient légers1, & qu’ori'détachoit de
la flotte pour aller annoncer Ion approche, tabella-
rioe. Ceux qui étoient creufés d’une feule piece, tra-
baria , lintres. Ceux qui portoient deux tours , Lune
à l’avant, l’autre à l’arriere, turritoe.
NAULAGE, f. m. (Marine.) c’eft un vieux terme
pour dire ce qu’on paie au patron ou maîtré’d’iin bâtiment
pour ie paflagë. (Z ) 1
Naulage , (Myihol.) ce mot lignifie chez les M ythologues
, le droit depaffage de la barque à Caron,
fur lequel les Poëtes lé font tant égayés.
Dès qu’on eut une fois imaginé que Caron ne
pafloit perfonne gratis fur 1e rivage des morts , on
établit la coutume de mettre fous la langue du défunt
une piece de monnoie, que les Latins appellent
..naulus, & lès Grecs S'a.var.», pour le droit du paffa-
,ge , autrement dit naulage. Cette coutume venoit
•des Egyptiens, quidonnoient quelque chofè à celui
qui palfoit les morts au-delà du marais Achérufe.
Lucien aflure que l’ufage de mettre une obole dans
la bouche des morts, pour payer le droit àe naulage,
étoit univerfelle chez les Grecs & chez les Romains;
on ne connoît que les Hermoniens qui s’en difpen-
foient, parce qu’ils fe difoientfi près de l’enfer, qu’ils
ne croyoient pas qu’il fût néceffaire de rien payer
pour le voyage. Mais Caron n’y perdoit pas grand
chofe ; car fi ce peuple ne lui payoit pas fes émolu-
mens , les Athéniens prétendirent qu’il falloit donner
quelque chofe de plus pour leurs rois, afin de les
■ diftinguer du vulgaire, & iis mirent dans leurs bouches
jufqu’à trois pièces d’or.
Il importe fort de remarquer qu ’on ne fe con-
îentoit pas de cette piece de monnoie ; mais qu’afin
•de mieux affurer le palfage, on mettoit dans le cercueil
du detuntune atteftationde vie & de moeurs.
Nous avons pour garant de ce finguiier fait Euf-
tache fur Homere, & le Scholiafte de Pindare. Cette
•atreftarion de vie & de moeurs étoit une efpece de
fauf-conduit,qu’on requéroit pour le défunt. Un ancien
auteur ( Fab. -Cel. lib. III. Anthol.) nous a conservé
le formulaire de cette attefiation. Ego Sextus
<dmcius pontifex, tcjlor hune honejle yixijjc ; mânes
ejùs inventant requiem. «Moi foufligné Anicîus SeXtuf
» pontife, j’attefte qu’un tel a été de bonne vie &
»> moeurs ; que fes mânes foient en paix ». Il panoït
de ce formulaire , qu’afin que cette atteftation fût
reçue dans l’ autre monde, il falloit que le pontife
lui-même l’écrivrît ou la fignât. {D . J.)
N AULOCHIUM, {Géog. dnc.') lieu de la Sicile
fur la cô te, entre Pdorum & Mylas. Augufte y remporta
une viâoire fur Pompée.
NAUM, ou NAUN, (Géog.) riviere de la grande
Tartarie, qui prend fa fource au midi d’Albafiuskoi,
ville des Rufles ruinée, arrofe le bourg auquel elle
donne fon nom , & finit par fe joindre à Chingal,
qui fe décharge dans le fleuve Amur.
NAUMACHIE , f. î. (Anùq.rom.) combat donné'
fur l’eau. Ces combats fur l’eau ont été les plus fu-
perbes fpe&acles de l’antiquité ; c’étoit un cirque entouré
de fieges & de portiques, dont l’enfoncement,
qui tenoit lieu d’arene, étoit rempli d’eau par le
moyen de vaftes canaux ; &: c’étoit dans ce cirque
qu’on donnoit le fpeûacle d’ un combat naval & fan-,
glànr.
Jules Céfar ayant trouvé un endroit favorable fur
le bord du T ib re , & allez proche de la ville, appelle
Codette , le fit creufer , & y donna le premier le di-
vertiffement une naumachie.Ony vit combattre des
vaifleaux tyriens & égyptiens, ôc les apprêts qu’on
fit pour ce nouveau fpectacle, piquèrent tellement
la curiofité des peuples , qu’il fallut loger fous des
tentes les étrangers qui s’y rendirent prefque en même
tems de toûè les endroits de la terre. Suétone,vie
de Céfar, ch. x x x ix .
Enfuite Lollius , fous le régné d’Augufte, donna;
pour lui faire fa cou r, le fécond fpettacle d’un combat
naval, en mémoire de la victoire d’Aftium. Les
empereurs imitèrent.à leur tour cet exemple.
Dans la naumachie de Claudius, qui fe donna fur
le lac Fuem , il fit combattre douze vaifleaux contre
un pareil nombre fous le nom de deux faûions ,
l’une rhodienne, & l’autre tyrienne. Elles étoient
animées au combat par les chamades; d’un triton ,
qui fortit du milieu de l’eau avec fa trompe. L’empereur
eut la curiofité de voir palier devant lui les
combattans , parmi lefquels fe trouvoient plufieurs
hommes condamnés à mort : ils lui dirent en paffant:
feigneur,recevez lefalut des troupes qui vont mourir
pour votre amufement; ave, imperator,moritun te falu-
tant. Il leur répondit en deux mots , avete , vos ; &
le combat fe donna.
Néron fit exécuter une naumachie encore plus horrible
&c plus confidérable ; car il perça exprès pour
cet effet la montagne qui fépare le lac Tucin de la riviere
de Lyre. Il arma des galeres à trois & quatre
rangs, mit deffus 19 mille hommes de combat, &
fitparoître fur l’eau toutes fortes de monftresmarins.
Cependant la plus finguliere de toutes les nauma-
chies, & la plus fameufe dans i’hiftoire , eft celle que
donna l’empereur Domitien, quoiqu’il ne fît paroi-
tre dans ce combat naval que trois mille combattans
en deux partis , dont il appella l’un celui des Athe~
niens, & l’autre, celui des Syracufains ; mais il entoura
tout le fpeâacle de portiques d’une grandeur
prodigieufe, & d’une exécution admirable. Suéto-
r e , dans la vie de cet empereur, ch. Lj. nous a con-
fervé la defeription de cette naumachie ; & les curieux
la trouveront repréfentéedans la 6e. pl. de l’ef-,
fai hiftorique d’Architefture de Fifcher. (-Ô. ƒ.)
NAUMBOURG , ( Géog.) ville d’Allemagne dans
le cercle de haute Saxe , en Mifnie , autrefois impériale
, avec un évêché fuffragant de Magdebourg,
qui a été fécularifé. Elle eft fur la Sale , à 15 lieues
N. E. d’Erfort, 22 S. O. de "Vittemberg , z 5 O. de
Drefde. Long. 29. lat. j i , i z , Il y a aufli dan§
N A U
la Siléfie deux petites villes ou bourgs qui portent le
nom de Naumbourg. (JD. /.)
NAU-MU, (Hijl. nat. Bot.') c’eft un arbre de la
Chine qui s’élève fort haut, èc dont le bois eft incorruptible
, comme celui du cèdre , dont il différé
cependant pour la forme & par fes feuilles. On s’en
fert à la Chine pour faire des pilaftres , des colonnes
, dès portes & des fenêtres , ainfi que les orne-
mens des temples & des palais.
N A VONIUS PO R T U S , ( Géog. anc. ) aujourd’hui
Porto-N avoue ; port des iles de Corfe, dans la
partie méridionale de cette ile , & dans le voifina-
ge du Portas Syracufanus de Ptolomée , livre III.
ch. ij.
N A UP A C T E , {Géog. anc.) en latin Naupaclus ;
c ’étoit d’abord une ville de la Locride occidentale.
Les Héraclides y firent conftruire la flotte qui les
tranfporta dans le Péloponnefe, d ou elle fe nomma
Naupacle, comme qui diroit lieu ou les vaijfeaux
avoient été conflruits, c’eft Strabon qui nous l’apprend.
Cette ville appartenoit anciennement aux Lo-
criens ozoles. Les Athéniens , après l’avoir prife, la
donnèrent aux Mefféniens chaffés du Péloponnèfe
par les Lacédémoniens. Mais quand Lifander eut entièrement
défait les Athéniens à Egos-Potamos , les
Lacédémoniens attaquèrent Naupacle , en dépouillèrent
les Mefféniens. Alors les Locriens rentrèrent
en poffeflion de leur ancien patrimoine, & en jouirent
jufqu’à ce que Philippe donna Naupacle aux
Etoliens, qu’elle accommodoit par fa proximité. Po-
lybe & T ite-Live la mettent entre les villes les plus
confidérables de ce pays-là , & en parlent même
comme de la capitale de l’Etolie.
On voit par ce détail que Naupacle effuya^ plufieurs
dominations , &: changea fouvent de maîtres.
Les Grecs modernes l’appellerent Nepaclos onEpac-
tos. Elle fe nomme aujourd’hui Lèpante, à 7 lieues
de Patras. ; & elle donna fon nom au golfe près duquel
elle eft fituée. Vyyeç L épante. {D . J .)
NAUPLIA, ou NAUPLIA NAVALE, {Géog. anc.)
ville & port de mer dans l’Argie , dont Hérodote ,
Strabon, Ptôlomée & Paufanias ont fait mention.
Ces auteurs en ayant parlé comme d’un port fort
commode , on a jugé que ce devoit être Napoli de
Romanie ; du moins voit-on encore des ruines d’une
ancienne ville auprès de Napoli de Romanie. La
montagne de Palamecle eft dans le voifinage ; mais
en ne peut plus démêler , dit la Guilletiere, la célébré
fontaine de Cànathus, ou la deefle Junon alloit
fouvent fe baigner , & d’où elle fortoit toujours en
état de vierge : fans doute que les femmes du pays
ayant inutilement eflayé fi elles' en fortiroient comme
la reine des dieux , ont laifle perdre exprès la
mémoire du nom de Canathus. {D .J .)
N AUPOR TUM, {Géog. anc. ) ville des Taurif-
ques vers la fource de la riviere Nauportus, dont elle
tiroit fon nom, félon Pline, liv. I II. ch. xvij. On juge
de la table de Peutingerque Nauponum étoit pré-
cifément au lieu où eft aujourd’hui Ober-Laubach, &
que la riviere Nauportus eft le Laubach.
NAUPORTUS , ou NAUPONTUS , {Géog.
*nc.) riviere q ui, félon Pline, /. I II. ch. xvij. prend
fa fource dans les Alpes , entre Æ/nona & les Alpes
, auprès de Longaticum, à 6 milles de la ville
Nauportus. Cette riviere paflbit à Æmona, & à un
mille au-deffous de eette ville , elle fe joignoit avec
la Save. On croit que cette riviere eft le Laubach.
NAVRER, v. aa . {Jardinage.j) c’eft faire une hoche
avec la ferpette à un échalas de treillage quand
il eft tortu.
NAUROUSE, {Géog.) lieu de France où l’on fait
le point de partage des eaux qu’on a affemblées pour
fournir aux canaux qui font la jonâjon de la mer
N A U 61
océanne avec la mer méditerranée. C ’eft une petite
éminence fituée dans la route qui conduit du bas au
haut Languedoc, 8i où il y a deux vallons qui naif-
fent. Pour former la jon&ion defirée , d’un côté on
a fait aboutir les canaux qui viennent à Nauroufe, &
qui communiquent à l’Océan ; & de l’autre c ô té , on
y a joint un canal qui, en traverfant la plage , fe
rend dans la mer Méditerranée. Ce canal, qui eft
profond de deux toifes , en a feize d’ouverture,
huit de bafe, & environ floo de longueur. On l ’appelle
en conféquence canal royal.
NAUSÉE, f. f. ( Médec. ) l’averfion qu’on a pour
tous les alimens , ou pour certains alimens en particulier,
s’appelle dégoût; c’eft un fymptome quifem-
ble compofé du défaut du vice de l’appétit & de la
naufée.
Si l’on a pris des fubftances pourries, corrompues
, rances, nidoreufes , vifqueufes , graffes,
oléagineufes, dégoûtantes, il les faut éviter dans la
fuite, & les chaffer du corps foit par le vomiffe-
ment, foit par les felles.
Si la corruption des humeurs de la bouche, des
narines, des dents, du gofier ; fi la matière capable
de eaufer des catharres , des aphthes , vient à produire
cette maladie , on évite la déglutition de ces
humeurs viciées ; on la détourne autre part ; on fe
lave fréquemment la bouche avec les antifeptiques,
- Quand le ventricule & le pancréas font remplis
d’un lue morbifique , & qu’une bile de mauvaife
qualité vient à couler dans le premier de ces vifee-
res , & qu’il s’y trouve en même-tems un amas de
cacochylie çrue, il faut employer les évacuans pour
chaffer par haut & par bas toutes ces matières, en-
fuite recourir auxftomachiques pour empêcher qu’el-,
les ne fe reforment de nouveau.
La naufée qui vient fur mèr, ou lorfqu’on eft en
voiture fur le devant d’un carroffe. fermé , ou celle
qui eft la fuite de quelqu’autre mouvement extraordinaire
& de quelque paflion de l’ame,.fediflipe en
ôtant les eaufes , en changeant de pofition, en pre->
nant les: acides, &c. mais elle eft dangereufe dans
la lienterie, la diffenterie, le choiera ; il la faut alors
traiter par les anodins ftomachiques.
Celle qui accompagne les fievres aiguës , ardentes
, éréfipélateufes, putrides , purulentes , malignes
, eftiques, la phthyfie, la goutte des piés, eft un
fâcheux fymptome qui demande ordinairement les
acides agréables, les délayans & les anodins ; mais
ce ne font là que des remedes palliatifs.
Dans la conftipation, la fuppreflion d’un ulcéré ,
ou de quelqu’autre évacuation ordinaire,il convient
de rétablir l’évacuation , ou d’en procurer une autre
qui faffe le même effet.
En général les préfages varient autant que les califes.
Dans cette maladie on doit attendre que lefujet
qui en eft conftamment attaqué, prendra.moins d’a-
limens que de coutume, qu’il en réfultera une mauvaife
chylification , la maigreur du corps, la foi-
bleffe, le dépériffement fenfible de toute la machine,
& finalement fa deftruftion. {D.J .)
NAUSTATHMUS, ( Géog. anc. ) nom commun
à divers ports : i° . au port de Sicile , félon Pline ,
lib. I II. cap.viij. c’eft aujourd’hui Fontane Bianche ,
entre Syracufe & le fleuve Acettaro , autrefois
nommé Elorus : z°. à un port d’Afrique dans la Pen-
tapole , félon Ptolomée , lib. IF . cap. iv. 30. à un
port qui étoit dans le golfe Canthi, à l’embouchure
du fleuve Indus : 40. à un port d’Afie aux environs
de la Troade , félon Strabon.
N AUTE , f. m. ( Littèrat.) en latin nauta, m.
Ce mot fignifie non feulement nnmatelot, mais aufli.
un marchand, un riche négociant qui équipe des
vaifleaux à fes frais, & fait un commerce confidéra-
ble. Il paroît même par quantité d’inferiptions qu*