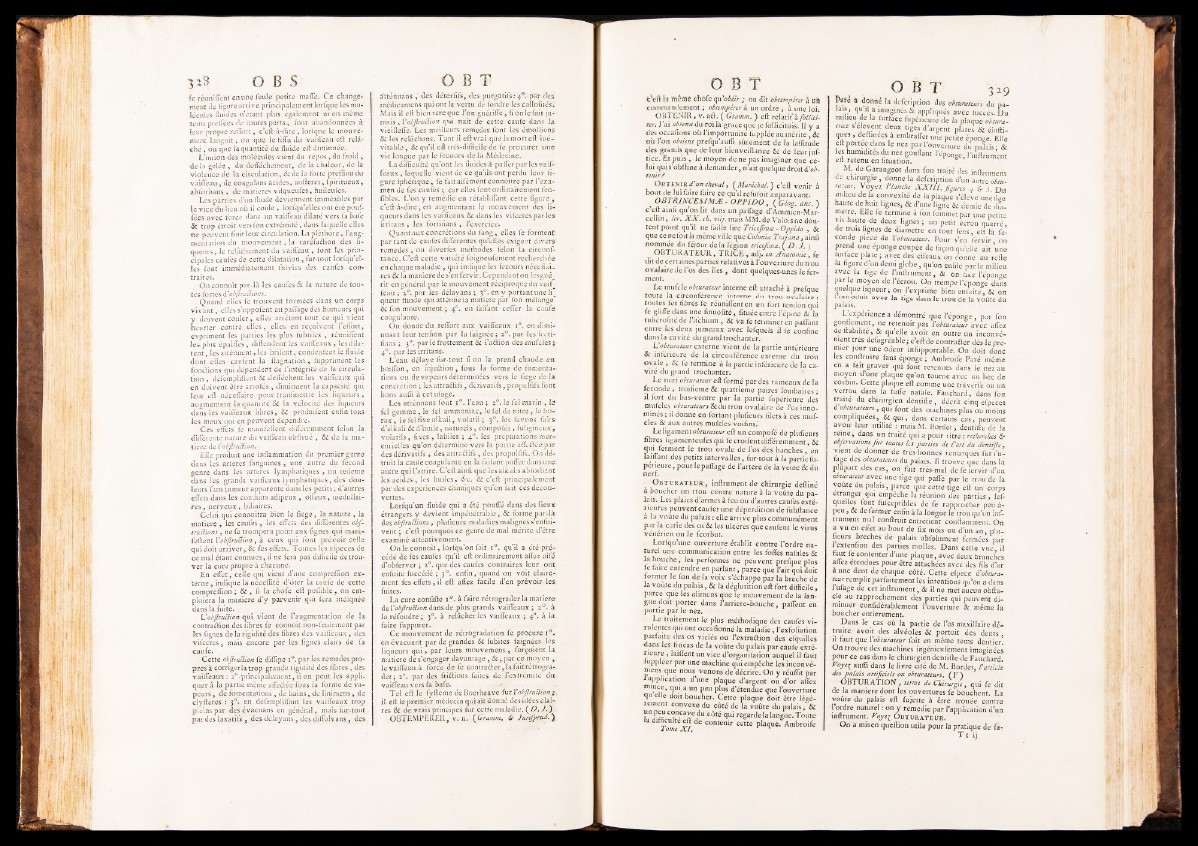
fe réunîffe'fit en ufie feule petite maffe. Ce changement
de fi«ure arrive principalement lorfque les molécules
fluides n’étant plus également ni en même
tems preffées de toutes parts, font abandonnées à
leur propre -reflbrt, c’eil-à-dire , lorfque le mouvement
languit, ou que le tiffu du vaiffeau eft relâché
, ou que la quantité du fluide eft diminuée.
L’union des molécules vient du repos, du froid ,
-delà gelée , du defléchement, de la chaleur, de la
violence de la circulation, & d e la forte preffiondu
Vaiffeau-, de-coagulans acides, aufteres, fpiritueux,
abforbans , de matières vifqueufes, huileufes»
Les parties d’un fluide deviennent imméablcs par
le vice du lieu oii il coule , lorfqu’elles ont été pouf-
fées avec force dans un vaiffeau dilaté vers la bafe
& trop étroit versfon extrémité, dans laquelle elles
ne peuvent finir leur circulation. La pléthore, l’aiig-
mentation du mouvement, la raréfaction des liqueurs,
le relâchement du vaifléau font les principales
caufes de cette dilatation, fur-tout lorfqu’el-
ïes font immédiatement fui vies des caufes contraires.
On connoît par-là les caufes & la nature de toutes
fortes d’obfiructions.
Quand elles fe trouvent formées dans un corps
v iv an t , elles s’oppofent au paffage des humeurs qui
y doivent couler, elles arrêtent tout ce qui vient
heurter contre elles, elles en reçoivent l’effort,
expriment les parties les plus fubtiles , réunifient
les. plus épaiffesj diftendent les vaiffeaux, lesdila*
tent, les atténuent, les brifent, condenfent le fluide
dont elles caufent la ftagnation., fuppriment les
fonctions qui dépendent de l’intégrité de la circulation
, défempliffent 6c defféchent les vaiffeaux qui
en doivent être arrofés , diminuent la capacité qui
leur eft néceffaire pour tranfmettre les liqueurs,
augmentent la quantité 6c la vélocité des liqueurs
dans les vaiffeaux libres, & produifent enfin tous
les maux qui en peuvent dépendre.
Ces effets fe manifeftcnt différemment félon la
différente nature du vaiffeau obftrué , 6c de la matière
de V objlruçtion.-
Ellc produit une inflammation du premier genre
dans les arteres fanguines , une autre du fécond
genre dans les arteres lymphatiques , un oedeme
dans les grands vaiffeaux lymphatiques, des douleurs
fans tumeur apparente dans les petits; d’autresi
effets dans les conduits adipeux , offeux, médullaires
, nerveux, biliaires.
Celui qui connoîtra bien le fiege, la nature , la
matière , les caufes, les effets des différentes obf-
truclions, ne fe trompera point aux Agnes qui mani-
feftent Yobftruclion, à ceux qui font prévoir celle
qui doit arriver, 6c fes effets. Toutes les efpeces de
ce mal étant connues, il ne fera pas difficile de trouver
la cure propre à chacune.
En effet, celle qui vient d’une compreffion externe
, indique la néceffité d’ôter la caufe de cette
compreffion ; & , fi la chofe eft poffible, on emploiera
la maniéré d’y parvenir qui fera indiquée
dans la fuite.
Vobjîruclion qui vient de l’augmentation de la
eontraélion des fibres fe connoît non-feulement par
les fignes de la rigidité des fibres des vaiffeaux, des
vifceres, mais encore par les fignes clairs de fa
caufe.
Cette objlruclion fe diffipe i° . par les remedes propres
à corriger la trop grande rigidité des fibres , des
vaiffeaux: i°.principalement, li on peut les appliquer
à la partie même affeôée fous la forme de vapeurs
, de fomentations, de bains, de linimens, de
clyfteres : 30. en défempliffant les vaiffeaux trop
pleins par des évacuans en général, mais fur-tout
par des laxatifs , des délayans, des diffolvans, des
à’îtéhuâns , des déterfifs, des purgatifs:40. pat- des
médicamens qui ont la vertu de fondre les callofitési
Mais il eft bien rare que l’on guériffe, fi on le fait jamais
, Yobftruclion qui naît de cette caufe dans la
vieilleflé. Les meilleurs remedes font les émolliens
6c les relâchans. Tant il eft vrai que la mort eft inévitable,
& qu’il eft très-difficile de fe procurer une
vie longue par le fecours de la Médecine.
La difficulté qu’ont les fluides à paffer par les vaiffeaux
, laquelle vient de ce qu’ils ont perdu leur figure
fphérique, fe faitaifément connoître par l’exa*
men de fes caufes ; car elles font ordinairement fen-
fibles. L’on y remédie en rétabliffant cette figure 9
c’eft-à-dire, en augmentant le mouvement des liqueurs
dans les vaiffeaux 6c dans les vifceres par les
irritans-, les fortifians , l’exercice-.
Quant aux concrétions du fang, elles fe forment
par tant de caufes différentes quelles exigent divers
remedes-, ou diverfes méthodes félon lacirconf-
tance. C ’eft cette variété foigneufement recherchée
en chaque maladie , qui indique les fecours néceflai-
res 6c la maniéré de s’en fervir. Cependant on les gué_
rit en général par le mouvement réciproque du vaif
feau ; 20. par les délayans ; 30. en y portant une li_
queur fluide qui atténue la matière par fon mélange
6c fon mouvement ; 40. en faifant cefler la caufe
coagulante.
On donne du. reffort aux vaiffeaux i°. en diminuant
leur tenfion par la faignée ; 20. par les fortifians
; 30. par le frottement 6c i’aélion des mufcies ;■
4°. par les irritans»
L’eau délaye fur-tout fi on la prend chaude en
hoiffon, en injeétion, fous la forme de fomentations
ou de vapeurs déterminées vers le fiege de la
concrétion ; les attraélifs, dérivatifs, propulfifs font
bons auffi à cet ufage.
Les atténuans font i° . l’eau ; 2°. le fel marin , lef
fel gemme, le fel ammoniac, le fel de nitre, le borax
, le fel fixe a ikali, vola til; 30. les favons faits
d’alkali & d’huile, naturels, compôfés , fuligineux,
volatils, fixes , labiles ; 40. les préparations mercurielles
qu’on détermine vers la partie affeûée par
des dérivatifs , desattraûifs , des propulfifs. On-dé-
truit la caufe coagulante en la faifant paffer dans une.
autre qui l’attire. C ’eft ainfi que les alkalis abforbent
les acides, les huiles, &c. 6c c’eft principalement
par des expériences chimiques qu’on fait ces découvertes.
Lorfqu’un fluide qui a été pouffé dans des lieux
étrangers y devient impénétrable, 6c forme par-là
des obftructions, plufieurs maladies malignes s’enfui-
vent ; c’eft pourquoi ce genre de mal mérite d’être
examiné attentivement.
On le connoît, lorfqu’on fait i° . qu’ il a été précédé
de fes caufes qu’il eft ordinairement affez aifé
d’obferver ; 20. que des caufes contraires leur ont
enfuite fuccédé ; 30. enfin, quand on voit clairement
fes effets,il eft allez facile d’en prévoir les.
fuites..
La cure confifte i ° . à faire rétrograder la matière
de Vobjîruclion dans de plus grands vaiffeaux; z°. à
la réfoudre ; 30. à relâcher les vaiffeaux ; 40. à la
faire fuppurer.
Ce mouvement de rétrogradation fe procure i ° .
en évacuant par de grandes & fubites faignées les
liqueurs q u i, par leurs mouvemens,, forçoient la
matière de s’engager davantage , & , par ce moyen ,
le vaiffeau à force de fe contrarier, la fait rétrograder;
20. par des friûions faites de l’extrémité du
vaiffeau vers fa bafe.
T el eft le fyftème deBoerhaave fur Yobftruclion;.
il eft le premier médecin qui ait donné des idées clai-,
res & de vrais principes .fur cette maladie. ( D . J. )
OBTEMPÉRER, v . n. ( Gramm. & Jurifprud. )
Ceft lâ ftieffïè chofe qu'obéir ; on dit 'obtempérer à tift
commandement ; obtempérer à un ordre , à une loi;
OBTENIR, v. aél. ( Grammy ) eft relatif à follici-
■'ter. J’ai obtenu du roi la grâce que je follicitois. Il y a
des occafions où l’importunité fupplée au mérite &
où l’on obtient prefqu’auffi sûrement de la laffitude
des grands que de leur bienveillance 6c de feurjuf-
tice. Et puis , le moyen de ne pas imaginer que celui
quis’obftine à demander, n’ait quelque droit d’o^-
tenir?
Obtenird’un cheval, ( Maréchal. ) c’eft venir à
bout de lui faire faire ce qu’il refufoit auparavant.
? O B T R IN C E S IM Æ -O P P ID O , ( Géog. anc. )
c’eft ainfi qu’on lit dans un paffage d’Ammien-Mar-
eellin, liv. X X . ch. viij. mais MM. de Valois ne doutent
point qu’il ne faille lire Tricejimat - Oppido , &
que ce ne fou la meme ville que Colonia■ Trajana, ainfi
nommée du féjour de la légion tricejima. ( D . J .)
OBTURATEUR, T R1CE , adj. en Anatomie , fe
dit de certaines parties relatives à l’ouverture du trou
ovalaire de l ’os des îles , dont quelques-unes le ferment.
Le mufcle obturateur interne eft attaché à prefque
toute la circonférence interne du trou ovalaire :
toutes lès fibres fe réuhiffenten un fort tendon qui
fe gliflè dans une finuofité, fituée entre l’épine & la
tuberolite de 1 ifchium , 6c va fe terminer en paffant
entre les deux jumeaux avec lefquels il fe confine
dans la cavité du grand trochanter.
L’obturateur externe vient de la partie antérieure
& inférieure de la circonférence externe du trou
ovale , 6c fe termine à la partie inférieure de la cavité
du grand trochanter.
Le nerf obturateur eft formé par des rameaux de la
fécondé, troifieme & quatrième paires lombaires ;
il fort du bas-ventre par la partie fupérieure des
mufcies obturateurs 6cdu trou ovalaire de l’os innommés
; il donne en fortant plufieurs filets à ces mufcies
& aux autres mufcies voifins.'
Le ligament obturateur eft un compofé de plufieurs
fibres ligamenteufesqui fecroifentdifféremment, &
qui ferment le trou ovale de l’os des hanches, en
laiffant des petits intervalles, fur-tout à la partie fupérieure,
pour le paffage de l’artere de la veine ôc du
nerf.
Obturateur, inftrument de chirurgie deftiné
à boucher un trou contre nature à la voûte du palais.
Les plaies d’armes à feu ou d’autres caufes extérieures
jaeuventcaufer une déperdition de fiffiftance
à la voûte du palais : elle arrive plus communément
par la carie des os 6c les ulcères que caufent le virus
vénérien ou le fcorbut.
Lorfqu’une ouverture établit contre l’ordre na- j
turel une communication entre les foffes nafales &
la bouche, les perfonnes ne peuvent prefque plus
le faire entendre en parlant, parce que l’air qui doit
former le fon de la voix s’échappe par la breche de
•la voûte du palais, & la déglutition eft fort difficile,
parce que les alimens que le mouvement de la langue
doit porter dans l’arriere-bouche, paffent en
partie par le nez.
Le traitement le plus méthodique des caufes virulentes
qui ont occafionné la maladie, l’exfoliation
parfaite des os viciés ou l’extraélion des efquilles
dans les fracas de la voûte du palais par caufe extérieure,
laiffent un vice d’organifation auquel il faut
fuppleer par une machine qui empêche les inconvé-
mens que nous venons de décrire. On y réuffit par
application d’une plaque d’argent ou d’or affez
» ■<ïu3 a un Peu plus d’étendue que l’ouverture
qu elle doit boucher. Cette plaque doit être légèrement
convexe du côté de la voûte du palais, &
un peu concave du côté qui regarde la langue. Toute
la difficulté eft de contenir cette plaque. Ambroife
Tome X I .
Paire à |ohné la defcrïptiori des olturaieurs du pa-
C1J “ a imaginés & appliqués avec fuccès. Du
milieu de la furface fupérieure de la plaqué ohtura- ■ tiges d'argent iüB & é ia ftiques,
deftmées à embraffer une petite éponge. Elle
eft porteedans le nez par l’ouverture du palais: &
les humidités du nez gonflant l’éponge, l ’inftrumcnt
elt retenu en fituation.
M de Gârangeot datts fon traité des inamhiens
de chirurgie , donne la defcription dhm autre àhu.
■ maur. Voyez PiamÈt X X I I I . figures 46■ i
■ rnlheu de la convexité de la plaque s’élève une tige
haute de huit lignes, & d’iine ligne & demie dé diamètre.
EUe fe termine à‘ fon foramet par une petite
VIS .hautiMe deux lignes un petit écrou quarré,
de trois lignes de diamètre en tout féns, eft la fe-
«onde 'pièce de {’obturateur. Polir s’en fervir oti
prend une éponge coupée de façon quelle, ait une
uttace plate , avec dés cifeaux on donné au refte
la hgiire d un demi globe, qu’on enfile pat le milieu
a a « | la tige de l’inftrutnent, & on hxe l’éponge
par le moyen de l’écrou. On trempe l’éponge dans
quelque liqueur;'on l’exprime bien enfuite, & on
1 introduit avec la tige dans le trou de la voûte du
palais.
L expérience a démontré que l’éponge, par fon
gonflement, ne retenoit pas l’obturateur avec affez
de fiabilité, & qu’elle avoit en outre un inconvénient
très-défagréable ; c’eft de contrarier dès le premier
jour une odeur infupportable. On doit doné
les conftruire fans épongé ; Ambroife Paré même
en a fait graver qui font retenues dans le nez au
moyen dune plaque qu’on tourne avec un bec de
corbin. Cette plaque eft comme une trâverfe ou un
verrou dans la foffe natale. Fauchard, dans fon
traite du chirurgien dentifte , décrit cinq efpeces
d obturateurs , qui font des machines plus ou moins
compliquées, & qui, dans certains cas, peuveiît
avoir leur utilité : mais M. Border, dentifte de la
reine, dans un traité qui a pour titre : recherches &
observations fur toutes les parties de l ’art du dentifte 9
•vient de donner de très-bonnes remarques furl’u-
fage des obturateurs du palais, il trouve, que dans la
pjûpart des cas, on fait très-mal de fe fervir d’un
obturateur avec une tige qui paffe par le trou de la
voiite du palais, parce que cette tige eft un corps
etranger qui empêche la réunion des parties, lesquelles
font fufceptibles de fe rapprocher peu à-
peu, 6c de fermer enfin à la longue le trou qu’un inf-
trument mal conftruit entretient conftamment. On
a vu en effet au bout de fix mois ou d’un an, plufieurs
breches de palais abfolument fermées par
l’extenfion des parties molles. Dans cette vue il
faut fe contenter d’une plaque, avec deux branches
allez etendues pour être attachées avec des fils d’or
à une dent de chaque côté. Cette efpece d’obturateur
remplit parfaitement les intentions qu’on a dans
1 ufage de cet inftrument, & il ne met aucun obfta-
cle au rapprochement des parties qui peuvent diminuer
confiderablement l’ouverture & même la
boucher entièrement.
Dans le ^ cas où la partie de Vos maxillaire détruite
avoit des alvéoles & portoit des dents ,
il faut que l’obturateur foit en même tems dentier.
On trouve des machines ingénieufement imaginées
pour ce cas dans le chirurgien dentifte de Fauchard.
y->yt{ auffi dans le livre cité de M. Bordet, l ’article
des palais artificiels ou obturateurs. ( T )
OBTURATION , terme de Chirurgie, qui fe dit
de la maniéré dont les ouvertures fe bouchent. La
voûte du palais eft fujette à être trouée contre
l’ordre naturel : on y remedie par l’application d’un
inftrument. Voye{ Ob tu r a t eu r .
On a mis en queftion utile pour la pratique de fà-
T t ij