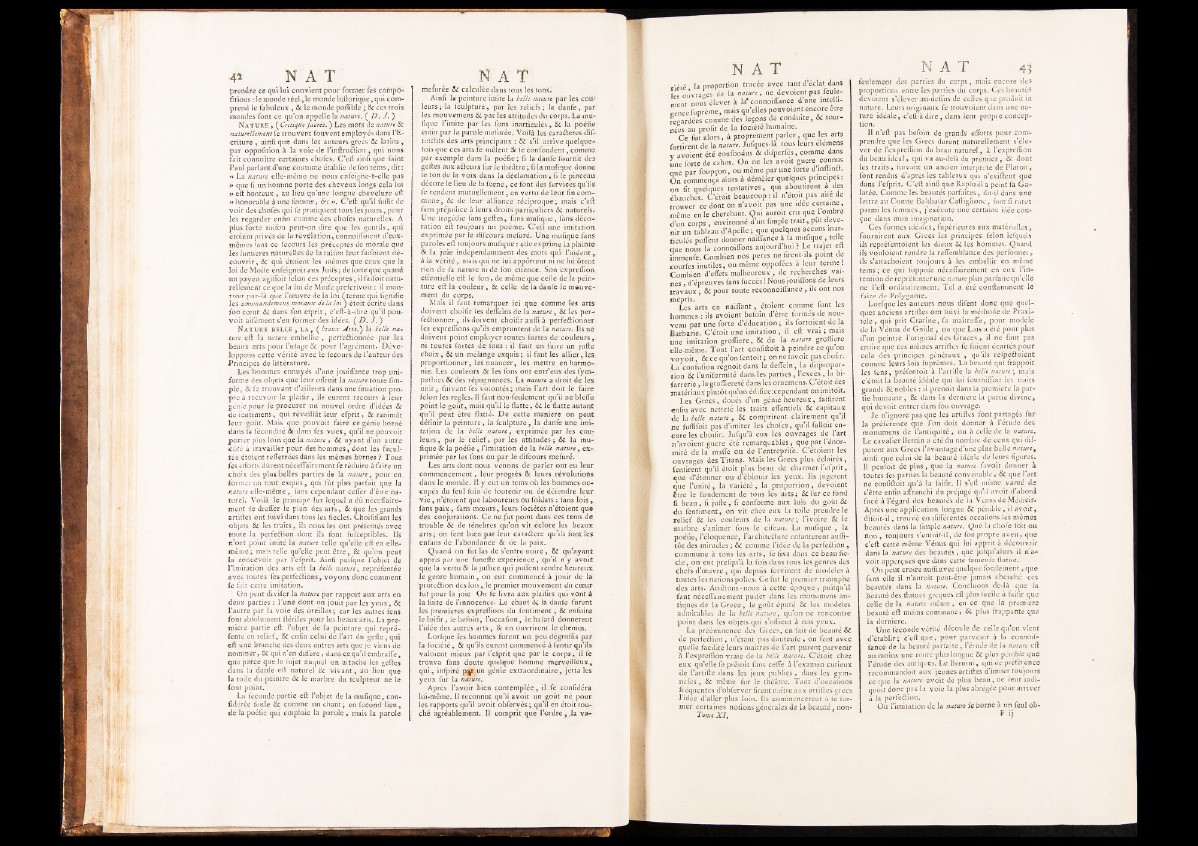
4 s n a t n a t
prendre ce qui lui convient pour former les côhVpô-
fitions : le monde réel, le monde hiftorique, qui comprend
le fabuleux , & le monde poflible ; Si ces trois
mondes font ce qu’on appelle la nature. \ D . J. )
Na t ü RtE , (■ Critique facrée. •) Les mots de nature &
'naturellement fe trouvent fou vent employés dans l'Ecriture
, ainfi que dans les auteurs grecs Si latins ,
par oppofition à la voie de l’inftruCtion , qui nous
fait connoître certaines chofes. C ’eft a mû que faint
Paul parlant d’une coutume établie de fon teins, dit :
■« La nature elle-même ne nous enfeigne-t-clle pas
» que fi un homme porte des cheveux longs cela lui
» eft honteux , au lieu qu’une longue chevelure eft
» honorable à une femme, &c ». C ’eft qu’il fuffit de
voir des chofes qui fe pratiquent tous les jours, pour
les regarder enfin comme des chofes naturelles. A
plus forte raifort peut-on dire que les gentils, qui
étoient privés de la révélation » connôiffoient d’eux-
mêmes fans ce fecoUrs les préceptes de morale que
les lumières naturelles de la railon leur faifoient découvrir,
& qui étoient les mêmes que ceux que la
loi de Moïfe enfeignoit aux Juifs ; de (orte que quand
un payen agifioit félon ces préceptes, il faifoit naturellement
ce que la loi de Moïfe prefcrivoit : il mon-
troit par-là que l’oeuvre de la loi (terme qui lignifie
les commandemens moraux de La loi ) étoit écrite dans
■ fon coeur Si dans fon efprit, c’eft-à-dire qu’il pou-
voit aifément s’en former des idées. ( D , J. )
NATURE belle , LA, ( beaux Arts.') la belle nature
eft la nature embellie , perfectionnée par les
beaux arts pour l’ulage & pour l’agrément. Développons
cette vérité avec le fecours de l’auteur des
Principes de littérature.
Les hommes ennuyés d’une jouiffance trop uniforme
des objets que leur offroit la nature toute Ample,
& fe trouvant d’ailleurs dans unefituation propre
à recevoir le plaifir -, ils eurent recours à leur
génie pour fe procurer un nouvel ordre d’idées &
de fentimens, qui réveillât leur efprit, & ranimât
leur goût. Mais que pouvoir faire ce génie borné
clans la fécondité St dans fes vue s, qu’il ne pouvoit
porter plus loin que la nature , Si ayant d’un autre
-côté à travailler pour des hommes, dont les facilitée
étaient refferrées dans les mêmes bornes ? Tous
fes efforts durent néceffairemcnt fe réduire à faire un
choix des plus belles parties de la nature, pour en
former un tout exquis, qui fût plus parfait que la
nature elle-même, fans cependant ceffer d’être naturel.
Voilà le principe fur lequel a dû néceffaire-
ment fe dreffer le pian des arts, & que les grands
artiftes ont fuivi dans tous les fiecles. Choififfant les
objets Si les traits, ils nous les ont préfentés avec
toute la perfeCtion dont ils font fufceptibles. Us
n’ont point imité la nature telle qu’elle eft en elle-
même; mais telle qu’elle peut être, Si qu’on, peut
la concevoir par l’efprit. Ainfi puifque l ’objet de
l ’imitation des arts eft la belle nature, représentée
avec toutes fes perfections, voyons donc comment
fe fait cette imitation.
On peut divifer la nature par rapport aux arts en
deux parties : l ’une dont on jouit par les yeux, Si
l ’autre par la voie des oreilles; car les autresYens
font abfolument ftériles pour les beaux arts. La première
partie eft l’objet de fa peinture qui repréfente
en relief, Si enfin celui de l’art du gefte, qui
eft une branche des deux autres arts que je viens de
nommer, Si qui n’ en différé, dans ce qu’il embrafle,
que parce que le fujet auquel on attache les geftes
dans la danfe eft naturel Si v iv an t, au lieu que
la toile du peintre Si le marbre du l'culpteur ne le
font point.
La fécondé partie eft l’objet de la mufique, con-
fidérée feule Si comme un chant ; en fécond lieu,
de la poéfie qui emploie la parole, mais la parole
mefuréc Si calculée dans tous les tons.*
Ainfi la peinture imite la belle nature par les COÜJ
leurs ; la fculpture, par les reliefs ; la danfe, paf
les mouvemens Si. par les attitudes du corps. La mu»
fique l’imite par les fons inarticulés, Si la poéfie
enfin par la parole mefurée. Voilà les cara&eres dif-
tinCtifs des arts principaux : Si s’il arrive quelquefois
que ces arts fe mêlent & le confondent, comme
par exemple dans la- poéfie ; fi la danfe fournit des
geftes aux adeurs fur le théâtre ; fi la mufique donne
le ton de la voix dans la déclamation , fi le pinceau
décore le lieu de la feene, ce font des fervices qu’ils
fe rendent mutuellement, en vertu de leur fin commune,
Si de leur alliance réciproque; mais c’eft
fans préjudice à leurs droits particuliers Si naturels*
Une tragédie fansgeftes, fans mufique, fans décoration
eft toujours un poëme. C ’ert une imitation
exprimée par le difeours mefuré. Une mufique fans
paroles eft toujours mufique : elle exprime la plainte
& la joie indépendamment des mots qui- l’aident,
à la vérité, mais qui ne lui apportent ni ne lui ôtent
rien de fa nature ni de fon effence. Son exprelîion
efiêntielle eft le fon, de même que celle de la peinture
eft la couleur, & celle de la danfe le rnouve-'
ment du corps.
Mais il faut remarquer ici que comme les arts
doivent choifir les deffein's de la nature, Si les perfectionner
, ils doivent choifir aufli à perfectionner'
les exprefîions qu’ils empruntent de la nature. Ils ne
doivent point employer toutes fortes de couleurs,,
ni toutes fortes de Ions : il faut en faire un jufte
choix, Si un mélange exquis ; il faut les allier, les,
proportionner, les nuancer, les mettre enharmo-.
nie. Les couleurs & les fons ont entr’eux des fym-,
pathies Si des répugnances. La nature a droit de les
unir, fuivant fes volontés ; mais l’art doit le faire
félon les réglés. II.faut rton-feulement qu’il ne bleffe
point le goût, mais qu’il le flatte, Si le flatte autant
qu’il peut être flatté. De cette maniéré on peut
définir la peinture, la fculpture, la danfe une imitation
de la belle nature, exprimée par les couleurs,
par le relief, par les attitudes; & la mufique
& la poéfie , l’imitation de la belle nature, exprimée
par les fons ou par le difeours mefuré.
Les arts dont nous venons de parler ont eu leur
commencement, leur'progrès & leurs révolutions
dans le monde. Il y eut un tems oit les hommes occupés
du feul foin de foutenir ou de défendre leur
v i e , n’étoient que laboureurs ou foldats : fans lo is ,
fans paix, fans moeurs, leurs fociétés n’étoient que
des conjurations. Ce ne fut point dans ces tems de
trouble Si de ténèbres qu’on vit éclore les beaux
arts ; on fent bien par leur cara&ere qu’ils font les
enfans de l’abondance & de la paix.
Quand on fut las de s’entre-nuire , Si qu’ayant
appris par une funefte expérience , qu’il n'y avoit
que la vertu & la juftice qui pufiënt rendre heureux
le genre humain, on eut commencé à jouir de la
proteCtion des lois, le premier mouvement du coeur
fut pour la joie On fe livra aux plaifirs qui vont à
la fuite de l’innocence. Le chant Si la danfe furent
les premières exprefîions du fentiment ; Si enfuire
le loifir, le befoin, l’occafion, le halard donnèrent
l’idée des autres arts , & en ouvrirent le chemin.
Lorfque les hommes furent un peu dégroffis par
la fociété, & qu’ils eurent commencé à fentir qu’ils
valoient mieux par l’elprit que par le corps, il fe
trouva fans doute quelque homme merveilleux,
qui, infpiré p y tun génie extraordinaire, jetta les
yeux fur la nature.
Après l’avoir bien contemplée, il fe confidéra
lui-même. II reconnut qu’il avoit un goût né pour
les rapports qu’il avoit obfervés ; qu’il en étoit touché
agréablement. Il comprit que l’ordre,.la va-
N A T
i\iié . la proportion tracée avec tant d’éclat.dans
les ouvrages de la nature, ne dévoient pas feulement
nous élever à la* connoiffance d’une intelligence
fuprème, mais qu’elles pou voient encore être
regardées comme des leçons de conduite, & tournées
au profit de la fociété humaine.
Ce fut alors, à proprement parler, que les arts
Sortirent de la nature. Jufques-là tous leurs elemens
V avoient été confondus & difperfés, comme dans
une forte de cahos. On ne les avoit guere connus
que par foupçotl, ou même par une lorte d inttintt.
On commença alôrs à démêler quelques principes :
on fit quelques tentatives, qui aboutirent à des
ébauches. C ’étoit beaucoup : il n’étoit pas aile de
trouver ce dont on n’avoit pas une idée certaine,
même en le cherchant. Qui auroit cru que 1 ombre
d’un corps , environné d’un fimple trait, put devenir
un tableau d’Apelle ; que quelques accens inarticulés
puffent donner naillance à la mufique, telle
que nous la connoiffons aujourd’hui ? Le trajet eft
ïmmenfe; Combien nos peres ne firent-ils point de
courfes inutiles, ou même oppofées à leur terme .
Combien d’effets malheureux, de recherches vaines
, d’épreuves fans fuccès ! Nous jouiflons de leurs
travaux ; Si pour toute reconnoiffance, ils ont nos
mépris* , . . r i
Les arts eii naiffant, etoient comme lont les
hommes : ils avoient befoin d’être formés de nouveau
par une forte d’éducation ; ils fortoient de la
Barbarie. C ’étoit une imitation, il eft vrai ; mais
une imitation groffiere, Si de la nature groffiere
elle-même. Tout l’art confiftoit à peindre ce qu’on
v o y o it , & ce qu’on fentoit ; on ne lavoit pas chofir.
La confufion régnoit dans le deflein, la difpropor-
tion Si l’uniformité dans les parties , l’excès , la bizarrerie
, la groffiereté dans les ornemens. C ’étoit des
matériaux plutôt qu’un édifice:cependant on imitoit.
Les Gre cs, doués d’un génie heureux, faifirent
enfin avec netteté les traits effentiels Si capitaux
de la belle nature , Si comprirent clairement qu’il
ne fuffifoit pas d’imiter les chofes, qu’il falloit encore
les choifir. Jufqu’à eux les ouvrages de l’art
n ’avoient guere été remarquables, que par l’énormité
de la maffe ou de l’entreprife. C ’étoient les
ouvrages des Titans* Mais les Grecs plus éclairés,
fentirent qu’il étoit plus beau de charmer 1 efprit,
que d’étonner ou d’éblouir les yeux. Ils jugèrent
que l’imité, la variété , la proportion, dévoient
être le fondement de tous les arts; & fur ce fond
fi beau, fi jufte, fi conforme aux lois du goût Si
du fentiment, on vit chez eux la toile prendre le
relief Si les couleurs de la nature ; l’i voire Si le
marbre s’animer fous le êifeau. La mufique , la
poéfie, l’éloquence, l’architefture enfantèrent auffi-
tôt des miracles ; & comme l’idée de la perfection,
commune à tous les arts, fe fixa dans ce beaufie-
c le , on eut prefqu’à la fois dans tous les genres des
chefs-d’oeuvre, qui depuis fervirent de modèles à
toutes les nations polies. Ce fut le premier triomphe
des arts. Arrêtons-nous à cette époque, piniqu’il
faut néceffairemcnt puifer dans les monumens antiques
de la G re ce, le goût épuré Si les modèles
admirables de la belle nature, qu’on ne rencontre
point dans les objets qui s’offrent à nos yeux.
La prééminence des Grecs, en fait de beauté Si
dé perfection, n’étant pas douteule, on fent avec
quelle facilité leurs maîtres de l’art purent parvenir
à l’expreffion vraie de la belle nature. C ’étoit chez
eux qu’elle fe prêtoit fans eeffe à l’examen curieux
de I’artifte dans les jeux publics, dans les gym-
nafes, Si même fur le théâtre. Tant d’occafions
fréquentes d’obferver firent naître aux artiftes grecs
l ’idée d’aller plus loin. Ils commencèrent à.fe former
certaines notions générales de la beauté, non-
Tome X I i
N A T 43
feulement des parties du corps, mais encore des
proportions entre les parties du corps. Ces beautés
dévoient s’élever au-defl'us de celles que produit la
nature. Leurs originaux fe trouvoient dans une nature
idéale, c’eft-à-dirc, dans leur propre conception.
Il ii’eft pas befoin de grands efforts pour comprendre
que les Grecs durent naturellement s'élever
de l’expreïïion du beau naturel, à l’expreffion
du beau idéal, qui va au-delà du premier, & dont
les traits, fuivanc un ancien interprète de Platon,
font rendus d’après les tableaux qui n’exiftent que
dans l’efprit. C ’eft ainfi que Raphaël a peint fa Ga-
latée. Comme les beautés parfaites, dit-il dans une
lettre au Comte Balthafar Caftiglionc, font fi rares
parmi les femmes, j’exécute une certaine idée con»
çue dans mon imagination.
Ces formes idéales, fupéfieures aux matérielles;
fournirent aux Grecs les principes félon lefqueU
ils repréfentoient les dieux Si les hommes. Quand
ils vôuloient rendre la reflcmblance des perfonnes,
ils s’attachoient toujours à les embellir en même
tems ; ce qui fuppofe néceffairement en eux l’intention
de rëpréfenter une nature plus parfaite qu’elle
ne l ’eft ordinairement. T el a été eonftammenf let
faire de Polygnote.
Lorfque les auteurs nous difent donc que quelques
anciens artiftes ont fuivi la méthode de Praxitèle
, qui prit Cratine, fa maîtreffe, pour modelé
de la Vénus de Gnide , ou que Laïs a été pour plus
d’un peintre l’original des Grâce s, il ne faut pas
croire que ees mêmes artiftes fe foient écartés pour
cela des principes généraux , qu’ils re/peéfoient
comme leurs lois fuprèmes. La beauté qui frappoit
les fens, préfentoit à l’artifte la belle nature ; mais
c’étoit la beauté idéale qui lui fourniffoit les traits
grands Si nobles : il prenait dans la première la partie
humaine , Si dans la derniere la partie divine,
qui devôit entrer dans fou ouvrage;
Je n’ignore pas que les artiftes font partagés fur
la préférence que l’ori doit donner à l’étude des
monumens de l’antiquité , Ou à celle de la nature.
Le cavalier Bernin a été du nombre de ceux qui dif-
putent aux Grecs l’avantage d’une plus belle nature,
ainfi que celui de la beauté idéale de leurs figures.
Il penfoit de plus, que la nature favôit donner à
toutes fes parties la beauté convenable ,■ & que l’art
ne confiftoit qu’à la faifir. Il s’eft même vanté de
s’être enfin affranchi du préjugé qu’il avoit d’abord
fucé à l’égard des beautés de la Vénus de Médicis.
Après une application longue Si pénible, il avoit,
dil'oit-il, trouvé en différentes occafions les mêmes
beautés dans la fimple nature. Que la chcffe foit ou
non , toujours s’enfuit-il, de fon propre aveu, que
c’eft cette même Vénus qui lui apprit à découvrir
dans la nature des beautés, que jufqu’alors il na-*
voit apperçues que dans cette fameufe ftatue.
On peut croire aufli avec quelque fondement, que
fans elle il n’auroit peut-être jamais cherché ces
beautés dans la nature. Concluons de-! à que la
beauté des ftatues greques eft plus facile à faifir que
celle de la nature même, en ce que la première
beauté eft moins commune, Si plus frappante que
la derniere.
Une fécondé vérité découle de celle qu’on vient
d’étabiir; c’eft que, pour parvenir à la connoiffance
de la beauté parfaite, l’étude de la nature eft
au moins une route plus longue Si plus pénible que
l’étude des antiques. Le Bernini, qui de préférence
recommandoit aux jeunes artiftes d’imiter toujours
ce que la nature avoit de plus beau, ne leur indi-
quoit donc pas la voie la plus abrégée pour arriver
à la perfection.
Ou l’imitation de la nature fe borne à un feul ob-
F ij