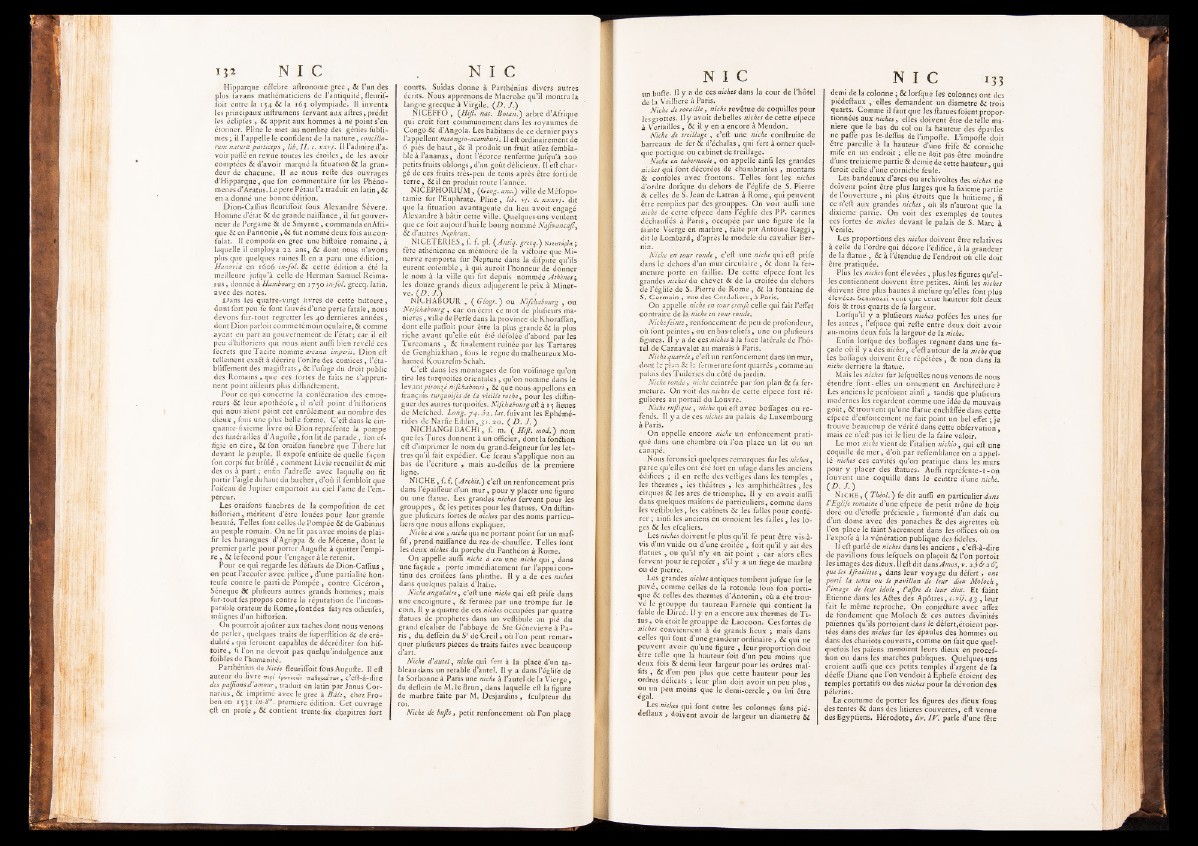
Hipparque célébré aftronorae grec , & l’un des
plus fa vans mathématiciens de l’antiquité, fleurif-
foit entre la 154 & la 163 olympiade. Il inventa
les principaux inftrumens lérvant aux aftres, prédit
les éclipfes , & apprit aux hommes à ne point s’en
étonner. Pline le met au nombre des génies fubli-
mes ; il l’appelle le confident de la nature, concilio-
rum naturtz pariiceps, lib. II. c. xxvj. Il l’admire d’avoir
pafle en revue toutes les étoiles, de les avoir
comptées & d’avoir marqué la fituation & la grandeur
de chacune. Il ne nous refte des ouvrages
d’Hipparque, que fon commentaire fur les Phénomènes
d’Aratus. Le pere Pétau l’a traduit en latin, &
en a donné une bonne édition.
Dion-Caflîus fleuriffoit fous Alexandre Sévere.
Homme d’état & de grande naiffance, il fut gouverneur
de Pergame & de Smyrne, commanda en Afrique
& en Pannonie, &L fut nommé deux fois aucon-
fulat. Il compofa en grec une hiftoire romaine, à
laquelle il employa zz ans, & dont nous n’avons
plus que quelques ruines II en a paru une édition,
Hanovioe en 1606 in-fol. & cette édition a été la
meilleure jufqu’à celle de Herman Samuel Reima-
rus, donnée à Hambourg en 1750 in-fol. grecq. latin,
avec des notes.
Dans les quatre-vingt livres de cette hiftoire,
dont fort peu fe font fauvés d’une perte fatale, nous
devons fur-tout regretter les 40 dernieres années,
dont Dion parloit comme témoin oculaire, & comme
ayant eu part au gouvernement de l’état; car il eft
peu d’hiftoriens qui nous aient aufli bien révélé ces
fecrets que Tacite nomme arcana imper il. Dion eft
tellement exaft à décrire l’ordre des comices, l’éta-
bliffement des magiftrats, & l’ufage du droit public
des Romains, que ces fortes de faits ne s’apprennent
point ailleurs plus diftinûement.
Pour ce qui concerne la confécration des emDe-
reurs & leur apothéofe, il n’eft point d’hiftoriêns
qui nous aient peint cet enrôlement au nombre des
dieux , fous une plus belle forme. C ’eft dans le cin-
quante-fixieme livre où Dion repréfente la pompe
des funérailles d’Augufte, fon lit de parade, fon effigie
en cire, & fon oraifon funebre que Tibere lut
devant le peuple. Il expofe enfuite de quelle façon
fon corps fut brûlé , comment Livie recueillit & mit
des os à part ; enfin l’adreffe avec laquelle on fit
partir l’aigle du haut du bûcher, d’où il fembloit que
l’oifeau de Jupiter emportoit au ciel l’ame de l’empereur.
Les oraifons funèbres de la compofition de cet
hiftorien, méritent d’être louées pour leur grande
beauté. Telles font celles de Pompée & de Gabinius
au peuple romain. On ne lit pas avec moins de plai-
fir les harangues d’Agrippa & de Mécene, dont le
premier parie pour porter Augufte à quitter i’empi-
re , & le fécond pour l’engager à le retenir.
Pour ce qui regarde les défauts de Dion-Caflius ,
on peut l’accufer avec juftice, d’une partialité hon-
îeufe contre le parti de Pompée , contre Cicéron,
Séneque de plufieurs autres grands hommes; mais
fur-tout fes propos contre la réputation de l’incomparable
orateur de Rome, font des fatyres odieufes,
indignes d’un hiftorien.
On pourroit ajouter aux taches dont nous venons
de parler, quelques traits de fuperftition & de crédulité
, qui feroient capables de décréditer fon hiftoire
, fi l’on ne devoit pas quelqu’indulgence aux
foibles de l’humanité.
Parthenius de Nicée fleuriffoit fous Augufte. Il eft
auteur du livre 1 tfu-riKoiv irciùtiparuv, c’eft-à-dire
des pajîonsd amour, traduit en latin par Janus Cor-
narius, & imprimé avec le grec à Bâle, chez Fro- :
ben en 153 1 première édition. Cet ouvrage
çft en profe , & contient trente-fix chapitres fort
courts. Suidas donne à Parthénius divers autres
écrits. Nous apprenons de Macrobe qu’il montra la
langue grecque à Virgile. (Z>. /.)
NICEFFO , (Hijl. nat, Botan.) arbre d’Afrique
qui croît fort communément dans les royaumes de
Congo & d’Angola. Les habitans de ce dernier pays
l’appellent maongio-acamburi. Il eft ordinairement dq
6 piés de haut, & il produit un fruit affez fembla-
bleà l’ananas, dont l’écorce renferme jufqu’à zoo
petits fruits oblongs, d’un goût délicieux. Il eft chargé
de ces fruits très-peu de tems après être forti de
terre, & i l en produit toute l ’année.
NICÉPHORIUM, (Gcog. anc.) ville de Méfopo-
tamie fur l’Euphrate. Pline, lib. vj. c. xxxvj. dit
que la fituation avantageufe du lieu avoit engagé
Alexandre à bâtir cette ville. Quelques-uns veulent
que ce foit aujourd’hui le bourg nommé Nafivancajî,
& d’autres Nephrun.
NICÉTÉRIES, f. f. pi. (Antiq. grecq.) N/icmt»/)/«;
fête athénienne en mémoire de la viftoire que Minerve
remporta fur Neptune dans la difpute qu’ils
eurent enfemble, à qui auroit l ’honneur de donner
le nom à la ville qui fut depuis nommée Athènes j
les douze grands dieux adjugèrent le prix à Minerve.
(D . ƒ.)
NICHABOUR , ( Géogr. ) ou Nifchabourg , ou
Neifchabourg, car on écrit ce mot de plufieurs maniérés
, ville de Perfe dans la province de Khoraffan,
dont elle paffoit pour être la plus grande & la plus
riche avant qu’elle eût été défolée d’abord par les
Turcomans , & finalement ruinée par les Tartares
de Gerighizkhan , fous le régné du malheureux Mohamed
Kouarefm-Schah.
C ’eft dans les montagnes de fon voifinage qu’on
tire les turquoifes orientales, qu’on nomme dans le
levant pirou^c nifehabouri, & que nous appelions en
françois turquoifes de la vieille roche, pour les diftin-
guerdes autres turquoifes. Nifchabourg eft à 15 lieues
de Mefched. Long, y4. Sx. lat. fuivant les Ephémé-
rides’ de Narfîe Eddin ,3 1 .2 0 . ( D . J. )
NICHANGI-BACH1, f. m. ( Hijl. mod. ) nom
que les T lires donnent à un officier, dont la fonction
eft d’imprimer le nom du grand-feigneur fur les lettres
qu’il fait expédier. Ce feeau s’applique non au
bas de l’écriture , mais au-deffus de la première
ligne.
NICHE, f. f. ( Archit.) c’eft un renfoncement pris
dans l’épaiffeur d’un mur, pour y placer une figure
ou une ftarue. Les grandes niches fervent pour les
grouppes, & les petites pour les ftatues. On diftin-
gue plufieurs fortes de niches par des noms particuliers
que nous allons expliquer.
Niche à cru , niche qui ne portant point fur un maf-
f i f , prend naiffance du rez-de-chauffée. Telles font
les deux niches du porche du Panthéon à Rome.
On appelle aufti niche à cru une niche qui, dans
une façade , porte immédiatement fur l’appui continu
des croifées fans plinthe. Il y a de ces niches
dans quelques palais d’Italie..
Niche angulaire, c ’eft une niche qui eft prife dans
une encoignure, & fermée par une trompe fur le
coin. Il y a quatre de ces niches occupées par quatre
ftatues de prophètes dans un veftibule au pié du
grand efcalier de l’abbaye de Ste Génevieve à Paris
, du. deffein du Sr de C re il, où l’on peut remarquer
plufieurs pièces de traits faites avec beaucoup
d’art.
Niche d'autel, niche qui fert à la place d’un tableau
dans un retable d’autel. Il y a dans l’églife de
la Sorbonne à Paris une niche à l’autel de la Vierge ,
du deffein de M. le Brun, dans laquelle eft la figure
de marbre faite par M. Desjardins, fculpteur du
roi.
Niche de bujle, petit renfoncement où l’on place
un bufte. Il y a de ces niches dans la cour de l’hôtel
de la V'rilliere à Paris.
Niche de rocaille, niche revêtue de coquilles pour
les grottes. Il y avoit de belles niches de cette elpece
à Verfailles, & il y en a encore à Meudon.
Niche de treillage , c’eft une niche conftruite de
barreaux de fer & d’échalas, qui fert à orner quelque
portique ou cabinet de treillage.
Niche en tabernacle, on appelle ainfi les grandes
niches qui font décorées de chambranles , montans
& confoles avec frontons. Telles font les niches
d’ordre dorique du dehors de l’églife de S. Pierre
& celles de S. Jean de Latran à Rome, qui peuvent
être remplies par des grouppes. On voit aufti une
niche de cette efpece dans l’églife des PP. carmes
déchauffés à Paris, occupée par une figure de la
fainte Vierge en marbre , faite par Antoine Raggi,
dit le Lombard, d’après le modèle du cavalier Ber-
nin.
Niche en tour ronde, c’eft une niche qui eft prife
dans le dehors d’un mur circulaire , & dont la fermeture
porte en faillie. D e cette efpece font les
grandes niches du chevet de de la croilee du dehors
de l ’églife de S. Pierre de Rome , & la fontaine de
S. Germain , rue des Cordeliers, à Paris.
On appelle niche en tour creufe celle qui fait l’effet
contraire de la niche en tour ronde.
Niche feinte, renfoncement de peu de profondeur,
où font peintes, ou en bas-reliefs, une ou plufieurs
figures. Il y a de ces niches à la face latérale de l’hôtel
de Carnavalet au marais à Paris.
Niche quarrée, c’eft un renfoncement dans un mur,
dont le plan d-: la fermeture font quarrés, comme au
palais des Tuileries du côté du jardin.
Niche ronde, niche ceintrée par fon plan & fa fermeture.
On voit des niches de cette efpece fort régulières
au portail du Louvre.
Niche ruflique , niche qui eft avec boffages ou refends.
Il y a de ces niches au palais de Luxembourg
à Paris.
On appelle encore niche un enfoncement pratiqué
dans une chambre où l’on place un lit ou un
canapé.
Nous ferons ici quelques remarques fur les niches,
parce qu’elles ont été fort en ufage dans les anciens
édifices ; il en refte des vertiges dans les temples ,
les thermes , les théâtres , les amphithéâtres , les
cirques & les arcs de triomphé. Il y en avoit aufti
dans quelques maifons de particuliers, comme dans
les veftibules, les cabinets & les falles pour conférer
; ainfi les anciens en ornoient les falles, les loges
& les efc^liers.
Les niches doivent le plus qu’il fe peut être vis-à-
vis d’un vuide ou d’une croilée , foit qu’il y ait des
ftatues , ou qu’il n’y en ait point ; car alors elles
fervent pour fe repofer, s’il y a un fiege de marbre
ou de pierre.
Les grandes niches antiques tombent jufque fur le
pave, comme celles de la rotonde fous fon portique
& celles des thermes d’Antonin, où a été trouvé
le grouppe du taureau Farnèfe qui contient la
fable de Dircé. Il y en a encore aux thermes de T itus
, où étoit le grouppe de Laocoon. Ces fortes cle
niches conviennent à de grands lieux ; mais dans
celles qui font d’une grandeur ordinaire, & qui'ne
peuvent avoir qu’une figure , leur proportion doit
être telle que la hauteur foit d’un peu moins que
deux fois & demi leur largeur pour les ordres maffias
, & d’un peu plus que cette hauteur pour les
ordres délicats ; leur plan doit avoir un peu plus ,
ou un peu moins que le demi-cercle, ou lui être
égal.
Les niches qui font entre les colonnes fans pié-
deltaux , doivent avoir de largeur un diamètre &
demi de la colonne ; & lorfque les colonnes ont des
piédeftaux , elles demandent un diamètre & trois
quarts. Comme il faut que les ftatues foient proportionnées
aux niches, elles doivent être de telle maniéré
que le bas du col ou la hauteur des épaules
ne paffe pas le-deffus de l’impofte. L’impofte doit
etre pareille à la hauteur d’une frife & corniche
mife en un endroit ; elle ne doit pas être moindre
d une treizième partie & demie de cette hauteur, qui
feroit celle d’une corniche feule.
Les bandeaux d’arcs ou archivoltes des niches ne
doivent point être plus larges que lafixieme partie
de l’ouverture , ni plus étroits que la huitième, fi
ce n’eft aux grandes niches, où ils n’auront que’ la
dixième partie. On voit des exemples de toutes
ces fortes de niches devant le palais de S. Marc à
Venife.
Les proportions des niches doivent être relatives
à celle de l’ordre qui décore l’édifice, à la grandeur
de la ftatue , & à l’étendue de l’endroit où elle doit
être pratiquée.
Plus les niches font élevées, plus les figures qu’elles
contiennent doivent être petites. Ainfi les niches
doivent être plus hautes à mefure qu’elles font plus
élevées. Scamozzi veut que cette hauteur foit deux
fois & trois quarts de fa largeur.
Lorfqu’il y a plufieurs niches pofées les unes fur
les autres, 1 efpace qui refte entre deux doit avoir
au-moins deux fois la largeur de la niche.
Enfin lorfque des boffages régnent dans une façade
où il y a des niches, c’eft autour de la niche que
les boffages doivent être répétées , & non dans la
niche derrière la ftatue.
Mais les niches fur lefquelles nous venons de nous
étendre font-elles un ornement en Architecture }
Les anciens le penfoient ainfi , tandis que plufieurs
modernes les regardent comme une idée de mauvais
goût, & trouvent qu’une ftatue enchâfféedans cette
efpece d’enfoncement ne fait point un bel effet ; je
trouve beaucoup de vérité dans cette obfervation,
mais ce n’eft pas ici le lieu de la faire valoir.
Le mot niche vient de l’italien niçhio , qui eft une
coquille de mer, d’où par reffemblance on a appel-
lé niches ces cavités qu’on pratique dans les murs
pour y placer des ftatues. Auflî repréfente-1-on
ïbuvent une coquille dans le ceintre d’une niche. GSI I N i c h e , ( T h è o l. ) fe dit aufti en particulier d a n s
l 'E g l i f e rom a in e d’une efpece de petit trône de bois
doré ou d’étoffe précieufe, furmonté d’un dais ou
d’un dôme avec des panaches & des aigrettes où
l’on place le faint Sacrement dans les offices où on
l ’expofe à la vénération publique des fideles.
Il eft parlé de niches dans les anciens , c’eft-à-dire
de pavillons fous lefquels on plaçoit & l’on portoit
les images des dieux. Il eft dit dansAmos, v. x5&x<?,
que les Ifraélites, dans leur voyage du défert, ont
porté la tente ou le pavillon de leur dieu Moloch ,
l'image de leur idole , l'aflre de leur dieu. Et faint
Etienne dans les Attes des Apôtres, c. vij. 43 , leur
fait le même reproche. On conjefture avec affez
de fondement que Moloch & ces autres divinités
païennes qu’ils portoient dans le défert,étoient portées
dans des niches fur les épaules des hommes ou
dans des chariots couverts, comme on fait que quelquefois
les païens menoient leurs dieux en procef-
fion ou dans les marches publiques. Quelques-uns
croient aufli que ces petits temples d’argent de la
déeffe Diane que l’on vendoit à Ephefe étoient des
temples portatifs ou des niches pour la dévotion des
pèlerins.
La coutume de porter les figures des dieux fous
des tentes & dans des litières couvertes, eft venue
des Egyptiens. Hérodote, liv. IN. parle d’une fête