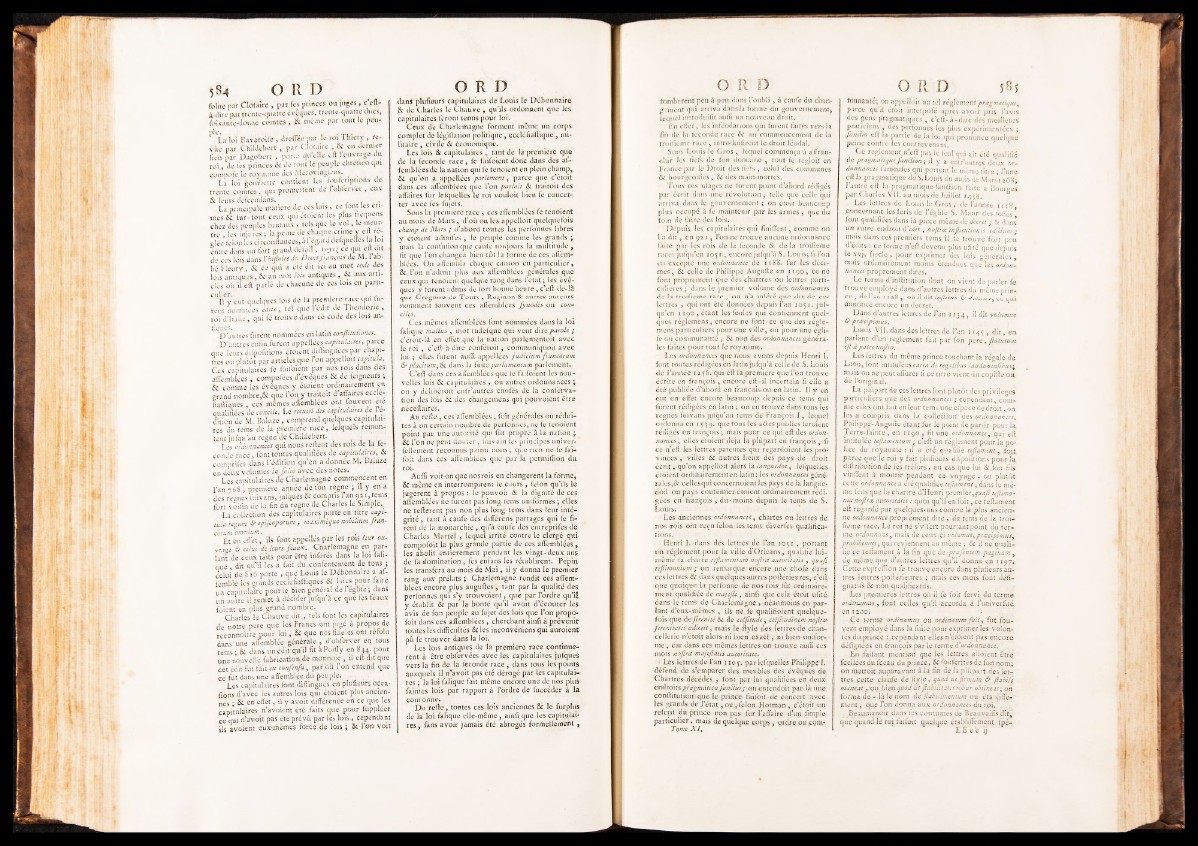
(blue par Clotaire , par fes princes ou juges, c’ cft-
ù-dire par trente-quatre évêques, trente-quatre ducs,
foixante-douae comtes, St meme par tout le peu-
La loi lîavàroile , dreflée par le roi Thtery , revile
par Childebert , par Clotaire , Si en dernier
lieu par Dagobert , porte qu'elle eft l’oUvtage dit
r o i , de les princes- 8c de tout le peuple chrétien qui
compole le royaume des Mérovingiens.
ta loi gomiiette contient les ioufcriptiôns de
trente comtes, qui promettent de l’oblerver, eux
& leurs defcencJaiis. .
L11 principale matière de ces lo is, ce font les crimes
8c fur-tout ceux qui étoient les plus frequens.
chez des peuples brutaux , tels que le v o l , le meurtreVies
injures ; la peine de chaque crime y elt réglée
félon les circontiances, à l'égard dcfquclles la loi
entre dans un fort grand détail, ce qui elt dit
de ces lois dans l'hifom du Drmi/runçois de M 1 ab-
bé Ffeury , Si ce qui a été dit ici au mot code des
lois antiques, 8c au mot lois antiques, 8c aux articles
oh il eft parlé de chacune de ces lots en parrt-
Cl'l l 'y eut quelques lois de la première race qui furent
nommées idits , tel que l’édit de Théodonc ,
■ ... , ■ • 1' /-1, /•Arlo npc lrtiC ;intiqr.
es, . .
D ’autres furent nommées en latin conjututiones.
D ’autres enfin furent appellées capitulaires, parce
que leurs dilpofitions étoient diftinguées par chapit
r e ou plutôt par articles que l’on appelloit capitula.
Ces capitulaires fe faifoient j>ar nos rois dans des
aflembiées , compofées d’évêques 6c de ieigneurs ;
& comme les évêques y étoient ordinairement en
grand nombre,& que l’ôn y traitoit d affaires éccle-
fiaftiques , ces mêmes afTemblées ont fouvent été
qualifiées de concile. Le recueil des capitulaires de 1 e-
dition de M, Baluze , comprend quelques capitulaires
du tems de la première race, lefquels remontent
jufqu’au régné de Childebert. 4 • ;
Les ordonnances qui nous reftent des rois de la ie-
conde race , font toutes qualifiées de capitulaires, &
compriles dans l ’édition qu’en a donnée M. Baluzë
en d e u x volumes in-folio avec des notes.
Les capitulaires de Charlemagne commencent en
l’an 768 , première année de fon régné ; il y en a
des régnés fuivans, jufques & compris l’an 9 1 1 , tems
fort voifin de la fin du régné de Charles le Simplè._
La collection des capitulaires porte en titre captcorum
omnium. . .
Et en effet, ils font appèltés par les rois leur ouvrage
& celui de leurs féaux. Charlemagne en parlant
de ceux faits pour être inférés dans la loi fali-
que , dit qu’il les a fait du conféntement de tous ;
celui de 816 porte , que Louis le Débonnaire a af-
femblé les grands eccléfiaftiques & laïcs pour faire
un capitulaire pour le bien général de l’églife; dan*
un autre il remet à décider julqu’à ce que fes féaux
foient en plus grand nombre. ' '
Charles le Chauve dit , tels font les capitulaires
de notre pere que les Francs ont jugé à propos de
reconnoître pour lo i, Sc que nos fideles ont réfolu
dans une affemblée générale , d’ôbfefver en tous
tems ; 6c dans un édit qu’il fit à Poifly en 844. pouf
une nouvelle fabrication de morinoié , il eft dit que
cet édit fut fait ex confenfû, par oii 1 On éiiteficl que
ce fut dans une affemblée du peuple.
Les capitulaires font diftingués en plufieurs àêca-
ftons d’avec les autres lois qui étoient plus anciennes
; & en effet > P y avoit différence en ce que les
capitulaires n’avoient été faits que pour füppléer
ce qui n’âvoit pas été prévu par lès lois, cependant
ils avoient eux-mêmes force de lois ; & l’on voit
dan$ plufiours capitulaires de Louis le Débonnaire
& de Charles le Chauve , qu’ils ordonnent que les
capitulaires feront tenus pour loi.
Ceux de Charlemagne forment même un corps
complet de légiflation politique, eccléfiaftique, militaire
, civile & économique.
Les lois & capitulaires , tant de la première que
de la fécondé race, fe faifoient donc dans des af-
fembléesde la nation qui fe tenoient en plein champ,
6c qu’on a appellées parlement, parce que c’étoit
dans ces aflembiées que l’on parloit & traitoit des
affaires fur lefquelles le roi vouloit bien fe concerter
avec fes fujets.
Sous la première race , ces afTemblées fe tenoient
au mois de Mars, d’oii on les appclloit quelquefois
champ de Mars ; d’abord toutes les perfonnes libres
y étoient admifes , le peuple comme les grands ;
mais la confnlion que caule toujours la multitude ,
fit que l’on changea bien tôt la forme de ces aflem-
blées. On affembla chaque canton en particulier,
6c l’on n’admit plus aux aflembiées générales que
ceux qui tenoient quelque rang dans l’état ; les évêques
y furent admis de fort bonne heure, c’eft de-là
que Grégoire de Tours , Régi non & autres auteurs
nomment fouvent ces aflembiées Jy/iodes ou conciles.
Ces mêmes afTemblées font nommées dans la loi
falique malins , mot ludelque qui veut dire parole ;
c’étoit-là en effet que la nation parlementoit avec
le roi , c’eft-à-dire conféroir, communiquoit avec
lui ; elles furent aufli appellées judicium francorütn
& placitum, & dans la fuite parlarnentum parlement.
C’eft dans ces afTemblées que fe faifoient les nouvelles
lois 6c capitulaires , ou autres ordonnances ;
on y délibéroit entr’antfes chofes de la conferva-
tion des lois 6c des changdnens qui pouvoient être
néceffarres.
Au refté , ces afTemblées, foit générales Ou réduites
à un certain nombre de perfonnes, ne fe tenoient
point par une autorité qui fût propre à la nation ;
& l’on ne peut douter, fuivant les principes univer-
fellement reconnus parmi nous, que rien ne fe faïé,
foit dans ces aflembiées que par la permiflion du
roi.A
ufli voit-on que nos rois en changèrent la forme,
& même en interrompirent le cours , félon qu’ils lé
jugèrent à propos : le pouvoir & la dignité de ce$
aflembiées ne furent pas long-tems uniformes ; elles
ne refterent pas non plus long-tems dans leur intégrité
, tant à caufe des diffefens partages qui fe
rent de la monarchie , qu’à caufe des entreprifes de
: Charles Martel , lequel irrité contre le clergé qui
: compofoit la plus grande partie de ces aflembiées j
| les abolit entièrement pendant les vingt-deux ans
de fa domination, fes enfans les rétablirent. Pepirt
les transfera au mois de M a i, il y donna le premier
rang aux prélats ; Charlemagne rendit ces aflembiées
encore plus auguftes , tant par la qualité des
perfonnes qui s’y trouvoient, que par l’ordre qu’il
y établit & par la bonté qu’il avoit d’écouter les
avis de fon peuple au fujet des lois que l’on propo-
foit dans ces aflembiées, cherchant ainfi à prévenir
toutes les difficultés 6c les inconvéniens qui auroient
pu fe trouver dans la loi.
Les lois antiques de la première race continuèrent
à être obfervées avec les capitulaires jufques
vers la fin de la fécondé race, dans tous les points.
auxquels il n’avoit pas été dérogé par les capitulaires
; la loi falique fait même encore une de nos pluà
faintes lois par rapport à l’ordre de fuccéder à là
couronne.
Du refte, toutes ces lois anciennes & le furplus.
de la loi falique elle-même , ainfi que les capitulaires
, fans avoir jamais été abrogés formellement ,
tombèrent peu-à-peu dans l’oubli, à caufe du changement
qui arriva dans la forme du gouvernement)
lequel introduifit aufli un nouveau droit.
En effet, les inféodations qui furent faites vers la
fin de la fécondé race 6c au commencement de la
troifieme race , introduifirent le droit féodal»
Sous Louis le Gros , lequel commença à affranchir
les fiefs de fon domaine , tout fe régloir en
France par le Droit des fiefs , celui des communes
6c bourgeoifies, 6c des main-mortes.
Tous ces ufages ne furent point d’abord rédigés
par écrit dans une révolution, telle que celle qui
arriva dans le gouvernement ; on étoit beaucoup
plus occupé à fe maintenir par les armes, que du
foin de faire des lois.
Depuis les capitulaires qui finiflent, comme on
l'a d it , en 9 2 1 , l’on ne trouve aucune ordonnance
faite par les rois de la feconcle & de la troifieme
races jufqu’en 105 r , encore jufqu’à S. Louis; fi l’on
en excepte une ordonnance de 1188. fur les décimes,
6c celle de Philippe Augufte en 1190, ce ne
font proprement que des Chartres ou lettres particulières
; dans le premier volume dés ordonnances
de la troifieme race, on n’a inféré que dix de ces
lettres , qui ont été données depuis l’an 1051. jufqu’en
1190-, étant les feules qui contiennent quelques
réglemens, encore ne font-ce que des regle-
mens particuliers pour une ville, ou pour une égli-
fc ou communauté , 6c non des ordonnances générales
faites pour tout le royaume.
Les ordonnances que nous avons depuis Henri I.
font toutes rédigées en latin jufqu’à celle de S. Louis
de l’année 1 '256. qui eft la première que l’on trouve
écrite en françois, encore eft-il incertain fi elle a
été publiée d’abord en françois ou en latin. Il y en
eut en effet encore beaucoup depuis ce tems qui
furent rédigées en latin ; on en trouve dans tous les
régnés fuivans jufqu’au tems de François I , lequel
ordonna en 1 539. que tous les aétes publics feroient
rédigés en françois ; mais pour ce qui eft des ordonnances
, elles étoient déjà la plupart en françois , .fi
ce n’eft les lettres patentes qui regardoient les provinces
, villes 6c autres lieux des pays de droit
écrit,.qu’on appelloit alors la languedoc, .lefquelles
étoient ordinairement en latin : les ordonnances générales,
St celles qui concernoient les pays de la langue-
doil ou pays coutumier étoient ordinairement rédigées
en françois , du-moins depuis le tems de S.
Louis.
• Les anciennes ordonnances, chartes ou lettres de
nos rois ont reçu félon' les;tems diverfes qualifications;
■
Henri I. dans des lettres de l’an 1051 , portant
un réglementopoiit la ville d’Orléans, qualifie lui-
même (à charte teflamentum nojlroe autoritatis , ■ .quajî
teflirnonium on remarque encore une. ehofe. da'ns
ces lettres & dans quelques autres poftérieures, c’eft
que quoique la perfonne de nos rois fût ordinairement
qualifiée de majejlé, ainfi que cela étoit ufité
dans le tems de Charlemagne néanmoins en parlant
d’eux^mêmes , ils ne. fe qiialifioient quelquefois
que Ide férénité 6c de ctljilude, çeLfitudintm nçflræ-
ferenitatis adierit, mais .le ftyje des lettres de chancellerie
n’étoit alors ni bien .exaft;, ni bien-uniforme
, car dans ces mèmès lettres-,on trouve aufli ces
mots noflroe majêjlatis automate.
! Les lettrbs.de l’an 110 y par-lefquelles Philippe I.
défend de s;emparer des meubles des! éÿêqûes de-
Chartres décédés,, >1 font par lui qualifiées en deux-
endroits p'ragmàtica fanclw,; on eotendoit par- là- un©,
conftitutibnn que. le prince- faifoit de concert .avec
lès grands de l ’état , ou -, félon jHotman , c’étçit. un
referit. du prince non pas,, fut l’affaire d’un Ample
particulier, mais de quelque corps, ordre ou.pom-;
Tome X I .
luunâute; on appelloit un tel réglement pragmatique,
parce quil étoit interpofé après avoir pris l’avis
des gens pragmatiques , c’eft-à-dire des meilleurs
^raî.!f‘cn/? ’ ^es Pcrfonnes les plus expérimentées ;
Janaho eft la partie de la loi qui prononce quelque
peine contre les contrevenans.
Ce reglement n’eft pas le feul qui ait été qualifié
de pragmatique ftnclion ■ il y a entr’autres deux ordonnances
fameufes qui portent le même titre ; l’une
eft la pragmatique de S. Louis du mois de Mar$iz68*
l’autre eft la pragmatique-fanétion faite à Bourges
pat Charles V ü . au mois de Juillet 1438.
Les lettres de Louis le Gros , de l’année 1 118.
concernant les ferfs de i’églife S. Maur des foffés
font qualifiées dans la piece même de decret ; & dans
un autre endroit tiédit, noflroe inflitutionis edielum ;
mais dans ces premiers tems il i’e trouve fort peu
d edits : ce terme n’eft devenu plus ufité que depuis
le xvj. fieele, pour exprimer des lois générales,
mais ordinairement moins étendues que les ordonnances
proprement dites.
Le terme d’inftitution dont on vient de parler fe
trouve employé dans d’autres lettres du même prince
, de l’an 11 z8 , où il dit injlituo & decerno, ce qui
annonce encore un decret.
Dans d autres lettres de l’an 1 134 , il dit volutnus
& proecipirnus.
Louis VII. dans des lettres de l’an 1145 , dit, en
parlant d’un reglement fait par fon pere , fiatutum
efi a pâtre nojlro.
Les lettres du même prince touchant la régale de
Laon, font intitulées caria de regalibus Laudunen(ibus\
mais on ne peutaffurer fi ce titre vient du copifte ou
de l’original.
La plûpart de ces lettres font plutôt des privilèges
particuliers que des ordonnances ; cependant, comme
elles ont fait en leur tems une efpece de droit ,on
les a compris dans la collection des ordonnances.
Philippe-Augufte étant fur le point de partir pour la
Terre-fainte , en. 1190, fit une ordonnance, qui eft
intitulée tejlamentûm ; c’eft un réglement pour la police
du royaume : il a éré qualifié tejlament, foit
parce que le roi y fait plufieurs difpoütions pour la
diftribution de fes rréfors, au cas que lui & fon fils
vinflent à mourir pendant ce voyage , ou plutôt
cette ordonnance a déqualifiée tefament, dans le même
fens que la chartre d’Henri premier,quaji uflimo-
nia nojlroe autoritatis : quoi qu’il en foit, ce teftament
eft regardé par quelques-uns comme la plus ancienne
ordonnance proprement dite , du tems de la troifieme
race. Le roi ne s’v fert pourtant point du terme
ordonnons, mais de ceux-ci volumus,pmcipimus.
prohibemus, qui reviennent au même ; & il ne qualifie
çç .teftament à la fin que de proefentcm paginam ,
de même, que d’autres lettres qu’il donna en 1197.
Cette exprefîïon fe trouve encore dans plufieurs autres
lettres poftérieures ; mais ces mots font défi-
gnatifs 6c non qualificatifs.
Les premières lettres où il fe foit fervi du terme
ordinqmus, font celles qu-’il accorda à l’univerfité
en izoo.
Ce terme ordinamus ou ordinatum fu it, fut fou-
yerçt employé dans la fuite pour exprimer les volontés
du prince ^cependant elles n’éroient pas encore
défignées en françois par le terme tiordonnance.
En faifant mention que les lettres alloient être
fcellées dufçeau du prince, & fpuferites de fon nom;
on mettoit auparavant à la fin de la plûpart des lettres
ççtte-claufe de ft-yle, quod ui firmum & (labile
maneat g&m bien quod ut Jlabilitatisrobur obtint a t ; on
forma de - là, le .nom de Jlabilimentum ou étaolifle- ‘
ment;, que l’on donna aux ordonnances du r.oï. .
__ Beaumanoir dans les coutumes de Beauvaifîs dit,
que quand lé roi faifoit quelque établifl'ement ipé-
E E e V ij‘ ’