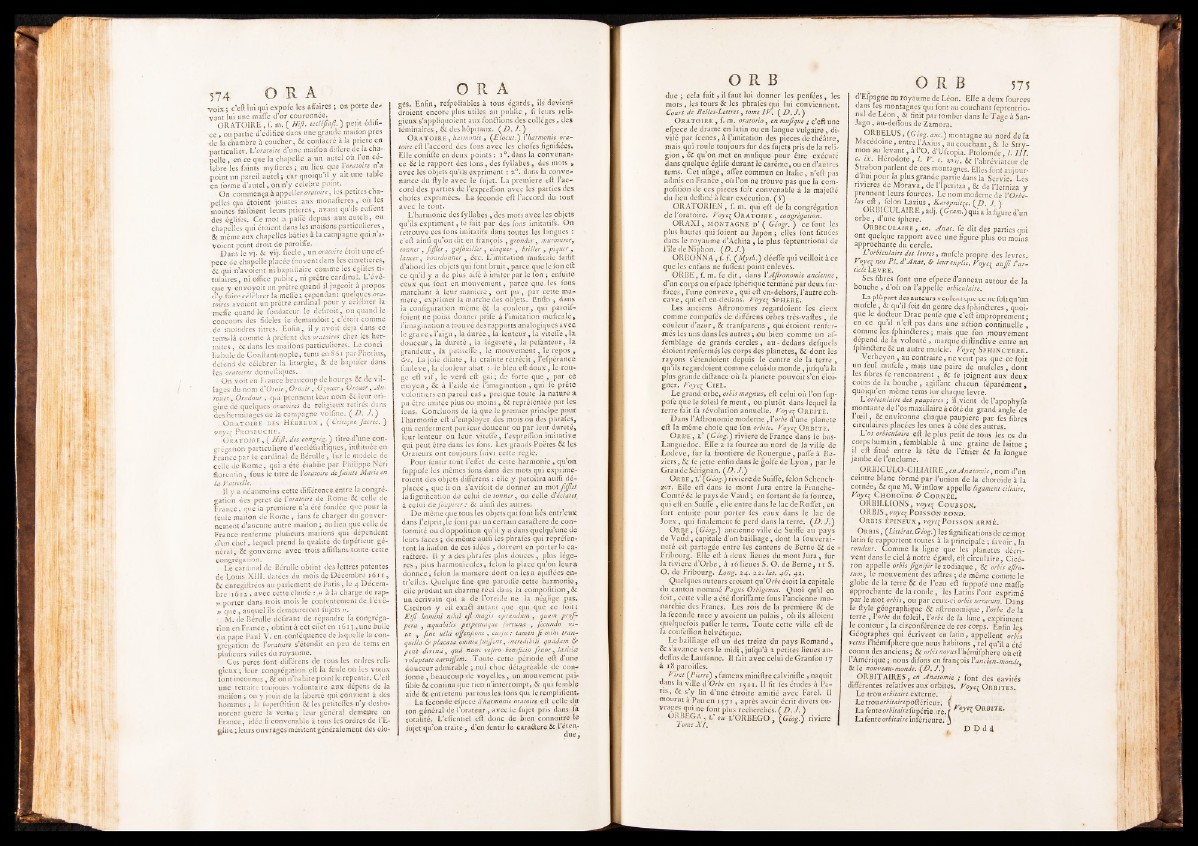
T r o i s ; c ’ e f t l u i q u i e x p o f e . l e s a f f a i r e s ; o n f o r t e d e -
v a n t lu i u n e m a f f e d ’ o r c o u r o n n é e .
O R A T O I R E , f. m . ( H f t . eccléfiafi. ) p e t i t é d i f i c
e , o u p a r t i e d ’ é d i f i c e d a n s u n e g r a n d e m a i f o n p r è s
d e l a c h a m b r e à c o u c h e r , 6c c o n l a c r é à l a p r i e r e e n
p a r t i c u l i e r . L ’oratoire d ’ u n e m a i f o n d i f f é r é d e l a c h a p
e l l e , e n c e q u e l a c h a p e l l e a u n a u t e l o u 1 o n c é l
é b r é l e s f a i n t s m y f f e r .e s ; a u l i e u q u e l'o r a to i r e n a
p o i n t u n p a r e i l a u t e l ; c a r q u o i q u ’i l y a i t u n e t a b l e
e n f o rm e d ’ a u t e l , o n n ’ y c é l é b r é p o in t .
O n c o m m e n ç a à a p p e l l e r oratoire, l e s p e t i t e s c h a p
e l l e s q u i é t o i e n t j o i n t e s a u x m o n a f t e r e s , 0l V ,'e s
m o i n e s f a i f o i e n t l e u r s p r i è r e s , a v a n t q u i l s e n f l e n t
d e s é g l i l è s . C e m o t ja. p a f f é d e p u i s a u x a u t e l s , o u
c h a p e l l e s q u i é t o i e n t d a n s l e s m a i f o n s p a r t i c u l i è r e s ,
& m ê m e a u x c h a p e l l e s b â t i e s à l a c a m p a g n e q u i n ’ a -
v o i e n t p o in t d r o i t d e p a r o i f l e .
D a n s l e v j . & v i j . f i e c l e , u n oratoire é t o i t u n e e f -
p e c e d e c h a p e l l e p l a c é e f o u v e n t d a n s l e s c im e t i è r e s ,
6c q u i n ’ a v o i e n t n i b a p t i f t a i r e c o m m e l e s e g l i f e s t i t
u l a i r e s , n i o f f i c e p u b l i c , n i p r e t r e c a r d i n a l . L é v e -
q u e y e n v o y o i t u n p r ê t r e q u a n d i l j u g e o i t à p r o p o s
d ’ y f a i r e c é l é b r e r l a m e f f e ; c e p e n d a n t q u e l q u e s oratoires
a v o i e n t u n p r ê t r e c a r d i n a l p o u r y c é l é b r e r l a
m e f f e q u a n d l e f o n d a t e u r l e d e f i r o i t , o u q u a n d l e
c o n c o u r s d e s f id e l e s l e d e m a n d o i t ; c ’ e t o i t c o m m e
d e m o in d r e s t i t r e s . E n f i n , i l y . a v o i t d é j à d a n s c e .
t em s - l à c o m m e à p r é f e n t d e s oratoires c h e z l e s h e r -
m i t e s , 6c d a n s l e s m a i f o n s p a r t i c u l i è r e s . L e c o n c i
l i a b u l e d e C o n f t a n t i n o p l e , t e n u e n 8 6 1 p a r P h o t i u s ,
d é f e n d . d e c é l é b r e r l a . l i t u r g i e , & d e b a p t i f e r d a n s
l e s oratoires d o m e f f i q u e s .
O n v o i t e n F r a n c e b e a u c o u p d e b o u r g s 6 c d e v i l l
a g e s d u n o m à.'O roir, Oroair, .0 potier , O rouer, Au-
rouer^.O radour, q u i p r e n n e n t l e u r n o m 6c l e u r o r i g
i n e d e q u e l q u e s oratoires d e r e l i g i e u x r e t i r é s d a n s
d e s h e rm i t a g e s d e l a c a m p a g n e v o i f i n e . ( D . J . )
O ratoire DES/Hébreux, ( Critique facrée. )
voyez Proseuche.
O ratoire, ( Hiß. des congrég. ) t i t r e d ’u n e c o n g
r é g a t i o n p a r t i c u l i e r e d ’ e c c l é f i a f f i q u e s , in f t i t u e e e n
F r a n c e p a r l e c a r d i n a l d e B é r u l l e , f u r l e m o d e l e d e
c e l l e d e R o m e , q u i a é t é é t a b l i e p a r P h i l i p p e N é r i
f l o r e n t i n , f o u s l e t i t r e d e 1 "oratoire defainte Marie en
la Vaticelle. • ■ 11 y a n é a n m o i n s c e t t e d i f f é r e n c e e n t r e l a c o n g r é g
a t i o n d e s p e r e s d e Moratoire d e R o m e 6c c e l l e d e
F r a n c e , q u e l a p r e m i è r e n ’ a é t é f o n d é e q u e p o u r l a
f e u l e m a i l o n d e R o m e , f a n s f e c h a r g e r d u g o u v e r n
e m e n t d ’ a u c u n e a u t r e m a i f o n ; a u l i e u q u e c e l l e d e
F r a n c e r e n f e rm e p lu f i e u r s m a i f o n s q u i d é p e n d e n t
d ’ u n c h e f , l e q u e l p r e n d l a q u a l i t é d e f u p é r i e u r g é n
é r a l j & g o u v e r n e a v e c t r o i s a f î i f t a n s t o u t e c e t t e
c o n g r é g a t i o n .
L e c a r d i n a l d e B é r u l l e o b t i n t d e s l e t t r e s p a t e n t e s
d e L o u i s XIII. d a t é e s d u m o i s d e D é c e m b r e j 6 1 1 ,
& e n r e g i f f r é e s a u p a r l e m e n t d e P a r i s , l e 4 D é c e m b
r e 1 6 1 2 , a v e c c e t t e c l a u f e . : ,« à l a c h a r g e d e r a p -
» p o r t e r d a n s t r o i s m o i s l e c o n f e n t e m e n i d e l ’é v ê -
» q u e , a u q u e l i l s d e m e u r e r o n t f u j e t s » .
M . d e B é r u l l e d e f i r a n t d e r é p a n d r e f a c o n g r é g a t
i o n e n F r a n c e , o b t i n t à c e t e f f e t e n 1 6 1 3 , u n e b u l l e
d u p a p e P a u l V . e n c o n f é q u e n c e d e l a q u e l l e l a c o n g
r é g a t i o n d e l ’oratoire s ’ é t e n d i t e n p e u d e t em s e n
p lu f i e u r s v i l l e s d u r o y a u m e .
/ ' C e s p e r e s f o n t d i f f é r e n s d e t o u s l e s o r d r e s r e l i g
i e u x ; l e u r c o n g r é g a t i o n e f t l a f e u l e o ù l e s v oe u x
f o n t i n c o n n u s , & o ù n ’h a b i t e p o in t l e r e p e n t i r . C ’ e f t
u n e r e t r a i t e t o u j o u r s v o l o n t a i r e a u x d é p e n s d e l a
m a i f o n ; o n y jo u i t ; d e l a l i b e r t é q u i c o n v i e n t à d e s
h o m m e s ; la f u p e r f t i t io n 6 c l e s p e t i t e f f e s n ’ y d e s h o ?
n o r e n t g u e r e l a v e r t u ; . l e u r g é n é r a l d e m e j i r e e n
F r a n c e , id é e f i c o n v e n a b l e à t o u s l e s o r d r e s d e l ’E -
j j l i f e , j l e u r s o u v r a g e s m é r i t e n t g é n é r a l e m e n t d e s é l o ges.
Enfin, refpe&ables à tous égards-, ils devient
droient encore plus utiles au public , fi leurs teli*
gieux s’appliquoient aux fondions des collèges, clés
léminaires, 6c des hôpitaux. {D . J. )
Or a to ir e , harmonie , (E lo c u t.) l’harmonie oratoire
eft l’accord des fons avec les chofes lignifiées-.
Elle confifte en deux points : x°. dans la convenance
6c le rapport des Ions, des fyllabes, des mots >
avec les objets qu’ils expriment : 20. dans la convenance
du ftyle avec le fujet.1 La première eft l’accord
des parties de l’expreffion avec les parties des.
chofes exprimées. La fécondé eft l’accord du tout
avec le tout.
L ’harmonie des fyllabes, des mots avec les objets
qu’ils expriment, fe fait par des fons imitatifs. On
retrouve ces fons imitatifs dans toutes les langues :
c’eft ainfi qu’on dit .en françois , gro n d e r, murmurer,
tonner , fiffie r , gafouiller , claquer , briller , piquer ,
lanc e r, bourdonner , &c. L’imitation muficale faifit
d’abord les objets qui font b ruit, parce que le fon eft:
ce qu’il y a de plus aifé à imiter par le fon ; enfuite
ceux qui font en mouvement, parce quelles fons
marchant à leur maniéré, ont pu , par cette maniéré
, exprimer la marche des objets. Enfin -, dans
la configuration même 6c la couleur, qui paroif-
foient ne point donner prife à l’imitation muficale,
l’imagination a trouvé des rapports analogiques avec
le grave, l’aigu , la durée , la lenteur, la vîteffe, la
douceur, la dureté , la légèreté, la pefanteur, la
grandeur, la petiteffe , le mouvement, le repos ,
&c. La joie dilate , la crainte rétrécit, l’efpérance
fouleve, la douleur abat :. le bleu eft doux, le rouge
eft v i f , le verd eft gai; de forte que , par ce
moyen, 6c à l’aide de i’imagination , qui fe prête
volontiers en pareil cas , prelque toute la nature a;
pu être imitée plus ou moins, 6c repréfentée par les
fons. Concluons de là que le premier principe pour
l’harmonie eft d’employer des mots ou des phrafes,
qui renferment par leur douceur ou par leur dureté,
leur lenteur ou leur vîteffe, l’expreffion imitative
qui peut être dans les fons. Les grands Poètes 6c les
Orateurs ont toujours fuivi cette réglé.
Pour fentir tout l’effet de cette harmonie , qu’oit
fuppofe les mêmes fons dans des mots qui exprime-
roient des objets différens : elle y paroîtra aufîi déplacée
, que fi on s’avifoit de donner au mot fiffler
la lignification de celui de to n n e r , ou celle d’éclater_
à celui de Jbupirer : & ainfi des autres.
De même que tous les objets qui font liés entr’ eux
dans l’efprit,le font par un certain cara&ere de conformité
ou d’oppofition qu’il y a dans quelqu’une de
leurs faces ; de même aulfi les phrafes qui repréfen-
tent la liaifon de ces idées , doivent en porter le ca*
radier e. Il y a des phrafes plus douces , plus légères
, plus harmonieufes, félon la place qu’on leur a
j donnée, félon la.maniéré dont on les a ajnftées en-r
tr’elles. Quelque fine que paroiffe cette harmonie,
elle produit un charme réel dans la compofition, &
un écrivain qui a de l’oreille ne ,1a néglige pas;
Cicéron y eft ex a â autant que qui que ce foit i
Etji homini nihil ejl magis optandum , quant prof*
pera , cequabilis perpetuaque fortuna , fecundo vite
fine ullà off enfione , curj'u : tamen f i rnihi Iran-
quilla & pla ç a t a omnia fuiflent, incredibili quâdam &
petit divinâ, quâ nunc vefiro beneficio fruor, Icetiticz
voluptate caru'îjjem. Toute cette période eft d’une
douceur admirable ; nul choc détagréable de con-
fonne , beaucoup de voyelles, un mouvement pair
fible 6c continu que rien 11’interrompt, & qui femble
aidé 6c entretenu par tous les fons qui lerempliffent.
La fécondé efpece d’harmonie oratoire eft celle du
ton général de l’orateur , avec le fujet pris dans fa
totalité. L’effentiel eft donc de bien connoître le
fujet qu’on traite, d’en fentir le caradtere & l’étendue
,
due ; cela fa it , il faut lui donner les penfées, les
mots , les tours & les phrafes qui lui conviennent.
■ Cours de Belles-Lettres, tome IF . ( D . J. )
ORATOIRE , f. m. oratorio, enmufique ; c’eft une
efpece de drame en latin ou en langue vulgaire, di-
vifé par feenes, à l’imitation des pièces de théâtre,
mais qui roule toujours fur des fujets pris de la religion
, 6c qu’on met en mufique pour être exécuté
dans quelque églife durant le carême, ou en d’autres
tems. Cet ufage, affez commun en Italie, n’eft pas
admis en France , où l’on ne trouve pas que là compofition
de ces pièces fok convenable à la majefté
du lieu deftiné à leur exécution. (•$)
ORATORIEN, f. m. qui eft de la congrégation
de l’oratoire. Voye{ O rato ire , congrégation.
O R A X I , m o n t agn e d’ ( Géogr. ) ce font les
plus hautes qui foient au Japon; elles font fituées
dans le royaume d’Achita , le plus feptentrional d,e
i ’île de Niphon. {D. ƒ.)
ORBONNA, f. f. (.Myth.) déeffe qui veilloit à ce
que les enfans ne fuffent point enlevés.
ORBE, f. m. fe dit, dans YAfironomie ancienne,
d’un corps ou efpace fphérique terminé par deux fur-
faces, l ’une convexe , qui eft en-dehors, l’autre coh-
ca ve , qui eft en-dedans. Voye1 Sphere.
Les anciens Aftronomes regardoient les deux
comme compofés de différens orbes très-vaftes , de
couleur d’azur, & tranfparens , qui étoient renfermés
les uns dans les autres ; ou bien comme un af-
femblage de grands cercles , au - dedans defquels
étoient renfermés les corps des planètes, & dont les
rayons s’étendoient depuis le centre de la terre ,
qu’ils regardoient comme celui du monde, jufqu’à la
plus grande diftance où la planete pouvoit s’en éloigner.
Voyez C ie l .
Le grand orbe, orbis magnus, eft celui où l’on fuppofe
que le foleil fe meut, ou plutôt dans lequel la
terre tait fa révolution annuelle. Voyez O r e it e .
Dans l’Aftronomie moderne , Y orbe d’une planete
eft la même chofe que fon orbite. Voye^ Or b it e .
O r b e , l ’ ( Géog.) riviere de France dans le bas-
Languedoc. Elle a là fource au nord de la ville de
Lodeve, fur la frontière de Rouergue, paffe à Be-
ziers, 6c fe jette enfin dans le golfe de Lyon, par le
Grau de Sérignan. (D. /.)
O rbe , l’ (Géog.) riviere de Suiffe, félon Scheuch-.
zer. Elle eft dans le mont Jura entre la Franche-
Comté 6c le pays de Vaud ; en fortant de fa fource,
qui eft en Suiffe , elle entre dans le lac de Roffet, en
fort enfuite pour porter fes eaux dans le lac de
Joux, qui finalement fe perd dans la terre. (Z>. ƒ.)
Or b e , (Géog.) ancienne ville de Suiffe au pays
de Vaud ; capitale d’un bailliage, dont la fouverai-
neté eft partagée entre les cantons de Berne 6c de
Fribourg. Elle eft à deux lieues du mont Jura, fur
la riviere d’Orbe, à 16 lieues S. O. de Berne, 11 S.
O. de Fribourg. Long. 24. 22. lat. 4(T. 42.
Quelques auteurs croient qu’OrÆ£ étoit la capitale
du canton nommé Pagus Orbigenus. Quoi qu’il en
foit, cette ville a été floriffante fous l’ancienne monarchie
des Francs. Les rois de la première 6c de
la fécondé race y avoient un palais, où ils alloient
quelquefois paffer le tems. Toute cette ville eft de
la confeflion helvétique.
Le bailliage eft un des treize du pays Romand,
6c s’avance vers le midi, jufqu’à 2 petites lieues au-
deffus de Laufanne. Il fait avec celui de Granfon 17
à 18 paroiffes.
Vfiet ( Pierre) , fameux miniftre calvinifte, naquit
dans la ville dYOrbe en 1$ 11. Il fit fes études à Pans
, 6c s’y lia d’une étroite amitié avec Farel. Il
-mourut à Pau en 1571 , après avoir écrit divers ouvrages
qui ne font plus recherchés. ( D . J. )
ORBEGA , l’ m l’ORBEGO , (Géog.) riviere
TomiXI. ’ v
d’Efpagne au royaume de Léon. Elle a deux fources
dans les montagnes qui font au couchant feptentrional
de Léon, & finit par tomber dans le T age à San-
Jago, au-deffous de Zamora.
w ànc.") montagne au nord de la
Macedoine, entre l’Axius, au couchant, & le Stry-
mon au levant, à l’O. d’Ufcopia. Ptolomée, l. I I I .
c. ix Hérodote, l. V. c. Xvij. & l’abréviateur de
ôtrabon parlent de ces montagnes. Elles font aujour-
d hui pour la plus grande partie dans la Servie. Lès
rivières de Morava, de l’Iperitza , 6c de l’Ietniza y
prennent leurs fources. Le nom moderne de YOrbe-
lus eft , félon Lazius, Karopnitre. (D . J. )
ORBICULA1R E , adj. {Gram.) qui a la figure d’un
o rb e, d’une fphere.
Or bicul aire , en. Anat. fe dit des parties qui
ont quelque rapport avec une figure plus ou moins
approchante du cercle.
Vorbiculaire des levres, mufcle propre des levres.
Voyez nos à'Anat. & leurexplic. Voyez aujji C article
Levre.
Ses fibres font une efpece d’anneau autour de la
bouche , d’où on l’appelle orbiculaire.
La plupart des auteurs veulent que ce ne foit qu’un
mufcle , & qu’il foit du genre des fphinâeres , quoique
le dofteur D rac penfe que c ’eft improprement;
en ce qu’il n’eft pas dans une aélion continuelle ,
comme les fphinfteres ; mais que Ion mouvement
dépend de la volonté , marque diftinélive entre un
fphinftere & un autre mufcle. Voyez Sph in c t e r e .
Verheyen , au contraire, ne veut pas que ce foit
un feul mufcle, mais une paire de mufcles, dont
les fibres fe rencontrent , 6c fe joignent aux deux
coins de la bouche , agiffant chacun féparément,
quoiqu’on même tems fur chaque levre.
Vorbiculaire des paupières ; devient de l’apophyfe
montante de l’os maxillaire à côté du grand angle de
l’oe il, 6c environne chaque paupière par fes fibres
circulaires placées les unes à côté des autres.
L’or orbiculaire eft le plus petit de tous les os du
corps humain , femblable à une graine de laitue ;
il eft fitué entre la tête de l’étrier 6c la longue
jambe de l’enclume.
ORBICULO-CILIAIRE, en Anatomie, nom d’un
ceintre blanc formé par l’union de la choroïde à la
cornée, 6c que M. "Winflov appelle ligament ciliaire.
V o y e z C horoïde & C ornée.
ORBILLIONS, voyez C ourson.
ORBIS, voyez Po is so n rond.
O rbis é p in eu x , voyez Po isso n a rm é .
O rbis , (.Littérat.Géog.) les lignifications de ce mot
latin fe rapportent toutes à la principale ; favoir, la
rondeur. Comme la ligne que les planètes décrivent
dans le ciel à notre égard, eft circulaire, Cicéron
appelle orbis fignifer le zodiaque, 6c orbis aflro-
rum, le mouvement des affres ; de même comme le
globe de la terre 6c de l ’eau eft fuppofé une maffe
approchante de la ronde, les Latins l’ont exprimé
par le mot orbis, ou par ceux-ci orbis terrarum. Dans
le ftyle géographique & aftronomique, Y orbe de la
terre , Yorbe du foleil, Yorbe de la lune , expriment
le contour, la circonférence de ces corps. Enfin les
Géographes qui écrivent en latin, appellent orbis
vêtus l’hémifphere que nous habitons , tel qu’il a été
connu des anciens ; & orbisnovus l’hémifphère où eft
l’Amérique ; nous difons en françois Y ancien-monde
& le nouveau-monde. {D . ƒ.)
ORBITAIRES, en Anatomie ; font des cavités
différentes relatives aux orbites. Voyez Orbites.
Le trou orbitaire externe. j
Lettonorbitaireno^ériem1, { „
La fente orbitaire fupérie ire. f Orbite.
La fente orbitaire inférieure, j
D D d d