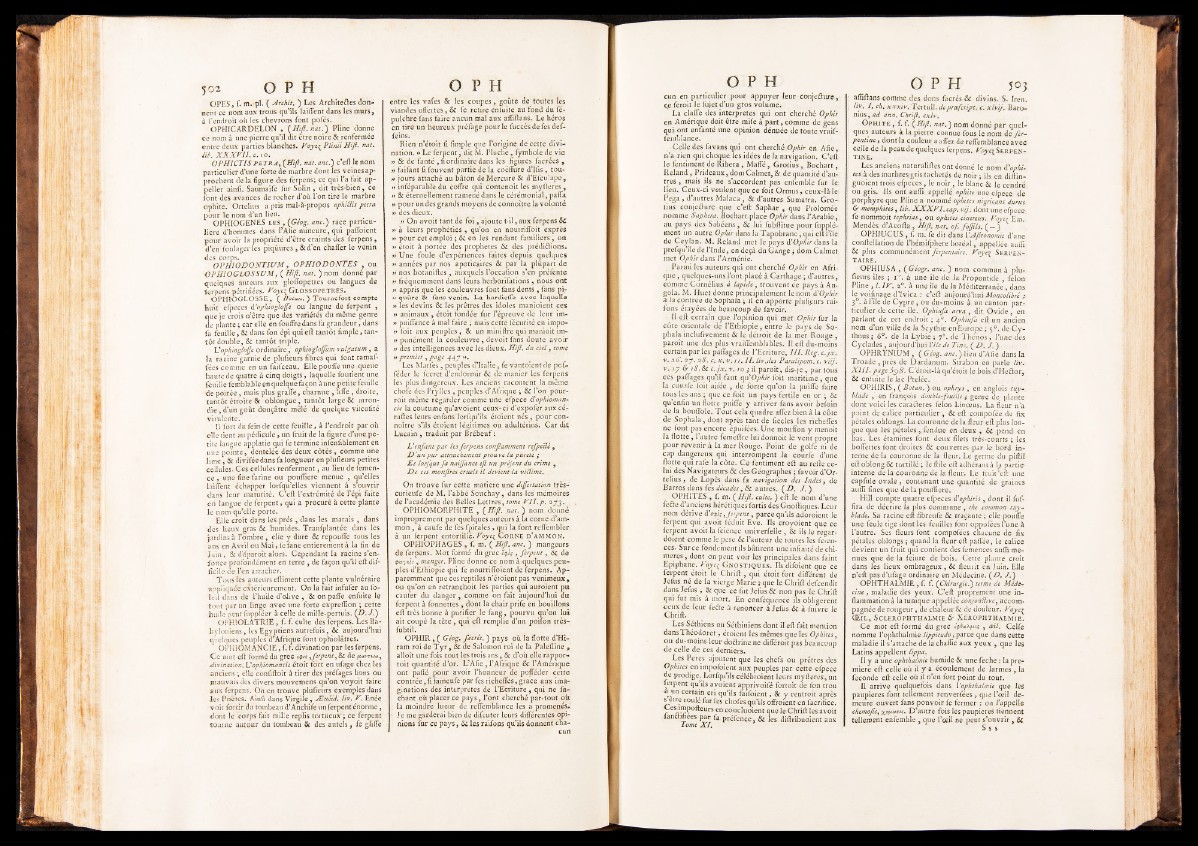
OPES, f. m.-pl. ( Archit. ) Les Archite&es donnent
ce nom aux trous qu’ils laiffent dans les murs,
à l’endroit où les chevrons font pofés. J
OPHICARDELON , ( Hiß. nat. ) Pline donne
ce nom à une pierre qu’il dit être noire 8t renfermée
entre deux parties blanches. Voyt{ Plinii Hiß. nat.
ab. xxxvii. c. i o.
OPHICTIS P E T R A , (Hiß. nat.anc.) c’eft le nom
particulier d’une forte de marbre dont les veines approchent
delà figure des ferpens; ce qui l’a fait app
e le r ainfi. Saumaife fur Solin , dit très-bien, ce
pont des avances de rocher d’où l’on tire le marbre
ophite. Ortelius a pris mal-à-propos ophiclis petra
pour le nom d’un lieu.
OPHIOGENES les , (Géog. anc.) race particulière
d’hommes dans l’Afie mineure, qui paffoient
pour avoir la propriété d’être craints des ferpens,
d’en foùlager les piqûures , 8c d’en chaffer le venin
des corps,
OPHIOD ON T IUM , OPHIODONTES , ou
OPH IO GLOS SUM, (Hiß. nat. ) nom donné par
quelques auteurs aux gloffopetres ou langues de
ferpens pétrifiées. Voye^ GlOSSOPETRES.
OPHIOGLOSSE, ( Botan. ) Tournefort compte
huit efpeces d'ophiogloffe ou langue de ferpent ,
oue je crois n’être que des variétés du même genre
de plante ; car elle en fouffre dans fa grandeur, dans
fa feuille, 8c dans fon épi qui eft tantôt fxmple, tantôt
double, 8c tantôt triple.
Uophioglojfe ordinaire, ophiogloffhm vulgatum, a
la racine garnie de plufieurs fibres qui font ramaf-
fées comme en un faifceau. Elle pouffe une queue
haute de quatre à cinq doigts, laquelle foutient une
feuille femblable en quelque façon à une petite feuille
-de poirée, mais plus graffe, charnue > liffe , droite,
tantôt étroite & oblongue, tantôt large 8c arrondie
, d’un goût douçâtre mêlé de quelque vifcofité
virulente.
Il fort du fein de cette feuille, à l’endroit par où
elle tient au pédicule, un fruit de la figure d’une petite
lingue applatie qui fe termine infenfiblement en
une pointe, dentelée des deux cô tés, comme une
lime, & divifée dans fa longueur en plufieurs petites
cellules. Ces cellules renferment, au lieu de femen-
c e , une fine farine ou poulîiere menue , qu’elles
laiffent échapper lorfqu’elles viennent à s’ouvrir
dans leur maturité. C ’eft l’extrémité de l’épi faite
en langue de ferpent, qui a procuré à cette plante
le nom qu’elle porte.
Elle croît dans les prés , dans les marais , dans
des lieux gras & humides. Tranfplantée dans les
jardins à l’ombre, elle y dure 8c repouffe tous les
ans en Avril ou M ai, fe fane entièrement à la fin de
Juin, & difparoît alors. Cependant la racine s’enfonce
profondément en terre , de façon qu’il eft difficile
de l’en arracher.
Tous les auteurs eftiment cette plante vulnéraire
appliquée extérieurement. On la fait infufer au fo-
lèil dans de ,l’huile d’olive , & on paffe enfuite le
tout par un linge avec une forte expreffion ; cette
huile peut fuppléer à celle de mille-pertuis. (D. J.)
OPHIOLATR1E , f. f. culte des ferpens. Les Babyloniens
, les Egyptiens autrefois, 8c aujourd’hui
quelques peuples d’Afrique font ophiolâtres.
OPHIOMANCIE, f. ri divination par les ferpens.
'Ce mot eft formé du grec oipic y ferpent, 8c de jUam/*,
■ divination. Uophiomancie étoit fort en ufage chez les
.anciens ; elle cohfiftoit à tirer des préfages bons ou
mauvais des divers mouvemens qu’on voyoit faire
aux ferpens. On en trouve plufieurs exemples dans
les Poètes. Ainfi dans Virgile, Æneid. Uv. V. Enée
voit fortir du tombeau d’Anchife un ferpent énorme,
dont le corps fait mil!e replis tortueux ; ce ferpent
tourne autour du tombeau & des autels, fe gliffe
entre les vafes & les coupes, goûte de toutes les
viandes offertes, 8c fe retire ènl'uite au fond du fé-
pulchre fans faire aucun mal aux afliftans. Le héros
en tire un heureux préfage pour le fuccès defes def-
feins.
Rien n’étoit fi fimple que l’origine de cette divination.
« Le ferpent, dit M. Pluche, fymbole de vie
» & de fanté , fi ordinaire dans les figures facrées ,
» faifant fifouvent partie de la coëffure d’Ifis , tou-
» jours attaché au bâton dé Mercure & d’Efculape,'
» inféparable du coffre qui contenoit les myfteres ,
» & éternellement ramené dans le cérémonial, paffa
» pour un des grands moyens de conrioître la volonté
» des dieux.
» On avoit tant de fo i, ajoute t-il ,aux ferpens &
» à leurs prophéties , qu’on en nourriffoit exprès
» pour cet emploi ; 8c en les rendant familiers, on
» étoit à portée des prophètes 8c des prédirions.
» Une foule d’expériences faites depuis quelques
» années par nos apoticaires & par la plûpart de
» nos botaniftes , auxquels l’occafion s’en préfente
» fréquemment dans leurs herborifations , nous ont
» appris que les couleuvres font fans dents , fans pi-
» quûre & fans venin. La hardieffe avec laquelle
» les devins 8c les prêtres des idoles manioient ces
» animaux, étoit fondée fur l’épreuve de leur im-
» puiffance à mal faire ; mais cette fécurité en impo-
» foit aux peuples , & un miniftre qui manioit im-
» punément la couleuvre, devoit fans doute avoir
» des intelligences avec les dieux. Hiß. du ciel, tome
»premier , page 447 ».
Les Maries, peuples d’Italie, fe vantoientde pcf-
féder le fecret d’endormir 8c de manier les ferpens
les plus dangereux. Les anciens racontent la même
choie des Prylles , peuples d’Afrique ; 8c l’on pour-
roit même regarder comme une efpece d'ophioman-
de la coutume qu’a voient ceux-ci d’expofer aux cé.-
raftes leurs enfans lorfqu’ils étoient nés , pour con-
noître s’ils étoient légitimes ou adultérins. Car dit
Lucain , traduit par Brébeuf :
L'enfant par les ferpens conßamment refpeclé ,
D'un pur attouchement prouve la pureté ;
E t lorfque fa naiffance eß un préjent du crime ,
De ces monßres cruels il devient la victime.
On trouve fur cette matière une differtation très-,
curieufe de M. l’abbé Souchay, dans les mémoires
de l’académie des Belles Lettres, zo/ne VII. p. 273. .
OPHIOMORPHITE , (Hiß. nat. ) nom donné,
improprement par quelques auteurs à la corne d’am-
mon , à caufe de fës fpirales, qui la font reffembler.
à un ferpent entortillé. Voye^ C orne d’am m o n .
OPHIOPHAGES , f. m. ( Hiß. anc. ) mangeurs
de ferpens. Mot formé du grec ofiç , ferpent, 8c de
Vctytiv, manger. Pline donne ce nom à quelques peuples
d’Ethiopie qui fe nourriffoient de ferpens. Apparemment
que ces reptiles n’étoient pas venimeux ,
ou qu’on en retranchoit les parties qui auroient pu
cauler du danger, comme on fait aujourd’hui du
ferpent à fonnettes, dont la chair prife en bouillons
eft très bonne à purifier le fang, pourvu qu’on lui
ait coupé la tête , qui eft remplie d’un poilon irès-
fubtil.
OPHIR, ( G log. facrée. ) pays où la flotte d’Hi-
ram roi de T y r , & de Salomon roi de la Paleftine ,
alloit une fois tout les trois ans, & d’où elle rappor-
toit quantité d’or. L’Afie, l’Afrique 6c l’Amérique
ont paffé pour avoir l’honneur de pofféder cette
contrée, fi fameufe par fes richeffes, grâce aux imaginations
des interprétés de l ’Ecriture, qui ne fa-
chant où placer ce pays, l’ont cherché par-tout où
la moindre lueur de reffemblance les a promenés.'
■ Je me garderai bien de difeuter leurs différentes opinions
fur ce pays, 8c les raifons qu’ils donnent chacun
cun en particulier pour appuyer leur conjetture ,:
ce feroit le fujet d’un gros volume.
La clàffe des interprètes qui ont cherché Ophir
en Amérique doit être mife à part, comme de gens
qui. ont enfanté une opinion dénuée de toute vraif-
femblance.
Celle des favans qui ont cherché Ophir en Afie,
n’a rien qui choque, les idées de la navigation. C’eft
le fentiment de Ribera, Maffé, Grotius, Bochart,
Reland, Prideaux,.dom Calmet,& de quantité d’aur'
très , mais ils ne s’accordent pas enfemble fur le;
lieu. Ceux-ci veulent: que ce foit Ormus, ceux-là le
Pega, d’autres Malaca ,.& d’autres Sumatra. Grotius
conje&ure que e’eft Saphar , que Ptolomée
nomme Saphera. Bochart, place Ophir dans l’Arabie,
au pays des Sabéens , 8c lui fubftitue pour fupplé-
ment un autre Opldrf&mla Tapobrane,qui eftl’île
de Ceylan. M. Reland met le pays à'Ophir dans la
prefqu’île de l’Inde , en deçà du Gange ; dom Calmet
met Ophir dans l’Arménie.
. Parmi l'es auteurs qui ont cherché Ophir en Afrique
, quelques-uns l’ont placé à Carthage ; d’alitres,
c-Omrae Cornélius à lapide, trouvent ce pays à Angola.
M. Huet donne principalement le nom. à'Ophir
à la contrée deSophala ; il en apporte plufieurs raifons
étayées de beaucoup de favoir.
Il eft certain que l’opinion qui met Ophir (\ur la
côte orientale de l’Ethiopie, entre le pays de So-
phala-inclufivement & le détroit de la mer Rouge ,
paroît une des plus vraisemblables. Il eft du-moins
çertain par les paffages de l ’Ecriture, II I . Reg. c.jx .
y . z S . 2,y. z8. c. x. v . 11. II. liv.des Paralipom. c. viii,-
v. ly & 18. IU è. jx . v. 10 ; il paroît, dis-je , par tous
ces paffages qu’il faut qu * Ophir foit maritime , que
la courfe foit ajfée , de forte qu’on la puiffe faire
tous les ans ; que ce foit un pays fertile en or ; 8c
qu’enfin un flotte puiffe y arriver fans avoir befoin
de la bouffole. Tout cela quadre affez bien à la côte
de Sophala, dont après tant de fiecles les richeffes
13e font pas encore çpuifées. Une mouffon y menoit
la flotte, l’autre femeftre lui donnoit le vent propre
pour revenir à la mer Rouge. Point de golfe, ni de
cap dangereux qui interrompent la courfe d’une
flotte qui rafe la côte. Ce fentiment eft au refte celui
des Navigateurs 8c des Géographes ; favoir d’Or-
telius, de Lopès dans fa navigation des Indes, de
Bàrros dans fes décades, & autres. (D . J A
OPHITES , f. m. ( Hift. culte. ) eft le nOm d’une
fe&e d’anciens hérétiques fortis des Gnoftiques. Leur
nom dérive à’oçiç ^Jerpent, parce qu’ils adoroient le
ferpent qui avoit léduit Eve. Ils croyoient que ce
ferpent avoit la fcience univerfelle , ôc ils le regar-
doient comme le pere 8c l’auteur de toutes les fcien^
ces. Sur ce fondement ils bâtirent une infinité de chimères
, dont on peut voir les principales dans faint
Epiphane. Voye{ Gnostiqües. Ils difoient que ce
ferpent étoit le Chrift , qui étoit fort différent de
Jefus né de la vierge Marie ? que le Chrift defeendit
dans Jefus , 8r que ce fut Jefus 8c non pas le Chrift
qui fut mis à mort. En conféquence ils obligèrent
ceux de leur fe&e à renoncer à Jefus 8c à fuivre le
Chrift.
Les Sethiens ou Séthiniens dont il eft fait mention
dansTheodoret, étoient les mêmes que les Oplûtes,
ou du-moins leur do&rine ne différoit pas beaucoup
-de celle de ces derniers.
Les Peres ajoutent que les chefs ou prêtres des
Ophites en impofoient aux peuples par cette efpece
de prodige. Lorfqu’ilscélébroient leurs myfteres, un
ferpent qu’ils avoient apprivoifé fortoit de fon trou
à un certain cri qu’ils faifoient, & y rentroit après
s etre roulé fur les chofesqu’ils offroient en facrifice.
Ges impofteu« en concluoient que le Chrift les avoit
lanetmees par fa préfence , 8c les diftribuoient aux
Tome X I .
afliftans comme des. dons facrés 8c divins. S. Iren.
liy. I. ch. xxxiv. Tertuil. deprotfeript. c. xlyij, Baro-
nius, ad ann, Chriß. cxlv,
O phit e , f. f. (Hiß. nat. ) nom donné par quelques
auteurs à la pierre connue fous le nom de yêr-
pentine, dont la couleur a affez de reffemblance avec
celle de la peau de quelques ferpens. Voye? Serpent
in e .
Les anciens naturaliftes ont donné le nom d\ophi-
tes k des marbje&gris.fachetés de noir ; ils en diftin-
guoient trois efpeces, le noir, le blanc & le cendré
ou gris. Ils ont aufli appellé ophite une efpece de
porphyre que Pline a nommé ophites nigricans durus
& memphites,,. lib. X X X V I . cap. vij. dont une efpece
fe nommoit tephrias, ou ophites cinereus. Voye? Em.
Mendès. d’Acofta , Hiß, nap. of. foffils. ( —)
OPHIUCUS., f. m. fe dit dans Y-Aßronomie d’une
conftellation de l’hémifphere boréal, appellée auflï
8c plus communément ferpeniaire. Voye{ Serpent
a ir e .
OPHIUSA , ( GéogrK anc. ) nom commun à plu-
fiettrs îles ; 1 '. à une île de, la Propontide , félon
Pline , 1. 1V. 20. à une île delà Méditerranée, dans
le voifinage d’ivica : c’eft aujourd’hui Mpncolibri $
3°. à l’île de Cypre , ou du-moins à un canton particulier
de cette île, Ophiufa arva, , dit Ovide , en
parlant de cet endroit ; 40. Ophiufa eft un ancien
nom d’un ville de la Scythie en Europe .; 50. d eC y -
thnus ; 6°. de la Lybie ; 70. de Thénos, l ’une des
Cyclades, aujourd’hui Vile de Tim. ( D . J. ) ,
OPHRYNiUM , ( Géog. anc. ) lieu d’Afie dans la
Troade , près de Dardanum. Strabon en parle liv.
X I I I . page S9 8. C ’étoit-làqii’étoit le bois d’Heûor,
8c enfuite le lac Ptelée.
OPHIRIS, ( Botan,')-, o,u. ophrys , en anglqfs fay-,
blade , en françois double-feuille ; genre de plante
dont voici les carafteres félon Linoeus. La fleur n’a
point de calice particulier , 8c eft çompofée de fix
pétales oblongs. La couronne delà fleur eft plus longue
que les pétales, fendue en deux , 8c. pend en
bas. Les étamines font deux filets très-courts ; les,
boffettes font droites 8c couvertes par le bord interne
de la couronne de la fleur. Le germe du piftil
eft oblong 8c tortillé ; le ftile eft adhérant à la partie
interne de la couronne de la fleur. Le fruit'efl une
capfule o v a le , contenant une quantité de graines
aufli fines que de la pouflîere.
Hill compte quatre efpeces d’opkiris , dont il fuf-
fira de décrire la plus commune , tke common tuy-
blade. Sa. racine eft fibreufe 8c traçante ; elle pouffe
une feule tige dont les feuilles font oppofées l’une à
l’autre. Ses fleurs font compofées chacune de fix
pétales oblongs ; quand la fleur eft paffée, le calice
devient un fruit qui contient des femences aufli menues
que de la fciure de bois. Cette plante croît
dan.s les lieux ombrageux , 8c fleurit en Juin. Elle
n’eft pas d’ufage ordinaire en Médecine. (D . J .)
OPHTHALMIE , f. f. (Chirurgie.) terme de Médecine
, maladie des yeux. C ’eft proprement une inflammation
à la tunique appellée conjonctive, accompagnée
de rougeur, de chaleur8c de douleur. Voye^
OEi l , Sclero ph thalmie & X ér o ph th alm ie.
Ce mot eft formé du grec ùpôctXpss , ceil. Celfe
nomme l’ophthalmie lippitudo, parce que dans cette
maladie il s’attache de la chaflie aux yeux , que les
Latins appellent lippa.
Il y a une ophthalmie humide 8c une feche : la première
eft celle où il y a écoulement de larmes , la
fécondé eft celle où il n’en fort point du tout.
II arrive quelquefois dans Yophthalmie que les
paupières font tellement renverfées, q.u.e l’oeil demeure
ouvert fans pouvoir fe fermer : on l’appelle
chemofisy D ’autre fois les paupières tiennent
tellement enfemhle , que l’oeil ne peut s’ouvrir, 8c
S s s