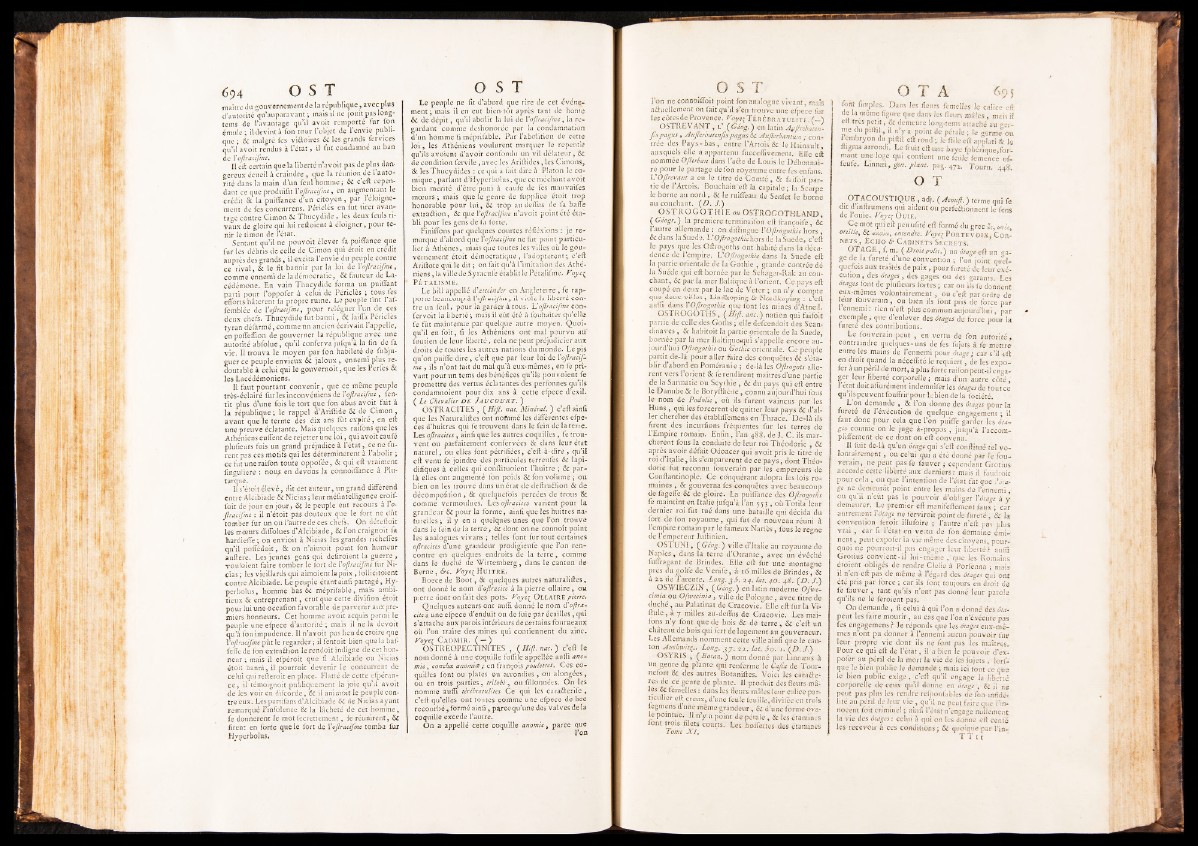
694 O S T
maître du gouvernement de la république, avec plus
d’autorité qu’auparavant ; mais il ne jouit pas long-
tems de l’avantage qu’il avoit remporté fur fon
émule ; il devint à ton tour l’objet de l’envie publique
; 6c malgré (es viâoires 6c les grands fervices
qu’il avoit rendus à l’état, il fut condamné au ban
de Yojlracifme.
Il eft certain que la liberté n’avoit pas de plus dangereux
écueil à craindre , que la réunion de l’autorité
dans la main d’un feul homme ; & c’eft cependant
ce que produifit Y ojlracifme, en augmentant le
crédit & la puiffance d’un citoyen, par l’éloignement
de fes concitrrens. Périclès en fut tirer avantage
contre Cimon 6c Thucydide, les deux feuls rivaux
de gloire qui lui reûoient à eloigner, pour tenir
le timon de l’état. ^
Sentant qu’il ne pouvoit élever fa puiffance que
fur les débris de celle de Cimon qui étoit en crédit
auprès des grands, il excita l’envie du peuple contre
ce rival, & le fit bannir par la loi de Yojlracifme,
comme ennemi de la démocratie, 6c fauteur de Lacédémone.
En vain Thucydide forma un puiffant
parti pour l’oppofer à celui de Périclès ; tous fes
efforts hâtèrent fa propre ruine. Le peuple tint l’af-
femblée de Y ojlracifme, pour reléguer l’un de ces
deux chefs. Thucydide fut banni, 6c laiffa Périclès
tyran défarmé, comme un ancien écrivain l’appelle,
en poffeflion de gouverner la république avec une
autorité abfolue, qu’il conferva jufqu’à la fin de fa
vie. Il trouva le moyen par fon habileté de fubjliguer
ce peuple envieux 6c jaloux , ennemi plus redoutable
à celui qui le gouvernoit, que les Perfes &
les Lacédémoniens.
Il faut pourtant convenir, que ce même peuple
très-éclairé furlesinconvéniens de Yofracifme , fen-
îit plus d’une fois le tort que fon abus avoit fait à
la république ; le rappel d’Ariftide 6c de Cimon,
avant que te terme des dix ans fût expire, en eft
une preuve éclatante. Mais quelques raifons que les
Athéniens euffent de rejetter une lo i, qui avoit caufé
plufieurs fois un grand préjudice à l’état,.ce ne furent
pas ces motifs qui les déterminèrent à l’abolir ;
cefutuneraifon toute oppofée, & qui eft vraiment
finguliere : nou$ en devons la connoiffance à Plutarque.
Il s’étoitélevé, dit cet auteur, un grand différend
entre Alcibiade & Nicias ; leur méfmtelligence croif-
foit de jour en jour, ôl le peuple eut recours à IV
Jlracifme : il n’étoit pas douteux que 1e fort ne dût
tomber fur un ou l’autre de ces chefs. On deteftoit
les moeurs diffolues d’Alcibiade, 6c l’on craignoit fa
hardieffe ; on envioit à Nicias les grandes richeffes
qu’il poffédoit, & on n’aimoit point fon humeur
auftere. Les jeunes gens qui defiroient la guerre,
voûtaient faire tomber 1e fort de Yofracifme fur Nicias
; tes vieillards qui aimoient la paix , follicitoient
contre Alcibiade. Le peuple étant ainfi partagé, Hy-
perbolus, homme bas 6c méprifable, mais ambitieux
& entreprenant, crut que cette divifion étoit
pour lui une occafion favorable de parvenir aux premiers
honneurs. Cet homme avoit acquis parmi 1e
peuple une efpece d’autorité ; mais il ne la devoit
qu’à fon impudence. Il n’avoit pas lieu de croire que
Yofracifme pût le regarder ; il fentoit bien que la baf-
feffe de fon extraftion le rendoit indigne de cet honneur
; mais il efpéroit que fi Alcibiade ou Nicias
étoit banni, il pourroit devenir le concurrent de
celui quirefteroit en place. Flatté de cette efpéran-
c e , il témoignoit publiquement la joie qu’il avoit
de les voir en difeorde, & il animoit le peuple contre
eux. Lespartifans d’Alcibiade 6c de Nicias ayant
remarqué l’infolcnce 6c la lâcheté de cet homme,
fe donnèrent 1e mot fecrettement, fe réunirent, 6c
firent en forte que 1e fort de Yofracifme tomba fur
Hvperbolus.
O S T
Le peuple pe fit d’abord que rire de cet événement;
mais il en eut bien tôt après tant de honte
& de dépit, qu’il abolit la loi de Yoflracifme, la regardant
comme déshonorée par la condamnation
d’un homme fi méprifable. Par l’abolition de cette
lo i , tes Athéniens voulurent marquer le repentir
qu’ils avoient d’avoir confondu un vil délateur , 6c
de condition fervile, avec les Ariftides, les Cimons,
& les Thucydides : ce qui a fait dire à Platon le comique
, parlant d’Hyperbolus, que ce méchant avoit
bien mérité d’être puni à caufe de fes mauvaifes
moeurs ; mais que le genre de fupplice étoit trop
honorable pour lu i, 6c trop au deflus de fa baffe
extradion, 6c que YofraciJ'me n’avoit point été établi
pour les gens de fa lorte.
Finiffons par quelques courtes réfléxions : je remarque
d’abord que YofraciJ'me ne fut point particulier
à Athènes, mais que toutes les villes où le gouvernement
étoit démocratique, l’adopterent; c’eft
Ariftote qui le dit ; on fait qu’à l’imitation des Athéniens
, 1a viltedeSyracufeétablitle Pétalifme. Voyt^
PÉTALISME.
Le bill appellé d'atteinder en Angleterre , fe rapporte
beaucoup à Yofracifme; il viole la liberté contre
un feul, pour la garder à tous. Uofracifme con*
fervoit la liberté ; mais il eût' été à fouhaiter qu’elle
fe fût maintenue par quelque autre moyen. Quoiqu’il
en foif, fi les Athéniens ont mal pourvu aTf
foutien de leur liberté, cela ne peut préjudicier aux
droits de toutes les autres nations du monde. Le pis
qu’on puiffe dire, c’eft que par leur loi de Yofracif-
me , ils n’ont fait du mal qu’à eux-mêmes, en fe privant
pour un tems des bénéfices qu’ils pouvoient fe
promettre des vertus éclatantes des perfonnes qu’ils
condamnoient pour dix ans à cette efpece d’exil.
( Le Chevalier DE Ja UCOURT. )
OSTRACITES , {Hijt. nat. Minéral. ) c’eft ainfi
que tes Naturaliftes ont nommé les différentes efpe-
ces d’huitres qui fe trouvent dans le fein de la terre.
Les oflracites, ainfi que les autres coquilles, fe trouvent
ou parfaitement' confervées & dans leur état
naturel, ou elles font pétrifiées, c’eft-à-dire, qu’il
eft venu fe joindre des particules terreufes 6c lapi-
difiques à celles qui conftituoient l’huitre ; 6c par-
là elles ont augmenté fon poids 6c fon volume ; oit
bien on les trouve dans un état de deftrudion & de
décompofition, & quelquefois percées de trous &
comme vermoulues. Les oflracites varient pour la
grandeur & pour la forme, ainfi que les huîtres naturelles
; il y en a quelques-unes que l’on trouve
dans le fein de la terre, 6c dont on ne connoît point
les analogues vivans ; telles font fur tout certaines
ofracites d’une grandeur prodigieufe que l’on rencontre
en quelques endroits de la terre, comme
dans 1e duché de Wirtemberg, dans le canton de
Berne, &c. Voye{ Huître.
Boece de B o o t, & quelques autres naturaliftes,
ont donné 1e nom d'ofracite à la pierre ollaire, ou
pierre dont on fait des pots. Poyei Ollaire pierre.
Quelques auteurs ont aufîi donné le nom d’o f radie
à une efpece d’enduit ou de fuie par écailles, qui
s’attache aux parois intérieurs de certains fourneaux
où l’on traite des mines qui contiennent du zinc.
Voye[ Cadmir. ( —)
OSTREOPECTINITES , ( Hif.n at. ) c’eft le,
nom donné à une coquille foffile appellée aufîi anomie,
conchce anomice ; en françois poulettes. Ces co*
quilles font ou plates ou arrondies, ou alongées,
ou en trois parties, trilobi, ou fillonnées. On tes
nomme aufîi térébratulites Ce qui les caraderife ,
c’eft qu’elles ont toutes comme une efpece de bec
recourbé , formé ainfi, parce qu’une des valves de la
coquille excede l’autre.
On a appellé cette coquille anomie, parce que
l’on
O S T
l’on ne connoiffoit point fon analogue vivant mais )
actuellement on fait qu’il s’en trouve une efpece fur
tes côtes de Provence. V^ « {T éré br a tu l it e . {—)
OSTR EVANT, l’ ( Géog. ~) en latin Ayftrèbaten-
fispagus, Auftrbatenfis pagus & Auficrbantum ; contrée
des P a y s -b a s , entre l’Artois & le Hainault
auxquels elle a appartenu fucceflivement. Elle eft
nommée Oferban dans l’ade de Louis le Débonnaire
pour le partage de fon royaume entre fes enfans.
VOfirevant a eu 1e titre de Comté, & faifoit partie
de l’Artois. Boùchàin'eft la capitale ; la Scarpe
le borne au nord, & le ruiffeau de Senfet le borne
au couchant. { D . J.)
O S T R O G O T H 1E ou OSTRQGOTHLAND,
( Géogr. ) la première terminaifon eft francoife, 6c
l’autre allemande : on diftingue YOflrogoîhie hors ,
&dans la Suede. VO/lrogothiehorsde laSuede, c’eft
le pays que tes Oftrogôths-.ohf habité dans la décadence
de l ’empire. L’Ofrogothie dans la Suede eft
la partie orientale de la Gothie , grande contrée dé
la Suède qui eft bornée par le Schager-Rak au couchant,
& par la mer Baltique à l’orient. Ce pays eft
coupe en deux par le lac de Veter j on n’y compte
que deux villes , Lindkoping & Nordkoping : c’eft
airfïi dans YOfrogothie que font tes mines d’Atned.
OSTROGOTHS , ( H if . anc.) nation qui faifoit
partie de celle des Goths ; elle defeendoit des Scandinaves
, & habitoit la partie orientale de la Suede,
bornee par la mer Baltique*cjui s’appelle encore aujourd’hui
Ofirogothie ou Gothic orientale. Ce peuple
partit de-là pour aller foire des conquêtes 6c s’établir
d’abord en Poméranie ; de-là les Ofirogots allèrent
vers l’orient & fe rendirent maîtres d’une partie
de la Sarmâtie ou Scythie , 6c du pays qui eft entre
1e Danube & le Boryfthèrie, connu aujourd’hui fous
le nom de Podolie , où ils furent vaincus par les
Huns , qui tes forcèrent de quitter leur pays 6c d’aller
chercher des établiffemens en Thrace. De-là ils
firent des incurfions fréquentes fur les terres de
l’Empire romain. Enfin, l’an 488. de J. C . ils marchèrent
fous la conduite de leur roi Théodoric , 6c
après avoir défait Odoacer qui avoit pris le titre de
roi d’Italie, ils s’emparèrent de ce pays, dont Théodoric
fut reconnu fouverain par les empereurs de
Conftantinople. Ce conquérant adopta les lois romaines
, & gouverna fes conquêtes avec beaucoup
de fageffe 6c de gloire. La puiffance des Ofirogoths
fe maintînt en Italie jufqu’à l’an 5 5 3 , où Totila leur
dernier roi fut tue dans une bataille qui décida du
fort de fon royaume, qui fut de nouveau réuni à
l’empire romain par le fameux Narl'ès, fous te regne
de l’empereur Juftinien.
OSTU N I, ( Géog. ) ville d’Italie au royaume dé
Naples, dans la terre d’Otrante, avec un évêché
fuffragant de Brindes. Elle eft fur une montagne
près du golfe de Venife, à 16 milles de Brindes, &
à a i de Tarente. Long. 3 J. 24. lat. 40. 48. ( D . J.)
OSWIECZIN, {.Géog.') en latin moderne Ofwe-
cimia ou Ofwecinia, ville de Pologne, avec titre de
duché, au Palatinat de Cracovie. Elle, eft fur la Vi-
ftule, à 7 milles au-deffus de Cracovie. Les mai-
fons n’y font que de bois & de terre, 6c c’eft un
chateau de bois qui iert de logement au gouverneur.
Les Allemands nomment cette ville ainfi que 1e canton
Aushwit{.. Long. 3 y. 22. lat. So. t. (D . J.)
OSYRIS , ( Botan. ) nom donné par Linnæus à
un genre d® plante qui renferme le Cafia de Tour-
nefort 6c des autres Botaniftes. Voici les carafte-
res de ce genre de plante. Il produit des fleurs mâ-
les & femelles : dans tes fleurs mâles leur calice particulier
eft creux, d’une feule feuille,divifée en trois
fegmens dune même grandeur, 6c d’une forme ovale
pointue. Il n’y a point de pétale , & les étamines
lont trois filets courts. Les bofi'ettes des étamines
Tome X I ,
O T A 695
font Amples. Dans les fleurs femelles le calice eft
g i| la même figure que dans les fleurs mâles, mais il
eft très petit, & demeure Iong-tems attaché au germe
du piftil, il n’y a point de pétale ; le germe on
I embryon dit ptftil eft tond • le ftile eft applati & le
ftigma arrondi. Le fruit eft utte baye fpbétique.fori.
mant une loge qui contient une feule femence of-
leule. Linnæi, g u . plant, pag. 4 7 i. Tourn. 448.
O T
. OTACOUSTIQUE , adj. ( Acmfi. > terme qui fe
dit d înftrumens qui aident ou perfeaionnent le fens
de l’ouie. Foye[ Ouïe.
Ce mot cjui eft peuufité eft formé du grec «rd*
oreille, Scàxoûu, entendre. Voyet^ Porte VOIX, CORNETS.,
Écho & C abinets Secrets.
O T AG E , f. m. {Droitpolit,') un otage eft un gage
de la furete d une convention ; l’on joint quelquefois
aux traités de paix, pour fureté de leur exécution
, des otages, des gages ou des garants. Les
otages lont de plufieurs fortes ; car ou ils fe donnent
eux-mêmes volontairement , ou c’eft par ordre de
leur fouverain, ou bien ils font pris de force par
1 ennemi : rien n’eft plus commun aujourd’hui, par
exemple > que d’enlever des otages de forcé pour la
fureté des contributions.
Le fouverain peut , en vertu de fon autorité,
contraindre quelques-uns de fes fujets à fe mettre
entre les mains de l’ennemi pour otage; car s ’il eft
en droit quand la néceffité le requiert, de les expo-
fer à un péril de mort, à plus forte raifon peut-il enga-
ger leur liberté corporelle; mais d’un autre côté,
l ’état doit affurément indemniferles otages de tout ce
qu’ils peuvent fouffrir pour le bien de la fociété.
L’on demande , & l’on donne des otages pour la
furete de 1 exécution de quelque engagement ; il
faut donc pour cela que l’on puiffe garder les otages
comme on le jugé à-propos , julqu’à l’accom-
pliffement de cé dont on eft convenu.
I II fuit de-là qu’un ôtage qui s ’eft conftitué tel volontairement
, ou celui qui a été donné par le fou-
Vérain , ne peut pasfe fauver ; cependant Grotius
accorde cette liberté aux derniers: mais il foudroie
pour cela , ou que l’intention de l’état fût que Y otage
ne demeurât point entre les mains de l’ennemi,
ou qu’il n’eût pas le pouvoir d’obliger Yôtage à y
demeurer. Le premier eft manifeftement faux ; car
autrement Yôtage^ ne ferviroir point de fureré, & la
convention feroit illufoire ; l’autre n’eft pas plus
vrai , car fi l’état en vertu de fon domaine éminent
, peut expofer la vie même des citoyens, pourquoi
ne pourroit-il pas engager leur liberté ? aufii
Grotius convient-il lui-même , ‘que les Romains
étoient obligés de rendre Clelie à Porfenna ; mais
il n’en-eft pas de même à l’égard des otages qui ont
été pris par force ; car ils font toujours en droit dé
fe îauver , tant qu’ils n’ont pas donné leur parole
qu’ils ne le feroient pas.
On demande , fi celui à qui l’on a donné des ôta-i
peut tes faire mourir, au cas que l’on n’éxécute pas
fes engagemens ? Je réponds que les otages eux-mêmes
n’ont pu donner à l’ennemi aucun pouvoir lur
leur propre vie dont ils ne font pas tes maîtres.
Pour ce qui eft de l’état, il a bien le pouvoir d’ex-i
pofer au péril de la mort la vie de fes fujets , lorfo
que le bien public le demande ; mais ici tout ce que
le bien public exige , c’eft qu’il engage la liberté
corporelle de ceux qu’il donne en otage , & il né
peut pas plus lés rendre refponfables de fon infidélité
au-péril de leur vie , qu’il ne peut faire que l’innocent
foit criminel ;■ ainfi l’état n’engage nullement
la vie des otages : celui à qui on les donne eft cenlé
tes recevoir à ces conditions ; 6c quoique par l’in-
T T t t