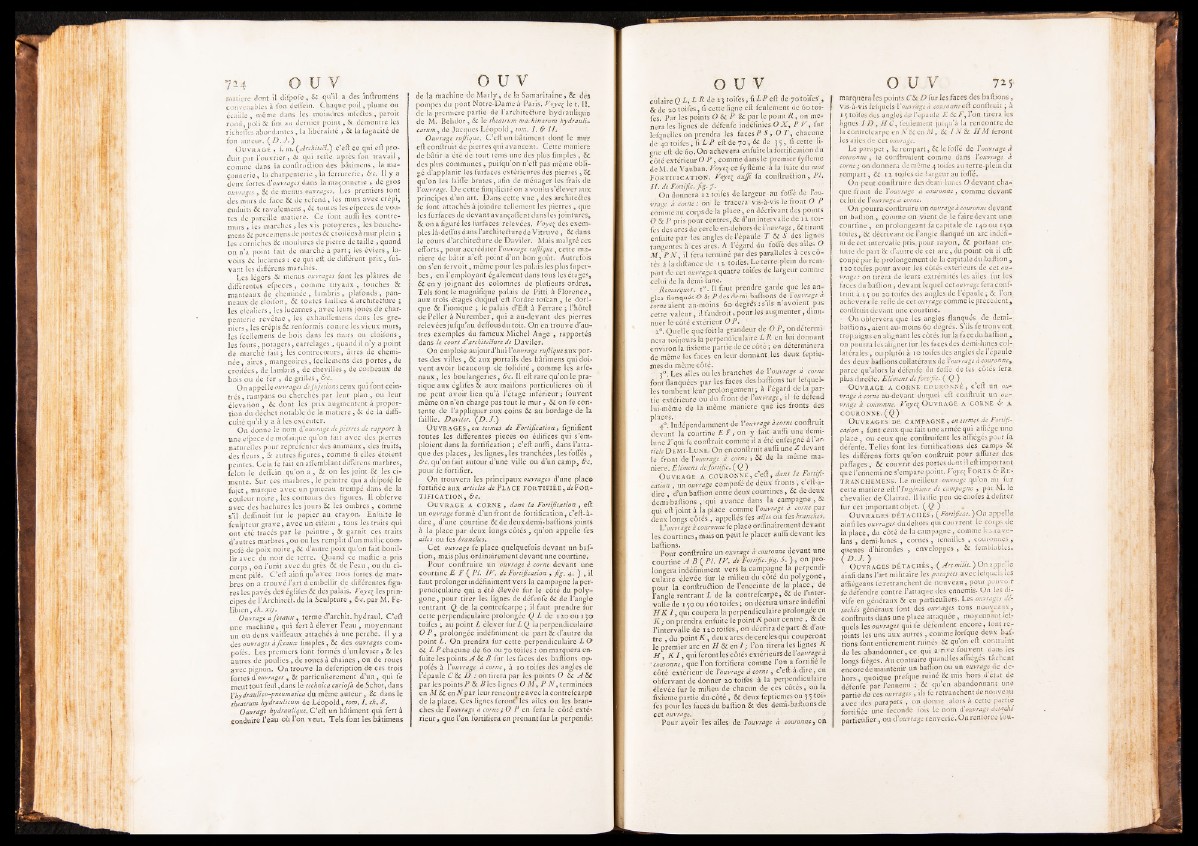
| j f |
-V
matière dont il difpofe, 6c qu’il a des inftfuméns
convenables à Ton deffein. Chaque poil, plume ou
écaille même dans les moindres inleries , paroît
rond, poli & fini au dernier point, & démontre les
richeflés abondantes , la libéralité , & la lagacite de
fon auteur. (Z>. J. ) ’ .t
Ouvrage , f. m. ( Architeci.) c’eft ce qui eft produit
par l’ouvrier, & qui refte après fon travail,
comme dans la conftru&ion des bâtimens, la maçonnerie,
la charpenterie , la ferrurerie, &c. Il y a
deux fortes d’ouvrages dans la maçonnerie , de gros
ouvrages , Si de menus ouvrages. Les premiers font
des murs de face 6c de refend, les murs avec crépi,
euduits 6c ravalemens , 6c toutes les efpcces de voûtes
de pareille matière» Ce font auifi les contie—
murs , les marches , les vis potoyeres, les bouche-
mens 6c percemens de portes Si croifées à mur plein ;
les corniches & moulures de pierre de taille , quand
on n’a point fait de marché à part ; les éviers, Lavoirs
6c lucarnes : ce qui eft de différent prix, fui-
vant les différens marchés.
Les légers & menus ouvrages font les plâtres de
différentes efpeces , comme tuyaux , louches &
manteaux de cheminée , lambris , plafonds , panneaux
de cloifon, Si toutes faillies d’architefhire ;
les efcaliers, les lucarnes , avec leurs joués de charpenterie
revêtue , les exhauflêmens dans les greniers
, les crépis Si renformis contre les vieux murs,
les fcellemens de bois dans les murs ou cloifons,
les fours, potagers, carrelages, quand il n’y a point
de marché fait ; les contrecoetirs, âtres de cheminée
aires , mangeoires, fcellemens des portes , de
croifées, de lambris, de chevilles, de corbeaux de
bois ou de fer , de grilles, &ç.
On appelle ouvrages deJujétions ceux qui font cein-
trés, rampans ou cherchés par leur plan , ou leur
élévation , Si dont les prix augmentent à proportion
du déchet notable de la matière, & de la difficulté
qu’il y a à les exccuter.
On donne le nom d’ouvrage de pierres de rapport à
une efpece de mofaïque qu’on fait avec des pierres
naturelles pour repréfenter des animaux, des fruits,
des fleurs , 5c autres figures, comme fi elles étoient
peintes. Cela fe fait en affemblant diffcrens marbres,
félon le deffein qu’on a ,, St on les joint Si les cimente.
Sur ces marbres, le peintre qui a difpofé le
fujet, marque avec un pinceau trempé dans de la
couleur noire, les contours des figures. Il obferve
avec des hachures les jours Si les ombres , comme
s’il deffinoit fur le papier au crayon. Enfuite le
fculpteur grave , avec un cifeau , tous les traits qui
ont été tracés par le peintre , & garnit ces traits
d’autres marbres, ou on les remplit d’un maftic com-
pofé de poix noire, Si d’autre poix qu’on fait bouillir
avec du noir de terre. Quand ce maftic a pris
corps, on l’unit avec du grès Si de l’eau, ou du ciment
pilé. C ’eft ainfi qu’avec trois fortes de marbres
on a trouvé l’art d'embellir de différentes figures
les pavés des églifes 8i des palais. Voye^ les principes
de l’Architeû. de la Sculpture , &c. par M. Fe-
libien 7ch. xij.
O-uvrage à fceaux, terme d’archit. hydraul. C ’eft
une machine, qui fert à élever l’eau , moyennant
un ou deux vaiffeaux attachés à une perche. Il y a
des ouvrages à fceaux fimples, Si des ouvrages com-
pofés. Les premiers font formés d’un levier, & les
autres de poulies , de roues à chaînes , ou de roues
avec pignon. On trouve la defcription de ces trois
fortes dû ouvrages , 8r particulièrement d’un, qui fe
meut tout feul ,dans le technica curiofa de Schot, dans
l’kydraulico-pneumatica du même auteur, Si dans le
theatrum hydraullcum de Léopold, tom. 1. ch. 8.
Ouvrage hydraulique, C ’eft un bâtiment qui fert à
conduire l’eau où l’on veut. Tels font les bâtimens
de la machine de Marly, de la Samaritaine, & défi
pompes du pont Notre-Dame à Paris. Poye^ le t. II.
de la première partie de l’architeéhire hydraulique
de M. Belidor, Si le theatrum machin arum hydrauli-
carum * de Jacques Léopold , tom. I. & I I<
Ouvrage rujlique. C’eft un bâtiment dont le mur
eft conftruit de pierres qui avancenr. Cette maniéré
de bâtir a été de tout tems une des plus fimples, ôc
des plus communes , puisqu'on n’eft pas même obligé
d’applanir les. furfaces extérieures des pierres, Sc
qu’on les laiffe brutes, afin de ménager les frais de
Youvrage. De cette fimplicité on a voulu s’élever aux
principes d’un art. Dans cette vue , des archite&es
fe font attachés à joindre tellement les pierres , que
les furfaces de devant avançaient dans les jointures,
& on a figuré les furfaces relevées. Voye\. des exemples
là-deffus dans l’architethirede Vitruve, ôi dans
le cours d’archite&ure de Daviler. Mais malgré ces
efforts, pour accréditer l'ouvrage rujlique, cette maniéré
de bâtir n’eft point d’un bon goût. Autrefois
on s’en fervoit, même pour les palais les plus fuper-
bes, en l’employant également dans tous les étages,
ôi en y joignant des colomnes de plufieurs ordres.
Tels font le magnifique palais de Pitti à Florence,
aux trois étages duquel eft l’ordre tofean , le dorique
& Bionique ; le palais d’Eft à Ferrare ; l’hôtel
de Peller à Nurember, qui a au-devant des pierres
relevées jufqu’au deffousdutoit. On en trouve d’autres
exemples du fameux Michel Ange , rapportés
dans le cours d’architecture de Daviler.
On emploie aujourd’hui l’ouvrage rujlique aux portes
des villes , 6c aux portails des bâtimens qui doivent
avoir beaucoup de folidité , comme les arfe-
naux, les boulangeries, &c. II eft rare qu’on le pratique
aux églifes & aux maifons particulières où il
ne peut avoir lieu qu’à l’étage inférieur ; fouvent
même on n’en charge pas tout le mur , 6c on fe contente
de l'appliquer aux coins 6c au bordage de la
faillie. Daviler, {D.J.')
Ou v r a g e s , en termes de Fortification, lignifient
toutes les différentes pièces ou édifices qui s’emploient
dans la fortification ; c’eft auffi, dans l’attaque
des places, les lignes, les tranchées, les foffés ,
&c. qu’on fait autour d’une ville ou d’un camp, &c.
pour fe fortifier.
On trouvera les principaux ouvrages d’une place
fortifiée aux articles de Pl a c e f o r t if ié e , Fort
i f ic a t io n , &c.
O u vr a g e a corne , dans la Fortification, eft
un ouvrage formé d’un front de fortification, c’eft-à-
dire, d’une courtine 6c de deux demi-baftions joints
à la place par deux longs côtés , qu’on appelle fes
ailes ou fes branches.
Cet ouvrage fe place quelquefois devant un baf-
tion, mais plus ordinairement devant une courtine.
Pour conftruire un ouvrage à corne devant une
courtine E F ( PI. IP. de Fortification , fig. 4. ) , il
faut prolonger indéfiniment vers la campagne la perpendiculaire
qui a été élevée fur le côté du polygone
, pour tirer les lignes de défenfe 6c de l ’angle
rentrant Q de la contrefcarpe ; il faut prendre fur
cette perpendiculaire prolongée Q L de 120011 130
toifes ; au point L élever fur L Q la perpendiculaire
O P , prolongée indéfiniment de part & d’autre du
point L. On prendra fur cette perpendiculaire L O
6c L P chacune de .60 ou 70 toiles : on marquera en-
fuite les points A 6c B fur les faces des baftions op-
pofés à l’ouvrage à corne, à 10 toifes des angles de
î’épaule C 6c D : on tirera par les points O 6c A 6c
par les points P & Pie s lignes O Af, P N , terminées
en M6c en N par leur rencontre avec la contrefcarpe
de la place. Ces lignes feront les aîles ou les branches
de l’ouvrage à corne j O P en fera le côté extérieur,
que l’on fortifiera en prenant fur la pçrpendiculaire
O L 7L R à e i 3 toifés, f iL P eft de 70 toifes*,
& de 20 toifes, fi cette ligne eft feulement de 60 toifes.
Par les points O 6c P & par le point R 7on mènera
les lignes de défenfe indéfinies O X , P P , fur
lefquelles on prendra les faces P S , O P , chacune
de 40 toifes, fi L P eft de 70 , 6c de 35, fi cette ligne
eft de 60. On achevera enfuite la fortification du
côté extérieur O P , comme dans-le premier fyftème
de M. de Vauban.Xoye^-ce fyftème à la-fuite du mot
Fo r t if ic a t io n . Poye{ auffi fa conftru&ion, PI.
II. de Fortifie, fig; ÿ* ;
On donnera 12 toifes de largeur -au foffé de l ouvrage
à corne : ôn le tracera vis-à-vis le front O P
comme au corpsdela place, en décrivant des points ;
O & P pris pour centres, 6c d’un intervalle de 12 toi^
fes des arcs de cercle en-dehors dé l'ouvrage, 6c tirant
enfuite par les angles de l’épaule T 6c S des lignes
tangentes à ce? arcs. A l’égard du folfé des ailes O
M , P N , il fera terminé par des parallèles à ces côtés*
à la diftance de 12 toifes. L e terre-plein du rempart
de cet ouvrage a quatre toifes de largeur comme
celui de la demi-lune:: 11 1 • ^
Remarques. i° . Il faut prendre garde que les angles
flanqués O & P des demi baftions de l'ouvrage a
corne aiertt au-moins 60 degrés : s’ils n avoient pas>
cette valeur, il faudrait, pour les augmenter, diminuer
le côté extérieur O P . \
20.Quelle quefôitla grandeur de O P , ondetermi-
pera toûjotirs la perpendiculaire A P en lui donnant
environ la fixieme partie de ce côte ; on determinei a
de même les faces en leur donnantes deux feptie-
mes du même côte.
: 30. Les aîles ou les branches de 1 ouvrage a corne
font flanquées par les faces des baftions tur lelquel-
les tombent leur prolongement ; à l’égard de la partie
extérieure où du front de Y ouvrage, il fe defend
lui-même ’de l i même maniéré' que'les .fronts des
places.' * ' " • , _ .
40. Indépendamment de l’ouvrage acorne conltruit
devant la courtine E F , on y fait auffi une demi-
lune Tqni fe conftruit comme il a été enfeigné à l’«r-
ticle D emi-Lune. On en conftruit auffi une Z. devant
lë front de l’ouvrage à co’rne , & de la même maniéré.
Elémens de’fortifie. ( Q )
O u v r a g e a co u r o n n é , c eft, dans la Fort fi-
cation, un ouvrage compofé de deux fronts , c’eft-à-
dire , d’un bàftiôn entre deux courtines, 6c dedeux
demi-baftions , : qui avance dans la campagne , &
qui eft joint à la place comme l’ouvragé à corne par
deux longs côtés , appellés fes ailes ou (es branchés. .
U ouvrage-à couronne fe place ordinairement devant
les courtines., mais on peut le placer auffi devant les
baftions.
Pour conftruire un ouvrage d. couronne devant une
courtine A B ( PL IV . de Fortifie.fig. i . >, on Prolongera
indéfiniment vers la campagne la perpendiculaire
élevée fur le milieu du côté du polygone,
pour la conftruâion de l’enceinte de la place, de
l’angle rentrant L de la contrefcarpe, 6c de l’mter-
valle de 150011160 toifes ; on décrira uffarc indéfini
H K / , qui coupera là perpendiculaire prolongée en
K ; on prendra enfuite le point K pour centre > &de
l’intervalle de 120 toifes, on décrira de part & d autre
, du point K , deux arcs de cercles qui couperont
le premier arc en H 6c en I ; l’on tirera les^lignes K
H , K l , qui feront les côtés extérieurs de l’ouvrage a
'. couronne, que l’on fortifiera comme l’on a fortifié le
côté extérieur de l’Ouvrage à corne , c’eft-à-dire,' en
obfervant de donner 20 toifes à la perpendiculaire
élevée fur le milieu de chacun de ces côtés, 011 la
fixieme partie du-côté, & deux feptiemes ou 3 5 toifes
pour les faces du baftion & 'des demi-baftions de
cet ouvrage.
Pour avoir les aîles de l’ouvrage à couronne, on
marquera les points C & D fur les faces des baftions,
■ vis-à-vis Iefquels l 'ouvr'àge a couronne eft conftruit ; à
15 toifes des angles de l’epaule E 6 cF 7 l’on tirera les
lignes ƒ D , H C , feulement julqu’à la rencontre de
la contrefcarpe en N 6c en M , 6c IN 6c H M feront
^ les aîles de cet ouvrage.
Le parapet, le.rempart, & le fofle de 1’'ouvrage a
couronne, té conftruilent comme dans l’ouvrage à
corne ; on donnera de même 4 toifes au terre-plein du
rempart, 6c 12 to.iles de largeur au fofle.
On peut conftruire des demi-lunes O devant cha-
• que front de l’ouvrage à couronne, comme devant
celui de l’ouvrage.à corne.
On pourra conftruire un ouvrage à couronne devant
un baftion, comme on vient de le faire devant une
• courtine, en prolongeant fa capitale de 140 ou 150.
toifes, & décrivant de l’angle flanqué un arc indéfini
de cet intervalle pris.pour rayon, & portant en-
fuite de part & d’autre de cet arc, du point où il eft:
coupé par le prolongement de la capitale du baftion ,
120 toifes .pour avoir les côtés extérieurs de cet ouj
Vrage: on tirera de leurs extrémités les aîles fur les
i faces du baftion, devant lequel cet ouvrage fera,conf-
truit à 15 ou 20 toifes des angles de l’épaule ; & l’on
; achèvera le refte de cet ouvrage comme le précédent,
; conftruit devant une courtine.
■ On obfervera que les angles flanqués de demi-
~ baftions, aient.au-moins 60 degrés. S’ils fe trouvent
trop.aigus en alignant les côtés fur la face du baftion ,
; on pourra lés aligner fur les faces des demi-lunes col-
latérales, ou plutôt à 10 toifes des angles de l’épaule
des deux baftions collatéraux de l’ouvrage à couronne,
parce qu’alors. la défenfe du folfé de fes côtés fera
plus direrie. Elémens de. fortifie. ( Q )
O uvrage a corne- couronné , c’eft un ou-
vrage à corne au-devant duquel eft conftruit un ou-
• vrage à couronne. Voye{ O u vrag e a corne & a
> COURONNE • ( Q ) ‘ •: Z1 ' . , .. •
Ouvrages de campagne , en termes de Fortification
, font ceux que fait une armée qui affiege une
place , ou ceux qiie conftruifent les affiéges pour fa
défenfe. Telles font les fortifications des camps 6c
les différens forts qu’on conftruit pour aflùrer des
partages , & couvrir des portes dunt il eftimportant
quel’ennemi ne s’empare point. Voye[ Forts 6*Re-
TRANCHEMENS. Le meilleur ouvrage qu’on ait fur
cette matière eftl’Ingénieur de campagne , par M. le
chevalier de Clairac. Il laiffe peu de chofes à defirer
fur cet important objet. ( Q ) . •
O uvrages d étachés", (Fonficat.)On appelle
ainfi les ouvrages du dehors qui couvrent le corps de
la place, du côté de la campagne , comme les rave-
lins', demi-lunes , cornes, tenailles ^couronnes ,
queues d’hirondes , enveloppes , & femblables.
( D . J . )
O uvrages d étachés ,. (A nm ilit.) On appelle
ainfi dans l ’art militaire les parapets avec Iefquels les
afliégeans leretranchent de nouveau, pour pouvo.r
fe défendre contre l’attaque dès ennemis. On les di-
vife en généraux & en particuliers. Les ouvrages détachés
généraux font des ouvrages tous nouveaux,
conftruits dans une place attaquée , moyennant lef-
quels les ouvrages qui fe défendent encore, font re-
joints les uns aux autres , comme lorfque deux baftions
font entièrement ruinés 6c qu’on eft contraint
de les abandonner, ce qui arrive fouvent dans les
longs lièges. Au contraire quand les affiéges tachent
encore de maintenir un baflion ou un ouvrage de dehors
, quoique prefque ruiné 6c mis hors d’état de
défenfe par l’ennemi ; & qu’en abandonnant une
partie de ces ouvrages, ils fe retranchent de nouveau
avec des parapets , on donne alors à cette partie
fortifiée une fécondé fois le nom d’ouvrage détaché
particulier, ou d’ouvrage renverlé. On renforce fou-
II