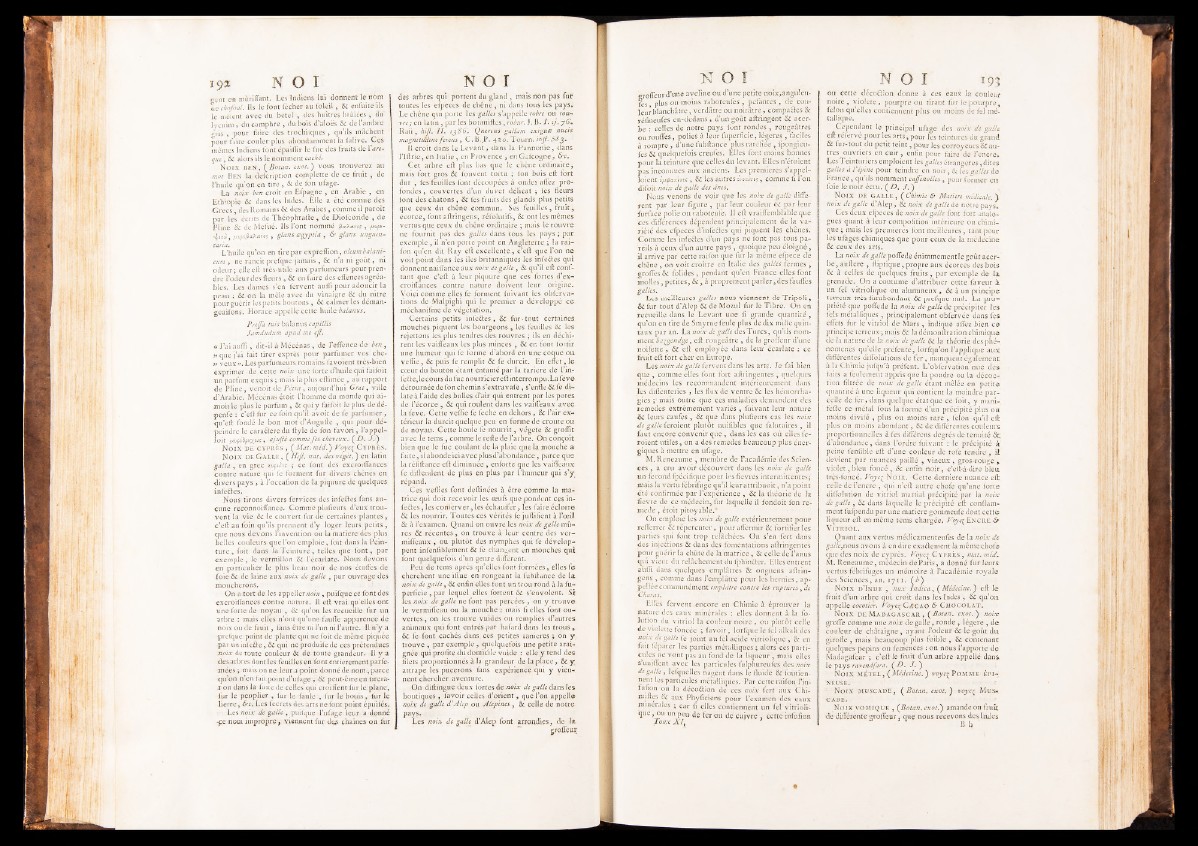
cent en mùriffant. Les Indiens lni donnent le nom
tic chofhal. Ils le font fécher au fole il, 6c enfuite ils
le mêlent avec du betel , des huîtres brûlées , du
lycuim , du camphre , du bois d’aloës 6c de l’ambre
gris , pour faire des trochilques , qu’ils mâchent
pour faire couler plus -abondamment la falive. Ces
mêmes Indiens font épaiffir le fuc des fruits de Yare-
que, 6c alors ils le nomment cache.
N o ix b e n , (Botan. ex or .) vous trouverez au
mot Ben la defeription co/nplette de ce fru it , de
l’huile qu'on en tire , & de fon ufage.
La noix ben croît en Efpagne , en Arabie , en
Ethiopie 6c dans les Indes. Elle a été connue des
Grecs des Romains 6c des Arabes, comme il paroît
par les écrits de Théophrafte , de Diofcoride , de
Pline 6c de Mefué. Ils l’ont nommé ßuhctm , fMipt-
4mî, /j.vpoß*\a.voc , glansoegyptia , & glans ungum-
taria.
L’huile qu’on en tire par expreffion, oleum balani-
cum , ne rancit prefque jamais , 6c n’a ni goût, ni
odeur; elle eft très-utile aux parfumeurs pour prendre
l’odeur des fleurs , 6c en faire des effences agréables.
Les dames s’en fervent auffi pour adoucir la
peau ; 6c on la mêle avec du vinaigre 6c du nitre
pour guérir lespetits boutons, 6c calmer les déman-
geaifons. Horace appelle cette huile balanus.
Prejfa tuis balanus capillis
Jamdudum apud me eß.
« J’ai aufli , dit-il à Mécénas , de l’effence de ben,
» que j’ai fait tirer exprès pour parfumer vos che-
» veux». Lès parfumeurs romains favoient très-bien
exprimer de. cette noix une lorte d’huile qui faifoit
un parfum exquis ; mais la plus eftimée , au rapport
de Pline, venoit de Pétra , aujourd’hui Grac, ville
d’Arabie. Mécénas étoit l’homme du monde qui ai-
moit le plus le parfum , & qui y faifoit le plus de dé-
penfe : c’eft fur ce foin qu’il a voit de fe parfumer ,
qu’eft fondé le bon mot d’Augufte , qui pour. dépeindre
le caraéteredu ftyle de fon favori, l’appel*
loit p.upt>6piXWi ajufié comme fes cheveux.■ ( D . /.<)
N o ix d e c y p r è s , ( Mat.mèd. ) Voyt{ C y p r è s .
N o i x d e G a l l e , (Hiß. nat. desvégét.) en latin
galla , en grec y.upiS’ic-'f ce font des excroiflanees
contre nature qui fe forment fur divers' chênes en
divers pays , à l’occafion de la piquure de quelques
infe&es.
Nous tirons divers fervices des infeftes fans aucune
reconnoiffance. Comme plufieurs d’eux trou-
v en t la vie 6c le couvert fur de certaines plantes,
c ’efl: au foin qu’ils prennent d’y loger leurs petits ,
que nous devons l’invention ou la matière des plus
belles couleurs que l’on emploie, foit danS1 la Peinture
, foit dans Ja Teinture, telles que• fon t, par
exemple , le vermillon & l’écarlate. Nous devons
en particulier le plus beau noir de nos étoffes de
foie & de laine au xnoix de galle , pur ouvrage des
moucherons.
On a tort de les appeller noix, puifque ce font des
excroiflanees contre nature. Il eft vrai qu’elles ont
une forte de noyau , 6c qu’on les recueille fur un
arbre : mais elles n’ont qu’une fauffe apparence de
noix ou de fruit, fans être ni l’un ni l’autre. Il n’y a
prefque point de plante qui ne foit de même piquée
par un infeéle, 6c qui ne produife de ces prétendues
noix de toute couleur & de toute grandeur. Il y a
des arbres dont les feuilles en font entièrement parfe-
mées ; mais on ne leur a point .donné de nom ,parce
qu’on n’en fait point d’iifage , & peut-être en nrera-
j-on dans la fuite de celles qui croiffent fur le.plane,
fur le peuplier , lur le faule , fur le bouis, fur le
lierre, &c. Les fecrets des arts ne font point épuifés.
Les noix de galle , puifque l’ufage leur ‘a donné
•pe nom impropre, viennent fur d^ chaînes ou fur
des arbres qui portent du gland , mais non pas fur
toutes les efpeces de chêne, ni dans fous les pays*
Le chêne qui porte les galles s’appelle robre ou rouvre;
en latin, par les botaniftes, robur. J. B. I. ij. j 6 . .
R a ii, hiß. II. i j 86. Quercus galla m exiguce nucis
magnitiMine ferais, C . B..P. 420. Tourn. inß. 5 8 ß . -
11 croît dans le Levant, dans la Pannonie, dans
l’Iftrie, en Italie , en Provence , en Gafcogne, &c.
Cet arbre efl plus bas que le chêne ordinaire,
mais fort gros 6c fouvent tortu ; fon bois eft fort
dur , fes feuilles font découpées à ondes allez profondes,
couvertes d’un duvet délicat ; fes fleurs
lont des chatons , 6c fes fruits des glands plus petits
que ceux du chêne commun. Ses feuilles, fruit,
écorce, font aftringens, réfolutifs, 6c ont les mêmes
vertus que ceux du chêne ordinaire ; mais le rouvre
ne fournit pas des galles dans tous les pays ; par
exemple , il n’en porte point en Angleterre ; la rai-
fon qu’en dit Ray eft excellente, c’eft que l’on ne
voit point dans les îles britanniques les inieéles qui
donnent naiffance aux noix de galle, & qu’il eft confiant
que c’efl: à leur piquure que ces fortes d’ex-
croiffances contre nature doivent leur origine.
Voici comme elles fe forment fuivant les obferva-
tions de Malpighi qui le premier a développé ce
méchanifme de végétation.
Certains petits infeâ es, 6c fur-tout certaines
mouches piquent les bourgeons , les feuilles 6c les
rejettons les plus tendres des rouvres ; ils en déchirent
les vaiffeaux les plus minces , 6c en font lbitir.
une humeur qui fe forme d’abord en une coque ou.
veflie, 6c puis fe remplit 6c fe durcit. En effet, le
coeur du bouton étant entamé par la tariere de l’in-
fe£le,le cours du fuc nourricier eft interrompu .La feve
détournée de fon chemin s’extravafe , s’enfle 6c(e dilate
à l’aide des bulles d’air qui entrent par les pores
de l’écorce , 6c qui roulent dans les vaifTeaux avec
la feve. Cette veflie fe feche en dehors , 6c l’air extérieur
la durcit quelque peu en forme de croûte ou
de noyau. Cette boule fe nourrit, végété 6c groflit
avec le tems , comme le refte de l’arbre. On conçoit
bien que le fuc coulant de la plaie que la mouche a
faite, il abonde ici avec plus d’abondance, parce que
la réffftance eft diminuée , enforte que les vaiffeaux
fe diftendent de plus en plus par l ’humeur qui s’y
répand.
Ces veflies font deftinées à être comme la matrice
qui doit recevoir les oeufs que pondent ces in-
feûe s, les conferver, les échauffer, les faire éclorre
& les nourrir. Toutes ces vérités fe juftifient à l’oeil
& à l’examen. Quand on ouvre les noix de galle mûres
6c récentes, on trouve à leur centre des ver-
miffeaux , ou plutôt des nymphes qui fe développent
infenfiblement 6c fe changent en mouches qui
font quelquefois d’un genre différent.
Peu de tems après qu’elles font formées, elles fé
cherchent une ifl'ue en rongeant la fubftance de la
noix de galle, & enfin elles font un trou rond à la fu-
perficie , par lequel elles fortent 6c s’envolent. Si
les noix de galle ne font pas percées , on y trouve
le vermiffeau ou la mouche : mais fi elles font ouvertes
, on les trouve vuides ou remplies d’autres
animaux qui font entrés par hafard dans les trous ,
6c fe font cachés dans ces petites tanières ; on y
trouve , par exemple , quelquefois une petite araignée
qui profite du domicile vuide : elle y tend des
filets proportionnés à la grandeur de la p lace, 6c y
attrape les pucerons fans expérience qui y vien-,
nent chercher aventure.
On diftingue deux fortes de noix de galle dans les
boutiques , favoir celles d’orient, que l’on appella
noix de .galle d'ALcp ou Alepines , & celle de notre
p a y s ..;.
Les noix de galle d’Alep font arrondies, de la
groffeur
groffeur d’une aveline ou d’une petite noix,anguîeu-
fes plus 011 m°ins raboteufes , pefantes , de couleur
blanchâtre , verdâtre ou noirâtre, compares &
réfineufes en-dedans, d’un goût aftringent 6c acerbe
: celles de notre pays font rondes , rougeâtres
ou rouffes, polies à leur fuperficie, légères , faciles
à rompre , d’une fubftance plus raréfiée , fpongieu-
fes 6c quelquefois creufes. Elles font moins bonnes
pour la teinture que celles du levant. Elles n’étoient
pas inconnues aux anciens. Les premières s’appel-
loient à/Mpcuhtç , &: les autres oVozm?, comme fi l’on
difoit noix de galle des ânes.
Nous venons de voir que les noix de galle different
par leur figure , par leur couleur 6c par leur
furface polie ou raboteufe. Il eft vraiffemblable que
ces différences dépendent principalement de la variété
des efpeces d’infe&es qui piquent les chênes.
Comme les infe&es d’un pays ne font pas tous pareils
à ceux d’un autre pays , quoique peu éloigné,
il arrive par cette raifon que fur la même efpece de
chêne , on voit croître en Italie des galles fermes ,
groffes & folides, pendant qu’en France, elles font
molles, petites, & , à proprement parler, des fauffes
galles.
Les meilleures galles nous viennent de Tripoli,
& fur-tout d’Alep & de Mozul fur le Tibre. On en
recueille dans le Levant une fi grande quantité,
qu’on en tire de Smyrne feule plus de dix mille quintaux
par an. La noix de galle des Turcs, qu’ils nomment
ba^gendge, eft rougeâtre , de la groffeur d’une
noifette , 6c eft employée dans leur écarlate : ce
fruit eft fort cher en Europe.
Les noix de galle fervent dans les arts. Je fai bien
que , comme elles font fort aftringentes , quelques
médecins les recommandent intérieurement dans
les diflènteries , les flux de ventre 6c les hémorrhagies
mais outre que ces maladies demandent des
remedes extrêmement variés , fuivant leur nature
6c leurs caufes , 6c que dans plufieurs cas les noix
de galle feroient plutôt nuifibles que falutaires , il
faut encore convenir que , dans les cas où elles feroient
utiles, on a des remedes beaucoup plus énergiques
à mettre en ufage.
M. Reneaume , membre de l’académie des Sciences
, a cru avoir découvert dans les noix de galle
un fécondfpécifique pour les fievres intermittentes;
mais la vertu fébrifuge qu’il leur attribuoit, n’a point
été confirmée par l’expérience , 6c la théorie de la
fievre de ce médecin, fur laquelle il fondoit fon re-
mede, étoit pitoyable.*
On emploie les noix de galle extérieurement pour
refferrer & répercuter, pour affermir 6c fortifier les
parties qui font trop Relâchées. On s’en fert dans
des injeÔions & dans des fomentations aftringentes
pour guérir la chûte de la matrice , & celle de l’anus
qui vient du relâchement du fphinûer. Elles entrent
auffi dans quelques emplâtres & onguens aftringens
, comme dans l’emplâtre pour les hernies, ap-
pellée communément emplâtre contre les ruptures, de
Char as.
Elles fervent ^encore en Chimie à éprouver la
nature des eaux minérales : elles donnent à la fo-
lution du vitriol la couleur noire, ou plutôt celle
de violette foncée ; favoir, lorfque le fel alkali des
noix de galle fe joint au fel acide vitriolique , & en
fait (eparer les parties métalliques ; alors ces particules
ne vont pas au fond de la liqueur , mais elles
s’unifient avec les particules fulphureufes des noix
de galle , lefquelles nagent dans le fluide 6c foutien-
nent les particules métalliques. Par cette raifon l’in-
fufion ou la décodion de ces noix fert aux Chi-
miftes 6c aux Phyficiens pour l’exameh des eaux
minérales ; car fi elles contiennent un fel vitriolé
que, ou un peu de fer ou de cuivre , cette infufion
Tome X I *
on cette décodion donne à ces eaux la couleur
noire , violete, pourpre ou tirant fur le pourpre,
félon qu’elles contiennent plus ou moins de fel mé>
tallique.
Cependant le principal ufage des, noix de galle
eft réfervé pour les arts, pour les teintures du grand
& fur-tout du petit teint, pour les corroyeurs 6c autres
ouvriers en cu ir , enfin pour faire de l’encre.
Les Teinturiers emploient les galles étrangères, dites
galles à l'épine pour teindre en noir, & les galles de
France, qu’ils nomment cajfenolles , pour former en
foie le noir écru. ( D . J. :
N o ix d e GALLE , ( Chimie & Matière médicale. )
noix de galle d’Alep, 6c noix de galle de notre pays*,
Ces deux efpeces de noix de galle font fort analogues
quant à leur compofition intérieure ou chimique
; mais les premières font meilleures , tant pour
les ufages chimiques que pour ceux de la médecine
6c ceux des arts.
La noix de galle poffede énimmement le goût acerbe,
auftere , ftiptique, propre aux écorces des bois
6c à celles de quelques fruits, par exemple de la
grenade. On a coutume d’attribuer cette faveur à
un fel vitriolique ou alumineux , 6c à un principe
terreux très furabondant 6c prefque nud. La propriété
que poffede la noix de galle de précipiter les
tels métalliques , principalement obfervée' dans fes
effets fur le vitriol de Mars , indique affez bien ce
principe terreux; mais 6c la démonftration chimique
de la nature de la noix de galle 6c la théorie des phénomènes
qu’elle préfente, lorfqu’on l’applique aux
differentes diffolutions de fer, manquent également
à la Chimie jufqû’à préfent. L’obfervation nue dès-
faits a feulement appris que la poudre ou la décoc-;
tion filtrée de noix de galle étant mêlée en petite
quantité à une liqueur qui contient la moindre parcelle
de fer, dans quelque état que ce foit, y mani-
fefte ce métal fous la forme d’un précipité plus ou
moins divifé , plus ou moins rare , félon qu’il efl:
plus ou moins abondant, 6c de différentes coiffeurs
proportionnelles à fes différens degrés de tenuité &;
d’abondance, dans l’ordre fuivant : le précipité à
peine lenfible eft d’une couleur de rofe tendre , il
devient par nuances paillé , vineux, gros-rouge ,
viole t, bleu foncé , 6c enfin noir, c’eft-à-dire bleu
trçs-foncé. Voye^ Noir. Cette derniere nuance eft
celle dé l’encre , qui n’eft autre chofe qu’une forte
diffolution de vitriol martial précipité par la noix
de galle , 6c dans laquelle le précipité eft conftam-
ment fufpendu par une matière gommeufe dont cette
liqueur eft en même tems chargée. Voyei Encre &
Vitriol.
Quant aux vertus médicamenteufes de la noix de
galle,nous avons à en dire exaélement la même chofe
que des noix de cyprès. Voyt{ C yprès, mat. méd.
M. Reneaume, médecin de Paris, a donné fur leurs
vertus fébrifuges un mémoire à l’académie royale
des Sciences, an. 1711. ( b )
Noix d’Inde , nux Indien, (Médecine.') eft le
fruit d’un arbre qui croît dans les Indes , & qu’oa
appelle cocotier. Voyeç Cacao & Chocolat.
Noix de Madagascar , (Botan. exot.') noix
groffe comme une noix de galle , ronde , légère , de
couleur de châtaigne , ayant l’odeur ôc le goût du
girofle , mais beaucoup plus foible , 6c contenant
quelques pépins ou femences : on nous l’apporte de
Madagafcar ; c’eft le fruit d’un arbre appeilé dans,
le pays ravendfara. ( D . J. )
N o ix métel, (Médecine.) voye^ Pomme épineuse.
- N o ix muscade , ( Botan. exot. ) voye£ Mus*
CADE.
N o ix vomique , (Botan. exot.) amande ou fruit
de différente groffeur, que nous recevons des ludes
B b /