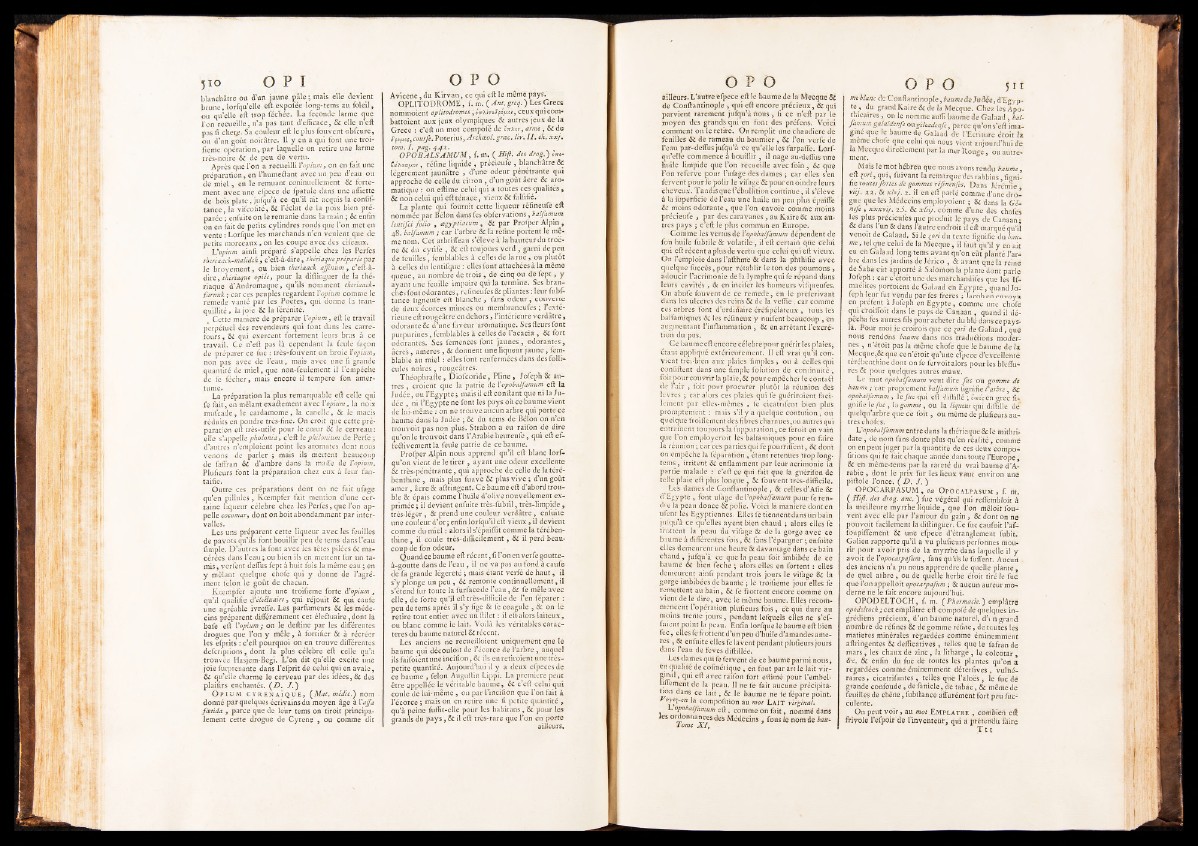
blanchâtre ou d’un jaune pâle ; mais elle devient
brune, lorfqu’elle eftexpoiée long-tems au foleil,
pu qu’elle eft trop féchée. La fécondé larme que
l’on recueille, n’ a pas tant d’efficace, fit elle n’eft
pas fi cher„e. Sa couleur eft le plus fouvent obfcure,
ou d’un goût noirâtre. Il y en a qui font une troi-
fieme opération, par laquelle on retire une larme
très-noire fit de peu de vertu.
Après que l’on a recueilli Yopium, on en fait une
préparation, en l’humcâant avec un peu d eau ou
de mie l, en le remuant coninuellement fit fortement
avec une efpece de fpatule dans une affiette
de bois plate, jufqu’à ce qu’il ait acquis la confif-
tance la vifcofité, fit l’éclat de la poix bien préparée
; enfuite on le remanie dans la main ; fit enfin
on en fait de petits cylindres ronds que l’on met en
vente : Lorfque les marchands n’en veulent que de
petits morceaux, on les coupe avec des cifeaux.
L'opium ainfi préparé s’appelle chez les Perfes
theriaack-malideh , c’eft-à-dire, thériaque préparée par
le broyement, ou bien theriaack affinum, c’eft-à-
dire, thériaque opiée, pour la diftinguer de la thériaque
d’Andromaque, qu’ils nomment theriaack-
farnuk; car ces peuples regardent Y opium comme le
remede vanté par les Poètes, qui donne la tranquillité
, la joie fit la férénité.
Cette maniéré de préparer Y opium , eft le travail
perpétuel des revendeurs qui font dans les carrefours
, fit qui exercent fortement leurs bras à ce
travail. Ce n’eft pas là cependant la feule façon
de préparer ce fuc : très-fouvent on broie Y opium,
non pas avec de l’eau, mais avec une fi grande
quantité de miel, que non-feulement il l ’empêche
de fe fécher, mais encore il tempere fon amertume.
La préparation la plus remarquable eft celle qui
fe fait, en mêlant exactement avec Y opium, la noix
mufcade, le cardamome, la canelle, & le macis
réduits en poudre très-fine. On croit que cette préparation
eft très-utile pour le coeur & le cerveau:
elle s’appelle pholonia, c’eft le philonium de Perfe ;
d’autres n’emploient point les aromates dont nous
venons de parler ; mais ils mettent beaucoup
de faffran 8t d’ambre dans la maffe de Yopium.
Plufieurs font la préparation chez eux à leur fan-
taifie.
Outre ces préparations dont on ne fait ufage
qu’en pillules, Koempfer fait mention d’une certaine
liqueur célébré chez les Perfes, que l’on appelle
cocomar, dont on boit abondamment par intervalles.
Les uns préparent cette liqueur avec les feuilles
de pavots qu’ils fontbouillir'peu de tems dans l’eau
fimple. D ’autres la font avec les têtes pilées fit macérées
dans l’eau ; ou bien ils en mettent fur un tamis
, verfent defliis fept à huit fois la même eau ; en
y mêlant quelque chofe qui y donne de l’agrément
félon, le goût de chacun.
Koempfer ajoute une troifieme forte d'opium ,
qu’il qualifie Ôl éleSuaire, qui réjouit fit qui caufe
line agréable ivreffe. Les parfumeurs fit les médecins
préparent différemment cet éle&uaire, dont la
bafe eft Yopium; on le deftine par les différentes
drogues que l’on y mêle, à fortifier & à récréer
les efprits : c’eft pourquoi on en trouve différentes
defcriptions, dont la plus célébré eft celle qu’a
trouvée Hasjem-Begi. L’on dit qu’elle excite une
joie furprenante dans l’efprit de celui qui en avale,
fit qu’elle charme le cerveau par des idées, fit des
plaifirs enchantés. (D . J. )
O p iu m c y r e n a ï q u e , {Mat. médicé) nom
donné par quelques écrivains du moyen âge à Yajfa
foetida , parce que de leur tems on tiroit principalement
cette drogue de Cyrene , ou comme dit
Avicene, du Kirvan, ce qui eft le même pays.'
OPLITODROME, f. m. ( Ant. greq. ) Les Grecs
nommoient oplitodromes j o7rxhoS'po/xoi, ceux qui corn*
battoient aux jeux olympiques & autres jeux de la
Grece : c’eft un mot compofé de ottAov, arme , 8t de
S-fopoç, courfe. Poterius, Archoeol. groec. liv. I I . ch. x x j.
tom. I. pag. 442..
OPOBALSAMUM, f. m. ( Hifi. des drog.) oW
CÀMapov, réfine liquide , précieufe , blanchâtre fit
légèrement jaunâtre , d’une odeur pénétrante qui
approche de celle du citron , d’un goût âere St aromatique
: on eftime celui qui a toutes ces qualités ,
& non celui qui eft tenace, vieux & falfifié.
La plante qui fournit cette liqueur réfineufé eft
nommée par Bélon dans fes obfervations, balfamum
lentifci folio , agyptiacum , fit par Profper A lpin,
48. balfamum ; car l’arbre St la réfine portent le même
nom. Cet arbriffeaiï s’élève à la hauteur du troène
St du cy tiîe , St eft toujours verd , garni de peu
de feuilles, femblables à celles de la rue, ou plutôt
à celles du lentifque : elles font attachées à la même
queue, au nombre de trois , de cinq ou de fep t , y
ayant une feuille impaire qui la termine. Ses branches
font odorantes, refineufes fit pliantes : leur fubf-
tance ligneufc eft blanche , fans odeur, couverte
de deux écorces minces ou membraneufes ; l’extérieure
eft rougeâtre en dehors , l’intérieure verdâtre ,
odorante & d’une faveur aromatique. Sesfleursfont
purpurines, femblables à celles de l’acacia , fit fort
odorantes. Ses femences font jaunes, odorantes,
âcre's, ameres , & donnent une liqueur jaune, fem-
blab'lé au miel : elles font renfermées dans des follicules
noires, rougeâtres. '
Théophrafte, Diofcoride, Pline, Jofeph & autres
, croient que la patrie de Yopobalfamum eft la
Judée, ou l’Egypte ; mais il eft confiant que ni la Judée
, ni l’Egypte ne font les pays oû ce baume vient
de lui-même : on ne trouve aucun arbre qui porte ce
baume dans la Judée ; fit du tems de Bélon on n’en
trouvoit pas non plus. Strabon a eu raifon de dire
qu’on le trouvoit dans l’Arabie heureufe, qui eft e f fectivement
la feule patrie de ce baume.
Profper Alpin nous apprend qu’il eft blanc lorf-
qu’on vient de le tirer , ayant une odeur excellente
& très-pénétrante, qui'approche de celle de la térébenthine
, mais plus fuave fit plus vive ; d’un goût
amer, âcre & aftringent. Ce baume eft d’abord trouble
& épais comme l’huile d’olive nouvellement exprimée
; il devient enfuite très-fubtil, très-limpide ,
très-léger, & prend une couleur verdâtre, enfuite
une couleur d’or ; enfin lorfqu’il eft vieux , il devient
comme du miel : alors il s’épaiffit comme la térébenthine
, il coule très-difficilement, St il perd beaucoup
de fon odeur.
Quand ce baume eft récent, fi l’on en verfe goutte-
à-goutte dans de l’ea u , il ne va pas au fond à caufe
de fa grande légèreté ; mais étant verfé de haut, il
s’y plonge un peu , fie remonte continuellement, il
s’étend fur toute la furfacede l’eau, fie fe mêle avec
elle, de forte qu’il eft très-difficile de l’en féparer :
peu de tems après il s’y fige & fe coagule , ôt on le
retire tout entier avec un ftilet : il eft alors laiteux,
ou blanc comme le lait. Voilà les véritables caractères
du baume naturel fit recent.
Les anciens ne recueilloient uniquement que le
baume qui découloit de l’écorce de l’arbre , auquel
ils faifoient une incifion, 8c ils en retiroient une très-
petite quantité. Aujourd’hui il y a deux efpeces de
ce baume , félon Auguftin Lippi. La première peut
être appellée le véritable baume, fie c’eft celui qui
coule de lui-même , ou par l’incifion que l’on fait à
l’écorce ; mais on en retire une fi petite quantité ,
qu’à peine fuffit-elle poiir les habitans, 6c pour les
grands du pa ys , fie il eft très-rare que l’on en porte
ailleurs.
a i l l e u r s . L ’ a u t r e e f p e c e e f t le b a u m e d e l a M e c q u e S t
d e C o n f i a n t i n o p l e , q u i e f t e n c o r e p r é c i e u x , fie q u i
p a r v i e n t r a r e m e n t j u f q u ’à n o u s -, f i c e n ’ e f t p a r le
m o y e n d e s g r a n d s q u i e n f o n t d e s p r é f e n s . V o i c i
c o m m e n t o n l e r e t i r e . O n r e m p l i t U n e C h a u d i è r e d e
f é u t l ï e s fit d è r a m e a u d u b a l im i e r , fie l ’ o n v e r f e d e
l ’e a u p a r - d e f f u s ju f q u ’ à t e q u ’ e l l e l e s fü r p a ïT e . L o r f -
q u ’e ï l é c o m m e n c e à b o u i l l i r , i l n a g e a u - d e f ï u s u n e
h u i l e l im p id e q u e l ’ o n r e c u e i l l e a v e c f o i n , fie q u e
l ’o n r e f e r v e p o u r l ’ u f a g e d e s d a m e s j c a r e l l e s s ’e n
f e r v e n t p o u r f e p o l i r l e v i f a g è - f i e p o u r e 'n o i n d r e l e u r s
c h e v e u x . T a n d i s q u e l ’é b u l l i t i o n c o n t i n u é -, i l s ’ é l è v e
à l a f ù p è r f i c i e d e l ’ e a u u n e h u i l e u n p e u p lu s é p u i f t e
fie m o in s o d o r a n t e , q u e l ’o n e n v o i e c o m m e m o in s
p r é c i e u f e , p a r d e s c a r a v a n e s , a u K à i r ë 'ô c a ü x a u t
r e s p a y s ; c ’ é f t l e p lu s c o m m u n e n E u r o p e .
Gottime les vertus de Y opobalfamum dépendent de
fon huilé fubtile & volatile', il eft certain qUe celui
qui eft récent a phts de Vertu que célüiqm eft Vieux-,
On l’emploie dans l’afthme & dans la phthifie avec
quelque fuccès, pour rétablir le ton des poumons ,
adoucir l’acrimonie, de la lymphe qui fe répand d'ans
leurs cavités , & en incifer les humeurs vifqueufes.
On abufe fouvent de ce rerriédë, en le preferivan't i
dans les ülceres des reins fit de la véffie, car Comme
ces arbres font d’ordinaire éréfipélâteux , toits léS
balfamique's St les réfirieux ÿ miifent beaucoup , en
augmentant l’inflammation , fie en arrêtant l’excrétion
du pUS.
Gè baumeeft encore célébré pour guérir les plaies;
étant appliqué extérieurement. Il eu Vrai qu’il convient
très-bien aux plaies Amples j où à celles qui
confident dans une fimple folution- de continuité -,
fbit pour couvrir la plaie,& pour empêcher le cohtaét
de l’air . foit pour procurer plutôt là réunion deS
îevres ; câr à fors ces piaie's qüi fe gUériroient facilement
par èlleS-mêmes , fe cicàtrifent bien plus
promptement : mais s’il y a quelque contiifion, ou
quelque froiflentent des fibres charnues,ou autres qui
entraînent toujours la fuppuration -, ce fefoit eh vain
que l’on employéroit les ballamiques pour en foire
la rélinioh ; car ces parties qui fe pourriffeni, fit dont
on empêché la féparation , étant retenues trop long-
tems , irritent fie enflamment par leüt acrimonie la
partie malade : c’eft ce qui fait que la guéfifori de
telle plaie eft plus longue , fouveht très-difficile.
LeS darties dé Gohftantînople , fit celles d’Afie fie
d'Egypte , font ufoge de Yopobalfamum pour fe tendre
la peau douce 6c polie. Voici là maniéré dont en
iifent les Egyptiennes. Elles fe tiennent dans lin bain
juiqu’à ce qu’elles ayënt bien chaud ; alors elles fe
trottent là péàü du vifage & dé la gorge avec ce
baume à différentes fois, & fans l’épargner ; enfuite
elles demeurent une heure fit davantage dans Ce bâin
chaud , jüfqli'à ce que la peau foit imbibée de ce
baume fit bien feche ; alors elles en fortent : elles
demeurent ainfi pendant trois jours le vifage fit la
gorge imbibées de bauffie ; lé troifieme jour elles fe
remettent au bain, fit fé Frottent encore comme on
Vient dè le dire, avec lë même baume. Elles recommencent
l’opération plufieurs fois , ch qüi dure au
moins trente jours, pendant lefquels elles rie s’ef-
fuient point la peau. Enfin lorfque le baume eft bien
fe c , elles fe frottent d’un pêli d’huile d’âmârtdês artte-
res , & fehfuite elles fe lavent pendant plufieurs jours
dans 1 eau de FeVes diftilléèi
Les dàrhes qiii fe fervent dë Cè baume parmi notis$
eu qualité de cofmétique , en font par art lè lait vir-
ginal, qui eft avec raifon fort eftimé pour l’embel-
liffement de la peau. Il fie le fait aücune précipitâ-
Uon dans ce lait, fit le baume he le fépàre poilit.
r d ÿ t ç - e h la compofitlOn âu m o t L a It v i r g in a l .
1 0£ 0i>a? fAmHfn r comme oh fait, riornttié dàriS
les ordonnances des Médecins, fous le nom de b a u -
Tome JlI , -
me blaïtc de Con flan fin op le, baume de Jlidée, d’Egyp-
te , du grand Kaire fit de la Mecque. Chez les Apothicaires
, on le nomme au'ffi baume de Gàlaad -, bal-
Jamiun galaldenfe on gileadenfe, parce qu’on s’eft imaginé
que le baume de Galâad de l’Ecriture étoit la
meme chofe qtie celui qui nous Vient aujourd’hui de
la Mecque directement par la mer Rouge ou autrement.
Mais lé mot hébreu que nous avons rendit baume,
eft [ori, qui* fuivânt la remarque dés rabbins,figni-
fie iQutes foYus de gommes réfiniafts. Dans Jérémie
viij. 3. x . & x'ivy. 2. il en eft parié comme d’une drogue
que lés Médecins employoient ; fit daiis la Gé-
nefe , xxxvij. xS. fit xliij. comme d’une des chofes
les plus précieufes que produit le pays de Canaan;
fit dans l’iin & dans l’autreendrOit il eft marqué qu’il
venoit de Galaad. Si le {ori du texte lignifie du bau-
me > tél qile Celui de la Mecque, il fallt qu’il y en ait
eu eh Galaad long-tems avant qu’on eût planté l’arbre
dans les jardins de Jérico , & avant tjuè là reine
de Saba eût apporté à Salomon la plante dont parle
Jofeph : car c’étoit une des matchandifes que les If-
maélites portoient de Galaad en Egypte, quand Jofeph
leur fut Vendu par fes Freres ; Jacoben envoya
en préfent à Jofeph en Egypte, comme une chofe
qhi Croiïîoit dans le pays de Canaan , quand il dépêcha
fes autres fils pour acheter du blé daiis ce pays'-
lâ. Pour moi je croirois que ce [ori de Galàad, qué
nous rendons baume dans itibs tràduéliorts moder-
hës -, n’étoit pas la même chofe que le baume de la
Mecque-,St que ce n’étoit qu’Urie efpece d’exeellehté
térébenthine dont onfe fervoit alors pour les blëffu-
res fit pour quelques autres maux.
Le mot opobalfamum veut dire fuc oli gomme de
bàutfi’e ■; ’car proprement balfamum lignifie l'arbre. fie
opobalfamum, le fuc qui eft ch ft illé ; oVoçeh grec fii
ghifie le fuc , la gomrrte , OU la liqueur qui diftille d’è*
qUelqu’arbre que ce fo i t , ou même de plufieurs autres
chofes.
L ’1opobalfamum entre dans la thériaque fit le mithri-
date i de nom fans doute plus qu’en réalité, coinmô
on en petit juger par la quantité de ces deüx cöffipo-
fitions qui fe fait chaque ahnée dans toute l’Eufope ,
fit en rnême-terns par là rareté dti vrai baume d ’Arabie
1, dont le prix fur les lieux vaut environ une
piftolë Poncé. ( D . J. )
OPOCARPASUM , ou OlPÖCALfASUM , f. m.
( Hiß. des drog. àhc. ) fuc végétal qui reffembloit à
la meilleure myrrhe liquide , que l’on mëiôit fbu-
véttt àvéc elle par l’artibuf du gain , fit dont on ne
pou voit facilement là diftinguer. C e fuc caufoit l’ai—
fbtipiffemëht fit une èfpece d’étranglement fubit.
Galien rapporte qu’il a vu plufieurs perfohnes mourir
polit avoir pris de la myrrhe dans laquelle il y
avoit de YopOcarpafiim , fans qu’ils le fuffertt. Aucurf .
des anciens n’à pu nous apprendre de quelle plante ,
de qiiel atbre , ou de quelle herbe étoit tiré le fuc
que l’on appelloit opocarpafum ; fit âiicun auteur moderne
hë le fait encore aujourd’hui.
OPODELTOCH, f. m. ( Pharmacie.) emptâtrë
opôddtoch; cet emplâtre eft compofé dé qüelqùefc in-
grédieris précieux, d’un bâuffle haturel, d’i n grand
nombre de réfines fit de gomme-réfine, de toutes lesi
matiefes minérales regardées Comme éminemment
âftririgetltes fit deffiCàtiveS * téllés que le fafran de
mars , les chaux de rint , Ia iitharge, le ebicotar,
trc. fit enfin dii fuc dé toutes les plantes qii’oh a
regardées comme éminemment détérfives , vulhé-
raires, cicatrifantes , telles qliè PàloèS 5 le fuc de
gtahde confoude , dë fonicle, de tabac, fit même de
feuilles de chêrié, fubftahee affurément fort peii file-
culente.
On peut v o ir , au mot Emplâtre , combien efl
frivole l’efpbir de l’invehteur, qui a prétendu faire
J t t