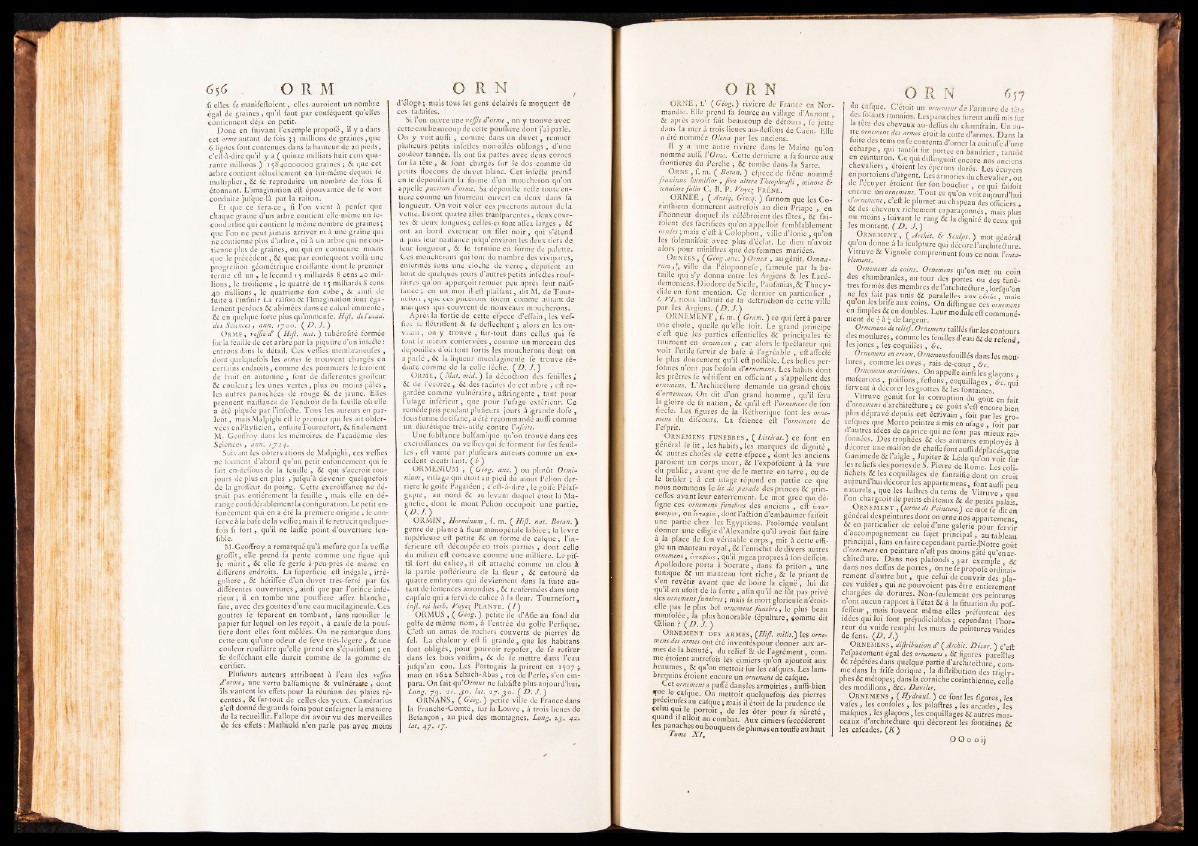
f i elles Te manifeftôîent, elles auroient un nombre '
■ égal de graines , qu’il faut par conféquent qu’elles
contiennent déjà en petit.
Donc en fuivant l’exemple propofé, il y a dàns
cet orme autant de fois 33 millions de graines , que
6 lignes font contenues dans la hauteur de zo pieds,
c ’eft-à-dire qu’il y a ( quinze milliars huit cens quarante
millions ) 15840000000 graines ; & que cet
arbre contient actuellement en lui-même dequoi le
multiplier., & fe reproduire un nombre de fois fi
étonnant. L’imagination eft épouvantée de fe voir
conduite jufque-là par la radon.
Et que ce fera-ce , li l’on vient à penfer que
chaque graine d’un arbre contient elle-même un le-
condarbre qui contient le même nombre de graines;
que l’on ne peut jamais arriver ni à une graine qui
ne contienne plus d’arbre, ni à un arbre qui ne contienne
plus, de graines, ou qui en contienne moins
que le précédent, & que par conféquent voilà une
progreflion géométrique croilfante dont le premier
terme eft un , le fécond 15 milliards 8 cens 40 millions
, le troifieme , le quarré de 15 milliards 8 cens
40 millions, le quatrième fon cube, & ainfi de
fuite à l’infini? La raifon & l ’imagination font également
perdues & abîmées dans ce calcul immenfe,
& en quelque forte plus qu’immenfe. Hiß, del'acad.
de s Sciences, ann. lyoo. ( Z ) . / . )
Orm e , v e ffîe d' (Hiß . nat. ) tubérofité formée
fur la feuille de cet arbre par la piquîire d’un infeûe :
entrons dans le détail. Ces velfies membraneufes ,
dont quelquefois les ormes fe trouvent chargés en j
certains endroits, comme des pommiers leleroient
de fruit en automne, font de différentes groffeur
& couleur ; les unes vertes, plus ou moins pâles,
les autres panachées de rouge & de jaune. Elles
prennent naiffance de l’endroit de la feuille où elle
a été piquée par l’infe&e. Tous les auteurs en parlent.,
mais Malpighi eft le premier qui les ait obfer-
vées enPhylicien, enfuiteTournefort, & finalement
M. Geoffroy dans les mémoires de l’académie des
Sciences, ann. i j z f .
Suivant les oblervations de Malpighi, ces veflîes
ne forment d’abord qu’un petit enfoncement qui fe
fait en-deffous de la feuille , & qui s’accroît toujours
de plus en plus , jufqu’à devenir quelquefois
de la groffeur du poing. Cette excroiffance ne détruit
pas entièrement la feuille , mais elle en dérange
confidérablement la configuration. Le petit enfoncement
qui en a été la première origine, fe con-
ferve à la baie de la veffîe ; mais il fe rétrécit quelquefois
fi fo r t , qu’il ne laiffe point d’ouverture fen-
fible.
M.Geoffroy a remarqué qu’à mefure que la veflie
groflit, elle prend fa pente comme une figue qui
fe mûrit, & elle fe gerfe à-peu-près de même en
différens endroits. La fuperficie eft inégale , irrégulière
, & hériffée d’un duvet très-ferré par fes
différentes ouvertures , ainfi que par l’orifice inférieur
; il en tombe une poufliere affez blanche,
fine, avec des gouttes d’une eau mucilagineufe. Ces
gouttes fe féparent en tombant, fans mouiller le
papier fur lequel on les reçoit, à caufe de la pouf-
ïiere dont elles font mêlées. On ne remarque dans
cette eau qu’une odeur de feve très-légere , & une
couleur rouffâtre qu’elle prend en s’épaififfant ; en
fe dcfféchant elle durcit comme de la gomme de
cerifier.
Plufieurs auteurs attribuent à l’eau des yeßies
d'orme t une vertu balfamique & vulnéraire , dont
ils vantent les effets pour la réunion des plaies récentes
, & fur-tout de celles des yeux. Camérarius
s’eft donné de grands foins pour enfeigner la maniéré
de la recueillir. Fallope dit avoir vu des merveilles
de fes effets ; Mathiold n’en parle pas avec moins
d’éloge ; mais tous les gens éclairés fe moquent de
ces fadaifes.
Si l’on ouvre une v e ffîe d'orme, on y trouve avec
cette eau beaucoup de cette poufliere dont j’ai parlé.
On y voit aufli , comme dans un duvet, remuer
plufieurs petits infe&es non-aîlés oblongs , d’une
couleur tannée. Ils ont fix pattes avec deux cornes
fur la tê te , & font chargés fur le dos comme de
petits floccons de duvet blanc. Cet infette prend
en fe dépouillant la forme d’un moucheron qu’on
appelle puceron d'orme. Sa dépouille refte toute entière
comme un fourreau ouvert en deux dans fa
longueur. On voit voler ces pucerons autour de la
veflie. Ils ont quatre aîles tranfparentes, deux courtes
& deux longues; celles-ci font affez larges , S c
ont au bord extérieur un filet n o ir, qui s’étend
depuis leur naiffance jufqu’environ les deux tiers de
leur longueur, & le termine en forme de palette.
Ces moucherons qui lont du nombre des vivipares,
enfermés lous une cloche de ve r re , dépofent au
bout de quelques jours d’autres petits infeftes rouf-
fâtres qu’on apperçoit remuer peu après leur naiffance
; en un mot il eft plaifant, dit M. de Tour-
nefort, que ces pucerons foient comme autant de
marques qui couvrent de nouveaux njoucherons.
Après la fortie de cette e’fpece d’effain, les vef-
fies le flétriffent & fe deffechent ; alors en les ouvrant
, on y trouve , fur-tout dans celles qui fe
font le mieux conlervées, comme un morceau dés
dépouillés d’où lont fortis les moucherons dont on
a parlé , S c la liqueur mucilagineufe fe trouve ré-,
duite comme de la colle féche. ( D . J. )
Orme, ( Mat.méd. ) la décottion des feuilles i
S c de l’écorce, S c des racines de cet arbre , eft regardée
comme vulnéraire, aftringente , tant pour
l’ufage inférieur, que pour l’ufage extérieur. Ce
remède pris pendant plufieurs jours à jgrande dofe ,
fous forme de tifane, a été recommandé aufli comme
un diurétique très-utile contre Vafcite.
Une fubftance balfamique qu’on trouve dans ces
excroiffances ou veflîes qui fe forment fur fes feuilles
, eft vanté par plufieurs auteurs comme un e*r
ceilent cicatrifant. ( b )
ORMENIUM , ( Géog. anc. ) ou plutôt Ormi-
nium, village qui étoit au pied du mont Pélion derrière
le golfe Pagaféen ; c’eft-à-dire , le golfe Pélaf-
gique, au nord S c au levant duquel étoit la Ma-
gnefie, dont le mont Pélion occupoit une partie. raD ORMIN, Horminum, f. m. ( Hifl. nat. Botan. )
genre de plante à fleur monopétale labiée ; la levre
liipérieure eft petite S c en forme de cafque ; l’inférieure
eft découpée en trois parties , dont celle
du milieu eft concave comme une milliere. Le pif-
til fort du calice, il eft attaché comme un clou à
la partie poftérieure de la fleur , S c entouré de
quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant
de femences arrondies , S c renfermées dans une
capfule qui a fervi de calice à la fleur. Tournefort,
inji. rei herb. Voyc[ Plante. (/ )
ORMUS , ( Géog. ) petite île d’Afie au fond du
golfe de même nom, à l’entrée du golfe Perfique.
C ’eft un amas de rochers couverts de pierres de
fel. La chaleur y eft fi grande, que les habitans
font obligés, pour pouvoir repofer, de fe retirer
dans les bois voifins, S c de fe mettre dans l’eau
jufqu’au cou. Les Portugais la prirent en 1507 y
mais en 1612 Schach-Abas , roi de Perfe, s’en empara.
On fait ayCOrmus ne fubfifte plus aujourd’hui.
Long, 79 . z i . j o . lat. zy. 30. ( D . J. )
ORNANS, ( Géog, ) petite ville de France dans
la Franche-Comté, fur la Louve , à trois lieues de
Befançon, au pied des montagnes. Long, 23. 4Z.
lat. 47. /7.
ORNE, l’ (Géog.') rivicre de France en Normandie.
Elle prend fa fource au village d’Aunont
& après avoir fait beaucoup de détours, fe jette
dans la mer à trois lieues au-deffous de Caën. Elle
a été nommée Olena par les anciens.
Il y a une autre riviere dans le Maine qu’on
nomme au{RVOrne. Cette dernierc a fa fource aux
frontières du Perche ; Sc tombe dans la Sarte.
O rne , f. m. ( Botan. ) efpece de frêne nommé
fraxinUs humilior , Jive altéra Theophrafti, minore &
tenuiore folio C. B. P. Voyt^ Frêne.
ORNÉE , ( Antiq. Grecq. ) furnom que les C o rinthiens
donnèrent autrefois au dieu Priape , en
l’honneur duquel ils célébraient des fêtes, Sc fai-
foient des facrifîces qu’on appelloit femblablement
omets ; mais c’eft à Colophon, ville d’Ionie, qu’on
les folemnifoit avec plus d’éclat. Le dieu n’avoit
alors pour miniftres que des femmes mariées.
ORNEES, (Géog .anc. ) Omeoe , augénit. Ornoea-
rum y J, ville du Péloponnefe, fameufe par la bataille
qui s’y donna entre les Argiens & les Lacédémoniens.
Diodore de Sicile, Paufanias,& T hucydide
en font mention. Ce dernier en particulier ,
l. VI. nous inftruit de la deftruélion de cette ville
par les Argiens. (D . ƒ.)
ORNEMENT, f. m. ( Gram. ) ce qui fert à parer
une chofe, quelle qu’elle foit. Le grand principe
c’eft que les parties effentielles Sc principales fe
tournent en ornemens. ; car alors le fpeâateur qui
voit l’utile fervir de bafe à l’agréable , eft affetlé
le plus doucement qu’il eft poflible. Les belles per-’
fohnes n’ont pas befoin d ornemens. Les habits dont
les pretres fe vêtiffent en officiant, s’appellent des
ornemens. L’Architecture demande un grand choix
dornemens. On dit d’un grand homme , qu’il fera
la gloire de fa nation, Sc qu’il eft Mornement de fon
fiecle. Les figures de la Réthorique font les orne- '
mens du difeours. La fcience eft l’ornement de
l ’efprit.
'O rnemens fun èbres, (Littéral.') ce font en
general le l i t , les habits, les marques de dignité ,
& autres chofes de cette efpece, dont les anciens
paroient un corps mort, Sc l’expofoient à la vue
du public, avant que de le mettre en terre, ou de
le brûler ; à cet ufage répond en partie ce que
nous nommons le lit de parade des princes & prin-
ceffes avant leur enterrement. Le mot grec qui dé-
figne ces ornemens funèbres des anciens , eft inct-
<pta.aft.ov, ou ïvrctfiovy dont l’aftion d’embaumer faifoit
une partie chez les Egyptiens. Ptolomée voulant
donner une effigie d’Alexandre qu’il avoir fait faire
à la place de fon véritable corps , mit à cette effigie
un manteau royal, Sc l’enrichit de divers autres
ornemens, m-ap/o/ç, qu’il jugea propres à fon deffein.
Apollodore porta à Socrate, dans fa prifon , une
tunique Sc un manteau fort riche, & le priant de
s’en revêtir avant que de boire la c igu ë , lui dit
qu’il en ufoit de la forte, afin qu’il ne fut pas privé
des ornemens funèbres ; mais fa mortglorieufen’étoit-
elle pas le plus bel ornement funebre, le plus beau
maufolee, la plus honorable fépulture, comme dit
CElian ? (D . J. )
Ornement des a rmes, (Hijl. milit.) les ornemens
des armes ont été inventés pour donner aux armes
de la beauté, du relief & de l’agrément, comme
etoient autrefois le"s cimiers qu’on ajoutoit aux
heaumes Sc qu’on mettoit fur les cafques. Les lambrequins
etoient encore un ornement de cafque.
Ç-fX ornement a paffe dansles armoiries „aufebien
que le cafque. On mettoit quelquefois des pierres
predieufes au cafque ; mais il étoit de la prudence de
ce tu qui le portoit , de les ôter pour fa sûreté, I
quan il alloit au combat. Aux cimiers fuccéderent
les panachcs ou bouquets de plumes en touffe ira haut
Tome X I ,
du tfàfque, C ’étoit un ornetntnt de farniuré de tête
des fôldats romains. Lespanaches * suffi mis fut
la tête des chevaux au-deffus du chamfrain. Un autre
ornement des armes étoit la cotte d’armes. Dans la
lutte des tems onfe contenta d’orner la cuiraffe d’une
echarpe, qui tantôt fut portée en baudrier, tantôt
en ceinturon. Ce qui diftinguoit encore nos anciens
chevaliers, etoient les éperons dorés. Les écuyers
en portoiens d argent. Les armories du chevalier, ou
de 1 écuyer etoient fur fon bouclier , ce qui faifoit
encore un ornement. Tout ce qu’on voit aujourd’hui
d ornementi c’eft le plumet au chapeau des officiers .
& des Chevaux richement caparaçonnés, mais plus
ou moins , fuivant le rang & la dignité de ceux oui
les montent. ( D . J.') n
Ornement, (Arshit. & Sculpt.) mot général
qu on donne à la fculpture qui dédore rarchiteûure.
Vitrnve & Vignole comprennent fous ce nom l'entas-
blement.
Ornement de coins, Ornemens qu’on met au coitl
des chambranles, au-tour des portes ou des fenê-
très formés des membres de l’architeaure, lorfqu’on
"Se i6 lt pas unis & Phalènes aux côtés, mais
qu on les brtfe aux coins. On diftingue ces ornement
en fimples & en doubles. Leur module eft communément
de j à i de largeur.
Ornemens derelief, Ornemens taillés furies contours
desmoulures, comme les feuilles d’eau & de refend,
les joncs , les coquilles, &c.
Ornemens en creux. Ornemens(omüés dans les moii*
litres ,hgbmme les oves , rais-de-coeur &c.
Ornemens maritimes. On appelle ainfi les "glâçbnS l
mafearons , poiffons, feftons, coquillages! &c. oui
fervent à décorer les grottes St les fontaines. ’
Vitruve gémit fur la corruption du goût en fait
cl ornemens d’architeaure ; ce goût s’ eft encore bien
plus dépravé depuis cet écrivain , foit par les gro-
tefques que Mono peintre a mis en ufage , foit par
d’autres idées de caprice qui ne font pas mieux rai-
foanées. Des trophées & des. armures employés à
décorer une maifon de chaffe font aulfidéplacés,que
panimede & l’aigle , Jupiter & Léda qu’on voit fur
les reliefs desportesde S. Pierre de Rome. Les coli-
fichets & les coquillages de fantaifie dont on croit
aujourd hui décorer les appartemens, font auffi peu
naturels, que les luftres.du tems de Vitruve, que
l’on, chargeoit de petits châteaux & de petits priais.
_ Ornement , (terme de Peinture.) c e mot fe dit en
général des peinturesdont on orne hos appartemens
Sc en particulier de celui d’une galerie pour fervir
d’accompagnement au fujet principal, au tableau
principal, fans en faire cependant partie,jNotre goût
! d’ornemens en peinture n’eft pas moins gâté qu’enar-
chiteélute. Dans nos plafonds , .par exemple Oc
dans nos deflus.de portes, 6nnefepropofeordinairement
d’autre but , que celui de couvrir des places
vuides, qui ne pouvoient pas être entièrement
chargées de dorures. Non-feulement ces peintures
n’ont aucun rapport à l’état & à la fituafion du pof-
feü'eur, mais fouvent même elles préfeutent des
idées qui lui font préjudiciables ; cependant Phor-
reur du vuide remplit les murs de peintures vuides
de feus. (D , J.)
O rnemens, diflrihutiond'( Archit. Oècor.) c’eft
l’efpaçement égal des ornemens, S c figures pareilles
& répétées dans quelque partis d’architecture comme
dans la frife dorique, la diftributiôn des trigiy-
phes &métopes; dans la corniche corinthienne celle
des modifions, &c. Daviler.
ORNEMENS , ( Sydmul. ) ce font les figures, les
vafes , les confoles, les pilaftres r les arcades, les
mafques^, les glaçons, les coquillages S c autres morceaux
d’architcclurc qui décorent les fontaines Sc
les cafcades. (K )
P O o o ii