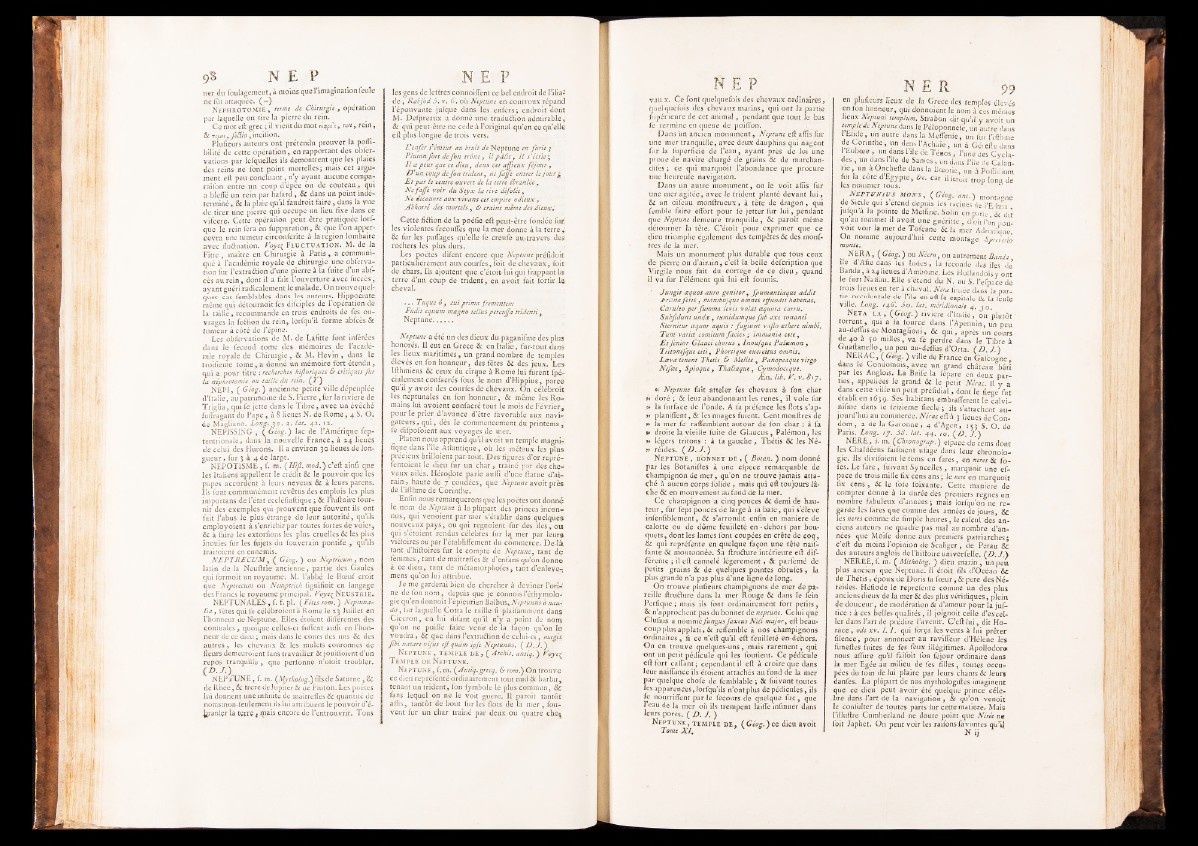
N E P
rtar du foulagemeut,à moins que 1 imagination feule
ne fût attaquée. ( - ) ’ # .
Néphrotomie , terme de Chirurgie , operation
par laquelle on tire la pierre du rein.
Ce mot eft grec ; il vient du mot r«ff» r, rtn, rein,
& To/Mt, J'eclio, incilion.
Plufieurs auteurs ont prétendu prouver la pofli-
bilité de cette opération, en rapportant des obfer-
vations par lefquelles ils démontrent que les plaies
des reins ne font point mortelles; mais cet argument
eft peu concluant, n’y ayant aucune compa-
raifon entre un coup d’épee ou de couteau, qui
a bleffé un rein par hafard , &C dans un point indéterminé,
& la plaie qu’il faudroit faire, dans la vue
de tirer une pierre qui occupe un lieu fixe dans ce
vilcere. Cette opération peut être pratiquée lorf-
que le rein fera en fuppuration, & que Ton apper-
£evra une tumeur circonfcrite à la région lombaire
avec fluctuation. Voye^ Fluctuation. M. de la
Fitte , maître en Chirurgie à Paris, a communiqué
à l’académie royale de chirurgie une obferva-
tion fur l’extraftion d’une pierre à la fuite d’un abf-
cès au rein, dont il a fait l’ouverture avec fuccès,
ayant guéri radicalement le malade. On trouve quelques
cas femblables dans les auteurs. Hippocrate
même qui détournoit fes difciples de l’operation de_;
la taille, recommande en trois endroits de fes ouvrages
la feétion du rein, lorfqu’il forme abfces &
tumeur à côté de l’épine.
Les obfervations de M. de Lafitte font inférées
dans le fécond tome des mémoires de l’académie
royale de Chirurgie, & M. Hevin , dans le
troifieme tome, a donné un mémoire fort étendu,
qui a pour titre : recherches hifloriques & critiques fur
la néphrotomie ou taille du rein. ( F )
NEPI, ( Géog.) ancienne petite ville dépeuplée
d’Italie, au patrimoine de S. Pierre, fur la riviere de
T r i t ia , qui fe jette dans le Tibre, avec un évêché
fuffragant du Pape, à 8 lieues N. de Rome, 4 S. O.
de Magliano. Long. 30. 2. lat. 42. 12.
NEPISSING , ( Géog. ) lac de l’Amérique fep-
tentrionale, dans la nouvelle France, à 24 lieues
de celui des Hurons. Il a environ 30 lieues de longueur
, fur 3 à 4 de large.
NEPOTISME , f. m. (Hift. moâ.) c’ eft ainfi que
les Italiens appellent le crédit & le pouvoir que les
papes accordent à leurs neveux & à leurs parens.
Ils font communément revêtus des emplois les plus
importans de l’état eccléfiaftique ; & l’hiftoire fournit
des exemples qui prouvent que fouvent ils ont
fait l’abus le plus étrange de leur autorité, qu’ils
employoient à s’enrichir par toutes fortes de voies,
& à faire les extorfions les plus cruelles & les plus
inouies fur les fujets du fouverain pontife , qu’ils
traitoient en ennemis.
NEPTRECUM, ( Géog. ) ou Neptricum, nom
latin de la Neuftrie ancienne, partie des Gaules
qui formoit un royaume. M. l’abbé le Boeuf croit
que Neptrecum ou Nemptrich fignifioit en langage
des Francs le royaume principal. Voye^ Neustrie.
NEPTUNALES, f. f. pi. ( Fêtes rom. ) Neptuna-
lia y têtes qui le célébroient à Rome le 23 Juillet en
l’honneur de Neptune. Elles étoient différentes des
conluales , quoique celles-ci fuffent aulïi en l’honneur
de ce dieu ; mais dans le cours des uns & des
autres, les chevaux & les mulets couronnés de
fleurs demeuroient fans travailler & jouiffoient d’un
repos tranquille, que perfonne n’ofoit troubler.
iD . J g
NEP1 UNE, f. m. (Mytkolog.) fils de Saturne , &
de Rhée, & trere de J upiier & de Piuton. Les poètes
lui donnent une infinité de maîtreffes 6c quantité de
nomsrnon-feulement ils lui attribuent le pouvoir d’é-
£ranlçr là tçfjrç * mais encore de l’entrouvrir. Tous
N E P
les gens de lettres connoiffent ce bel endroit de l’ilia*
de , Rabfod 5 . v. 6. oit Neptune en courroux répand
l’épouvante jufque dans les enfers; endroit dont
M. Defpreaux a donné une traduftion admirable,
& qui peut-être ne cede à l’original qu’en ce qu’elle
eft plus longue de trois vers.
Venfer s’émeut au bruit de Neptune en furie ;
Piuton fort de fon trône , il pâlit, il s’écrie ;
IL a peur que ce dieu, dans cet affreux féjour ,
D un coup de fon trident y ne faffe entrer le jour ;
E t par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne faffe voir du Styx la rive défolée,
Ne découvre aux vivans cet empire odieux ,
Abhorré des mortels, & craint meme des dieux'.
Cette fiéfion de la poéfiè eft peut-être fondée ftuj
les violentes fecouffes que la mer donne à la terre
& fur les paffages qu’elle fe creufe au-travers des
rochers les plus durs.
Les poètes difent encore que Neptune préfidoit
particulièrement aux courfes, foit de chevaux, foit
de chars. Ils ajoutent que c’étoit lui qui frappant la-
terre d’un coup de trident, en avoit fait fortir le
cheval.
. . . Tuque Ô y cui prima frementem
Fudit equùm magno tellus pereuffa tridenti,
Neptune...........
Neptune a été un des dieux du paganifme des plus
honorés. Il eut en Grece & en Italie, fur-tout dans
les lieux maritimes, un grand nombre de temples
élevés en fon honneur, des fêtes & des jeux. Les
Ifthmiens & ceux du cirque à Rome lui furent fpé-
cialement confacres fous le nom d’Hippius, parce
qu’il y avoit des courfes de chèvaux. On célébroit
les neptunales en fon honneur, & même les Romains
lui avoient confacré tout le mois de Février,-
pour le prier d’avance d’être favorable aux navigateurs,
qui, dès le commencement du printems
fe difpofoient aux voyages de mer.
Platon nous apprend qu’il avoit un temple magnifique
dansl’île Atlantique, où les métaux les plus
précieux brilloient par-tout. Des figures d’or repré-
fentoient le dieu fur un char, trainé par des cher
vaux aîlés. Hérodote parle aufli d’une ftatue d’airain
, haute de 7 coudées, que Neptune avoit près
de l’ifthme de Corinthe.
Enfin nous remarquerons que les poètes ont donné
le nom de Neptune à la plûpart des princes incon->
nus, qui venoient par mer s’établir dans quelques
nouveaux pays, ou qui regnoient fur des îles, ou
qui s’étoient rendus célébrés fur la mer par leurs
viftoires ou par l’établiffement du commerce. D e là
tant d’hiftoires fur le compte de Neptune y tant de
femmes, tant de maîtreffes & d’enfans qu’on donne
à ce dieu, tant de métamorphofes, tant d’enleve-
mens qu’on lui attribue.
Je me garderai bien de chercher à deviner l’ori-]
ne de fon nom, depuis que je connoisl’éthymolor
gie qu’en donnoit l’épicurien Balbus, Neptunus à nau~
do, lur laquelle Cotta le raille fi plaifamment dans
Cicéron, en lui difant qu’il n’y a point de nom
qu’on ne puiffe faire venir de la façon qu’on le
voudra, & que dans l’extraâion de celui-ci, rnagis
Jîbi natare v if us eft quàm ipfe Neptunus. ( D. J. )
Neptune , TEMPLE DE , ( Archit. antiq. ) P^oyeï
T emple de Neptune.
Neptune, f,m. (Antiq. grecq. & rom.) On trouve
ce dieu repréfenté ordinairement tout nud & barbu ,
tenant un trident, fon fymbole le plus commun, &
fans lequel on ne le voit guere. Il paroît tantôt
affis, tantôt de bout fur les flots de la mer , fou-
vent for un char traîné par deux ou quatre cbe^
vau x. Ce font quelquefois des chevaux ordinaires,
quelquefois des chevaux marins, qui ont la partie
fupérieure de cet animal, pendant que tout le bas
fe termine en queue de poiffon.
Dans un ancien monument, Neptune eft aflis fur
une mer tranquille, avec deux dauphins qui nagent
fur la fuperficie de l’eau, ayant près de lui une
proue de navire chargé de grains & de marchandées
; ce qui marquoit l’abondance que procure
une heureulè navigation.
Dans un autre monument, on le voit aflis fur
une mer agitée, avec le trident planté devant lu i,
& un oifeau monftrueux, à tête de dragon, qui
femble faire effort pour fe jetter fur lu i , pendant
que Neptune demeure tranquille, & paroît même
détourner la tête. C ’étoit pour exprimer que ce
dieu triomphe également des tempêtes & des monf-
tres de la mer.
Mais un monument plus durable que tous ceux
de pierre ou d’airain, c’eft la belle defeription que
Virgile nous fait du cortege de ce dieu, quand
il va fur l’élément qui lui eft fournis.
’ Jungit cequos auro genitûr, fpumantiaque addit
Freina feris , manibufque ornnes effundit habenas.
Cceruleo per fumma levis volât cequora curru.
Subjîdunt undee , tumidumque fub axe tonanti
Sternitur aquor aquis : fugiunt vaflo cethere nimbi.
Tum varice comitum faciès ; immania cete,
E t fenior Glauci chorus , Inoufque Palcemon ,
TritoneJ'que citi, Phorcique exercitus omnis.
Lava tenent Thetis & Melite , Panopeaque virgo
Nefoecy Spioque , Thaliaque, Cymodoceque.
Æn, lib. V. v. Siy.
« Neptune fait atteler fes chevaux à fon char
fi doré ; & leur abandonnant les renes, il vole fur
la furface de l’onde. A la préfence les flots s’ap-
» planifient, & les nuages fuient. Centmonftres de
» la mer fe raffemblent autour de fon char : à fa
» droite la vieille fuite de Glaucus , Palémon, les
» légers tritons : à la gauche , Thétis ÔC les Né-
» réides, ( D . J. )
Neptune , b’onnet de , ( Botan. ) nom donné
par les Botaniftes à une elpece remarquable de
champignon de mer, qu’on ne trouve jamais attaché
à aucun corps folide , mais qui eft toujours lâche
& en mouvement au fond de la mer.
Ce champignon a cinq pouces & demi de hauteur
, fur fept pouces de large à fa baie, qui s’élève
infenfiblement, & s’arrondit enfin en maniéré de
calotte ou de dôme feuilleté en - dehors par bouquets,
dont les lames font coupées en crête de coq,
& qui repréfente en quelque façon une tête naif-
fante & moutonnée. Sa ftruûure intérieure eft différente
; il eft cannelé légèrement, & parfemé de
petits grains & de quelques pointes obtufes, la
plus grande n’a pas plus d’une ligne de long.
On trouve plufieurs champignons de mer de pareille
ftruâure dans la mer Rouge & dans le fein
Perfique ; mais ils font ordinairement fort petits,
& n’approchent pas du bonnet de neptune. Celui que
Clufius a nommé fungus faxeus Nili major y eft beaucoup
plus applati, & reffemble à nos champignons
ordinaires , li ce n’eft qu’il eft feuilleté en-dehors.
On en trouve quelques-uns, mais rarement, qui
ont un petit pédicule qui les foutient. Ce pédicule
eft fort caffant; cependant il eft à croire que dans
leur naiffance ils étoient attachés au fond de la mer
par quelque chofe de femblable ; & fuivant toutes
les apparences, lorfqu’ils n’ont plus de pédicules, ils
fe nourriffent par le fecours de quelque fu c , que
1 eau de la mer oit ils trempent laiffe infinuer dans
leurs pores. ( D . J . )
Neptune, temple de , ( Géog. ) ce dieu avoit
Tome X I . > \ » J |
en plufieurs lieux de la Grece des temples éleve's
en ton hpnneur, qui donnoient le nom à ces mêmes
lieux Ncpiuni tcniplum. Srrabon dit qu’il y avoit un
. Î S f * I N‘P‘ un‘ dans le Péloponnefe, un autre dans
1 ttide I un autre dàffl la Meffenie, un fur l’ifthme
de Corinthe, un dans l’Achaie, un à Géreftedans
1 Euboee , un dans l’île de Ténos, l’une des Cycla-
des , un dans I île de Sâm|^ un dans l’île de Caiau-
r ie , un àOnchéfte dàn^la Boeotie, un à Poffidium
fur la;cote d’Egypte, Æ*i. car ilf„o it trop long de
'les nommer tous,
' - Ne p t o n w s u o k s , W M ans.) montagne
de oicu'e qui s etend depuis les racines de l’E'hna
jnfquKirjpoiiite de Mèffiné. Solin en parle & dit
qu’âii fommet il avoit une gu é r it» , d’eh l’on pouvoir
voir la mer de Tofcanc & la mer Adriatique.
On nomme aujourd’hui cette montage Sprevmâ
monte.
NERA, ( Géog. ) ou NécrOy ou autrement Banda
île d Afie dans Les Indes , la fécondé des îles de
Banda, à 24lieuesd’Amboine. Les Hoilandoisy ont
le fort Nali'au. Elle s’étend du N. au S. l’efpace de
trois lieues en ter à cheval. Néra licuée dans la partie
occidentale de l’île en eft la capitale & la feule
Ville. Long. 146. 60. lat. méridionale 4. 30.
Neta l a , (Géog.) riviere d’Italie, ou plutôt
torrent, qui a fa iource dans l’Apennin, un peu
au-deffus de Montaglioni, & qui, après un cours
de 40 à 50 milles, va fe perdre dans le Tibre à
Guaftanello, un peu au-deffus d’Orta. (D . J .)
NER A C , ( Géog. ) ville de France en Ga/Cogne
dans le Condomois, avec un grand château bâti
par les Anglois. La Baife la fépare en deux parties,
appellées le grand & le petit Nérac. U y a
dans cette ville un petit préfidiai, dont le fiege fut
établi en 1639. ? es. habirans embrafferent le calvi-
nifme dans le feizieme fiecle ; ils s’attachent aujourd’hui
au commerce. Nérac eft à 3 lieues de Condom
, 2 de la Garonne, 4 d’Agen, 153 S. O. de
Paris. Long. ry. 58. lat. 44. /©. (O . J .)
NERE, f. m. (Chronograp.) efpace de tems dont
les Chaldéens faifoient ufage dans leur chronologie.
Ils divifoient le tèms en fares, en neres & foies.
Le fare, fuivant Syncelles , marquoit une efpace
de trois mille fix cens ans ; le ntre en marquoit
fix cen s, & le fofe foixanté. Cette maniéré de
compter donne à la durée des premiers régnés un
nombre fabuleux d’années ; mais lorfqu’on ne regarde
les fares que comme des années de jours, &
les neres comme de fimple heures, le calcul des anciens
auteurs ne quadre pas mal au nombre d’années
que Moïfe donne aux premiers patriarches;
c ’eft du moins l’opinion de Scaliger, de Petau &
des auteurs anglois de l’hiftoire univerfelle. (D . J .j
NERÉE,f. m. ( Mitholdg. ) dieu marin , un peu
plus ancien que Neptune. Il étoit fils d’Océan
de Thétis, époux de Doris fa foeu r, & pere des Néréides.
Héfiode le reprefente comme un des plus
anciens dieux de la mer & des plus véridiques, plein
de douceur, de modération & d’amour pour la juf-
tice : à ces belles qualités, il joignoit celle d’exceller
dans l’art de prédire l’avenir. C ’eft lu i, dit Horace
, ode xv. I, I . qui força les vents à lui prêter
filence, pour annoncer au raviffeur d’Hélene les
funeftes fuites de fes feux illégitimes. Apollodor»
nous affure qu’il faifoit fon féjour ordinaire dans
la mer Egée au milieu de fes filles, toutes occupées
du loin de lui plaire par leurs chants & leurs
danfes. La plupart de nos mythologiftes imaginent
que ce dieu peut avoir été quelque prince céle-
,bre dans l’art de la navigation, & qu’on venoit
le confulter de toutes parts lur cette matière. Mais
l’illuftre Cumberland ne doute point que Nérée ne
foit Japhet. On peut voir les ranons favantes qu’ü