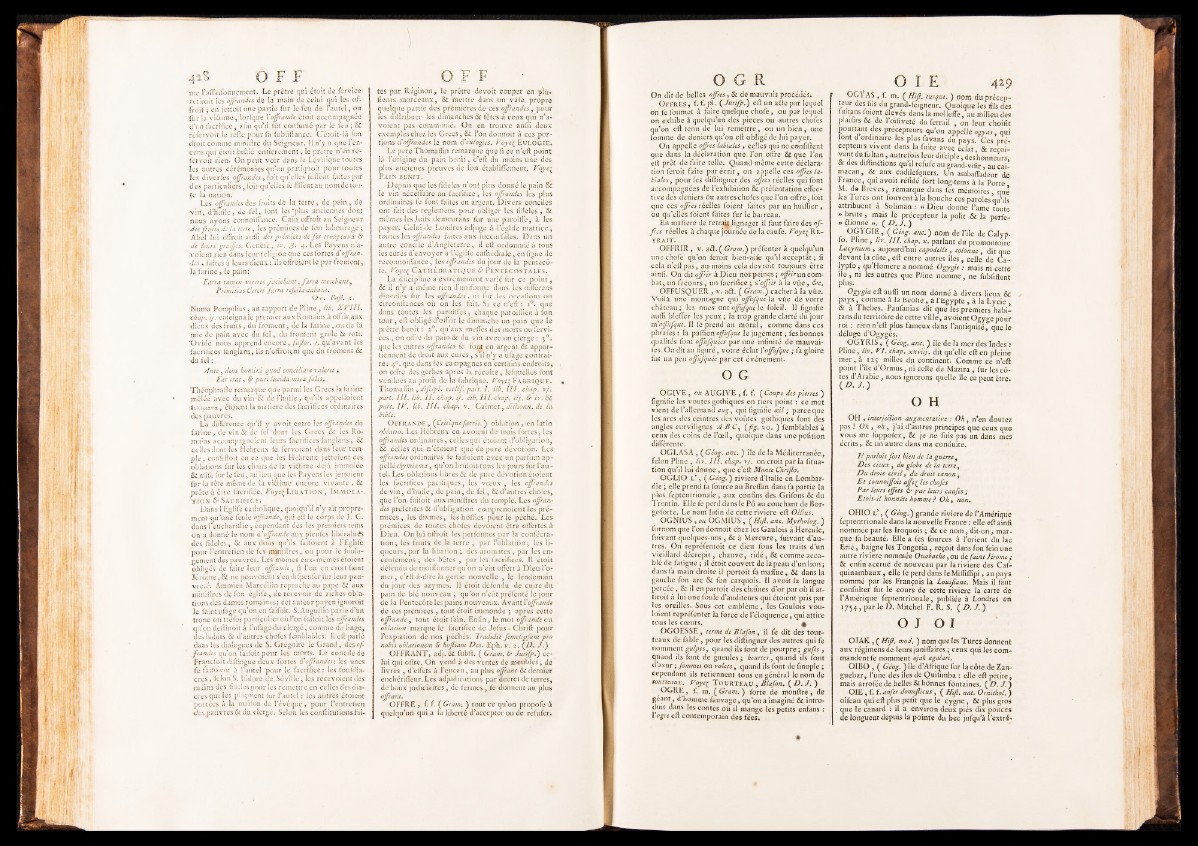
4*8 O F F O F F
me l’affaifonncment. Le prêtre qui étoit de fervice
retiroit les offrandes de la main de celui qui les offroit
; en jettoit une partie fur le feu de l’autêl, ou
fur la viûime, lorfque l'offrande étoit accompagnée
d’un facrifice, afin qu’il fut confumé par le leu ; &
réfervoit le refte poiir fa fubfiftance. C’étoit-là fon
droit comme miniftre du Seigneur. Il n’y-a que l’encens
qui étoit brûlé entièrement, le prêtre n’ên réfervoit
rien. On peut voir dans le Lévitique toutes
les autres cérémonies qu’on pratiquoit pour toutes
les diverfes offrandes, foit qu’elles fuffent faites par
des particuliers, foit qu’elies fefiffent au nom de toute
la nation.
Les offrandes des fruits de la terre, de pain, de
v in , d’huile, de fe l, font les’ plus anciennes dont
nous ayons connoiffancé. Caïn offroit au Seigneur
des fruits de la terre, les prémices de fon labourage ;
Abel lui offroit auffi des prémices de f i s troupeaux &
de leurs großes. Genefe, ïv. 3. 4. Les Payens n'a-
voient rien dans leur religion que ces fortes d’offran-
sdes, faites à leur s-dieux : ils offroientle pur froment,
la farine, le pain:
Farra tarnen veteres jaciibant, farra metebant,
Prïmltias Cereri farra reficla dabant.
Ov. Faß. 2:
Numa Pompilius , au rapport de Pline , lib. X V III.
chap. ij. enfeigna le premier aux R omains à offrir aux
dieux- des fruits, du froment, de la farine, ou de la
mie de pain avec du fe l, du froment grillé & rôti.
'Ovide nous apprend encore, faflor.j. qu’avant les
facrifices lanelans, ils n’offroient que du froment &
du fel :
Ante, deos homini quod conciliare valeret,
Far erat, & puri lucida mica faits.
Théophrafte remarque que parmi les Grecs la farine
mêlée avec du vin & de l’huile, qu’ ils appelloient
ivMfjut™ , étoient la matière des facrifices ordinaires
•des pauvres.
La différence qu’il y avoit entre les offrandes de
farine, de vin & de fel dont les Grecs & les Romains
accompagnoient leurs facrifices fanglans, &
celles dont les Hébreux fe fervoient dans leur temple
, confiftoit en ce que les Hébreux jettoient ces
oblations fur les chairs de la viftime déjà immolée
& mife fur le feu, au lieu que les Payens les jettoient
fur la tête même de la vi&ime encore vivante , &
prête à être facrifiée. Voye^ L i b a t i o n , Im m o l a -.
T iO N 6* S a c r i f i c e .
Dans l’Eglife catholique, quoiqu’il n’y ait propre*
ment qu’une feule offrande, qui eft le corps de J. C.
dans l’euchariftie, cependant dès les premiers tems
on a donné le nom A'offrande aux pieufes libéralités
des fideles, & aux dons qu’ils faifoient à l’Eglife
pour l’entretien de fes miniftres, ou pour le foula-
gement des pauvres. Les moines eux-mêmes étoient
obligés de faite leur offrande, fi l’on en croit faint
Jérôme, & ne pouvoient s’en difpenfer fur leur pauvreté.
Ammien Marcellin reproche au pape & aux
miniftres de fon églife, de recevoir de riches oblations
des dames romaines; cet auteur payen ignoroit
le faint ufage qu’on en faifoit. S.Auguftin parle d’un
tronc ou tréfor particulier oit l’on faifoit les offrandes
qu’on deftinoit à l’ufagedu clergé, comme clu linge,
des habits & d’autres chofes femblables. Il eft parlé
dans les dialogues de S. Grégoire le Grand, dés offrandes
qu’on faifoit pour les morts. Le concile de
Francfort diftingue deux fortes AU offrandes', les unes
fe faifoient à l’autel pour le facrifice: les foufdia-
cres, félon S. Ifidore de Séville, les recevoient des
mains des fideles pour les remettre en celles des diacres
qui les pîaçoient fur l’autel : les autres étoient
portées à la maifon de l’évêque, pour l’entretien
■ des .pauvres & du clergé. Selon les conftitutionsfaites
par Réginon, le prêtre devoit coupef en plu-
fieurs morceaux, & mettre dans un vafe propre
quelque partie des premières de ces offrandes, pour
les diftribuer les dimanches & fêtes à ceux qui n’a-
voient pas communié. On en trouve aum deux
exemples chez les Grecs, tk. l’on donnoit à ces portions
offrandes le nom d’eulogies. Voye{ Eulogie*
Le pere Thomaffin remarque que fi ce n’eft point
là l’origine du pain bénit, c’eft du moins une des
plus aheienes preuves de fon établiffement. Voye^
Pain bénit.
Depuis que les fideles n’ont plus donné le pain &
le vin néceffaire au facrifice, les offrandes les plus
ordinaires fe font faites en argent. Divers conciles
ont fait des reglemens pour obliger les fideles , &
mêmes les Juifs demeurans fur une paroiffe, à les
payer. Celui de Londres adjuge à l’églife matrice,
tontes les offrandes faites aux lùccurfales. Dans un
autre concile d’Angleterre, il eft ôrdonnné à tous
les curés d’envoyer à Téglife cathédrale, en ligne dé
reconnoiffance, les offrandes du jour de la pentecô-
te. Vbye^ Cathédratique & Pentegostales.
La difeipline a extrêmement varié fur ce point,
& il n’y a même rien d’uniforme dans les différens
diocefes fur les offrandes, ni fur les occafions ou
circonftances où on les fait. Si ce n’eft: i°. que
dans toutes les paroiflés, chaque parôiflien à fon
tour, eft obligé d’offrir le dimanche un pain que lé
prêtre bénit : 2°. qu’aux meffes des morts ou fervi-
ces , on offre du pain & du vin avec un cierge : 3°-.
que les autres offrandes fe foijtt en argent & appartiennent
de droit aux curés, s il n’y a ufage contrai*
re: 40. que dans les campagnes en certains endroits*
on offre des gerbes après la récolte, lefquelles font
vendues au profit de la fabrique. Voye{ Fabrique;.
Thomaffin , difiipl. eccléf. pan. I. lib. I I I . chap. vj.
part. III. lib. II. chap, ij-, eib. III. chap. iij. & iv. 8>C
part. IV. lib. I II. chap. v. Calmet, diclionn. de là
bible.
Offrande , {Critique facrée. ) oblation , en latin
oblatio. Les Hébreux en avoient de trois fortes, les
offrandes ordinaires, celles qui étoient d’obligation,
& celles qui n’étoient que de pure dévotion. Les
offrandes ordinaires fe faifoient avec un parfum ap*
pellithymiama , qu’on brûloit-tous les jours fur l’autel.
Les oblations libres & de pure dévotion étoient
les facrifices pacifiques, les voeux , les offrandes
d e vin , d’huile, de pain, de fe l, & d’autres chofes,
que l’on faifoit aux miniftres du temple. Les offrandes
preferites & d’obligation comprenoient les prémices
, les dixmes, les hofties pour le péché. Les
prémices de toutes chofes dévoient être offertes à
Dieu. On lui offroit les perfonnes par la confécra-
tion ; les fruits de la terre , par l’oblation ; les liqueurs,
par la libation ; des aromates , par les en-
cenfemens ; des bêtes , par les facrifices. Il étoit
défendu de moiffonner qu’on n’eût offert à Dieu l’o*
mer, c’eft-à-dire la gerbe nouvelle , le lendemain
du jour des azymes. Il étoit défendu de cuire du
pain de blé nouveau , qu’on n’eût préfenté le jour
de la Pentecôte les pains nouveaux. Avant l’offrande
de ces prémices , tout étoit immonde ; après cette
offrande , tout étoit fain. Enfin, le mot offrande ou
oblation marque le facrifice de Jefus- Chrift pour
l’expiation de nos péchés. Tradidit fimetipfum pro
nobis oblationetn & hofliam Deo. Eph. v. 2. {D. J.)
OFFRANT, adj. &C fubft. ( Gram. & Jurifp.) celui
qui offre. On vend à des ventes de meubles', de
livrés , d’effets à l’encan, au plus offrant & dernier
enchériffeur. Les adjudications par decret de terres,
de baux judiciaires, de fermes, fe donnent au plus
offrant.
OFFRE , f. f. ( Gram. ) tout ce qu’on propofe à
quelqu’un qui a la liberté d’accepter ou de refufer».
O G R
On dit de belles offres , & de mauvais procédés*
Offres, f. f. pl. ( Jurifp.) eft un aftepar lequel
on fe foumet à faire quelque chofe, ou par lequel
on exhibe à quelqu’un des pièces ou autres chofes
qu’on eft tenu de lui remettre, ou un bien, une
fomme de deniers qu’on eft obligé de lui payer.
On appelle offres labiales, celles qui ne confiftent
que clans la déclaration que l’on offre & que l ’oq
eft prêt de faire telle. Quand même cette déclaration
feroit faite par éc r it, on appelle ces offres labiales
, pour les diftinguer des offres réelles qui font
accompagnées de l’exhibition & préfentation effective
des deniers ou autres chofes que l ’on offre, foit
que ces offres réelles foient faites par un huiflier ,
ou qu’elles foient faites fur le barreau.
En matière de retrak lignager il faut faire des offres
réelles à chaque journée de la caufe. Voye^ R etrait.
OFFRIR, v. aft. ( Gram.) préfenter à quelqu’un
une chofe qu’on feroit bien-aifc qu’il acceptât ; fi
cela n’eft pas, au-moins celadevroit toujours être
ainfi. On dit offrir à Dieu nos-peines; offrir un combat,
un fecours, un facrifice ; s ’offrir à la v û e , &c.
OFFUSQUER, v. ad. ( Gram.) cacher à la vûe.
Voilà une montagne qui offufque la vue de votre
château ; les nues ont offufque le foleil. Il fignifie
auffi bleffer les yeux ; la trop grande clarté du jour
nCoffufque. II fe prend au moral, comme dans ces
phrafes : la paffion offufque le jugement ; fes bonnes
qualités font offufquées par une infinité de mauvai-
fes. On dit au figuré, votre éclat l’offufque ; fa gloire
fut un peu offufquèe par cet événement.
O G
O G IV E , ou AUGIVE , f. f. {Coupe des pierres )
lignifie les voûtes gothiques en tiers point : ce mot
vient de l’allemand aug, qui fignifie oeil; parce que
les arcs des ceintres des voûtes gothiques font des
angles curvilignes A B C , {fig. 2 0 . ) femblables à
ceux des coins de l’oe il, quoique dans unepofition
différente.
OGLASA , {Géog. anc. ) ’île de la Méditerranée,
félon Pline , liv. I I I . chap. vji on Croit par la fitua-
tion qu’il lui donne, que c’eft Monte Chrijlo.
OGLIO l’ , ( Géog. ) riviere d’Iralie en Lombardie
; elle prend la fource au Breffan dans fa partie la
plus feptentrionale, aux confins des Grifons & du
Trentin. Elle fe perd dans le Pô au couchant de Bor-
goforte. Le nom latin de cette riviere eft Ollius.
OGNIUS , ou OGMIUS, {Hifi, anc. Mytholog. )
furnom que l’on donnoit chez les Gaulois à Hercule,
fuivant quelques-uns , & à Mercure, fuivant d’autres.
On repréfentoit ce dieu fous les traits d’un
vieillard décrépit, chauve, ridé, & comme accablé
de fatigue ; il étoit couvert de la peau d’un lion ;
dans fa main droite il portoit fa maffue, & dans la
gauche fon arc & fon carquois. Il avoit la langue
percée, & il en partoit des chaînes d’or par où il at-
tiroit à lui une foule d’auditeurs qui étoient pris par
les oreilles. Sous cet emblème, les Gaulois vou-
loient repréfenter la force de l’éloquence, qui attire
tous les coeurs. ^
OGOESSE , terme de Blafon, il fe dit des tourteaux
de fable, pour les diftinguer des autres qui fe
nomment guipes, quand ils font de pourpre ; gu fes ,
quand ils font de gueules ; heurtes, quand ils font
d’azur ; fommes ou volets, quand ils font de finople ;
cependant ils retiennent tous en général le nom de
tourteaux. Voye{ TOURTEAU , Blafon. {D . J . )
O G R E , f. m. {Gram.) forte de monftre, de
géant, d homme fauvage, qu’on a imaginé & introduit
dans les contes où il mange les petits enfans :
Vogre eft contemporain des fées.
O I E 4 1 c )
OGŸAS , f. m. ( Hijl. turque. ) nom du précep-*
teur des fils du grand-feigneur. Quoique les fils des
lult^ns foient élevés dans la molleffe, au milieu des
P •rs & ae l’oifiveté du ferrail , on leur choifit
pourtant des précepteurs qu’on appelle ogyas. qui
font d ordinaire les plus favans du pays. Ces précepteurs
vivent dans la fuite avec éclat, & reçoivent
du fultan, autrefois leur difciple, des honneurs
& des diftinûions qu’il refufe au grand-vifir , aU caï-
macan, & aux cadilefquers. Un ambaffadeur de
France, qui avoit réfidé fort long-tems à la Porte
M. d® Brèves, remarque dans fes mémoires, que
les Turcs ont fouventàla bouche ces paroles qu’ils
attribuent à Soliman : « Dieu donne l’ame toute
» brute, mais le précepteur la polit & la perfe-
» âionne ». { D . J . )
O G YG IE , ( Géog. anc. ) nom de l’île de Calyp-
fo. Pline, liv. I II. chap. x. parlant du promontoire
Lacyntum , aujourd’hui capodelle, colonne , dit que
devant la côte, eft entre autres îles , celle de Ca-
lypfo, qu’Homere a nommé Ogygie : mais ni cette
île , ni les autres que PJine nomme, ne fubfiftent
plus.
Ogygia eft auffi un nom donné à divers lieux &
pa ys, comme à la B éotie, à l’Egypte , à la Lycie ,
& à Thebes. Paufanias dit que les premiers habi-
tans du territoire de cette ville , avoient Ogyge pour
roi : rien n’eft plus fameux dans l’antiquité, que le
déluge d’Ogygès.
OGYR IS, ( Géog. anc. ) île de la mer des Indes :
Pline, liv. VI. chap. xxviij. dit qu’elle eft en pleine
mer, à 125 milles du continent. Comme ce n’eft
point l’île d’Ormus, ni celle de Mazira , fur les cô^
tes d’Arabie, nous ignorons quelle île ce peut être.
{D. J . )
O H
OH , interjection augmentative : Oh, n’en doutez
pas ! Oh t oh y j’ai d’autres principes que ceux que
vous me fuppofez, & je ne fuis pas un dans mes
écrits, & un autre dans ma conduite.
I l parloit fort bien de la guerre ,
Des cieux, du globe de la terre,
Du droit civil, du droit canon ,
E t connoiffoit affe^ les chofes
Par leurs effets & par leurs caufis ;
Etoit-il honnête homme ? Oh, non.
OHIO l’ , ( Géog. ) grande riviere de l’Amérique
feptentrionale dans la nouvelle France : elle eft ainfi
nommée par les Iroquois ; & ce nom, dit-on , marque
fa beauté. Elle a fes fources à l’orient du lac
Erié, baigne les Tongoria, reçoit dans fop fein une
autre riviere nommée Ouabache, ou de faint Jérome;
& enfin accrue de nouveau par la riviere des Caf-
quinambaux , elle fe perd dans leMiffiffipi, au pays
nommé par les François la Louifiane. Mais il faut
confulter fur le cours de cette riviere la carte de
l’Amérique feptentrionale, publiée à Londres en
1754, par le D . Mitchel F. R. S. {D . J .)
O J 0 1
O JAK , ( Hifi. mod. ) nom que les Turcs donnent
aux régimens de leurs janiffaires ; ceux qui les commandent
fe nomment ojak agalari.
OIBO , ( Gé6g. ) île d’Afrique fur la côte de Zan-
guebar, l’une des îles de Quifimba : elle eft petite,
mais arrofée de belles & bdhnes fontaines. {D . J .)
OIE , f. f. anfir domefiieus , { Hiß. nat. Ornithol. )
oifeau qui eft plus petit que le cy gne, & plus gros
que le canard : il a environ deux piés dix pouces
de longueur depuis la pointe du bec jufqu’à l ’extré-*