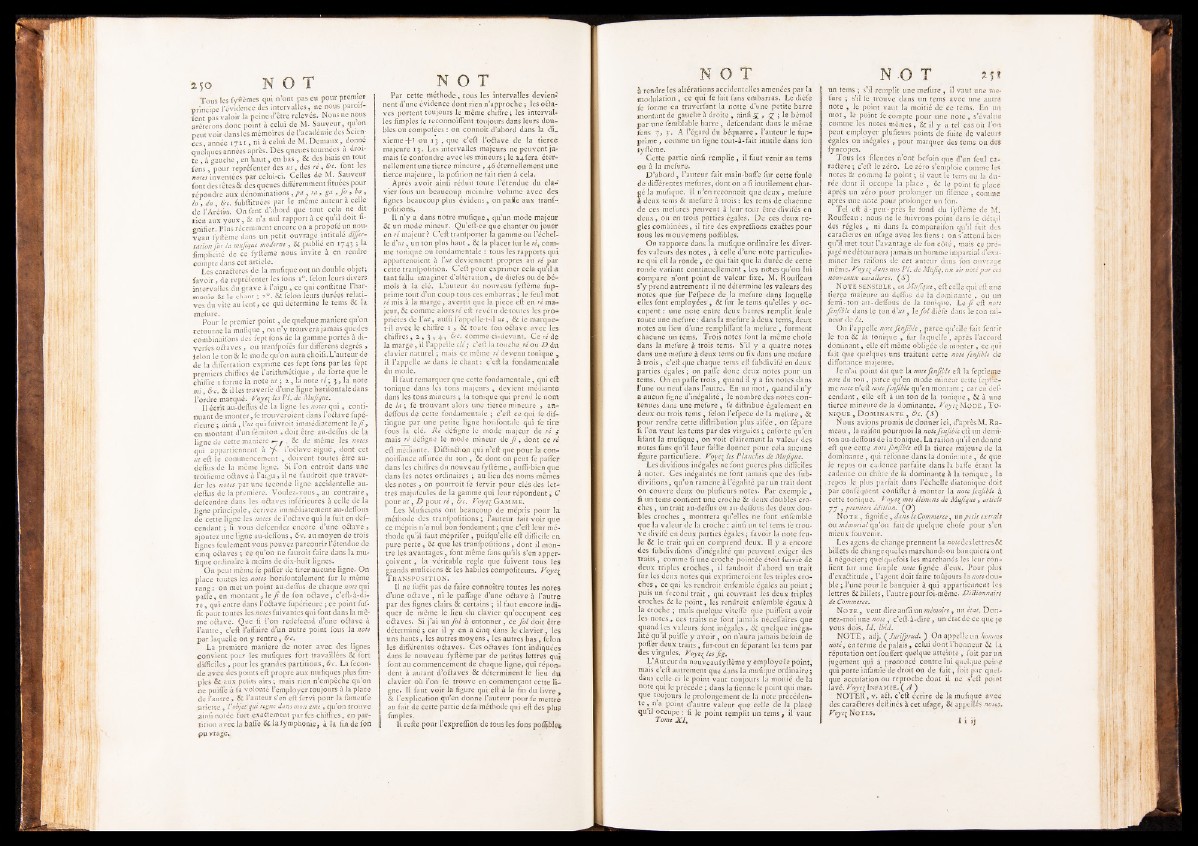
Tous les fy'ftèmes qui n’ont pas eu pour premier
principe l’évidence des intervalles, ne nous parodient
pas valoir la peine d’être relevés. Nous ne nous
prêterons donc point à celui de M. Sauveur, qu on
peut voir dans les mémoires de l’académie des Sciences,
année 1 7 1 1 , ni à celui de M. Demaux, donne
quelques années après. Dès queues tournées à droite
, à gauche, en haut, en bas , & des biais en tout
fen s , pour repréfenter des u t, des rc , &c. font les
nous inventées par celui-ci. Celles de M. Sauveur
font des têtes & des queues différemment fituees pour
répondre aux dénominations , pu , ra, ga , fo f 0 t
lo , d o, &c. fubftituées par le même auteur à celle
de l’Arétin. On fent d’abord que tout cela ne dit
rien aux yeux , & n’a nul rapport à ce qu’il doit lignifier.
Plus récemment encore on a propofé un nouveau
fyftème dans un petit ouvrage intitulé differ-
tntionfur la mufique moderne , & publié en 1743 ; la
fimplicité de ce fyftème nous invite à en rendre
compte dans cet article.
Les caraûeres de la mufique ont un double objet;
favoir, de repréfenter les fans i°. félon leurs divers
intervalles du grave à l’aigu, ce qui conftitue l’harmonie
& le chant ; z ° . & félon leurs durées relatives
du vite au lent, ce qui détermine le tems & la
mefure. . ,
Pour le premier point, de quelque maniéré qu on
retourne la mufique , on n’y trouvera jamais que des
combinàifons des fept fons de la gamme portés à cli-
verfes octaves , ou tranfpofés fur differens degrés ,
lelon le ton & le mode qu’on aura choili. L’auteur de
de la dilfertation exprime ces fept fons par les fept
premiers chiffres de l’ arithmétique , de forte que le
chiffre 1 forme la note ut ; z , la note ré; 3 , la note
mi &c. & il les traverfe d’une ligne horifontale dans
l’ordre marqué. Voye{ Les Pl. de Mujîque.
Il écrit au-deffus de la ligne les nous q u i, continuant
de monter, fe trouveroient dans l’oétave fupé-
rieure * ainfi, Vue qui fuivroit immédiatement le f i f
en montant d’un fémiton , doit être au-deffus de la
ligne de cette maniéré *7 ƒ , & de même les nous
qui appartiennent à f i l’o&ave aiguë, dont cet
ut eft le commencement , doivent toutes être au-
deffus de la même ligne. Si l’on entroit dans une
troifieme oûave à l’aigu, il ne faudroit que traver-
fer les notes par une fécondé ligne accidentelle au-
deffus de la première. Voulez-vous, au contraire,
defcendre dans les o&aves inférieures à celle de la
ligne principale, écrivez immédiatement au-deffous
de cette ligne les nous de l’oâa ve qui la fuit en def-
cendant ; fi vous defcendez encore d’une o fta v e ,
ajoutez une ligne au-deffous, &c. au moyen de trois
lignes feulement vous pouvez parcourir l’étendue de
cinq o&aves ; ce qu’on ne fauroit faire dans la mufique
ordinaire à moins de dix-huit lignes.
On peut même fe paffer de tirer aucune ligne. On
place toutes les notes horifontalement fur le même
rang : on met un point au-deffus de chaque note qui
paffe, en montant, le Jî de fon oclave, c’eft-à-di-
r e , qui entre dans l’o&ave fupérieure ; ce point fuf-
fit pour toutes les notes fuivantes qui font dans la même
oftave. Que fi l’on redefcend d’une oftave à
l’a u t r e c ’eft l’affaire d’un autre point fous la note
par laquelle on y rentre, &c.
La première maniéré de noter avec des lignes
convient pour les mufiques fort travaillées & fort
difficiles , pour les grandes partitions, &c. La fécondé
avec des points eft propre aux mufiques plus fim-
ples & aux petits airs ; mais rien n’empêche qu’on
-ne puiffe à fa volonté l’employer toujours à la place
de l’autre, & l’auteur s’en eft fervi pour la fameufe
ariette , l'objet qui régné dans mon curie , qu’on trouve
ainfi notée fort exactement par fes chiffres, en partition
avec la baffe & la lymphonie, à la fin de fon
puvrage«.
Par cette méthode, tous les intervalles devient
nent d’une évidence dont rien n’approche ; les o£la-
ves portent toujours le même chiffre ; les intervalles
fimples fe reconnoiffent toujours dans leurs doubles
ou compofées : on connoît d’abord dans la dixième
+ ? ou 13 , que c’eft l’o&ave de la tierce
majeure 13. Les intervalles majeurs ne peuvent jamais
fe confondre avec les mineurs ; le 14 fera éternellement
une tierce mineure , 46 éternellement une
tierce majeure, la pofition ne fait rien à cela.
Après avoir ainfi réduit toute l’étendue du clavier
fous un beaucoup moindre volume avec des
lignes beaucoup plus évidens, on paffe aux tranf-
pofitions.
Il n’y a dans notre mufique, qu’un mode majeur
& un mode mineur. Qu’eft-ce que chanter ou jouer
en ré majeur ? C ’eft tranfporter la gamme ou l’échelle
d’ut, un ton plus haut, & la placer fur le ré, comme
tonique ou fondamentale : tous les rapports qui
appartenoient à l'ut deviennent propres au ré par
cette tranfpofition. C ’eft pour exprimer cela qu’il a
tant fallu imaginer d’altération, de dièfes ou de bémols
à la clé. L’auteur du nouveau fyftème fup-
prime tout d’un coup tous ces embarras ; le feul mot
ré mis à la marge, avertit que la piece eft en ré majeur,
&C comme alors rc eft revêtu de toutes les propriétés
de Vut, auffi l ’appelle-t-il u t , & le marque-
t-il avec le chiffre 1 , &c toute fon o&ave avec les
chiffres, 1 , 3 , 4 , comme ci-devant. Ce ré de
la marge, il l’appelle clé; c’eft la touche, ré ou D du
clavier naturel ; mais ce même ré devenu tonique ,
il l’appelle ut dans le chant : c’eft la fondamentale
du mode.
Il faut remarquer que cette fondamentale, qui eft
tonique dans les tons majeurs , devient médiante
dans les tons mineurs ; la tonique qui prend le nom
de la ; fe trouvant alors une tierce mineure , ati-
deffous de cette fondamentale ; c’eft ce qui fe distingue
par une petite ligne horifontale qui fe tire
fous la clé. Ré défigne le mode majeur de ré ;
mais ré défigne le mode mineur de f i , dont ce ré
eft médiante. Diftinâitin qui n’eft que pour la con-
noiffance affurée du ton , & dont on peut fe paffer
dans les chiffres du nouveau fyftème, auffi-bien que
dans les notes ordinaires ; au lieu des noms mêmes
des notes , on pourroit fe fervir pour clés des lettres
majufcules de la gamme qui leur répondent, C
pour u t , D pour ré, &c. Foye{ G a m m e .
Les Muficiens ont beaucoup de mépris pour la
méthode des tranfpofitions ; l’auteur fait voir que
ce mépris n’a nul bon fondement; que c’eft leur méthode
qu’il faut méprifer , puifqu’elle eft difficile en
pure perte, & que les tranfpofitions, dont il montre
les avantages, font même fans qu’ils s’en apper-
ço iven t, la véritable réglé que luivent tous les
grands muficiens & les habiles compofiteurs. Voyet
T r a n s po s it io n .
Il ne fuffit pas de faire coflnoître toutes les notes
d’une oûave , ni le paffage d’une oétave à l’autre
par des lignes clairs & certains ; il faut encore indiquer
de même le lieu du clavier qu’occupent ces
o&aves. Si j’ai un fo l à entonner , ce fo l doit être
déterminé; car il y en a cinq dans le clavier, les
uns hauts, les autres moyens, les autres bas , félon
les différentes oftaves. Ces oélaves font indiquées
dans le nouveau fyftème par de petites lettres qui
font au commencement de chaque ligne, qui répondent
à autant d’oétaves & déterminent le lieu du
clavier où l’on fe trouve en commençant cette ligne.
Il faut voir la figure qui eft à la fin du livre ,
& l’explication qu’en donne l’auteur pour fe mettre
au fait de cette partie de fa méthode qui eft des plus
fimples.
Il refte pour l’expreffion de tous les fons poffibleç
à rendre les altérations accidentelles amenées par la
modulation , ce qui fe fait fans embarras. Le dièfe
fe forme en travcrfant la notte d’une petite barre
montant de gauche à droite , ainfi s . , £ ; le bémol
par une femblable barre , defcendant dans le même
fens ÿ , y . A l’égard du béquarre, l’auteur le fup-
priine, comme un ligne tout-à-fait inutile dans fon
fyftème.
Cette partie ainfi remplie, il faut venir au tems
ou à la mefure.
D ’abord, l’auteur fait main-baffe fur cette foule
de differentes mefures, dont on a fi inutilement chargé
la mufique. Il n’en reconnoît que deux, mefuré
a deux tems & mefure à trois: les tems de chacune
de ces mefures peuvent à leur tour être divifés en
deux, ou en trois parties égales. De ces deux réglés
combinées, il tire des expreffions exaftes pour
tous les mouvemens poffibles.
On rapporte dans la mufique ordinaire les diver-
fes valeurs des notes , à celle d’une note particulière
qui eft la ronde, ce qui fait que la durée de cette
ronde variant continuellement, les nettes qu’on lui
compare n’ont point de valeur fixe. M. Rouffeau
s’y prend autrement : il ne détermine les valeurs des
notes que fur l’efpece de la mefure dans laquelle
elles font employées , & fur le tems qu’elles y occupent
: une note entre deux barres remplit feule
toute une mefure : dans la mefure à deux tems, deux
notes au lieu d’une rempliffant la mefure , forment
chacune un tems. Trois notes font la même chofe
dans la mefure à trois tems. S’il y a quatre notes
dans une mefure à deux tems ou fix dans une mefure
à trois, c’eft que chaque tems eft fubdivifé en deux
parties égales ; on paffe donc deux notes pour un
tems. On en paffe trois , quand il y a fix notes dans
l’une ou neuf dans l’autre. En uii mot, quand il n’y
a aucun ligne d’inégalité , le nombre des-notes contenues
dans une mefure , fe diftribue également en
deux ou trois tems , félon l’efpece de la mefure , &
pour rendre cette diftribution plus aifée, on fépare
fi l’on veut les tems par des virgules ; enforte qu’en
lifant la mufique, on voit clairement la valeur des
notes fans qu’il leur faille donner pour cela aucune
figure particulière. Poye^ les Planches de Mufique.
Les divifions inégales ne font gueres plus difficiles
à noter. Ces inégalités ne font jamais que des fub-
divifions, qu’on ramene à l’égalité par un trait dont
on couvre deux ou plufieurs notes. Par exemple ,
fi un tems contient une croche & deux doubles croches
, un trait au-deffus ou au-deffous des deux doubles
croches , montrera qu’elles ne font enfemble
que la valeur de la croche : ainfi un tel tems fe trouv
e divifé en deux parties égales; favoir la note feule
& le trait qui en comprend deux. Il y a encore
des fubdivifions d’inégalité qui peuvent exiger des
traits, comme fi une croche pointée étoit fuivie de
deux triples croches , il faudroit d’abord un trait
fur les deux notes qui exprimeroient les triples croches
, ce qui les rendroit enfemble égales au point ;
puis un fécond tra it, qui couvrant les deux triples
croches & le point, les rendroit enfemble égaux à
la croche ; mais quelque viteffe que puiffent avoir
les notes., ces traits ne font jamais néceffaires que
quand les valeurs font inégales, ôc quelque inégalité
qu’il puiffe y a v o ir , on n’aura jamais befoirt de
paffer deux traits , fur-tout en féparant les tems par
des virgules. Voyelles fig.
L’Auteur du nouveau fyftème y employé le point,
mais c’eft autrement que dans la mufique Ordinaire;
dans celle-ci le point vaut toujours la moitié de la
note qui le précédé ; dans la fienne le point qui marque
toujours le prolongement de la note précédente
, n a point d’autre valeur que celle de la place
qu’il occupe : fi le point remplit un tems , il vaut
Tonte X I ,
un tems ; s*il remplit une mefure, il vaut une mefure
; s’il fe trouve dans un tems avec une autre
note , le point vaut la moitié de ce tems. En un
mot, le point fe compte pour une no te, s’évalue
comme les notes mêmes, & il y a tel cas où l’on
peut employer plufieurs points de fuite de valeurs
égalés ou inégalés , pour marquer des tems ou des
fyncopes.
Tous les filences n’ont befoin que d’un feul ca-
raélere ; c’eft le zéro. Le zéro s’emploie comme les
notes & comme le point ; il vaut le tems ou la durée
dont il occupe la place , & le point fe place
après un zéro pour prolonger un filence , comme
après une note pour prolonger un fon.
Tel eft à-peu-près le fond du fyftème de M.
Rouffeau : nous ne le fuivrons point dans le détail,
des régies , ni dans la comparaifon qu’il fait des
cara&eres en ufage avec les liens : on s’attend bien
qu’il met tout l’ avantage de fon cô té, mais ce préjugé
ne détournera jamais un homme impartial d’examiner
les raifons de cet auteur dans fon ouvrage
même. Voye^ dans nos PL. de Mufiq, un air noté par ces
nouveaux caractères. (S)
Note sensible , en Mufique, eft celle qui eft une
tierce majeure au deffus de la dominante , ou un
femi-ton au-deffous de la tonique. Le f i eft note
fenfible dans le ton A'ut, le fo l dièfe dans le ton mineur
de la.
On l’appelle note fenfible, parce qu’elle fait fentif
le ton & la tonique , fur laquelle, après l’accord
dominant, elle eft même obligée de monter , ce qui
fait que quelques-uns traitent cette note fenfible de
diffonance majeure.
Je n’ai point dit que la note fenfible eft la feptiegje
note du ton , parce qu’en mode mineur cette feotse-
me note n’eft note fenfible qu’en montant ; car en defcendant
, elle eft à un ton de la tonique, & à une
tierce mineure de la dominante. Foye^MoDE, T onique
, D ominante , &c. (£)
Nous avions promis de donner ici, d’après M. Rameau
, la raifon pourquoi la note fenfible eft un demi-
ton au-deffous de la tonique. La raifon qu’il en donne
eft que cette note fenfible eft la tierce majeure de la
dominante, qui réfonne dans la dominante , & que
le repos ou cadence parfaite dans la baffe étant la
cadence ou chûre de la dominante à la tonique, le
, repos le plus parfait dans l’échelle diatonique doit
par conféquent Confifter à monter la note fenfible à
cette tonique, moye% mes élémens de Mufique, article
y j , première édition. (O)
Note , fignifie , dans le Commerce, un petit extrait
ou mémorial qu’on fait de quelque chofe pour s’en
mieux fouvenir.
Les agens de change prennent la noie des lettres Sc
billets de change que les marchands ou banquiers ont
à négocier; quelquefois les marchands les leur confient
fur une fimple note lignée d’eux. Pour plus
d’exaftitude , l’agent doit faire toujours la note double
; l’une pour le banquier à qui appartiennent les
lettres & billets, l’autre pour foi-même. Dictionnaire
de Commerce.
Note , veut dire auffi un mémoire, un état. Donnez
moi une note, c’eft-à-dire , un état de ce que je
vous dois. Id. ibid.
N O T É , adj. ( Jürifprud. ) On appelle un komni6
noté, en terme de palais, celui dont l’honneur & la
réputation ontfouffert quelque atteinte , foit par uii
jugement qui à prononcé contre lui quelque peine
qui porte infamie de droit ou de fait, foit par quelque
accufation ou reproche dont il ne s’eft point
lavé. V'oye^ Infamie. ( A ^
NOTER, v. a£h c’eft écrire de la mufique avec
des caraftcres deftinés à cet ufage, & appelles nous»
Voye{ N o t e s .
I i ij