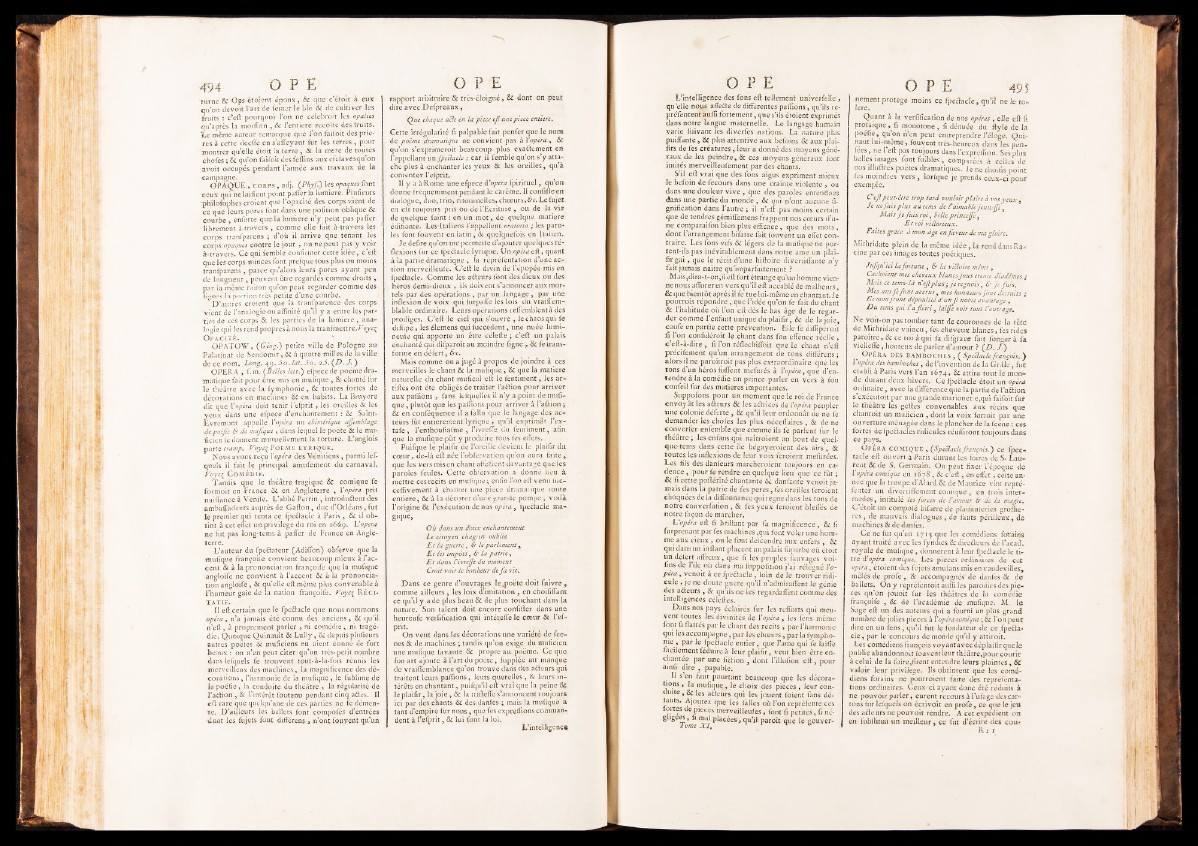
turne & Ops ëtèient époux, 6c que c’étoît à eux
qu’on devoit Part de feiner le blé 6c de cultiver les
fruits : c’eft pourquoi Ton ne célebroit les opalies
qu’après la moiffon , 6c l’entiere récolté des fruits.
Le même auteur remarque que l’on faifoit des prières
à cette déeffe en s?affeyant fur les terres , pour
montrer qu’elle étoit la terre, & la mere déroutes
chofes ;& qu?on faifoit des feftins aux efclaves qu’on
•avoir occupés pendant l’année aux travaux de la
campagne. E
OPAQUE , CORPS , adj. (Phyfi) les opaques font
ceux qui ne laiflent point paffer la lumière. Plulieurs
philofophes croient que l’opacité des corps vient de
ce que leurs pores font dans une pofition oblique 6c
courbe , enforte que* la lumière n’y peut pas paffer
librement à-travers , comme elle fait à-travers les '
corps tranfparens ; d’où il arrive que teftaht les
corps opaques contre le jour , on-ne.peut pas y voir
à-travers. Ce qui femble confirmer cette idée, c ’eft
que les corps minces font prefque tousplus ou moins
tranfparens , parce qu’alors leurs pores ayant peu
de longueur , peuvent être regardés comme droits ,
par la même railon qu’on peut regarder comme des
lignes la.portion très-petite d’ une courbe.
D ’autres croient que la tranfparence des corps
vient de l’analogie ou affinité qu’il y a entre les parties
de ces corps & les parties de la lumière, analogie
qui les rend propres à nous la tranfmettre.-^oye^;
Op a c it é .
O P A T O V , ( Géog.) petite ville de Pologne au
Palatinat de Sendomir, 6c à quatre milles de la v ille
de ce -nom. Long. 4$. 5 o. lat. 60. a.5 . (.D . J. )
OPERA , l.m. ( B e l l e s l e t t .) efpecede poëme dramatique
fait pour être mis en mufique , & chanté fur
le théâtre avec la fymphonie, 6c toutes fortes de
décorations en machines- 6c en habits. La Bruyere
dit que 1 '‘ o p é ra doit tenir l’efprit, les oreilles & les
yeux dans une efpece d’enchantement : 6c Saint-
Evremont appelle Y o p é ra un c h im é r iq u e a fem b la g e
■ de p o è jie & d e m u j îq u e , dans lequel le poëte & le milicien
fe donnent mutuellement la torture. L’anglois
porte c ram p . V o y e { POEME LYRIQUE.
Nous avons reçu l’opéra des Vénitiens , parmi lef-
quels il fait le principal amufement du carnaval.
Voye^ C om éd ie .
Tandis que le théâtre tragique & comique fe
formoit en France 6c en Angleterre , l’opéra prit
naiffance à Venife. L’abbé Perrin , introducteur des
-ambaffadeurs auprès de Gafton, duc d’Orléans, fut
le premier qui tenta ce fpe&acle à Paris , 6c il obtint
à cet effet un privilège du roi en 1669. \J opéra
ne fut pas. long-tems à paffer de France en Angleterre.
L’auteur du fpeâateur (Adiffon) obferve que la
mufique françoife convient beaucoup mieux à l’accent
& à la prononciation françoife que la mufique
angloife ne convient à l’accent & à la prononciation
angloife, & qu’elle eft même plus convenable à
l’humeur gaie de la nation françoife. Foye^_ Ré c it
a t if .
Il eft certain que lé fpe&acle que nous nommons
opéra, n’a jamais été connu des anciens, 6c qu’il
n’e ft , à proprement parler , ni comédie , ni tragédie.
Quoique Quinault & Lu lly, 6c depuis plufieurs
autres poëtes & muficiens en aient donné de fort
beaux : on n’en peut citer qu’un très-petit nombre
dans lefquels fe trouvent tout-à-Ia-fois réunis les
merveilleux des machines, la magnificence des décorations
, l’harmonie de la mufique , le. fublime de
la poéfie, la conduite du théâtre , la régularité de
l’a&ion , & l’intérêt foutenu pendant cinq aftes. Il
eft- rare que quelqu’une de ces parties ne le démente.
D ’ailleurs les ballets font compofés d’entrées
dont les fujets font différens, n’ont fouvent qu’un
rapport arbitraire & très-éloigné, & dont on peut
dire avec D efpreaux,
Que chaque acte en la piece ejl unepiece entière.
Gette irrégularité fi palpable fait penfer que le nom
de poème dramatique ne convient pas à l’opéra, &
qu’pn s’exprimeroit beaucoup plus exactement en
l ’appellant un Jpeclacle : car il femble qu’on s’y attache
plus à enchanter les yeux & les oreilles, qu’à
contenter l’efprit.
Il y 'a à Rome une efpece d’o/’e/vz fpirituel, qu’on
'donne fréquemment pendant le carême. Il confilteen
dialogue, duo, trio, ritournelles, choeurs,&c. Le fujet
en eft toujours pris ou de l’Ecriture , ou de la vie
de quelque faint : en un mot, de quelque matière
édifiante. Les‘Italiens Tappeilent oratorio ; les paroles
font fouvent en latin, & quelquefois en Italien.
-Je defire qu’on me permette d’ajouter quelques ré^
flexions fur ce Ipeétacle lyrique. Un opéra eft, quant
à la partie dramatique , la répréfentation d’une ac-;
tion merveilleufe. C ’eft le divin de l’épopée mis en
fpeâacle. Comme les afteurs font des dieux ou des
héros demi-dieux , ils doivent s’annoncer aux mortels
par des opérations , par un langage, par une
inflexion de voix qui furpaffe les lois du vraiflem-
blable ordinaire. Leurs opérations reffemblent à des
prodiges. C ’eft le ciel qui s’ouvre , le chaos qui fe
diflipe > les élemens qui fuccedent, une nuée lumi-
neule qui apporte un être célefte ; c’eft un palais
enchanté qui difparoît au moindre ligne , 6c fe transforme
en défert, 6*c.
Mais comme on a jugé à propos de joindre à ces
merveilles le chant & la mufique, 6c que la matière
naturelle du chant mufical eft le fentiment, les ar-
tiftes ont été obligés de traiter l’a&ion pour arriver
aux pallions -, fans lefquelles il n’y a point de mufique
, plutôt que les pallions pour arriver à l’aCtion ;
6c en conféquence il a fallu que , le langage des acteurs
fût entièrement lyrique , qu’il exprimât Tex-
ta fe , l’enthoufiafme , l’ivreffe du fentiment, afin
que la mufique pût y produire tous les effets.
Puifque le plaifir de l’oreille devient le plaifir du
coeur, de-là eft née l’obfervation qu’on aura faite ,
que les vers mis en chant aftè&ent davantage que les
paroles feules. Cette obfervati'on a donné lieu à
mettre ces récits en mufique; enfin l’on eft venu lue-
ceflivement à chanter une piece dramaiique ro,ute
entière, & à la décorer d’une grande pompe ; voilà
l’origine 6c l’exécution de nos opéra, Ipeûacle magique,
Où dans un dôùx enchantement
Le citoyen chagrin oublie
Et la guerre, & le parlement,
Et les impôts, & la patrie,
E t dans livrejfe du moment
'Croit voir le bonheur de fa vit.
Dans ce genre d’ouvrages le«poëte doit fuivre é
comme ailleurs , les loix d’imitation , en choififlànt
ce qu’il y a de plus beau 6c de plus touchant, dans la
nature. Son talent doit encore confifter dans une
heureufe verfification qui intéçeffe le coeur & l’efprit
.O
n veut dans les décorations une variété de fee-
nes & de machines ; tandis qu’on exige du muficien
une mufique lavante 6c propre au poëme. Ce que
fon art ajoute à l’art du poëte, fupplée au manque
de vraiffemblance qu’on trouve dans des aéteurs qui
traitent leurs pallions, leurs querelles , & leurs intérêts
en chantant, puifqu’il eft vrai que la peine 6c
le plaifir, la joie, & la trifteffe s’annoncent toujours
ici par des chants 6c des danfes ; mais la mufique a
tant d’empire fur nous, que fes expreffions commandent
à l’efprit, 6c lui font la loi.
L ’intelligence
L’intelligence des fons eft tellement univerfeile,
qu’elle nous affeCte de différentes pallions, qu’ils re-
préfentent auflî fortement, que s’ils étoient exprimés
dans notre langue maternelle. Le langage humain
varie fuivant les diverfes nations. La nature plus
puiffante, 6c plus attentive aux befoins 6c aux plaisirs
de fes créatures, leur a donné des moyens généraux
de les peindre, & ces moyens généraux font
imités merveiileufement par des chants.
S’il eft vrai que des fons aigus expriment mieux
le befoin de fecours dans une crainte violente , ou
dans une douleur vive , que des paroles entendues
dans une partie du monde , & qui n’ont aucune fi-
gnification dans l’autre ; il n’eft pas moins certain
que de tendres gémiffemens frappent nos coeurs d’une
comparaifon bien plus efficace , que des mots ,
dont l’arrangement bifarre fait fouvent un effet contraire.
Les ion s vifs 6c légers de la mufique ne portent
ils pas inévitablement dans notre ame un plaifir
g a i , que le récit d’une hiftoire divertiffante n’y
fait jamais naître qu’imparfaitement ?
Mais,dira-t-on,il eft fort étrange qu’un homme vienne
nous a ffurer en vers qu’il eft accablé de malheurs,
& que bientôt après il fe tue lui-même en chantant. Je
pourrois répondre, que l’idée qu’on fe fait du chant
& l’habitude où l’on eft dès le bas âge de le regarder
comme l’enfant unique du plaifir, 6c de la joie,
caufe en partie cette prévention. Elle fe diflîperoit
fi l’on confidéroit le chant dans fon effence réelle ,
c ’eft-à-dire , fi l’on réflechiffoit que le chant n’eft
précisément qu’un arrangement de tons différens ;
alors il ne paroîtroit pas plus extraordinaire que les
vtons d’un héros fuffent mefurés à Y opéra, que d’entendre
à la comédie un prince parler en vers à fon
confeil fur des matières importantes.
Suppofons pour un moment que le roi de France
envoyât les aÛeurs & les aftriçes de Y opéra peupler
une colonie déferte , 6c qu’il leur ordonnât de ne fe
demander les chofes les plus néceffaires , & de ne
converfer enfemble que-comme ils fe parlent fur le
théâtre ; les enfans qui naîtroient au bout de quel-
que-tems dans cette île bégayeroient des airs, &
toutes les inflexions de leur voix feroient mefurées.
Les fils des danfeurs marcheroient toujours en cadence
, pour fe rendre en quelque lieu que ce fût ;
& fi cette poftérité chantante 6c danfante venoit jamais
dans la patrie de fes peres, fes oreilles feroient
choquées de la diffonnance qui régné dans les tons de
notre converfation , & fes yeux feroient bleffés de
notre façon de marcher.
L 'opéra eft fi brillant par fa magnificence, & fi
furprenant par fes machines ,qui font voler une homme
aux d e u x , ou le font defeendre aux enfers , 6c
qui dans un inftant placent un palais fuperbe où étoit
un défert affreux, que fi les peuples fauvages voi-
fins de l’île où dans ma fuppofition j’ai rélégué Yo-
pera, venoit à ce fpeftacle, loin de le trouver ridicule
, je ne doute guere qu’il n’admiraflent le génie
des aéteurs , & qu’ils ne les regardaflent comme des
intelligences céleftes.
Dans nos pays éclairés fur les refforts qui meuvent
toutes les divinités Ae Y opéra , les fens même
font fi flattés par le chant des récits , par l’harmonie
qui les accompagne, par les choeurs, parla fymphonie
, par le fpeâacle entier, que l’ame qui fe laiffe
facilementféduireà leur plaifir, veut bien être enchantée
par une fiélion , dont l’illufion e f t , pour
ainfi dire , papable.
Il s’en faut pourtant beaucoup que les décorations
, la mufique, le choix des pièces , leur con-
uite, 8c les aâeurs qui les jouent foient fans défauts.
Ajoutez que les falles où l’on repréfente ces
lottes de pièces merveilleufës, font fi petites, fi né-
g igees,^fi mal placées, qu’il paroît que le gouyernemeftt
protégé moins ce fpedacîe, qn’ii ne le toléré.
Quant à la verfification de nos opéras , elle eft fi
profàique fi monotone , fi dénuée du ftyle de la
poefie, qu on n’en peut entreprendre l’éloge. Qui-
naut lui-même, fouvent très-heureux dans les pen-
fées, ne l’eft pas toujours dans l’expreflion. Ses plus
belles images font foibles, comparées à celles de
nos illuftres poëtes dramatiques. Je ne choifis point
fes moindres vers , lorfque je prends ceux-ci pour
exemple.
C’efl peut-etre trop tard vouloir plaire à vos yeux
Je ne fuis plus au terns de Caimable jeuntffï,
Mais je fuis roi, belle princejfe9
E t roi victorieux.
Faites grâce a mon âge en faveur de mà gloire.
Mithridate plein de la même idée, la rend dans Ra»'
cine par ces images toutes poétiques.
Jufqiï ici la fortune, & la victoire même ,
Cachoient mes cheveux blancs fous trente diadèmes $
Mais ce tems-là rYejl plus; je regnois, & je fuis.
Mes ansJe font accrus, mes honneurs font détruits ;
Et mon front dépouillé d’un f i noble avantage ,
D u tems qui l’a flétri , laiffe voir tout L’outrage.
Ne voit-on pas tomber tant de couronnes de la tête
de Mithridate vaincu, fes cheveux blancs, fes rides
paroître, 6c ce roi à qui fa difgrace fait fonger à fa
vielleffe, honteux de parler d’amour ? (Z>. /.)
> O péra des BAMBOCHES , ( Spectacle françois. )
1 opéra des bamboches, de l’invention de la Gr.ile, fut
établi a Paris vers l’an 1674, 6c attira tout le monde
durant deux hivers. Ce fpedacle étoit un opéra
ordinaire, avec la différence que la partie de l’aôion
s executoit par une grande marionetie,qui faifoit fur
le théâtre les geftes convenables aux récits que
chantoit un muficien , dont la voix fortoit par une
ouverture ménagée dans le plancher de lafeene : ces
fortes de fpeélacles ridicules réufliront toujours dans
ce pays.
Opéra com iq ue , (Spectacle françois J) ce fpec-
tacle eft ouvert à Paris durant les foires de S. Laurent
& de S. Germain. On peut fixer l’époque de
1 opéra comique en 1 6 7 8 ,6c c’e ft , en e ffet, cette année
que la troupe d’Alard 6c de Maurice vint représenter
un divertiffement comique, en trois intermèdes,
intitule les forces de l ’amour & de la magie.
C ’étoit un compofé bifarre de plaifanteries groffie-
res, de mauvais dialogues , de fauts périlleux, de
machines & de danfes.
Ce ne fut qu’en 1715 que les comédiens foïains
ayant traité avec les fyndics 6c dire&eurs de l’acad.
royale de mufique, donnèrent à leur fpeftacle le titre
d’opéra comique. Les pièces ordinaires de cct
opéra, étoient des fujets amufans mis en vaudevilles,
mêlés de profe , & accompagnés" de danfes & de
ballets. On y rep réfentoit aufli les parodies des pièces
qu’on jouoit fur les théâtres de la comédie
françoife , 6c de l’académie de mufique. M. le
Sage eft un des auteurs qui a fourni un plus grand
nombre de jolies pièces à Y opéra comique ; 6c l ’on peut
dire en un fens, qu’il fut le fondateur de ce fpeûa-*
c le , par le concours de monde qu’il y attiroit.
Les comédiens françois voyant avec déplaifir que le
public abandonnoit fouvent leur théâtre,pour courir
à celui de la foire,firent entendre leurs plaintes , 6c
valoir leur privilège. Ils obtinrent que les comédiens
forains ne pourroient faire des repréfenta-
tions ordinaires. Ceux-ci ayant donc été réduits à
ne pouvoir parler, eurent recours à l’ufage des cartons
fur lefquels on écrivoit en profe, ce que le jeu
des afteurs ne pouvoit rendre. A cet expédient on
en fubftirua un meilleur, ce fut d’écrire des cou*
R r r