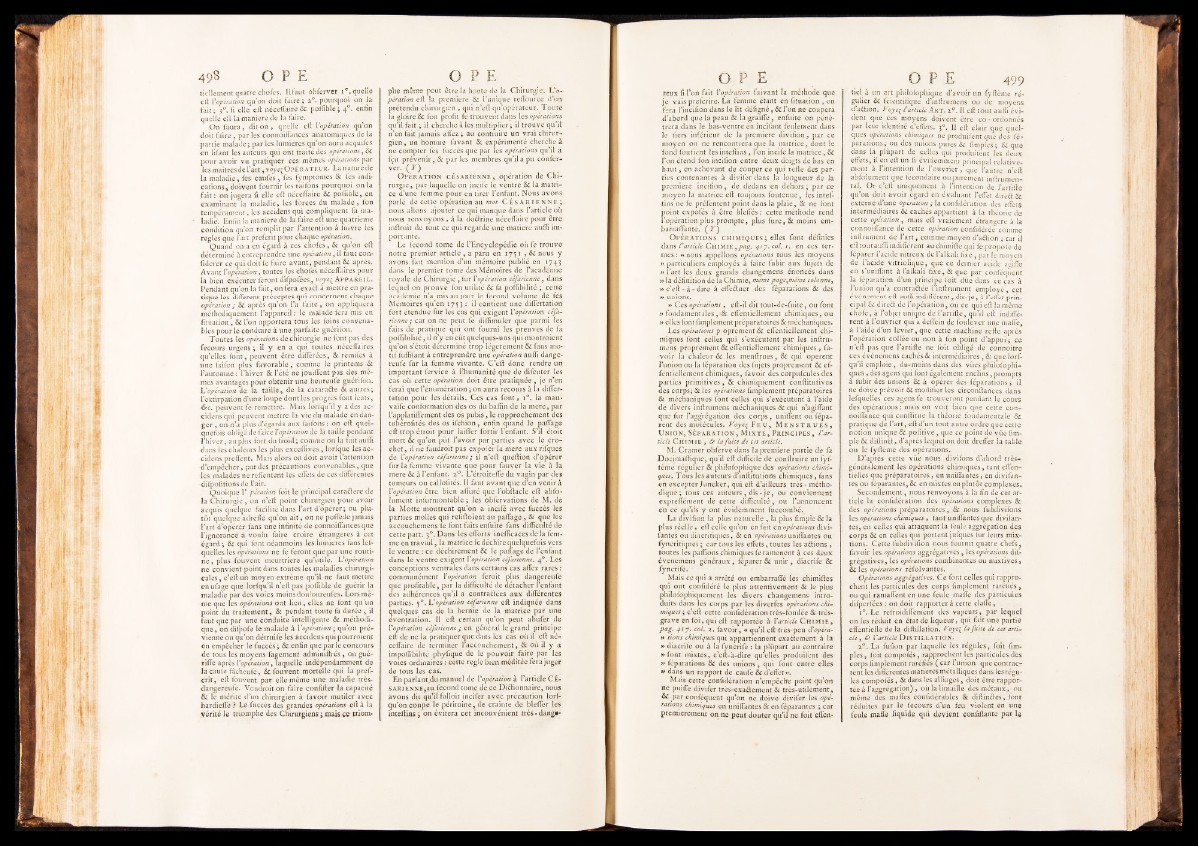
tiellementquatrechofes. Ilfaut obferver laq u e lle
eft l’opération qu’on doit faire ; z°. pourquoi on la
fait ; 3°. fi elle eft néceflaire 6c poflible ; 40. enfin
quelle eft la maniéré de la faire.
On faura, dit-on, quelle eft l'opération qu’on
doit faire , par les connoiflances anatomiques de la
partie malade; par les lumières qu’on auraacquifes
en lifant les auteurs qui ont traité des opérations, 6c
pour avoir vu pratiquer ces mêmes opérations par
lesmaîtresdel’art,voye{OPÉRATEUR. La nature de
la maladie, fes caufes , fes fymptomes & les indications,
doivent fournir les raifons pourquoi on la
fait : on jugera fi elle eft néceflaire &c pofiible, en
examinant la maladie, les forces du malade , fon
tempérament, les accidens qui compliquent fa maladie.
Enfin la maniéré de la faire eft une quatrième
condition qu’on remplit par l’attention à fuivre les
réglés que l’art prefcrit pour chaque opération.
Quand on a eu égard à ces chofes, & qu’on eft
déterminé à entreprendre une opération, il faut con-
fiderer ce qui doit fe faire avant, pendant 6c après.
Avant l'operation, toutes les chofes néceflaires pour
la bien exécuter feront difpofées, voye{ Ap p a r e il .
Pendant qu’on la fait, on fera exaét à mettre en pratique
les differens préceptes qui concernent chaque
opération ; & après qu’on l’a faite, on appliquera
méthodiquement l’appareil : le malade fera mis en
fituation, 6c l’on apportera tous les foins convenables
pour le conduire à une parfaite guérifon.
Toutes les opérations de chirurgie ne font pas des
fecours urgens ; il y en a qui toutes néceflaires
qu’elles font, peuvent être différées, & remifes à
une faifon plus favorable, comme le printems &
l’automne : l’hiver & l’été ne jouiffent pas des memes
avantages pour obtenir une heureufe guérifon.
L 'opération de la taille, de la cataratte & autres ;
l’extirpation d’une loupe dont les progrès font lents,
&c. peuvent fe.remettre. Mais lorfqu’il y a des ac-
'cidens qui peuvent mettre la vie du malade en danger
, on n’a plus d’égards aux faifons : on eft quelquefois
obligé de faire l'opération de la taille pendant
l’hiver, au plus fort du froid; comme on la fait aufli
dans les chaleurs les plus exceflives , lorfque les accidens
preflent. Mais alors on doit avoir î’attention
d’empêcher, par des précautions convenables, que
les malades ne refi’entent les effets de ces différentes
-difpofitions de l’air.
Quoique 1’ péradon foit le principal caraétere de
la Chirurgie, on n’eft point chirurgien pour avoir
acquis quelque facilité dans l’art d’opérer; ou plutôt
quelque adreffe qu’on ait, on ne poffede jamais
l ’art d’opérer fans une. infinité de connoiflances que
l’ignorance a voulu faire croire étrangères à cet
égard ; 6c qui font néanmoins les lumières fans lel-
quelles les opérations ne fe feront que par une routine
, plus fouvent meurtrière qu’utile. U operation
ne convient point dans toutes les maladies chirurgicales
, c’eft un moyen extrême qu’il ne faut mettre
enufage que lorfqu’il n’eft pas pofîible de guérir la
maladie par des voies moins douloureufes. Lors même
que les opérations ont lieu, elles ne font qu’un
point du traitement, & pendant toute fa durée , il
faut que par une conduite intelligente 6c méthodique,
on difpofe le malade à l'opération ; qu’on parvienne
ou qu’on détruife les accidens qui pourroient
en empêcher le fuccès ; 6c enfin que parle concours
de tous les moyens fagement adminiftrés , on gué-
rifle après l'operation, laquelle indépendamment de
la caule fâcheufe , & fouvent mortelle qui la prescrit,
eft fouvent par elle-même une maladie très-
dangereufe. Voudroit on faire confifter la capacité
6c le mérite d’un chirurgien à favoir mutiler avec
hardieffe ? Le fuccès des grandes opérations eft à la
yérité le triomphe des Chirurgiens ; mais ce triomphe
même peut être la honte de la Chirurgie. L V
pération eft la première 6c Tunique reffource d’un
prétendu chirurgien, qui n’eft qu’opérateur. Toute
fa gloire 6c fon profit fe trouvent dans les opérations
qu’il fait ; il cherche à les multiplier ; il trouve qu’il
n’en fait jamais affez ; au contraire un vrai chirurgien
, un homme favant & expérimenté cherche à
ne compter fes fuccès que par les opérations qu’il a
fçu prévenir, & par les membres qu’il a pu confer-
ver. ( JT)
O p ér a t io n c é sar ien n e , opération de Chirurgie,
par laquelle on incife le ventre 6c la matrice
d’une femme pour en tirer l’enfant. Nous avons
parlé de cette opération au mot C é s a r i e n n e ;
nous allons ajouter ce qui manque dans l’article oii
nous renvoyons , à la dottrine néceflaire pour être
inftruit de tout ce qui regarde une matière aufli importante.
Le fécond tome de l’Encyclopédie où fe trouve
notre premier article , a paru en 1751 , 6c nous y
avons fait mention d’un mémoire publié en 1743
dans le premier tome des Mémoires de l’académie
royale de Chirurgie, fur l'opération céfarienne, dans
lequel on prouve fon utilité 6c fa poffibilité ; cette
académie n’a mis au jour le fécond volume de fes
Mémoires qu’en 1753 : il contient une differtation
fort étendue fur les cas qui exigent l'opération céfarienne
; car on ne peut fe diflimuler que parmi les
faits de pratique qui ont fourni les preuves de fa
poffibilité, il n’y en eût quelques-uns qui montroient
qu’on s’étoit déterminé trop légèrement 6c fans motif
fuffilant à entreprendre une opération aufli dange-
reufe fur la femme vivante. C ’eft donc rendre un
important fervice à l’humanité que de difeuter les
cas où cette opération doit être pratiquée, je n’en
ferai que l’énumération ; on aura recours à la diflertation
pour les détails. Ces cas font, i° . la mau-
vaife conformation des os du baffin de la mere, par
l’applatiffement des os pubis, le rapprochement des
tubérofités des os ifehion, enfin quand le paflage
eft trop étroit pour laiffer fortir l’enfant. S’il étoit
mort & qu’on pût l’avoir par parties avec le crochet,
il ne faudroit pas expofer la mere aux rifques
de l’opération céfarienne; il n’eft queftion d’opérer
fur la femme vivante que pour fauver la vie à la
mere 6c à l’enfant. z°. L’étroiteffe du vagin par des
tumeurs ou callofités. Il faut avant que d’en venir à
Topération être bien afluré que l’obftacle eft abfo-
Iument infurmontable ; les obfervations de M. de
la Motte montrent qu’on a incifé avec fuccès les
parties molles qui refiftoient au paflage, & que les
accouchemens le font faits enfuite fans difficulté de
cette part. 30. Dans les efforts inefficaces de la femme
en travail, la matrice fe déchire quelquefois vers
le ventre : ce déchirement 6c le paflage de l’enfant
dans le ventre exigent l'opération céfarienne. 40. Les
conceptions ventrales dans certains cas affez rares :
communément l’opération feroit plus dangereufe
que profitable, par la difficulté de détacher l’enfant
des adhérences qu’il a contraûées aux différentes
parties. 50. L'opération céfarienne eft indiquée dans
quelques cas de la hernie de la matrice par une
éventration. Il eft certain qu’on peut abufer de
M opération céfarienne ; en général le grand principe
eft de ne la pratiquer que dans les cas où il eft né-
ceffaire de terminer l’accouchement, & où il y a
impoffibilité phyfique de le pouvoir faire par les
voies ordinaires : cette réglé bien méditée fera juger
de tous les cas.
En parlantdu manuel de Topération à l’article CÉr
s arienne,au fécond ton# de ce Dictionnaire, nous
avons dit qu’il falloit incifer avec précaution lôrf-
qu’on coupe le péritoine, de crainte de bleffer les
inteftins; on évitera cet inconvénient très-dangiïeux
fi l’on fait l'opération fuivant la méthode que
je vais preferire. La femme étant en fituation , on
fera l’incifion dans le lit défigné, 6c Ton ne coupera.
d’abord que la peau & la graiffe, enfuite on pénétrera
dans le bas-ventre en incifant feulement dans
le tiers inférieur de la première divifion 3 par ce
moyen on ne rencontrera que la matrice, dont le
fond foutient les inteftins , l’on incife la matrice, 6c
l’on étend fon incifion entre deux doigts de bas en
haut, en achevant de couper ce qui refte des parties
contenantes à divifer dans la longueur de la
première incifion , de dedans en dehors ; par ce
moyen la matrice eft toujours foutenue, les inteftins
ne fe préfentent point dans la plaie, & ne font
point expofés à être bleffés : cette méthode rend
l’opération plus prompte, plus fure, & moins em-
barraffante. ( T )
O perations ch im iq u e s ; elles font définies
dans L'article C h im ie , pag. 4/7. col. 1. en ces termes
: « nous appelions opérations tous les moyens
». particuliers employés à faire fubir aux fujets de
» l’art les deux grands changemens énoncés dans
» la définition de la Chimie, même page,même colonne,
» c’eft - à - dire à effectuer des féparations & des
» unions.
» Ces opérations, eft-il dit tout-de-fuite, ou font
» fondamentales ,*& effentiellement chimiques, ou
» elles font Amplement préparatoires & méchaniques.
Les opérations p:oprement 6c effentiellement chimiques
font celles qui s’exécutent par les inftru-
mens proprement 6c effentiellement chimiques, favoir
la chaleur 6c les menftrues, 6c qui opèrent
l’union ou la féparation des fujets proprement 6c ef- .
fentiellement chimiques, favoir des corpufcules des
parties primitives, & chimiquement conftitutives
des corps; & les opérations Amplement préparatoires
& méchaniques font celles qui s’exécutent à l’aide
de divers inftrumens méchaniques 6c qui n’agiffant
que fur Taggrégation des corps, unifient ou fépa-
rent des molécules. Voye^ F e u , Me n s t r u e s ,
Un ion, Sé p a r a t io n , Mix t e , Pr in c ip e s , l'ar-
ticle CHIMIE, & la fuite de cet article.
M. Cramer obferve dans la première partie de fa
Docimaftique, qu’il eft difficile de conftruire un fyf-
tème régulier & philofophique des opérations chimiques,
Tous les auteurs d’inftitutions chimiques , fans
en excepter Juncker, qui eft d’ailleurs très - méthodique
; tous ces auteurs , dis - je , ou conviennent
expreffément de cette difficulté, ou l’annoncent
eu ce qu’ils y ont évidemment fuccombé^
La divifion la plus naturelle , la plus Ample & la
plus réelle, eft celle qu’on en fait en opérations divi-
fantes ou diacritiques, & en opérations unifiantes ou
fyncritiques; car tous les effets, toutes les a étions ,
toutes les paflions chimiques fe ramènent à ces deux
évenemens généraux, féparer 6c unir , diacrife &
fyncrife.
Mais ce qui a arrêté ou embarraffé les chimiftes
qui ont confidéré le plus attentivement & le plus
philofophiquement les divers changemens introduits
dans les corps par les diverfes opérations chimiques,
c’eft cette confidération très-fondée & très-
grave en foi, qui eft rapportée k l'article C h im ie ,
pag. 41-7. col. z . favoir , « qu’il eft très-peu d'opéra-
» dons chimiques qui appartiennent exactement à la
» diacrife ou à la fyncrife : la plûpart au contraire
»font mixtes, c’eft-à-dire qu’elles produifent des
» féparations & des unions, qui font entre elles
» dans un rapport de caufe & d’effet».
Mais-cette confidération n’empêche point qu’on
ne puiffe divifer très-exaCtement & très^utilement,
oc par conféquent qu’on ne doive divifer les opé~
rations chimiques en unifiantes & en féparantes ; car.
premièrement on ne peut douter qu’il ne. foit effentiel
à un art philofophique d’avoir un fyftème régulier
6c feientifique d’inftrumens ou de moyens
d’aCiion. V ye^ l'article Ar t . z°. Il eft tout aufli évident
que ces moyens doivent être co - ordonnés
par leur identité d’effets. 30. Il eft clair que quelques
operations chimiques ne produifent que des féparations
; ou des unions pures 6c Amples ; 6c que
dans la plûpart de celles qui produifent les deux
effets, il en eft un A évidemment principal relativement
à l’intention de l’ouvrier , que l’autre n’eft
■ abfolument que Secondaire ou purement inftrumen-
tal. Or c’eft uniquement à l’intention de l’artifte
qu’on doit avoir égard en évaluant l’effet direCt &
externe d’une opération ; la confidération des effets
intermédiaires 6c cachés appartient à la théorie de
cette opération, mais eft vraiement étrangère à la
connoillance de cette opération confidérée comme
infiniment de l’art, comme moyen d’aCtion ; car il
eft tout aufli indifférent auchimifte qui fe propofe de
féparer l’qcide nitreux de Talkali fixe , par le moyen
de l’acide vitriolique, que ce dernier acide agiffe
en s’unifiant à Talkali fixe, & que par conféquent
la féparation d’un principe foit dûe dans ce cas à
l ’union qu’a contractée l’inftrument employé , cet
événement eft aufli indifférent, dis-je, à i’effet principal
6c direCt de l’opération, ou ce qui eft la même
chofe, à l’objet unique de l ’artifte, qu’il eft indifférent
à l’ouvrier qui a deffein de foulever une maffe,
à l ’aide d’un levier, que cette machine refte après
l’opération collée ou non à fon point d’appui; ce
n’eft pas que Tartifte ne foit obligé de connoître
ces événemens cachés & intermédiaires , & que lorfqu’il
emploie, du-moins dans des vûes philofophi-
ques, des agens qui font également enclins, prompts
à fubir des unions 6c à opérer des féparations, il
ne doive prévoir 6c modifier les circonftances dans
lefquelles ces agens fe trouveront pendant le cours
des opérations : mais on voit bien que cette con-
noiffance qui conftitue la théorie fondamentale 6c
pratique de l’art, eft d’un tout autre ordre que cette
notion unique 6c pofitive, que ce point de vûe Ample
6c diftind, d’après lequel on doit dreflèr la table
ou le fyftème des opérations.
D ’après cette vûe nous divifons d’abord très-
généralement les opérations chimiques, tant effen-
tielles que préparatoires, en unifiantes, en divifan-
tes ou féparantes, 6c en mixtes ou plutôt complexes.
Secondement, nous renvoyons à la fin de cet article
la confidération des opérations complexes &
des opérations préparatoires, 6c nous fubdivifons
les opérations chimiques, tant unifiantes que divifan-
tes, en celles qui attaquent la feule aggrégation des
corps & en celles qui portent jufques lur leurs mixtions.
Cette fubdivifion nous fournit quatre chefs,
favoir les opérations aggrégatives, les opérations dif-
grégatives, les opérations combinantes ou mixtives,
6c les opérations réfolvantes.
Opérations aggrégatives. Ce font celles qui rapprochent
les particules des corps Amplement raréfiés,
ou qui ramaffent en une feule maffe des particules
difp.erfées : on doit rapporter à cette claffe,
i°. Le refroidiffement des vapeurs, par lequel
oh les réduit en état de liqueur, qui fait une partie
efléntielle de la diftillation. Voye{ la fuite de cet article
& l'article DISTILLATION.
z°. La fufion par laquelle les régules, foit Amples
, foit compofés, rapprochent les particules des
corps Amplement raréfiés ( car l’union que contracr
tent les différentes matières métalliques dans les régules
compofés, &dan$les.alliag>es, doit être rapportée,
à l’aggrégation) , où la limaille des métaux, ou
même des maffes confidérables & diftinéles, font
réduites par le fecours d’un feu violent en une
feule maffe liquide qui devient confiftante par 1@