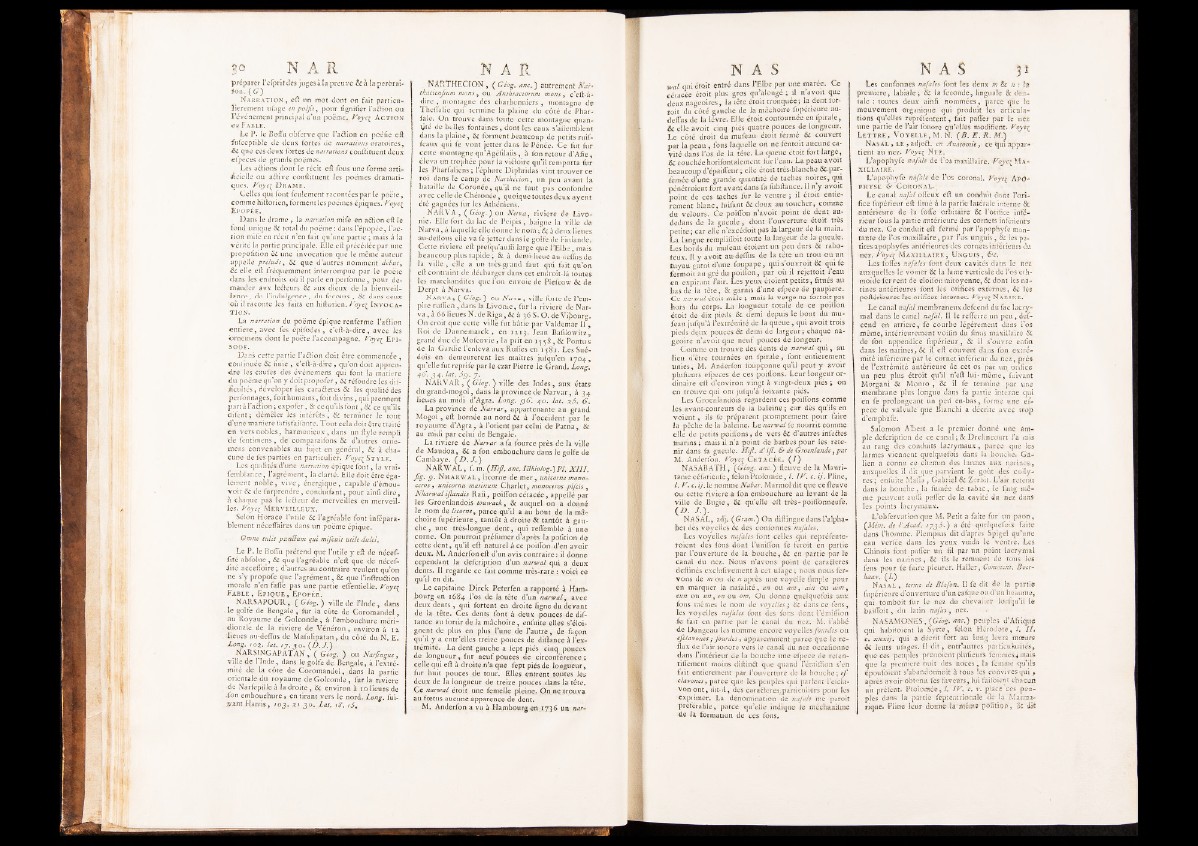
N A R N A R
préparer l’efprit dés juges à la preuve & à ïaperôrai-
Narration, eft un mot dont on fait particulièrement
ufage en poéjie, pour fignifier l’a&ion ou
l ’événement principal d’un poëme, Voye^ Action
ou Fable.
Le P. le BoiTu obferve que l’a&ion en poéfie eft
fufceptible de deux fortes de narrations oratoires,
Si que ces deux fortes de narrations conrtituent deux
efpeces de grands poëmes.
Les actions dont le récit eft fous une forme artificielle
ou a&ive conftituent les poëmes dramatiques.
Voye{ D rame.
Celles qui font feulement racontées par le poëte,
comme hiltorien, forment les poëmes épiques. Voye[
Epopée.
Dans le drame , la narration mife en aélion eft le
fond unique & total du poëme : dans l’épopée, Faction
mife en récit n’en fait qu’une partie ; mais à la
vérité la partie principale. Elle eft précédée par une
propofition Si une invocation que le même auteur
appelle prélude, Si que d ’autres nomment début,
Si elle eft fréquemment interrompue par le poëte
dans les endroits où il parle en perfonne, pour demander
aux le&eurs & aux dieux de la bienveillance,
de l’indulgence, du fecours, Si dans ceux
où il raconte les faits en hiftorien. Voye^ Invocation.
La narration du poëme épique renferme l’aôion
entière, avec fes épifodes, c’eft-à-dire, avec les
bfnemens dont le poëte l’accompagne. Voye^ Episode.
Dans cette partie l’a&ion doit être commencée ,
continuée Si finie , c’eft-à-dire, qu’on doit apprendre
les caufès des événemens qui font la matière
«du poëme qu’on y doit propofer , & réfoudre les difficultés,
déveloper les cara&eres & les qualité des
perfonnages, foit humains, foit divins, qui prennent
part à l’a&ion ; expofer, & ce qu’ils fon t, Si ce qu’ils
ciifent ; démêler les intérêts, Si terminer le tout
d’une maniéré fatisfaifante. Tout cela doit être traité
en vers nobles, harmonieux, dans un ftyle rempli
de fentirnens, de comparaifons Si d’autres orne-
mens convenables 311 fujet en général, & à chacune
de fes parties en particulier. Voyeç St y l e .
Les qualités d’une narration épique font, la vrai-
femblance, l’agrément, la clarté. Elle doit être également
noble, v iv e , énergique, capable d’émouvoir
& de furprendre, conduifant, pour ainfi dire,
à chaque pas le leûeur de merveilles en merveilles.
Voyei Merveilleux.
Selon Horace l’utile Si l’agréable font infépara-
blement néceflaires dans un poëme épique.
Gmnt tulit pitnclum qui mifeuit utile dulci.
Le P. le Boflù prétend que l’utile y eft de nécef-
fité abfolue , Si que l’agréable n’ell que de nécef-
ü té accefloire; d’autres au contraire veulent qu’on
ne s’y propofe que l’agrément, Si que l’inftruftion
morale n’en faffe pas une partie effentielle. Voye^
Fable, Epique, Epopée.
Na RSAPOLJR , (G eog .) ville de l’Inde, dans
le golfe de Bengale , fur la côte de Coromandel,
au Royaume de Golconde ; à l’embouchure méridionale
de la riviere de Vénéron, environ à 12
lieues au-deflùs de Mafulipatan, du côté du N. E.
Long. IOZ. lat. 1 y . j o. (D . J .) ,
NARSINGAPATAN, ( Géog. ) ou Narfîngue,
ville de l’Inde^, dans le golfe de Bengale, à l’extré-
mite de la côte de Coromandel^$dans la partie
orientale du royaume de Golconde, fur la riviere
de Narfepille à la droite, Si. environ à 10 lieues de
Ton embouchure, en tirant vers le nord. Long, fui-
®,ant Harris, 103. 21 3 0 . Lat. 1$.
NAR THECION , ( Géog. anc. ) autrement ffar*
tkacienfium nions, ou Anthraceorum morts, c’eft-à-j
dire , montagne des charbonniers , montagne de
Theflalie qui termine la plaine du côté de Phar-
fale-. On trouve dans toute cette montagne quantité
de belles fontaines, dont les eaux s’afiemblent
dans la plaine, & forment beaucoup de petits ruif-
feaux qui fe vont jetter dans le Pénée. Ce fut fur
cette montagne qu’Agéfiiaiis, à fon retour d’Afie,
éleva un trophée pour la vi&oire qu’il remporta fur
les Pharfaliens ; l’éphore Diphridas vint trouver ce
roi dans le camp de Nartkécionf un peu avant la.
bataille de Coronée, qu’il ne taut pas confondre
avec celle de Chéronée, quoique toutes deux ayent
été gagnées fur les Athéniens.
, N A R V A , ( Géog. ) ou N er va, riviere de Livonie.
Elle fort du lac de Peipis , baigne la ville de
Narva, à laquelle elle donne le nom ; Si à deux lieues
au-deftous elle va fe jetter dans le golfe de Finlande*
Cette riviere eft prefqu’aufii large que l ’Elbe, mais
beaucoup plus rapide ; & à demi-lieue au-iieflùs de
la v ille , elle a un très-grand faut qui fait qu’on
eft contraint de décharger dans cet endroit-là toutes
les marchandifes que l’on. envoie de Plefcow Si de
Derpt à Narva.
Na r v a , ( Géog. ) ou Nerv a , ville forte de l ’empire
ruflien , dans la Livöiiie, für la riviere de Narv
a , à 66 lieues N. de Riga, & à 36 S. Ö. de Vibourg.
On croit que cette ville fut bâtie par Valdeniar II ,
Roi de Dannemarck, en 1213. Jean Bafilowitz,
grand duc de Mofcovie, la prit en 15 58, Si Pontu s
de la Gardie l’enleva aux Rufies en 1581. Les Suédois
en demeurèrent les maîtres jufqu’en 1704,
qu’elle fut reprife par le czar Pierre le Grand. Long.
4 f . g 4. lat. 5g . y.'
NARVAR, ( Géog. ) ville des Indes, aux états
du grand-mogol, dans la province de Narvar, à 34
lieues au midi d’Agra. Long, g G. 40. lat. z 5. G.
La province de Narvar, appartenante au grand.
Mogol, eft bornée au nord Si à l’occident par le
royaume d’Agra, à l’orient par celui de Patna, &
au midi par celui de Bengale.
La riviere de Narvar a fa fource près de la ville
de Maudoa, Si a fon embouchure dans le golfe de
Cambaye. ( D . J . )
NARWAL, f. m. (Hiß. anc. Icthiolog.) PI. X I I I .
fig. g . Nh a r v a l , licorne de mer, uniçorne mono-
ceros, unicornu marinum Charlet, monoçeros pij'cis 9
Nharwal ißandis Ra ii, poiflon cétacée, appellé par
les Groenlandois touwaek, & auquel on a donné
le nomde licorne 9 parce qu’il a au bout de la mâchoire
fupérieure, tantôt à droite & tantôt à gauche
, une très-longue dent, qui refîëmble à une
corne. On pourroit préfumer d’après la pofition de
cette dent, qu’il eft naturel à ce poiflond’en avoir
deux. M. Anderfon eft d’un avis contraire : il donne
cependant la defeription d’un narwal qui a deux
dents. Il regarde ce fait comme très-rare : voici ce
qu’il en dit.
Le capitaine Dirck Peterfen a rapporté à Hambourg
en 1684 l’os de la tête d’un narwal, avec
deux dents , qui fortent en droite ligne du devant
de la tête. Ces dents font à deux pouces-de dif-
tance au fortir de la mâchoire, enfuite elles s’éloignent
de plus en plus l’une de l’autre ,• de-façon
qu’il y a entr’elles treize pouces de diftance à l ’extrémité.
La dent gauche a lept pies cinq pouces
de longueur, fur neuf pouces :de circonférence.;
celle qui eft à droite n’a que fept piés de longueur y
fur huit pouces de tour. Elles entrent toutes les
deux de la longueur de treize pouces dans la tête.
Ce narwal étoit une femelle pleine. On ne trouva
au foetus aucune apparence de dent.
M, Anderfon a vu à Hambourg en 1736 un nar~
N A S N A S 3 l
wal qui étQit entré dans l’Elbe par une marée. Ce
cétacée étoit plus gros qu’alongé ; il n’avoil que
deux nageoires, la tête étoit tronquée; la dent lor-
toit du côté gauche de la mâchoire fupérieure au-
deflùs de la lèvre. Elle étoit contournée en fpirale,
Si elle avoit cinq piés quatre pouces de longueur.
Le côté droit du mufeau etoit ferme Si couvert
par la peau > fous laquelle on ne fentoit aucune cavité
dans l’os de la tête. La queue étoit fort large,
Si couchée horifontaiement fur l’eau. La peau avoit
beaucoup d’épaifleur ; elle etoit tres-blanche ôi-par-
fexnée d’une grande quantité de taches noires, qui
pénétroient fort avant dans fa fubftance. Il n y avoit
point de ces taches fur le ventre ; il eroit entièrement
blanc, luifant Si doux au toucher, comme
du velours. Ce poiflon n’avoit point dé dent au-
dedans de la güeule, dont l’ouverture etoit très
petite ; car elle n’èxcédoit pas la largeur de la main.
La langue rempliflbit toute la largeur de la gueule.
Les bords du mufeau étoient un peu durs & raboteux.
Il y avoit au-deflùs de la tête un trou ou un
tuyau garni d’une foupape, quisouvroit & qui fe
fermoir au gré du poiflon, par où il rejettoit l’eau
en expirant l’air. Les yeux etoient petits, fitues au
bas de la tête, & garnis d’une efpece de paupière.
Ce narwal étoit mâle ; mais la verge ne fortoit pas
hots du corps. La longueur totale de ce poiflon
étoit de dix pieds Si demi depuis le bout du mu-
fean jufqu’à rextrémité de la queue, qui avoit trois
pieds deux pouces & demi de largeur; chaque nageoire
n’avoit que neuf pouces de longeur.
Comme on trouve des dents de narwal q ui, au
lieu d’être tournées en fpirale, font entièrement
unies, M. Anderfon foupçonne qu’il peut y avoir
plufieurs efpeces de ces poiflbns. Leur longeur ordinaire
eft d’environ vingt à vingt-deux piés ; on
en trouve qui ont jufqu’à loixante piés.
Les Groenlandois regardent ces poiflbns comme
les avant-coureurs de la baleine ; car dès qu’ils en
v o ien t , ils fe préparent promptement pour faire
la pêche de la baleine. Le narwal fe nourrit comme
elle de petits poiflbns, de vers Sa d’autres infeéles
marins; mais il n’a point de barbes pour les retenir
dans fa gueule. Hiß. d'Iß. G de Groenlandt, par
M. Anderfon. Voye^ C e t à c ÉE. ( / )
NASABATH, (Géog. anc.') fleuve de la Mauritanie
céfarienle, félon Ptolomée, l. IV. c. ij. Pline,
/. V. c. ij. le nomme Nabar. Marmol dit que ce fleuve
ou cette riviere a fon embouchure au levant de la
ville de Bugie, Si qu’elle eft très-poiflbnneufe. ■ H H i ■ M NASAL, adj. (Gram.) On diftinguedans l’alphabet
des voyelles Si des confonnes rtufâles.
Les voyelles nafales font celles qui repréfente-
roient des fons dont i’uniflbn fe fèroit en partie
par l’ouverture de la bouche * Si en partie par le
canal du nez. Nous h’avons point de caraâeres
deftinés exclufivement à cet ufage ; hous nous fer-
vons de m ou de n après une voyelle fimple pour
en marquer la nafalité, an ou am, ain ou aim,
tun ou un, on ou orn. On donne quelquefois aux
fons mêmes le nom de voyelles i Si dans ce fens,
les voyelles naj'âles font des fons dont l’émifîion
fe fait en partie par le. canal du nez. M. l’abbé
de Dangeau les nomme encore voyelles Jburdes ou
ejelavones ; Jburdes, apparemment parce que le reflux
de l’air lonore vers le canal du nez occafionne
dans l’intérieur ce la bouche une efpece de retert-
tiflement moins diftinft que quand l’émiflion s’en
fait entièrement par l’ouverture de la bouche; e f
clavones, parce que les peuples qui parlent l’efcla-
von on t, dit-il, des carafteres^particuliers pour les
exprimer. La dénomination de naj'ale me paroît
•préférable, parce qu’elle indique le mcchanifme
file la formation de ces fons.
Les conformes nafàlts font les deux ifi Si h : là
première, labiale; & la fécondé, linguale & dën-
talc : toutes deux ainfi nommées, parce que le
mouvement organique qui produit les articulations
qu’elles repréfentent, fait païlér par le nez
une partie de l’air fonore qu’elles modifient; Voyt^
Lettre, Voyelle, M. N. {B . E . R. M.)
NasaL , le , adjeft. en Anatomit, ce 'qui appartient
ail nez. Voyeç Nez.
L’apophyfe nofult de l’os maxillaire. Voyc{ Maxillaire.
L’apophyfe nafale dé l’os COronal. Voye^ ABÔ-
PHYSE G CoRONAL.
Le canal nafal ofleux eft un conduit dont l’ori*
fice fupérieur eft fitiié à la partie latérale interne &
antérieure de la fofle orbitaire Si l’orifice inférieur
fous la partie antérieure des cornets inferieuts
du nez. Ge conduit eft fermé par l’âpophyfe montante
de l’os maxillaire, par l’os unguis, Si les petites
apôphyfés antérieures dès cornets inférieurs du
nez. Voyei Maxillaire , Unguis , Gc*
Les foflés nafales font deux cavités dans le nez
auxquelles le vomer Si la lame verticale de l’os eth-
moïde fervent de cloifbn mitoyenne, ôc dont les narines
antérieures font les ôtifices externes, Si lés
poftérieures les orifices internes. Voye\ Narine.
Le canal nafal membraneux dëfcend du fac lacrymal
dans le canal nafal. Il le reflerre un peu, descend
en a r r ié r é fè courbe légèrement dans l’os
même, intérieurement voifin du fimis maxillaire &.
de fon appéndiçë fupérieur, & il s’ouvre enfin
dans.les narines, & il eft couvert dans fon extrémité
inférieure par le cornet inférieur du nez, près
de l’extrémité antérieure de. cet os par un orifice
un peu plus étroit qu’il n’eft lui-même, fuivant
Morgani & Monro , & il fe termine par une
membrane plus longue dans fa partie interne qui
en fe prolongeant un peù en-bas, forme une efpece
de valvule que Bianchi a décrite avec trop
d’emphafe.
Salomon Albert a le premier donné une ample
defeription de ce canal ; & Drelincourt l’a mis
au rang des conduits lacrymaux, parce que les
larmes viennent quelquefois dans la bouche-. Galien
a connu ce- chenun des larmes aux narines!,
auxquelles il dit que parvient le goût ries collyres;
enfuite Mafia , Gabriel Si Zerbit. L’air retenu,
dans la bouche 9 la fumée de tabac, le fang même
peuvent aufii palier de la cavité du nez dans
les points lacrymaux.
L’obfervation que M. Petit à faite fur tnt paon,
(Mém. de l'Acad. / y j i . ) a été quelquefois faite
dans rhomme. Plempius dit d’après Spigel qu’une
eau verfée dans les yeux vuida le véntre. Les
Chinois font pafler un fil par un point lacrymal
dans les narines, & ils le remuent de tons les
fens pour fe faire pleurer. Haller, Comment, Boer-
haav, (L)
Nasal , terme de Blafon. Il fe dit de la partie
fupérieure d’ouverture d’un cafque ou d’un heaume,
qui tomboit fur le nez du chevaiiet iorfqu’il lê
baiflbit, du latin nafus -, nez.
NASAMONES , (Géog. anc.) peuples d’Afrique
qui habitoient la Syrte, félon Hérodote, l. //.
e. xxxij. qui a décrit fort au long leurs moeurs
Si leurs ufdges. Il d it , entr’autres pârticukrités,
que ces peuplés prenoiertt plilfieurs fêmmes.^ mais
que la prenliere nuit dès noces, la femrtie qu’ ils
époufoient s’abandontioit à tous les convives qui ,
aorès avoir obtenu fes faveurs, lui faifoient chacun
n'n préfent. Ptolomée, L IV. c. v. place ces peuples
dans la partie feptentrionale de la Marma-
rique. Pline leur donne la même pofition , & dit