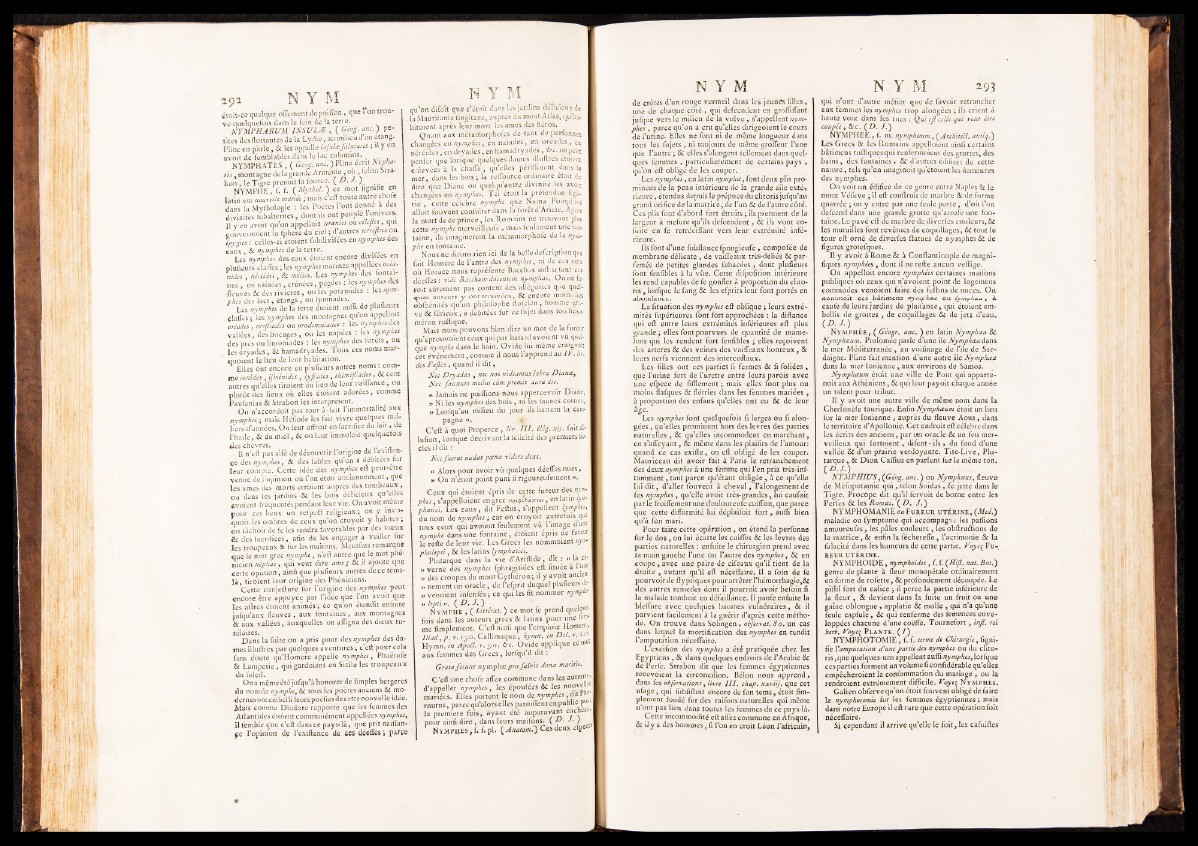
N Y M
dtort-ce quelque offenient de poiffon, que l’on trouve
quelquefois dans le fein de la terre.
NYMPHARUM INSULÆ , ( Gtog. anc.) petites
îles flottantes de la Lydie, au milieu d un étang.
Pline en parle, & les appelle infulafalutares } il y en
avoit de femblables dans le lac calamina. _
NYMPHATÈS , ( Géog. anc. ) Pline écrit Nypha-
i h , montagne de la grande Arménie, ou , félon btra-
bon , le Tigre prenoit fa fource. ( D . J . )
NYMPHE f. f. ( Mythol. ) ce mot fignine en
latin une nouvelle manie -, mais c’eft toute autre chofe
dans la Mythologie : les Poetes 1 ont donne à des
divinités iubalternes, dont ils ont peuple l univers.
Il y en avoit qu'on appelloit uranies ou celeftes, qui
couvernoient la fphere du ciel ; d’autres terrefires ou
épygies : celles-ci étoient fubdivifées en nymphes des
eaux & nymphes de la terre.
Les nymphes des eaux étoient encore divifees en
plufieurs clafles ; les nymphes marines appellees ocea-
nides , néréides, 6c mélies. Les nymphes des fontaines
, ou naïades, crénées, pégées : les nymphes des
fleuves & des rivières , ou les potamides : les nymphes
des lacs , étangs , ou lymnades. I
Les nymphes de la terre etoient aufîi de plufieurs
clafles ; les nymphes des montagnes qu’on appelloit
oréades , orefiiades ou orodemniades : les nymphes des
vallées, des bocages, ou les napées : les nymphes
des prés ou limoniades : les nymphes des forets, ou
les dryades, 6c hamadryades. Tous ces noms mar-
quoient le lieu de leur habitation.
Elles ont encore eu plufieurs autres noms : comme
ionides , ifménides , lyfmdes , thémijhadts, 6l cent
autres quelles tiroient du lieu de leur naiflance, ou
plutôt des lieux oîi elles étoient adorees, comme
Paufanias & Strabon les interprètent. |
On n’accordoit pas tout à-fait l’immortalité aux
nymphes ; mais Héfiode les fait vivre quelques milliers
d’années. On leur offroit en facrifice du lait, de
l ’huile, & du miel, 6c on leur immoloit quelquefois
des chevres. I . . .a
Il n’eft pas aifé de découvrir l’origme de 1 exilten-
c e des nymphes, & des fables qu’on a débitees^iur
leur compte. Cette idée des nymphes eft peut-etre
venue de l’opinion où l’on étoit anciennement, que
les âmes des morts erroient auprès des tombeaux ,
ou dans les jardins & les'bois délicieux quelles
avoient fréquentés pendant leur vie. On avoit meme
pour ces lieux un refpeft religieux; on y mvo-
ouoit les ombres de ceux qu’on croyoit y habiter ;
on tâchoit de fe les rendre favorables par des voeux
& des facrifices, afin de les engager à veiller lur
les troupeaux & fur les mailons. Meurflus remarque
que le mot grec nymphe, n’eft autre que le mot phénicien
nèphas, qui veut dire ame ; 6c il ajoute que
cette opinion, ainfique plufieurs autres decetems-
là tiroient leur origine des Phéniciens.
Cette conjeéhire fur l’origine des nymphes peut
encore être appuyée par l’idée que l’on avoit que
les aftres étoient animés ; ce qu’on étendit enfuite
iufqu’aux fleuves , aux fontaines, aux montagnes
& aux vallées, auxquelles on afligna des dieux tutélaires.
Dans la fuite on a pris pour des nymphes des dames
illuftres par quelques aventures ; c’eft pour cela
fans doute qu’Homere appelle nymphes, Phaëtufe
& Lampetie , quigardoient en Sicile les troupeaux
Au foleil.
Ona même été jufqu’à honorer de Amples bergeres
du nom de nymphe% 6c tous les poètes anciens & modernes
ont embelli leurs poéfies de cette nouvelle idee.
Mais comme Diodore rapporte que les femmes des
Atlantides étoient communément appellees nympkest
il femble que c’eft dans ce pays-là, que prit naifîan-
ce l’opinion dç i’exiftençe de ces déefles ; parce
N Y M
qu'on difoit que c'étoit dans les jardins délicieux de
-la Mauritanie tingitane, auprès du mont Atlas, qu’ha*
bitoient après leur mort les âmes des héros.
Quant aux métariîorphofes de tant de perfonnes
changées en nymphes, en naïades, en oréades, en
néréides, en dryades , en hamadryades , &c. on peut
penfer que lorfque quelques dames illuftres étoient
enlevées à la chaffe , qu’elles périffoient dans la
mer, dans les bois ; la refl'ource ordinaire étoit de I
dire’ que Diane ou quelqu’autre divinité les avoit I
changées en nymphes. Tel etoit la prétendue Egé- I
rie , cette célébré nymphe que Numa Pompilius I
alloit fou vent confulter dans la foret d Aricie. Après I
la mort de ce prince , les Romains ne trouvant plus I
cette nymphe merveilleufe y mais feulement une ton- I
taine, ils imaginèrent la métamorphofe de la nym. I
phe en fontaine. t .
Nous ne dirons rien ici de la belle description que I
fait Homere de l’antre des nymphes, ni de ces vers I
où Horace nous repréfente Bacchus inftiuifant ces I
déefles : vidi Bacchum doetntem nymphas. On ne fe- I
roit sûrement pas content des allégories que quel- I
ques auteurs y ont trouvées, & encore moins des I
obfcénités qu’un philofophe ftoicien, homme gra- I
v e 6c férieux, a débitées fur ce fujet dans Ion hexa-
méron ruftique.
Mais nous pouvons bien dire un mot de la fureur
qu’éprouvoient ceux qui par hafard avoient vu quelque
nymphedans le bain. Ovide lui même craignoit I
cet événement, comme il nous l’apprend au IY . liv.
des Fafies, quand il dit,
Nec Dryadas , nec nos videamus labra Diana y
Nec faunum medio cùm promit aura die.
<« Jamais ne puiflions-nous appercevoir Diane,
» Ni les nymphes des bois , ni les faunes cornus, j
» Lorl'qu’au milieu du jour ils battent la campagne
». . % T , , .. I ,
C’eft à quoi Properce , Uv. I I I . éleg. x ij. fait al-
lufion, lorfque décrivant la félicité des premiers fie- |
clés il dit :
Nec fuerat nudas pcena videre deas.
« Alors pour avoir vu quelques déefles nues,
» On n’étoit point puni fi rigoureufement ».
Ceux qui étoient épris de cette fureur des nymphes
f s'appelaient en grec i/o/^eàaVrw , en latin lym-
phatici. Les eaux, dit Feftus, s’appellent lymphes,
du nom de nymphes ; car on croyoit autrefois que
tous ceux qui avoient feulement vû l’image d’une
nymphe dans une fontaine, étoient épris de fureur
le refte de leur vie. Les Grecs les nommoient nym•
pholepti, & les latins lymphatici. _
Plutarque dans la vie d’Ariftide, dit : « H ca-
» Verne des nymphes fphragitides eft fituée à l’une
» des croupes du mont Cythéron ; il y avoit ancien*
» nement un oracle, de l’efprit duquel plufieurs de*
,, venoient infenfés ; ce qui les fit nommer nympw
» lepti». ( D . J .') ^ ’
N y m p h e , ( Littéral. ) ce mot fe prend quelque*
fois dans les auteurs grecs & latins pour une femme
Amplement. C ’eft ainfi que l’emploie Homere »
Iliad.p. v. iyp. Callimaque, hyrnn. in Del. v . f •
Hymn. in Apoll. v .90 . &c. Ovide applique ce mot
aux femmes des Grecs, lorfqu’il dit :
G rata ferunt nymphæ pro falvis dona maritis.
C ’eft une chofe aflez .commune dans les auteurs»
d’appeller nymphes, les époufees 6c les noiive e
mariées. Elles portent le nom de nymphes, ditFno*
rnutus, pai ce qu’alors elles paroiflent en public P0'1
la première fois, ayant été auparavant caçhee
pour ainfi dire , dans leurs maifons. ( D . J . )
Nymphes , f. f* pl* ( Anatom.') Ces deux efpeo
NYM
de crêtes d’un rouge vermeil dans les jeunes filles,
une de chaque côté , qui defeendent en grofliflant
iufque vers le milieu de la vulve , s’appellent nymphes
, parce qu’on a cru qu’elles dirigeoient le cours
de l’urine. Elles ne font ni de même longueur dans
tous les fujets , ni toujours de même grofleur l’une
que l ’autre; & elles s’a longent tellement dans quelques
femmes , particulièrement de certains pays ,
qu’on eft obligé de les couper.
Les nymphes, en latin nymphee, font deux plis pro-
minens de la peau intérieure de la grande aîle exté?
rieure, étendus depuis le prépuce du clitoris jufqu’au
grand orifice de la matrice, de l’un & de l’autre côté.
Ces plis font d’abord fort étroits ; ils prennent de la
largeur à mefure qu’ils defeendent, & ils vont en-
fuite en fe retréciflant vers leur extrémité inférieure.
Ils font d’une fubftance fpongieufe, compofée de
membrane délicate , de vaifleaux très-deliés & par-
femés de petites glandes febacées, dont plufieurs
font fenfibles à la vue. Cette difpofition intérieure
les rend capables de fe gonfler à proportion du clitoris
, lorfque le fang & les efprits leur font portés en
abondance.
La fituation des nymphes eft oblique ; leurs extrémités
fupérieures font fort approchées : la diftance
qui eft entré leurs extrémités inférieures eft plus
grande; elles font pourvues de quantité de mamelons
qui les rendent fort fenfibles ; elles reçoivent
des arteres & des veines des vaifleaux honteux, &
leurs nerfs viennent des intercoftaux.
Les filles ont ces parties fi fermes & fi folides ,
que l’urine fort de l’uretre entre leurs parois avec
une efpece de fifflement ; mais elles font plus ou
moins flafques & flétries dans les femmes mariées ,
à proportion des enfans qu’elles ont eu & de leur
âge.
Les nymphes font quelquefois fi larges ou fi alon-
gées , qu’elles prominent hors des levres des parties
naturelles , & qu’elles incommodent en marchant,
en s’afleyant, &c même dans les plaifirs de l ’amour:
quand ce cas exifte, on eft obligé de les couper.
Mauriceau dit avoir fait à Paris le retranchement
des deux nymphes à une femme qui l’en pria très-inf-
ramment, tant parce qu’étant obligée , à ce qu’elle
lui d it , d’aller fouvent à ch eval, l’alongement de
fes nymphes, qu’elle avoit très-grandes, lui caufoit
par le froidement une douloureufe cuiflon, que parce
que cette difformité lui déplaifoit fo r t , aufli bien
qu’à fon mari.
Pour faire cette opération, on étend la perfonne
fur le d o s , on lui écarte les cuifles & les levres des
parties naturelles : enfuite le chirurgien prend avec
la main gauche l’une ou l’autre des nymphes, 6c en
coupe, avec une paire de cifeaux qu’il tient de la
droite , autant qu’il eft néceflaire. Il a foin de fe
pourvoir de ftyptiques pour arrêter l’hémorrhagie,&
des autres remedes dont il pourroit avoir befoin fi
la malade tomboit en défaillance. Il panfe enfuite la
hleflùre avec quelques baumes vulnéraires, & il
parvient facilement à la guérir d’après cette méthode.
On trouve dans Solingen, objervat. 80. un cas
dans lequel la mortification des nymphes en rendit
l’amputation néceffaire.
L’excifion des nymphes a été pratiquée chez les
Egyptiens , & dans quelques endroits de l’Arabie &
de Perfe. Strabon dit que les femmes égyptiennes
recevoient la circoncifion. Bélon nous apprend,
dans fes obfervations, livre I I I . chap. xxviij. que cet
ufage, qui fubfiftoit encore de fon tems, étoit Amplement
fondé fur des raifons naturelles qui même
n’ont pas lieu dans toutes les femmes de ce pays-là.
Cette incommodité eft aflez commune en Afrique,
& il y a des hommes, fi l’on en croit Léon l ’africain,
N Y M 2 9 3
qui n’ont d’autre métier que de favoir retrancher
aux femmes les nymphes trop alongées ; ils crient à
haute voix dans les rues : Qui ejl celle qui veut être
coupée y &c. (D . ƒ .)
NYMPHÉE , f. m. nymphaum, ( Architecl. antiq.)
Les Grecs & les Romains appelaient ainfi certains
bâtimens ruftiques qui renfermoient des grottes', des
bains, des fontaines, & d’autres édifices de cette
nature, tels qu’on imaginoit qu’étoient les demeures
des nymphes.
On voit un édifice de ce genre entre Naples & le
mont Véfuve ; il eft conftruit de marbre & de forme
quarrée ; on y entre par une feule porte, d’où l’ on
defeend dans une grande grotte qu’arrofe une fontaine.
Le pavé eft de marbre de diverfes couleurs, 6c
les murailles font revêtues de coquillages, & tout le
tour eft orné de diverfes ftatues de nymphes 6c de
figures grotefques.
Il y avoir à Rome 6c à Conftantinople de magnifiques
nymphees , dont il ne refte aucun veftige.
On appelloit encore nymphees certaines maifons
publiques où ceux qui n’avoient point de logemens
commodes venoient faire des feftins de noces. On
nommoit ces bâtimens nymphaa ou lymphaa, à
caufe de leurs jardins de plaifance, qui étoient embellis
de grottes , de coquillages 6c de jets d’eau. . H - I N y m p h e e , ( Géogr. anc. ) en latin Nymphcea 6c
Nymphaum. Ptolomée parle d’une île Nymphaadans
la mer Méditerranée , au voifinage de l’île de Sardaigne.
Pline fait mention d’une autre île Nymphaa
dans la mer Ionienne , aux environs de Samos.
Nymphaum étoit une ville de Pont qui apparte-
noit aux Athéniens, 6c qui leur payoit chaque année
un talent pour tribut.
Il y avoit une autre ville de même nom dans la
Cherlonèfe taurique. Enfin Nymphaum étoit un lieu
fur la mer Ionienne , auprès du fleuve Aous, dans
le territoire d’Apollonie. C et endroit eft célébré dans
les écrits des anciens, par un oracle 6c un feu merveilleux
qui fortoient, difent - ils , du fond d’une
vallée 6c d’un prairie verdoyante. Tite-Live, Plutarque
, & Dion Caflius en parlent fur le même ton. ■Hi . I ■ I .. ■ I 1 NYMPHIUS, ( Geog. anc. ) ou Nymphaus, fleuve
de Méfopotamie q u i, félon Suidas, fe jette dans le
Tigre. Procope dit qu’il fervoit de borne entre les
Perfes 6c les Romai. ( D . J.')
NYMPHOMANIE ou F u r e u r u t é r i n e , (Med.)
maladie ou fymptome qui accompagne les pallions
amoureufes, les pâles couleurs , les obftru&ions d!e
la matrice, & enfin la fécherefle, l’acrimonie & la
falacité dans les humeurs de cette partie. Voye[ F u r
e u r u t é r i n e .
NYMPHOIDE, nymphoides, f. f. (jîift. nat. Bot.)
genre de plante à fleur monopétale ordinairement
en forme de rofette, & profondément découpée. L e
piftil fort du calice ; il perce la partie inférieure de
la fleur , & devient dans la fuite un fruit ou une
gaine oblongue, applatie 6c molle , qui n’a qu’une
feule capfule, 6c qui renferme des femences enveloppées
chacune d’une coëffe. Tournefort, injl. rei
herb. Noye{ Plante, ( ƒ )
NYMPHOTOMIE, f. f . terme de Chirurgie, lig n i fie
Yamputation d'une partie des nymphes o u d u c l i to r
is , q u e q u e lq u e s -u n s ap p e llen t a u fli nymphes, lo r fq u e
c e s p a r t ie s fo rm e n t un v o lum e fi c o n f id é r a b le q u ’ e lle s
em p ê c h c r o ie n t la co n fom m a t io n d u m a r ia g e , o u la
r en d ro ie n t e x t rêm em en t d if f ic i le . Voye{ N y m p h e s .
Galien obferve qu’on étoit fouvent obligé de faire
la nymphotomie fur les femmes égyptiennes ; mais
dans notre Europe il eft rare que cette opération foit
néceflaire.
S i c e p en d a n t i l a r r iv e q u ’ e l le le f o i t , le s c a fu ifte s