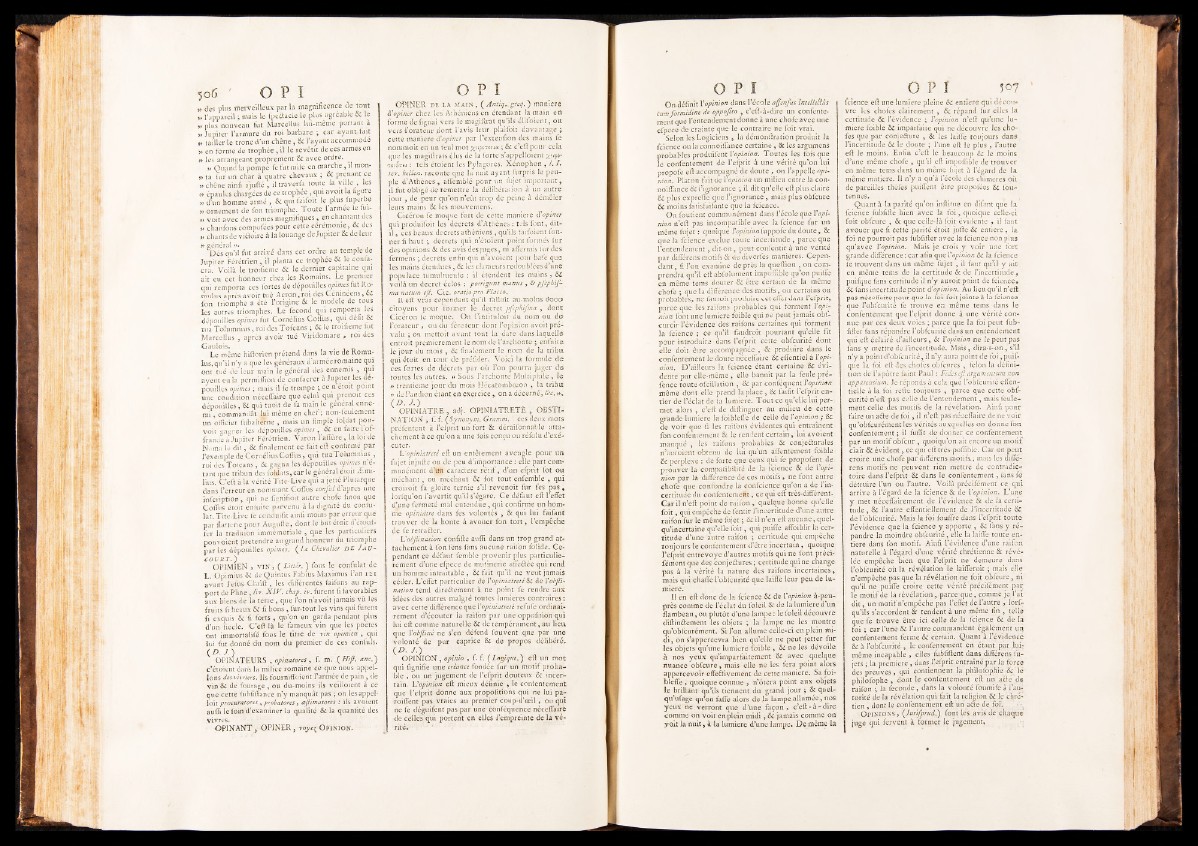
w des plus merveilleux par la magnificence de tout
» l’appareil ; mais le fpe£tacle le plus agréable & le
» plus nouveau tut Marceilus lui-même portant a
» Jupiter l’armure du roi barbare ; car ayant, tait
»> tailler le tronc d’un chêne , 6c l’ayant accommode
» en forme de trophée , il le revêtit de ces armes en
„ les arrangeant proprement 6c avec ordre.
» Quand la pompe fe fut mile en marche, il mon-
*> ta fur un char à quatre chevaux ; 6c prenant ce
» chêne ainfi ajufté , il traverfa toute la ville , les
» épaules chargées de ce trophée, qui avoit la figufe
» d’un homme armé f .6c qui taifoit le ^plus foperbe
» ornement de fon triomphe. Toute 1 armee le lui-
» voit avec des armes magnifiques, en chantant des
» chanfons compofées pour cette cérémonie, & des
» chants de viéfoire à la louange de Jupiter & de leur
» général». H
Dès qu’il fut arrivé dans cet ordre au temple de
Jupiter Férétrien, il planta ce trophée 6c le confa-
cra. Voilà le troifieme 6c le dernier capitaine qui
ait eu cet honneur chez les Romains. Le premier
qui remporta ces fortes de dépouilles opimes tu\ Ro-
mulus après avoir tué Acron ,roi des Cénineens, &
fon triomphe a été l’origine & le modèle de tous
les autres triomphes. Le fécond qui remporta les
dépouilles opimes fut Cornélius Coffus, qui défit 6c
tua Tolumnius, roi des Tofcans ; 6c le troifieme fut
Marceilus , après avoir tue Viridomare , roi des
Gaulois. .
Le même hiftorien prétend dans la vie de Romu-
lus,qu’ il n’y a que les généraux d’armee romaine qui
ont tué de leur main le général des^ ennemis , qui
ayent eu la permiflion de confacrer a Jupiter les dépouillés
opimes ; mais il fe trompe ; ce n étoit point
une condition néceffaire que celui qui prenoit ces
dépouilles, 6c qui tuoit de fa main le général ennemi
, commandât lui même en chef; non-leulement
un officier fubaltHne , mais un fimple fojdat pou-
voit gagner les dépouilles opimes , & en faire ! o ffrande
à Jupiter Férétrien. Varon l'affùre, la loi de
Nüina le dit, 6c finalement ce fait eft confirmé par
l’exemple de Cornélius Coffus, qui tuaTolumnius ,
roi des Toicans , 6c gagna les dépouilles opimes n é-
tant que tribun des foklats,car le général etoit Æmi-
lins. C ’eft à la vérité Tite-Live qui a jette Plutarque
dans l’erreur en nommant Coffus conjul d’après une
infcription, qui ne fignifioit autre chofe finon que
Coffus étoit enluite parvenu à la dignité du conlu-
lat. Tite-Live fé conduifit ainfi moins par erreur que
par flatterie pour Augufte, dont le but étoit d étouffer
la tradition immémoriale , que les particuliers
pouvoient prétendre au grand honneur du triomphe
par les dépouilles opimes. ( Le Chevalier d e Ja v -
COURT. )
OPIMIEN , vin , ( Liuér. ) fous le confulat de
L. Opimius 6c de Quintus Fabihs Maximus l’an 121
avant Jefus-Chrift , les différentes faifons au rapport
de Pline , Hv. X IF . chap. iv. furent fi favorables
aux biens.dé la terre, que l’on n’avoit jamais vu les
fruits fi beaux 6c fi bons , fur-tout les vins qui furent
fi exquis 6c fi forts , qu’on en garda pendant plus
d’un liecle. C ’eftlà le fameux vin que les poètes
ont immortalifé fous le titre de vin opimien , qui
lui fut donné »du nom du premier de ces confuls.
{ d . j . ) , m .. I
O P I N A T E U R S , opinatores, f . m . ( Hijl. anc.')
c’ étoient dans la milice romaine ce que nous appelions
des vivriers. Ils fourniffoient l’armée de pain, de
vin & de fourage , ou du-moins ils veilloient à ce
que cette (ubfiftance n’y manquât pas ; on lesappel-
loit procuratorts, probatores, aflimatores : ils a voient
auffi le foin d’examiner la qualité 6c la quantité des
yivres.
OPINANT, OPINER, voÿeç Op inion.
OPINER DE LA MAIN, ( Àntiq^greq.) maniéré
à’opiner chez les Athéniens en étendant la main en
forme de fignal vers le magiffrat qu’ils éliloient, ou
vers -l’orateur .dont l’avis leur plaifoit davantage ;
cette maniéré d'opiner par l’extenfion des mains fe
nommoit en un feul mot x e/p0T0VJet » c’eft pour cela
que les magiftrats élus de la forte s’appelloient x«fo-
TovnTti : tels étoient les Pylagôres. Xénophon , /. I.
rev. hetlen. raconte que la nuit ayant furpris le peuple
d’Athènes , affemblé pour un fujet important,
il fut obligé de remettre la délibération à un autre
jour , de peur qu’on n’eut trop de peine à démêler
leurs mains 6c les mouvemens.
Cicéron fe moque fort de cette maniéré d’opiner
qui produifoit les decrets d’Athènes : tels font, dit-
il , ces beaux decrets athéniens, qu’ils faifoient Tonner
fi haut ; decrets qui n’étoient point formés fur
des opinions & des avis des juges, ni affermis inr des
fermens ; decrets enfin qui n’avoient pour bafé que
les mains étendues, 6c les clameurs redoublées d’une
populace tumultueufe : il étendent les mains , 6c
voilà un decret éclos : porrigunt ma nus , & pfephif-
ma natum efl. Cic. oratiopro Flacco.
Il eft vrai cependant qu’il falloit au-moins 6000
citoyens pour former le decret pfephifma , dont
Cicéron 1e moque. On l’intitnloit du nom ou de
l’orateur , ou du fénateur dont l’opinion avoit prévalu
; on mettoit avant tout la date dans laquelle
entroit premièrement le nom de l’archonte ; enfuite
le jour du mois , 6c finalement le nom de la tribu
qui étoit en tour de préfider. Voici la formule de
ces fortes de décrets par oit l’on pourra juger de
foutes les autres. « Sous l’archonte Multiphilè , le
» trentième jour du mois Hécatomboeon , la tribu
» dePandion étant en exercice,. on a décerné, &c. »;
H
OPINIATRE, adj. OPINIÂTRETÉ , OBSTINATION
, f. f. (Synonym. Gramm. ces deux mots
préfentent à l’efprit un fort & déraifonnable attachement
à ce qu’on a une fois conçu ou réfolu d’exécuter.
L'opiniâtreté eft un entêtement aveugle pour un
fujet injufte ou de peu d’importance : elle part communément
d’un caractère rétif, d’un efprit lot ou
méchant, ou méchant 6c fot tout enfembte , qui
croiroit fa gloire ternie s’il revenoit fur fes pas ,
lorfqu’on l’avertit qu’il s’égare. Ce défaut eft l’effet
d’une fermeté mal entendue, qui confirme un hom-
j me opiniâtre dans fes volontés , & qui lui faifant
trouver de la honte à avouer fon tort, l ’empêche
de fe retrafter.
Vobjlination confifte auffi dans un trop grand attachement
à fon fens fans aucune raifon folide. Cependant
ce défaut femble provenir plus particulièrement
d’une efpece de mutinerie affeéfée qui rend
un homme intraitable , 6c fait qu’il ne veut jamais
céder. L’effet particulier de Vopiniatreté 6c de Vobjlination
tend directement à ne point fe rendre aux
idées des autres malgré toutes lumières contraires:
avec cette différence que l'opiniâtreté refufe ordinairement
d’écouter la raifon par une oppofition qui
lui eft comme naturelle 6c de tempérament, au lieu
que Vobjliné ne s’en défend fouvent .que par une
volonté de pur caprice 6c de propos délibéré. {d. j.) ■ 1 ■ ■ 1 m m
OPINION , opi'nio , f. f . ( Logique. ) eft un mot
qui lignifie une créance fondée fur un motif probable
, ou un jugement de l’efprit douteux 6c incertain.
L ’opinion eft mieux définie , le conientement
que -l’efprit donne aux propofitions qui ne lui pa-
roiffent pas vraies au premier coup-d’oeil , ou qui
ne fe déguifent pas par une cônféquence néceffaire
de celles qui portent en elles l’empreinte de la v érité
»'
On-définit Vopinion dans l’école ajfenj'as inttlUclâs
tüm formidine de oppojito , c’eft-à-dire un confente-
ment que l’entendement donne à une chofe avec une
efpece de crainte que le contraire ne foit vrai.
Selon les Logiciens > la démonftration produit la
fcience oulaconnoiffance certaine , & les argumens
probables produifent Vopinion. Toutes les fois que
le confentement de l’elprit à une vérité qu’on lui
propofe eft accompagné de doute , on l’appelle opinion.
Platon fait de Vopinion un milieu entre la con-
noiffance 6c l’ignorance ; il dit qu’elle eft plus claire
6c plus expreffe que l’ignorance, mais plus obfcure
6>c moins fatisfaifante que la fcience.
On foutient communément dans l’école que VopU
nion n’eft pas incompatible avec la fcience fur un
même fujet : quoique Vopinion fuppofe du doute, &
que la fcience exclue toute incertitude , parce que
l’entendement, dit-on, peut confentir à une vérité
par difîerens motifs & cie-diverfes maniérés. Cependant
, fi l’on examine de près la queftion , on comprendra
qu’il eft abl’olument impoffible qu’on puiffe
en même tems douter 6c etre certain de la meme
chofe ; que la différence des motifs, ou certains ou
probables, ne fauroit produire cet effet dans l’efprir,
parce que les raifons probables qui forment Vopinion
font une lumière foible qui ne peut jamais obscurcir
l’évidence des raifons certaines qui forment
la fcience ; ce qu’il faudroit pourtant qu’elle fît
pour introduire dans l’efprit cette obfcurité dont
elle doit, être accompagnée , & produire dans le
confentement le doute néceffaire 6c effentiel à Vopinion.
D ’ailleurs la fcience étant certaine & évidente
par elle-même , elle bannit par la feule pré-
fence toute ofciilation , & par conféqnent Vopinion
même dont elle prend la place, 6c faifit l’efprit entier
de l’éclat de fa lumière. Tout ce qu’elle lui permet
alors , c’eft de diftinguer au milieu de cette
grande lumière la foibleffe de celle de Vopinion ,• 6c
de voir que fi les raifons évidentes qui entraînent
fon confentement & le rendent certain, lui avoient
manqué , Tes raifons probables & conjecturales
n’auroient obtenu de lui qu’un affentement foible-
& perplexe : de forte que ceux qui fe propofent de
prouver la compatibilité de la fcience & de Vopinion
par la différence de ces motifs, ne font autre
chofe que confondre la confcience qu’on a de l’incertitude
du confentement, ce qui eft très-différent.
Car il n’eft point de raifon , quelque bonne qu’elle
fo i t , qui empêche de fentir l’incertitude d’une autre
raifon fur le même fujet ; 6c il n’en eft aucune, quel-
qu’incertaine qu’elle fo it , qui puiffe affaiblir la certitude
d’une autre raifon ; certitude qui empêche
toujours le confentement d’être incertain, quoique
l ’efprit entrevoye d’autres motifs qui ne font préci-
fémentque des conjectures; certitude qui ne change
pas à la vérité la nature des raifons incertaines,
mais qui chaffe l’oblcurité que laiffe leur peu de lumière.
Il en eft donc de la fcience 6c de Vopinion à-peu-
près comme de l’éclat du foleil & de la lumière d’un
flambeau, ou plutôt d’une lampe : le foleil découvre
diftinCtement les objets ; la lampe ne les montre
qu’obfcurément. Si l’on allume celle-ci en plein midi
, on s’appercevra bien qu’elle ne peut jetter fur
les objets qu’une lumière foible , 6c ne les dévoile
à nos yeux qu’imparfaitement 6c avec quelque
nuance obfcure, mais elle ne les fera point alors
appercevoir effectivement de cette maniéré. Sa foibleffe
, quoique connue , n’ôtera point aux objets
le brillânt qu’ils tiennent du grand jour ; & quel-
qu’ufage qu’on faffe alors de la lampe allumée, nos
yeux ne verront que d’une façon , c’eft-à-dire
comme on voit en plein midi, 6c jamais comme on
yoit la nuit, à la lumière d’une lampe. De même la
fcience ëft une lumière pleine 6c entiefe qui découvre
les chofes clairement , 6c répand fur elles la
certitude 6c l’évidence ; Vopinion n’eft qu’une lumière
foible 6c imparfaite qui ne découvre les cho-
fes que par conjecture , & les laiffe toujours dans
l’incertitude 6c le doute ; l’une eft le plus , l’autre
eft le moins. Enfin c’eft le beaucoup 6c le moins
d ’une même chofe , qu’il eft impoflible de trouver
en même tems dans un même fujet à l’égard de la
même matière. Il n’y a qu’à l’école des chimères oit
de pareilles thèfes puiffent être propofées 6c fou-
tenues.
Quant à la parité qu’on inftitue en dliant que la
fcience fubfifte bien avec la f o i , quoique celle-ci
foit obfcure , & que celle-là foit évidente , il faut
avouer que fi cette parité étoit jufte 6c entière, la
foi ne pourroit pas fubfifter avec là fcience non plus
qu’avec Vopinion. Mais je crois y voir une fort
grande différence : car afin que Vopinion 6c la fcience
fe trouvent dans un même fujet , il faut qu’il y ait
en même tems de la certitude & de l’incertitude ,
puifque fans certitude il n’y auroit point de fcience>
6c fans incertitude point d'opinion. Au lieu qu’il n’efi:
pas néceffaire pour que la foi foit jointe à la fcience
que l’obfcurité fe trouve en même tems dans ie
confentement que l’efprit donne à une vérité connue
par ces deux voies ; parce que la foi peut fubfifter
fans répandre l’obfcurité dans un entendement
qui eft éclairé d’ailleurs, & Vopinion ne le peut pas
fans y mettre de l’incertitude. Mais, dira-t-on, s’il
n’y a point d’obfcurité, il n’y aura point de foi »puifque
la foi eft des chofes obfcures , félon la définition
deTapôfre faint Paul : Fides ejl argumentum non
apparentïurn. Je réponds à cela que l’obfcurité eflen-
tielle à la foi refte toujours , parce que cette obi-
curité n’eft pas ceUe dé l’entendement, mais feule--
ment celle des motifs de la révélation. Ainfi pour
faire un a&e de fo i , il n’eft pas néceffaire de ne voir
qu’obfcurément les vérités auxquelles on .donne fon
‘ confentement ; il fuffit de donner ce confentement
par un motif obfcur , quoiqu’on ait encore un motif
ciair & évident, ce qui eft très-poffible. Car on peut
croire une chofe par différens aïotifs.; mais les diffé-
rens motifs ne peuvent rien mettre de contradictoire
dans l’efprit 6c dans le confentement, fans lè
détruire l’un ou l’autre. Voilà précifément ce qui
arrive à l’égard de la fcience & de l'opinion. L’une
y met néçeffairement de l’évidence & de la certitude,
6c l’autre effentiellement de l ’incertitude 6c
de Tobfcurité. Mais la foi fouffre dans l’efprit toute
l’évidence que la fcience y apporte , 6c fans y répandre
la moindre obfcurité, elle là laiffe toute entière
dans fon motif. Ainfi l’évidence d’une raifon
naturelle à l’égard d’une vérité chrétienne & révélée
empêche bien que,l’efprit ne demeure dans
l’obfcurité oît la révélation le laifferoit ; mais elle
n’empêche pas que la révélation ne foit obfcure, ni
qu’ il ne puiffe croire cette vérité précifément pat;
M e motif de la révélation, -parce que, comme je l’ai
dit, un motif n’empêche pas l’effet de l’autre , lorf-
qu’ils s’accordent & tendent à; une même fin , telle
que fe trouve être ici celle de la fcience 6c de la
foi ; car Tune & l’autre commandent également up
conientement ferme 6c certain. Quant à révidence
6c à l’obfcurité-, le confentement en étant par ,luiT
même incapable , eiles fubfiftent dans différens fu-
■ jets ;.la première , dansTeiprit entraîné par la force
des preuves, qui contiennent la philolophie 6c le
philofophe , dont le confentement eft un afté de
raifon ; la fécondé, dans la volonté foumife à l’autorité
de la révélation qui fait la religion & lç chré-
■ tien , do.nî le confentement eft un afte de foi...
O p i n i o n s , ( 7 urifprud.J fo n t lé s avis" d e 'c h a q u e
ju g e q u i f e r v e n t à fo rm e r le ju g em en t .