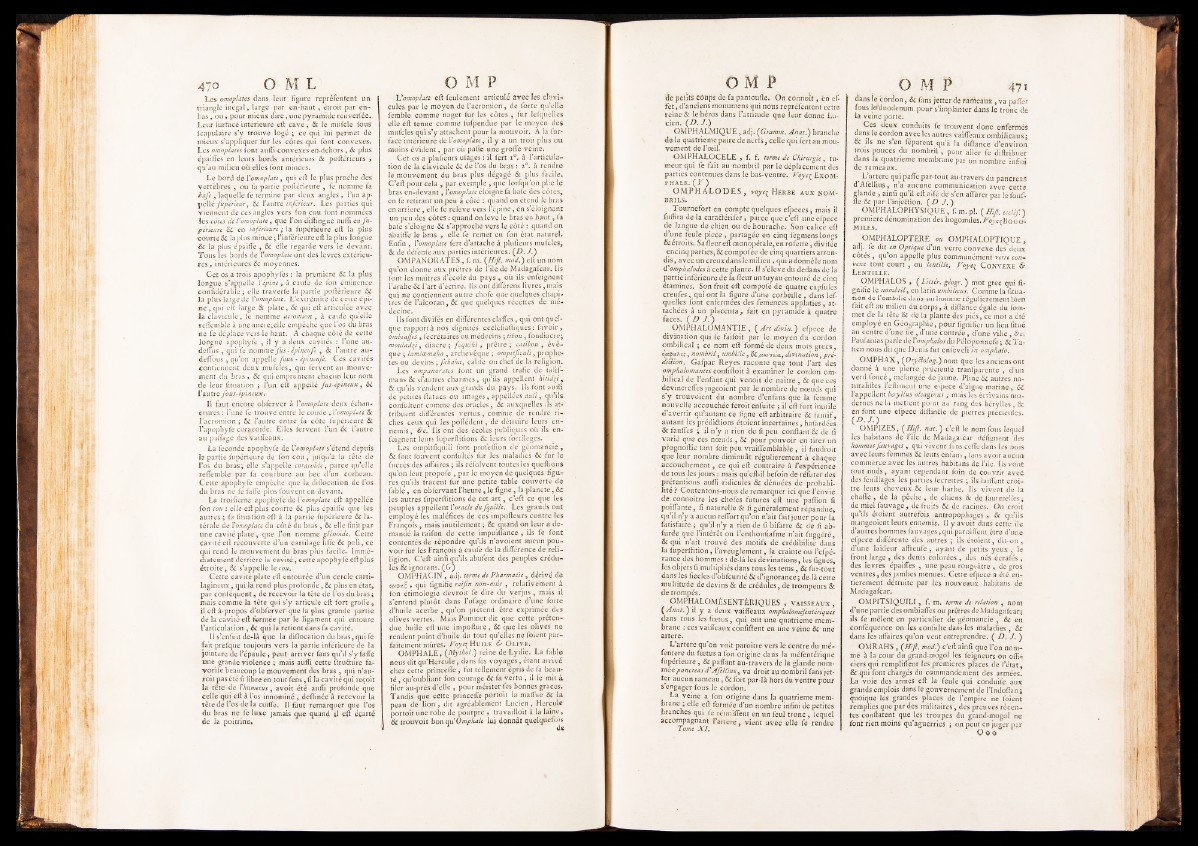
I l j 1 1
470 O M L
Les omoplates dans leur figure représentent un
triangle inégal, large par en-haut, étroit par en-
bas , ou , pour mieux dire, une pyramide renverfée.
Leur furface intérieure eft c a v e , & le mufcle fous
fcapulaire s’y trouve logé ; ce qui lui permet de
mieux s’appliquer fur les côtes qui font convexes.
Les omoplates font aufli convexes en-dehors , & plus
épaifles en leurs bords antérieurs & poftérieurs ,
qu’au milieu où elles font minces.
Le bord de l’omoplate, qui eft le plus proche des
vertèbres , ou fa partie poflérieure , fe nomme fa
hafe , laquelle fe termine par deux angles, l’un ap-
pelle fupérieur, & l’autre inferieur. Les parties qui
viennent de ces angles vers fon cou font nommées
les côtes de l'omoplate, que l’on diftingue auflî en fu-
périeure &Ç en inférieure ; la fupérieure eft la plus
’courte & la plus piin.ee ; [’intérieure eft la plus longue
& la plus épaiffe , & elle regarde vers le devant.
Tous les bords de l’omoplate ont des levres extérieures
, intérieures & moyennes.
Cet os a trois apophyfes : la première 6c la plus
longue s’appelle l'épine, à caufe de fon éminence
confidérabîe ; elle traverfe la partie poflérieure 6c
la plus large de l’omoplate. L’extrémité de cette épine
, qui eft large & plate, 6c qui eft articulée avec
la clavicule, le nomme acromion , à caufe qu’elle
reflemble à une.ancre;elle empêche que l’os du bras
ne fe déplace vers le haut. A chaque côté de cette
longue apophyse , il y a deux cavités : l’une au-
deflus , qui fe nomme fus - épineufe , & l’autre au-
deffous , qu’on appelle fous - épineufe. Ces cavités
contiennent deux mufcles, qui fervent au mouvement
du bras, & qui empruntent chacun leur nom
de leur fituatipn ; l’un eft appellé fus-épineux, 6c
l’autre Jous-épineux.
Il faut encore obferver à l’omoplate deux échancrures
: l’une fe trouve entre le coude , 1.’omoplate &
Facromiom; 6c l’autre entre la côte lupérieure &
l’apophyfe coracoïde. Elles fervent l’un 6c l’autre
au paffage des vaifleaux.
La fécondé apophyfe de l’omoplate s’étend depuis
la partie fupérieure de fon cou , jufqu’â la tête de
l’os du bras; elle s’appelle coracoïde, parce qu’elle
reflemble par fa courbure au bec d’un corbeau.
Cette apophyfe empêche que la diflocation de l’os
du bras ne fe faffe plus fouvent en-devant.
La trpifieme apophyfe de Vomoplate eft appellée
fon cou : elle eft plus courte 6c plus épaiffe que les
autres ; fa fituation eft à la partie fupérieure & latérale
de l’omoplate du côté du bras , 6c elle finit par
une cavité plate, que l’on nomme glénoïde. Cette
cavité eft recouverte d’un cartilage lifi'e 6c poli, ce
qui rend le mouvement du bras plus facile. Immédiatement
derrière la cavité, cette apophyfe eft plus
étroite, 6c s’appelle le cou.
Cette cavité plate eft entourée d’un cercle cartilagineux
, qui la rend plus profonde, 6c plus en état,
par conféquent, de recevoir la tête de l’os du bras ;
mais comme la tête qui s’y articule eft fort grofle,
il eft à-propos d’obferver que la plus grande partie
de la cavité eft formée par le ligament qui entoure
l’articulation , & qui la'retient dans fa cavité.
Il s’enfuit de-là que la diflocation du bras, qui fe
fait prefque toujours vers là partie inférieure de la
jointure de l’épaule, peut arriver fans qu’il s’y fafle
«ne grande violence ; mais aufli cette ftruâure fa-
yorife beaucoup le mouvement des bras , qui n’au-
roitpasété fi libre en tout fens,fila cavité qui reçoit
la tête de l’humérus, avoit été aufli profonde que
celle qui eft à l’os innominé , deftinée à recevoir la
tête de l’os de la cuiffe. Il faut remarquer que l’os
du bras ne fe luxe jamais que quand il eft écarté
de la poitrine.
O M P
"Vomoplate eft feulement articulé avec les clavicules
par le moyen de l’acromion, de forte qu’elle
femble comme nager fur les côtes , fur lefquelles
elle eft tenue comme fufpendue par le moyen des
mufcles qui s’y attachent pour la mouvoir. A la fur-
face intérieure de l’omoplate 9 il y a un trou plus ou
moins évident, par où pafle une grofle veine.
Cet os a plufieurs ufages : il fert i° . à l’articulation
de la clavicule & de l’os du bras : 20. à rendre
le mouvement du bras plus dégagé & plus facile.
C ’eft pour cela , par exemple , que lorfqu’on plie le
bras en-devant, l’omoplate éloigne fa baie des côtes,
en fe retirant un peu à côté : quand on étend le bras
en arriéré, elle fe releve vers l’épine, en s’éloignant
un peu des côtes : quand on leve le bras en haut, la
bafe s’éloigne 6c s’approche vers le côté : quand on
abaiffe le bras , elle fe remet en fon état naturel.
Enfin , l’omoplate fert d’attache à plufieurs mufcles,
& de défenfe aux parties intérieures. (JD. J.')
OMPANORATES, f. m. {Hift. rnod.') eft un nom
qu’on donne aux prêtres de l’ile de Madagafcar. Ils
font les maîtres d’école du pays , où ils enféignent
l’arabe 6c l ’art d’écrire. Ils ont différens livres, mais
qui ne contiennent autre chofe que quelques chapitres
de l’alcoran, 6c que quelques récettes de médecine.
Ils font divifés en différentes claffes, qui ont quelque
rapporté nos dignités eccléfiaftiques: fa'voir,
ombiafjés, fecrétaires ou médecins ; tibou, foudiaçre;
mouladfi, diacre; faquihi, prêtre; caribou y évêque
; lamlcemaha , archevêque ; ompitficuli, prophètes
ou devins ; fabaha, calife ou chef de la religion.
Les ompanorates font un grand trafic de tàlif-
mans 6c d’autres charmes, qu’ils appellent hiridf,
& qu’ils vendent aux grands du pays. Ils font aufli
de petites ftatues ou images, appellées auli, qu’ils
confultent.comme des oracles, 6c auxquelles ils attribuent
différentes vertus, comme de rendre riches
ceux qui les poffédent, de détruire leurs ennemis,
&c. Ils ont des écoles publiques où ils en-
feignent leurs fuperftitions & leurs fortileges.
Les ompitfiquili font profeflion de géomancie ,
& font fouvent confultés fur les maladies 6c fur le
fuccès des affaires ; ils réfolvent toutes les queftions
qu’on leur propofe , par le moyen de quelques figures
qu’ils tracent fur une petite table couverte de
fable, en obfervant l’heure, le ligne, la planete, 6c
les autres fuperftitions de cet a r t , c ’eft ce que les
peuples appellent l'oracle dufquille. Les grands ont
employé les maléfices de ces impofteurs contre les
François, mais inutilement ; 6c quand on leur a demandé
la raifon de cette impuiflance , ils fe font
contentés de répondre qu’ils n’avoient aucun pouvoir
fur les François à caufe de la différence de reli-
figion. C ’eft ainfi qu’ils abufent des peuples crédules
&: ignorans. {G)
OMPHACIN, adj. terme de Pharmacie , dérivé de
opuçaJ; , qui lignifie raifin non-mûr , relativement à
fon étimologie devroit fe dire du verju s , mais il
s’entend plutôt dans l’ufage ordinaire d’une forte
d’huile acerbe , qu’on prétend être exprimée des
olives vertes. Mais Pommet dit que cette prétendue
huile eft une impofture, & que les olives ne
rendent point d’huile du tout qu’elles ne foient parfaitement
mûres.’ Voye^ Huile & Ol iv e .
OMPHALE, (Mythol.) reine de Lydie. La fable
nous dit qu’Hercule, dans fes voyages, étant arrivé
chez cette princeffe , fut tellement épris de fa beauté
, qu’oubliant fon courage 6c fa vertu , il fe mit à
filer au-près d’elle , pour mériter fes bonnes grâces.
Tandis que cette princeffe portoit la maffue 6c la
peau de lion , dit agréablement Lucien, Hercule
portoit une robe de pourpre , travaillât à la laine ,
& trouyoit bon q\x Omphale lui donnât quelquefois
O M P
ide petits coups de fa pantoufle. On côrinoit, éh effet
, d’anciens monumens qui nous repréfentent cette
reine & le héros dans l’attitude que leur donne Lucien.
{D . J.)
OMPHALMIQUE, àdj. (Gramm. Anat.) branche
de la quatrième paire de nerfs , celle qui fert au mouvement
de l’oeil.
OMPHALOCELE > f. f. terme de Chirurgie, tum
e u r q u i fe fa i t au n om b r i l p a r l e d é p la c em e n t des
p a r t ie s co n te n u e s d an s le b a s - v e n t r e . Voye^ E x o m -
PHALE. ( T )
O M P H A L O D E S , voye^ H e r b e a u x n o m b
r i l s .
Tournefort en compte quelques efpeces , mais il
fuffira de la caraétérifer, parce que c’eft une efpece
de langue de chien ou de bourache. Son calice eft
d’une feule piece , partagée en cinq fegmens longs
& étroits. Sa fleur eft monopétale, en rofette, divifée
encinq parties, &compofée dé cinq quartiers arrondis,
avec un creux dans le milieu , qui a donné le nom
d’ornpkalodes à cette plante. II s’élève du dedans de la
partie inférieure de la fleur un tuyau entouré de cinq
étamines. Son fruit eft compofé de quatre capfules
creufes, qui ont la figure d’une corbeille , dans lefquelles
font enfermées des femences applaties, attachées
à un placenta, fait en pyramide à quatre
faces. ( D J. )
OMPHALOMANTIE, {Art divin.) efpece de
divination qui fe faifoit par le moyen du cordon
ombilical ; ce nom eft formé de deux mots grecs,
eptpctXoe, nombril, umbihc, & /xetmicty divination t prédiction.
Gafpar Reyes raconte que tout l’art des
omphalomantes confiftoit à examiner le cordon ombilical
de l’enfant qui venoit de naître , & que ces
devinereffes jugeoient par le nombre de noeuds qui
s’y trouvoient du nombre d’énfans que la femme
nouvelle accouchée feroit enfuite ; il eft fort inutile
d’avertir qu’autant ce figne eft arbitraire 6c fautif,
autant les p rédirions étoient incertaines, hafardées
& faufles ; il n’y a rien de.fi peu confiant & de fi
varié que ces noeuds , & pour pouvoir en tirer un
prognoftic tant foit peuvraiffemblable , il faudroit
que leur nombre diminuât régulièrement à chaque
accouchement, ce qui eft contraire à l’expérience
de tous les jours : mais queft-il befoin de réfuter des 1
prétentions aufli ridicules & dénuées de probabilité
? Contentons-nous de remarquer ici que l’envie
de connoître les chofes futures eft une paflion fi
puifîante, fi naturelle & fi généralement répandue,
qu’il n’y a aucun reffort qu’on n’ait fait jouer pour la
fatisfaire ; qu’il n’y a rien de fi bifarre & de fi ab-
furde que l’intérêt ou l’enthoufiafme n’ait fuggéré, •
& qui n’ait trouvé des .motifs de crédibilité dans
la fuperftition, l’aveuglement, la crainte ou l’efpé- j
rance des hommes : de-là les devinations, les lignes,
les objets fi multipliés dans tous les tems, & fur-tout
dans les fiecles-d’obfcurité & d’ignorance; de-là cette
multitude de devins & de crédules, de trompeurs &
détrompés.
OMPHALOMÉSENTÉRIQUES , v a i s s e a u x ,
{Anat.) il y a deux vaifleaux omphaloméfentériques
dans tous les foetus, qui ont une quatrième membrane
: ces vaifleaux confiftent en une veine & une
artère.
L’artere qu’on voit paroître vers le centre du mé-
fentere du foetus a fon origine dans la méfentérique
fuperieure , & paffant au-travers de la glande nommée
pancréas d'Afellius, va droit au nombril fans jet-
ter aucun rameau, & fort par-là hors du ventre pour
s engager fous le cordon.
u La veine a fon origine dans la quatrième membrane
; elle eft formée d’un nombre infini de petites
branches qui fe réuniffent en un feul tronc , lequel
accompagnant l’artere, vient avec elle fe rendre
Tome X L
O M P 471
dans le cordon, & fans jetter de rameaux, va paffer
fous le^duodenum pour s’implanter dans le tronc de
la veine porte.
Ces deux conduits fe trouvent donc enfermés
dans le cordon avec les autres vaifleaux ombilicaux;
& ils iie s en feparent qu’à la diftance d’environ
trois pouces du nombril, pour aller fe diftribuer
dans la quatrième membrane par un nombre infini
de rameaux.
^ L’artere qui pafle par-tout au-travers du pancréas
d’Afellius, n’a aucune communication avec cette
glande , ainfi qu’il eft aifé de' s’en aflurer par le fouf-
fle & par Finjeâion. { D J . )
OMPHALOPHYSIQUE, f. m. pi. ( Hiß. eccléf. )
première dénomination des bogômiles. gom
iles.
OMPHALOPTERE ou OMPHALOPTIQUE,
adj- fe dit en Optique d’un verre convexe des deux
côtés , qu’on appelle plus communément verre convexe
tout court , ou lentille, froye^ C onvexe <S*
L en til le:
OMPHALOS , { Littèr. géogr. ) mot grec qui lignifie
le nombril, en latin umbilicus. Comme la fituation
de 1 ombilic dans un homme régulièrement bien
fait eft au milieu du corps, à diftance égale du fom-
met dé la tête & de la plante des piés, ce mot a été
employé en Géographie, pour lignifier un lieu fitiié
au centre d’une î le , d’une contrée, d’une v ille , &c.
Paufanias parle de l’ompkalosdu Péloponnefe ; & Ta-
tien nous dit que Denis fut enfeveli in omphalo.
OMPHAX, {Oryctolog.) nom que les anciens ont
donné à une pierre précieufe tranfparente , d’un
verd foncé, mélangée de jaune. Pline & autres na-
turaliftes l’eftiment une efpeçe d’aigue marine, 6c
l’appellent beryllus oleaginus ; mais les écrivains modernes
ne la mettent point au rang des bérylles , &
en font une efpece diftin&e de pierres précieules.
{ D .J . )
OMPIZES, {Hiß. nat. ) c’eft le nom fous lequel
les habitans de l’île de Madagafcar défignent des
hommesJauvages , qui vivent fans ceffe dans les bois
avec leurs femmes & leurs enfans, fans avoir aucun
commerce avec les autres habitans de File. Ils vont
tout nuds, ayant cependant foin de couvrir avec
des feuillages les parties fecrettes ; ils laiffent croître
leurs cheveux & leur barbe. Ils vivent de la
chaffe , de la pêche , de chiens & de fauterelles,
de miel fauvage , de fruits & de racines. On croit
qu’ils étoient autrefois antropophages , & qu’ils
mangeoient leurs ennemis. Il y avoit dans cette île
d’autres hommes fauvages, qui paroiffent être d’une
efpece différente des autres ; ils étoient, dit-on,
d’une laideur affreufe, ayant de petits yeux , le
front large , des dents colorées , des nés éerafés ,
des levres épaiffes , une peau rougeâtre , de gros
ventres, des jambes menues. Cette efpece a été entièrement
détruite par les nouveaux habitans de
Madagafcar.
OMPITSIQUILI,. f. m. terme de relation , nom
d’une partie des ombiaffes ou prêtres de Madagafcar;
ils fe mêlent en particulier de géomancie , & en
conféquence on les confulte dans les maladies , 6c
dans les affaires qu’on veut entreprendre. ( D . J. )
OMRAHS , {Hiß. mod.) c’eft ainfi que l’on nomme
à la cour du grand-mogol les feigneurs ou officiers
qui remplifl'ent les premières places de l’état,
& qui font chargés du commandement des armées.
La voie des armes eft la feule qui conduife aux
grands emplois dans le gouvernement de I’Indoftan $
quoique les grandes places de l’empire ne foient
remplies que par des militaires, des preuves récentes
conftatent que les troupes du grand-mogol ne
font rien moins qu’aguerries ; on peut en juger par
O o o