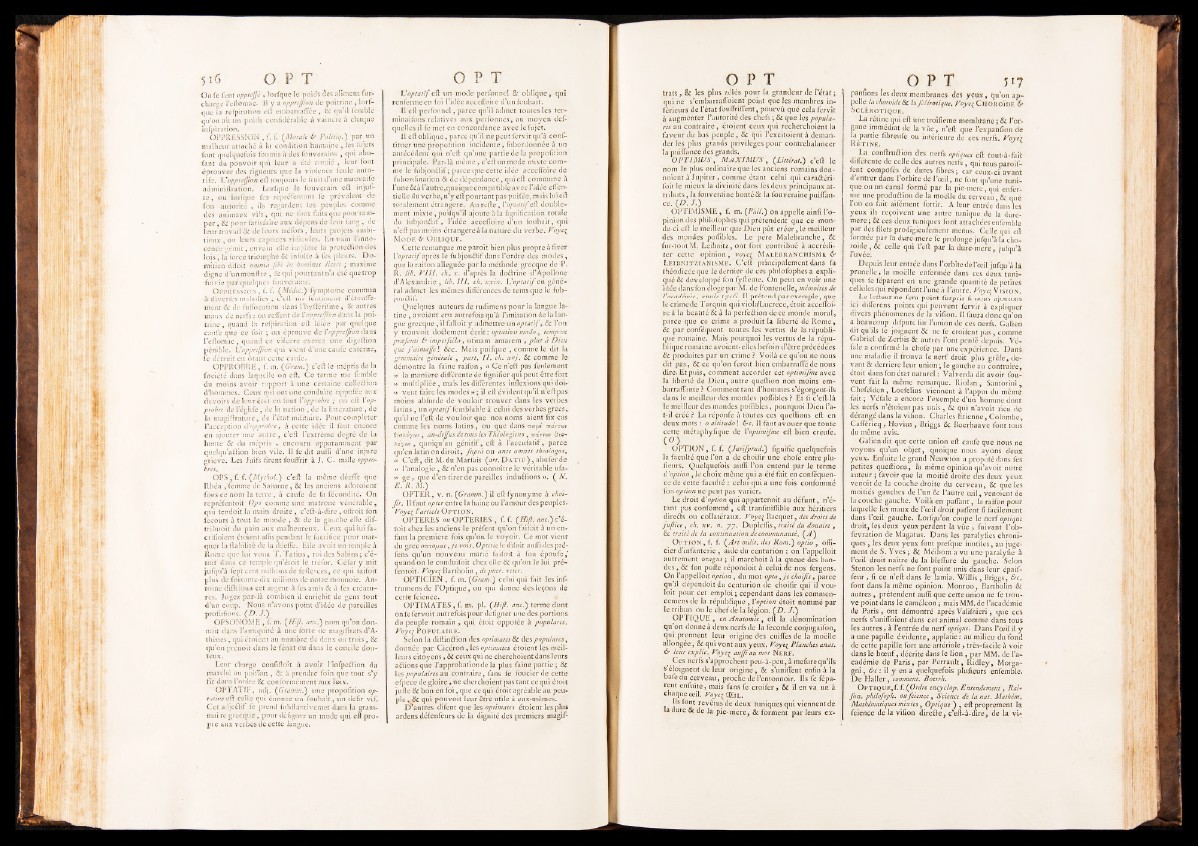
fr
II
516 O P T
On fe Cent oppreffé , lorfque le poids des ahrhcns fur-
charge Teftomac. il y a opprejfion de poitrine y lorsque
la refpiration eft embarraffée , 6c cju’ il (emble
qu’on ait un poids coniidérable à vaincre à chaque
infpirarion.
OPPRESSION , f. f. (Morale & Politiq.) par un
malheur attaché à la condition humaine , les injets
font quelquefois fournis à des fouverains , qui abu-
fant du pouvoir qui leur a été confié , leur font
éprouver des rigueurs que la violence feule auto-
rife. L'opprejfion eft toujours le fruit d’une mauvaife
adminiftration. Lorfque le fouverain eft injuf-
t e , ou lorfque fes repréfentans fe prévalent de
l'on autorité , ils regardent les peuples comme
des animaux vils, qui ne font faits que pour ramper
, 6c pour fatisfaire aux dépens de leur fang , de
leur travail Sc de leurs tréfors , leurs projets ambitieux
ou leurs caprices ridicules. En vain l’innocence
'jemit j envain elle implore la protection des
lo is , la force triomphe 6c inlulte à fes pleurs. D o natien
difoit omnui ßbi in homines lice ri ; maxime
digne d’unmonftre , &qui pourtant n’a été que trop
fume par quelques fouverams.
O p p r e s s io n , f. f. (Médcc.) fymptome commun
à diverfes maladies ; c’eft un fentiment d’étouffe-
ment 6c de fuffocation dans Thyftérilme , & autres
maux de nerfs : on reffent de Yopprcffion dans la poitrine
, quand la refpiration eft léiée par quelque
caufe que ce foit ; on éprouve de Yopprcffion dans
Teftomac, quand ce vifeere exerce une digeftion
pénible. Uoppreffion qui vient d’une, caufe externe,
le détruit en ôtant cette caufe.
OPPROBRE, f. m. (Gram.) c'eft le mépris de la
fociété dans laquelle on eft. Ce terme me femble
du moins avoir rapport à une certaine colleChon
d’hommes. Ceux qui ont une conduite oppofée aux
devoirs de leur et i»t en font Y opprobre ; on eft Y opprobre
de Téglife, de la nation , de la littérature , de
la magiftrature, de l’état militaire. Pour compléter
l’acception à’opprobre, à cette idée il faut encore
en ajouter une autre, c’eft l’extrême degré de la
honte & du mépris , encouru apparamment par
quelqu’adion bien vile. Il fe dit aufli d’une injure
grieve. Les Juifs firent fouffrir à J. C. mille opprobres.
•
O P S , f. f. (Mythol.) c’eft la même déeffe que
Rhéa , femme de Saturne , 6c les anciens adoroient
fous ce nom la terre, à caufe de fa fécondité. On
repréfentoit Ops comme une matrone vénérable,
qui tendoit la main droite , c’cft-à-dire , oftroit fon
fecours à tout le monde , & de la gauche elle dif-
tribuoit du pain aux malheureux. Ceux qui lui fa-
crifioient étoientafiis pendant le facrifice pour marquer
la Habilité de la déeffe. Elle avoit un temple à
Rome que lui voua T. Tatius , roi des Sabins; c’é-
toit dans ce temple qu’étoit le tréfor. Céfar y mit
îufqu’à fept cent millions de feftc'ces, ce qui faifoit
plus de foixanteclix millions de notre monnoie. Antoine
diftribua cet argent à fes amis & à fes créatures.
Jugez par-là combien il enrichit de gens tout
d’un coup. Nous n’avons point d’idée de pareilles
profufions. (D . J.)
OPSONOME , f. m. (Hiß. anc.) nom qu’on don-
noit dans l’antiquité à une forte de magiftrats d’Athènes
, qui étoient au nombre de deux ou trois, 6c
qu’on prenoit dans le fénat ou dans le concile douteux.
Leur charge confiftoit à avoir l ’infpeâion du
marché au poiffon , 5c à prendre foin que tout s’y
fit dans l’ordre 6c conformément aux l©ix.
OPTATIF, adj. (Gramm.) une propofition Optative
eft cell e qui énonce un fouhait, un defir vif.
Ce t adjeélif fe prend fubftantivemet dans la gram-
mai re grecque, pour défigrrer un mode qui eft propre
aux verbes de cette langue.
O P T
L ''optatif eft un mode perfonnel & oblique, qui
renferme en foi l’idée acceffoire d’un fouhait.
Il eft perfonnel, parce qu’il admet toutes les ter-
minaifons relatives aux perfonnes, au moyen def-
quelles il fe met en concordance avec le fujet.
ïl eft oblique, parce qu’il ne peut fervirqu’à conf-
tituer une propofition incidente, fubordonnée à un
antécédent qui n’cft qu’une partie de la propofition
principale. Par-là meme, c’eft un mode mixte comme
le fubjonftif ; parce que cette idée acceffoire de
fubordination & de dépendance, qui eft commune à
Tune&à l’autre,quoique compatible a v ccl’idee effen-
tielle du verbe, n’y eft pourtant pas puiféc, mais lui eft
totalement étrangère. Au refte, Y optatif eft doublement
mixte, puifqu’il ajoute à la fignification totale
du fubjonftif, l’idée acceffoire d’un fouhait, qui
n’eft pas moins étrangère à la nature du verbe. Voyeç
Mode & O blique.
Cette remarque me paroît bien plus propre à fixer
l’optatif après le fubjonftif dans l’ordre des modes,
que la raifon alléguée par la méthode grecque de P.
R. lib. VIH. ch* x. d’après la doctrine d’Apollone
d’Alexandrie , lib. III. ch. xxix. Uoptatif en général
admet les mêmes différences de tems que le fub-
jon&if.
Quelques auteurs de rudimens pour la langue latine
, avoient cru autrefois qu’à l’imitation de la langue
grecque, il falloit y adrtiettre un optatif, & Ton
y trouvoit doâement écrit : optativo modo, temporc
prafenti & imptrfeclo, utinam amarem , plut a Dieu
que fa im a (Je. ! & c . Mais puifque , comme le dit la
grmmaire générale , part. I I . ch. xvj. 6c comme le
démontre la faine raifon, « Ce n’eft pas feulement
» la maniéré differente de lignifier qui peut être fort
» multipliée, mais les différentes inflexions qui doi-
»> vent faire les modes » ; il eft évident qu’il n’eft pas
moins abfurde de vouloir trouver dans les verbes
latins , un optatif femblable à celui des verbes grecs,
qu’il ne l’efïde vouloir que nos noms aient lix cas
comme les bonis latins, ou que dans 7râpa tkIvtuv
ètoxôym , au-deffus de tous les Théologiens , W vrav Ato-
Xoyuv, quoiqu’au génitif, eft à Taccufatif, parce
qu’en latin on diroit, fuprà ou ante omnes theologos.
« C ’eft, dit M. du Mariais (art. D a t if ) , abufer de
» l’analogie , 6c n’en pas connoître le véritable ufa-
» g e , que d’en tirer de pareilles induirions ». ( N.
E. R. M.)
OPTER, v. n. (Gramm.,) il eft fynonyme à choi-
f r . Il faut opter entre la haine ou l’amour des peuples.
Voyc{ Ü article OPTION.
OPTERES ou OPTERIES , f. f. (H if. anc.) c’é-
toit chez les anciens le préfent qu’on faifoit à un enfant
la première fois qu’on le voyoit. Ce mot vient
du grec omo/uti y je vois. Opterie fe difoit aufîi des pré-
fens qu’un nouveau marié faifoit à fon époufe,*
quand on le conduifoit chez elle 6c qu’on le lui pré-
fentoit. Voye7 Bartholin, de puer, veter.
OPTICIEN , f. m. (Gram.) celui qui fait les inf-
trumens de l’Optique, ou qui donne des leçons de
cette fcience.
OPTIM A TES, f. m. pl. (Hift. anc.) terme dont
on fe fervoit autrefois pour défigner une des portions
du peuple romain , qui étoit oppofée à populares.
Voye{ Po pu la ir e .
Selon la diftin&ion des optimales 6c des populares,
donnée par Cicéron , les optimales étoient les meilleurs
citoyens, & ceux qui ne cherchoient dans leurs
actions que l’approbation de la plus faine partie; 6c
les populaires au contraire, fans fe foucier de cette
efpece de gloire , ne cherchoient pas tant ce qui étoit
jufte 6c bon en fo i, que ce qui étoit agréable au peuple
, 6c qui pouvoit leur être utile à eux-mêmes.
D ’antres difent que les optimales étoient les plus
ardens défenfeurs de la dignité des premiers magif-
O P T
tfats > & les plus zélés pour la grandeur de l’état ;
qui ne s’embarrafloient point que les membres inférieurs
de l’état fouffriffent, pôurvû qué cela fervît
à augménter l’autorité des chefs ; & que les populaires
au contraire, étoient ceux qui rechérchoient la
faveur du bas peuple, ô£ qui Texcitoient à demander
les. plus grands privilèges pour contrebalancer
la puiffance des grands.
O P T I MU S , M A X IM U S , (Littéral.) c’eft le
nom le plus Ordinaire que les anciens romains dori-
noiertt à Jupiter, comme étant celui qui câra&éri-
foit le mieux la divinité dans fes deux principaux attributs
, la fouveriline bonté & la fou veraine puiffan-
ce. (D. J.)
OPTIMISME , f. m. (Phil.) on appelle ainfi l’opinion
des philofopheS qui prétendent que ce ni oncle
ci eft le meilleur que Dieu pût créer, le meilleur
des mondes po/fibles. Le pere Malebranche, &
fur-tout M. Leibnitz, ont fort contribué à accréditer
cette opinion, voyeç M a l ë b r a n c h ism e &
L e i b n i t z i aMi sMe. C ’eft principalement dans fa
théodicée que le dernier de ces philofophesa expliqué
& développé fon fyftcme. On peut en voir une
idée dans fon éloge par M. de Pontenelle, mémoires de
V académie, année iy t6 . Il prétend par exemple, qüe
le crime de Tarquin qui violajLucrece, étoit accefloi-
rc à la beauté & à la perfection de ce monde moral,
parce que ce crime a produit la liberté de Rome,
& par confequent toutes les vertus de la république
romaine. Mais pourquoi les vertus de la république
romaine avoient-elles befoin d’être précédées
6c produites par un crime ? Voilà ce qu'on ne nous
dit pas, & ce qu’on feroit bien embarrafféde nous
dire. Et puis, comment accorder Cet optimifthe avec
la liberté de Dieu, autre queftion non moins em-
barraffante ? Comment tant d’hommes s’égorgent-ils
dans le meilleur des mondes poflibles ? Et fi c’eft-là
le meilleur des mondes poflibles, pourquoi Dieu l’a-
t-il créé} La réponfe à toutes ces queftions eft en
deux mots : 0 altitudo ! &c. Il faut avouer que toute
cette métaphyfique de Yoptimifme eft bien creufe. (o) jgjfBli I I OPTION , f. f. (Jtmfprud.) fignifie quelquefois
la faculté que l’on a de choifir une chofe entre plu-
fieurs. Quelquefois auffi Ton entend par le terme
d’option y le choix même qui a été fait en conféquen-
ce de cette faculté : celui qui a une fois confommé
fon option ne peut pas varier.
Le droit à.'Option qui appartenoit au défunt, n’étant
pas confommé, eft tranfmiflible aux héritiers
direCts ou collatéraux. Voye^ Bacquet, des droits de
juflice y ch. xv. n. yy. Duplelfis, traité du douaire ,
6c traité de la continuation de communauté. (A )
O p t io n , f. f. (Art milit. des Rom.) optio , officier
d’infanterie , aide du centurion : on l’appelloit
autrement uragus ; il marchoit à la queue des bandes
, & fon pofte répondoit à celui de nos fergens.
On Tappelloit option, du mot optOyje choifis, parce
qu’il dépendoit du centurion de choifir qui il vou-
loit pour cet emploi ; cependant dans les commen-
cemens de la république , Yoption étoit nommé par
le tribun ou le chef de la légion. (D . J.)
OPTIQUE , en Anatomie, eft la dénomination
qu’on donne à deux nerfs de la fécondé coojugaifon,
qui prennent leur origine des cuiffes de la moelle
allongée, & qui vont aux yeux. Voyt{ Planches anat.
& leur explic. Voye^ auffi au mot N e r f .
Ces nerfs s’approchent peu--à-peu, à mefure qu’ils
s’éloignent de leur origine, & s’uniffent enfin à la
bafedu cerveau, proche de l’entonnoir. Ils fe fépa-
rent enfuite, mais fans fe croifer, & il en va un à
chaque oeil. Voyt[(S.\i,.
Ils font revêtus de deux tuniques qui viennent de
la dure & de la pie-mere, & forment par leurs ex-
O P T 517
pâmions le s d e u x m em b ra n e s d e s y e u x , q u ’o n a p p
e l l e la choroïde 6 c la fclèrotique. Voye^ CH ORO ÏD E <5*
S CL ÉROT IQ UE;
La rétine qui eft une troifieme membiâné ; & i’01-
gané immédiat de la vu e , n’eft que l’expahfion de
la partie fibreufe ou intérieure de ces nerfs. Voye'7
RÉTINE; J 1
La conftruCHori des nerfs optiques eft tout-à-fait
différente de celle des autres nerfs , qui tous paroif-
fent compofés de dures fibres ; car ceux-ci avant
d’entrer dans l’orbite de l ’oe il, ne foht qu’une tunique
ou un canal forihé par la pie-mere, qui enferme
une production de la moelle du cerveau, & qué
Ton en fait aifément fortir. A leur entrée dans les
yeux ils reçoivent une autre tunique de la duré-
mere; & ceS deux tuniques font attachées enfemble
par des filets prodigieulertient menus. Celle qui eft
formée par là dure-mere fe prolonge jufqu’à la choroïde
, & celle qui l’cft par la dure-mere, jufqu’à
Tlivée;
Depuis leiir entrée dans l’orbite de l’oeil jufqii’à Ii
prunelle, la moelle enfermée dans ces deux tuniques
fe féparent en une grande quantité de petites
cellules qui répondent Tune à l ’autte. Voye\ V isio n.
Le leCteur ne fera point furpris fi nous ajoutons
ici differens points qui peuvent fervir à expliquer
divers phenomenes de la vifion. Il faura donc qu’on
a beaucoup difputd fur l’union de ces nerfs. Galieil
dit qu ils fe joignent & ne fe croifent pas, comme
Gabriel de Zerbis & autres l’ont penfé depuis. Vé-
fale a confirme la chofe par une expérience. Dan£
une maladie il trouva le nerf droit plus grêle, devant
& derrière leur union ; le gauche au contraire,
étoit dans fon état naturel : Valverda dit avoir fou-
vent fait la même remarque. Riolan , Santorini,
Chefelden, Loefelius Viennent à l’appui du même
fait ; Véfale a encore l’exemple d’un homme dont
les nerfs n’étoient pas unis, 6c. qui n’avoit rien de
dérangé dans la vifion. Charles Etienne, Colombe,
Cafféricq , Hovius, Briggs 6 c Boerhaave font tous
du même avis.
Galien dit que cette union eft caufe que nous ne
Voyons qu’un objet, quoique nous ayons deux
yeux. Enfuite le grand Neuwton a propolé dans fes
petites queftions, la même opinion qu’avoit notré
auteur ; favoir que la moitié droite des deux yeux
venoit de la couche droite du cerveau, & que les
moitiés gauches de Tun & l ’autre oe il, venoient de
la couche gauche. Voilà en paffant, la raifon pouf
laquelle les maux de l’oeil droit paffent fi facilement
dans l’oeil gauche. Lorfciu’on coupe le nerf optique
droit, les deux yeux perdent la vûe , fuivant l ’ob-
fevration de Magatus. Dans les paralyfies chroniques
, les deux yeux font prcfque inutiles, au jugement
de S. Yves ; & Méibom a vu une paralyfie à
l’oeil droit naître de la bleffure du gauche. Selon
Stenon les nerfs ne font point unis dans leur épaif*-
feur, fi ce n’eft dans le Iamia. Willis , Briggs, &c.
font dans la même opinion. Monroo, Bartholin &
autres , prétendent auffi que cette union ne fe trouve
point dans le caméléon ; mais MM. de Tacadémie
de Paris, ont démontré après Valifnieri, que ces
nerfs s’uniffoient dans cet animal comme dans tous
les autres, à l’entrée du nerf optique. Dans l’oeil il y
a une papille évidente, applatie : au milieu du fond
de cette papille fort une artériole , très-facile à voir
dans le boeuf, décrite dans le lion , par MM. de Tacadémie
de Paris, par Perrault, Ridley, Morga-
gni, &c : il y en a quelquefois plufieurs enfemble.
De Haller, comment. Boerrk.
O p tiq ue, f. f. (Ordre tncyclop. Entendement, Rai*
fon. philofoph. ou fcience, Science de la nat. Mathém.
Mathématiques mixtes y Optique ) , eft proprement la
fcience delà vifion directe, c’eft-à-dire, de la vi*