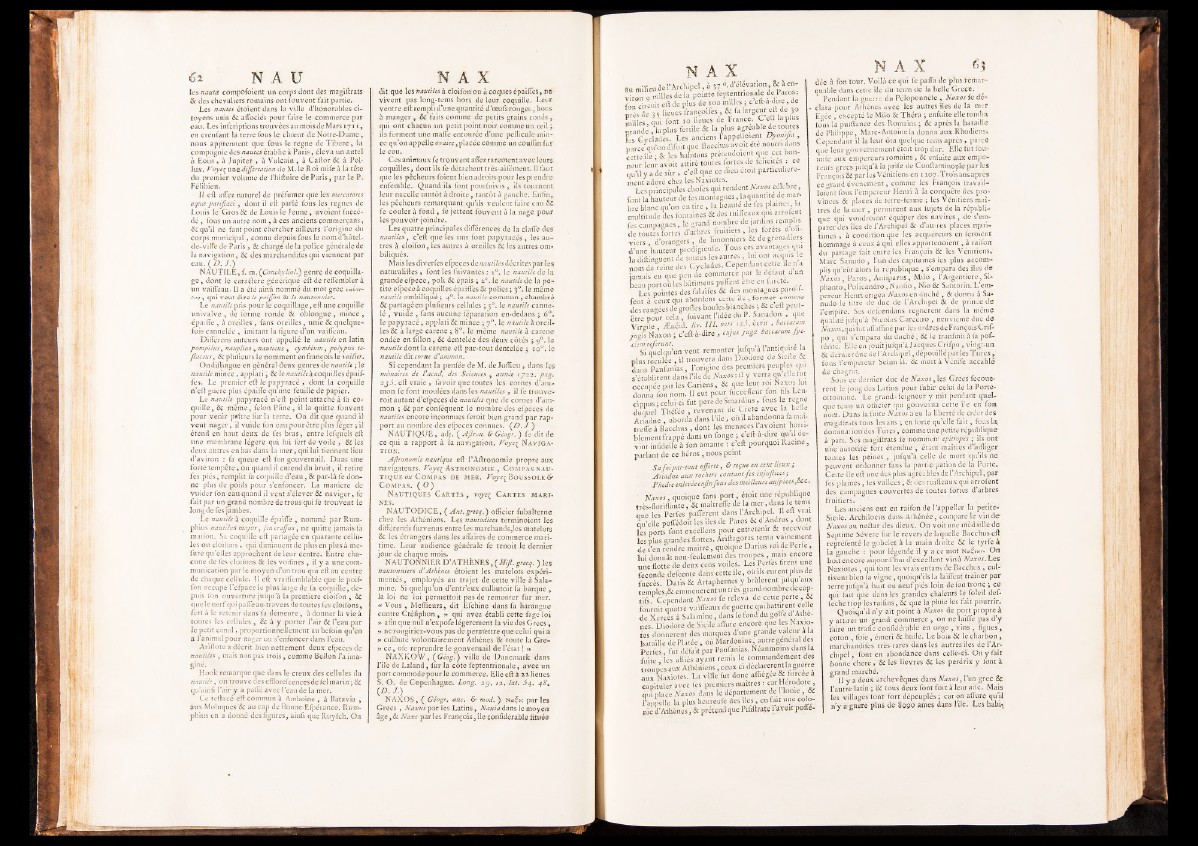
6 i N A U
les nauta compofoient un corps dont des magiftrats
& des chevaliers romains ont fouvent fait partie.
Les nautes étoient dans la ville d’honorables citoyens
unis 8c affociés pour faire le commerce par
eau. Les infcriptions trouvées au mois de Mars 17 1 1 ,
en crenfant la terre fous le choeur de Notre-Dame,
nous apprennent que fous le régné de Tibe re, la
compagnie des nautes établie à Paris, éleva un autel
à Eoiis , à Jupiter , à Vulcain , à Caftor & à Pol-
lux. Voyc^ une differtation de M. le Roi mile à la tête
du premier volume de l’hiftoire de Paris, par le P.
Félibien.
II eft affez naturel de préfumer que les mercatorts
aquce parijiaci, dont il eft parlé fous les régnés de
Louis le Gros 8c de Louis le Jeune, a voient fitccé-
d é , fous un autre nom, à ces anciens commerçans,
8c qu’il ne faut point chercher ailleurs l’origine du
corps municipal, connu depuis fous le nomd’hôtel-
de-vilfe de Paris , & chargé de la police générale de
la navigation, ÔC des marchandifes qui viennent par
eau. ( A / . )
NAUTILE, f. m. (Conchyliol.) genre de coquillage
, dont le caraélere générique eft de reffembler à
un vaiffeau. Il a été ainfi nommé du mot grec mim-
, qui veut dire le poiffon & le nautonnier.
Le nautile pris pour le coquillage, eft une coquille
univalve , de forme ronde & oblongue , mince ,
épaiffe , à oreilles , fans oreilles, unie & quelquefois
cannelée , imitant la figure d’un vaiffeau.
Différens auteurs ont appellé le nautile en latin
pompilus, n au plias , nauticus , cymbiurn, polypus te-
Jlaccus, & plufieurs le nomment enfrançois le voilier.
Ondiftingue en général deux genres de nautile ; le
nautile mince, applati, & le nautile à coquilles épaif-
fes. Le premier eft le papyracé , dont la coquille
n’eft guere plus épaiffe qu’une feuille de papier.
Le nautile papyracé n’eft point attaché à fa coquille
, 8c même, félon Pline, il la quitte fouvent
pour venir paître fur la terre. On dit que quand il
veut nager, il vuide fon eau pour être plus léger ; il
étend en haut deux de fes bras, entre lefquels eft
une membrane légère qui lui fert de voile , 8c les
deux autres en bas dans la mer, qui lui tiennent lieu
d’aviron : fa queue eft fon gouvernail. Dans une
forte tempête, ou quand il entend du bruit, il retire
fes piés, remplit fa coquille d’eau, & par-là fe donne
plus de poids pour s’enfoncer. La maniéré de
vuider fon eau quand il veut s’élever 8c naviger, fe
fait par un grand nombre de trous qui fe trouvent le
long de fes jambes.
Le nautile à coquille épaiffe , nommé par Rum-
phius nautilus major, feu craffus, ne quitte jamais fa
maifon. Sa coquille eft partagée en quarante cellules
on cloifons , qui diminuent de plus en plus à me-
fure qu’elles approchent de leur centre. Entre chacune
de fes cloifons & les voilines , il y a une communication
par le moyen d’un trou qui eft au centre
de chaque cellule. Il eft vraiffemblable que le poif-
fon occupe l’efpace le plus large de fa coquille, depuis
fon ouverture julqu’à la première cloifon , 8c
que le nerf qui paffe au-travers de toutes les cloifons,
fert à le retenir dans fa demeure, à donner la vie à
toutes les cellules , & à y porter l’air 8c l’eau par
le petit canal, proportionnellement au befoin qu’en
a l’animal pour nager ou s’enfoncer dans l’eau.
Ariftore a décrit bien nettement deux efpeces de
nautiles , mais non pas trois, comme Bellon l’a imaginé.
■
Hook remarque que dans le creux des cellules du
nautile, on trouve des efflorefcences de fel marin ; 6c
qu’ainfi l’air y a paffé avec l’eau de la mer.
Ce teftacé eft commun à Amboine , à Batavia
aux Moluques 8c au cap de Bonne-Efpérance. Rum-
phius en a donné des figures, ainfi. que Ruy fch. On
N A X
dit que les nautiles à cloifon ou à coques épâiffeS, né
vivent pas long-tems hors de leur coquille. Leur
ventre eft rempli d’une quantité d’oeufs rouges, bons
à manger , 6c faits comme de petits grains ronds ,
qui ont chacun un petit point noir comme un oe il,
ils forment une malle entourée d’une pellicule mince
qu’on appelle ovaire, placée comme un couffin fur
le cou.
Ces animaux fe trouvent affez rarement avec leurs
coquilles, dont ils fe détachent très-aifément. Il faut
que les pêcheurs foient bien adroits pour les prendre
enfemble. Quand ils font pourfuivis , ils tournent
leur nacelle tantôt à d roitetantôt à gauche. Enfin,
les pêcheurs remarquant qu’ils veulent faire eau 6c.
fe couler à fond , fe jettent fouvent à la nage pour
les pouvoir joindre.
Les quatre principales différences de la claffe des
nautiles , c’eft que les uns font papyracés , les autres
à cloifon, les autres à oreilles 8c les autres ombiliqués.
Mais les diverfes efpeces de nautiles décrites par les
naturaliftes, font les luivantes : x°. le nautile de la
grande efpece, poli 8c épais ; x°. le nautile de la petite
efpece à coquilles épaiffes & polies ; 30. le même
nautile ombiliqué ; 40. le nautile commun, chambré
8c partagé en plufieurs cellules ; 50. le nautile cannelé
, vuide , fans aucune féparation en-dedans ; 6°.
le papyracé, applati 8c mince ; 70. le nautile à oreilles
& à large càrene ; 8°. le même nautile à caréné
ondée en fillon, 6c dentelée des deux côtés ; 90. le
nautile dont la caréné eft par-tout dentelée $ io ° . le
nautile dit corne d'ammon.
Si cependant la penfée de M. de Jufiîeu, dans les
mémoires de l acad, des Sciences , année ty zz, pag.
x j i . eft vraie , favoir que toutes les cornes d’am-
mon fe font moulées dans les nautiles , il fe trouve-
roit autant d’efpeces de nautiles que de cornes d’am-
mon ; &c par conféquent le nombre des efpeces de
nautiles encore inconnues feroit bien grand par rapport
au nombre des efpeces connues. ( A J )
NAUTIQUE, adj. ( Aflron. & Géogr, ) fe dit de
ce qui a rapport à la navigation. Foyt^ Navigation.
AJlronofnie nautique eft l’Aftronomie propre aux
navigateurs. Voyeç Astronomie , Compas nautique
ou Compas de mer. Voye^ Boussole 6*
C ompas. (O )
Nautiques C artes , voyei Cartes marines.
N AUTODICE, ( Ant. grecq.') officier fubalterne
chez les Athéniens. Les nautodiccs terminoient les
différends furvenus entre les marchands,les matelots
8c les étrangers dans les affaires de commerce maritime.
Leur audience générale fe tenoit le dernier
jour de chaque mois.
NAUTONNIER D ’ATHÈNES, {Hifl. grecq. ) les
nautonniers d'Athènes étoient les matelots expérimentés
, employés au trajet de cette ville à Sala-
mine. Si quelqu’un d’entr’eux culbutoit fa barque ,
la loi ne lui permettoit pas de remonter fur mer.
« Vous , Meilleurs, dit Efchine dans fa harangue
contre Ctéfiphon , » qui avez établi cette fage loi
» afin que nul n’expofe légèrement la vie des Grecs,
» ne rougiriez-vous pas de permettre que celui qui a
» culbuté volontairement Athènes & toute la Gre-
» c e , ofe reprendre le gouvernail de l’état ! »
N A X KOW , ( Gèog. ) ville de Danemark dans
l’îlé de Laland, fur la côte feptentrionale, avec un
port commode pour le commerce. Elle eft à zx lieues
S. O. de Copenhague. Long. 29. i z . lat. S4. aS.
CD - J •) ■ . - y
N A X O S , ( Géogr. anc. & mod. ) N*%oç par les
Grecs , Naxus par les Latins, Naxia dans le moyen
âge, & N axe par les François, île confidérable fituée
N A X N A X 0 3
•.,» 1 ■!» a ,-rl-iinel à x i d. d’élévation, & à eft-
«u m i1C” .jj J la pointe feptentrionale de Paros: wmmÊmÊÈm H ■ i | Dfès de 3 s lieues françoiies , & fa largeur B H H H
l i f t e s , qui font .0 lieues de France. C eft la plus
Grande .lapins fertile & la plus agréable de toutes
les Cyclades. Les anciens l’ appelloient Dyamfib.,
mrce qu’on difoit que BacChusavo.téte nourri dans
cette île ■ & les habitans prétendaient que cet honneur
leur avoit attiré touies fortes de félicités : ce
qu’il y a de sûr , c’ eft que ce dieu «o it particulièrement
adoré chez les Naxiotes. '
Les principales cliofes qui rendent Naxbs cqlebi e ,
font la hauteur de fes montagnes ,1a quantité de marbre
blanc qu’on en tire , la beauté.de fes plaines,
multitude des Fontaines & des luiffean* qui an oient
fes campagnes, le grand nombre de jardins remplis
de toutesfortes d’arbres
viers , d’orangers , de limonmers & de grenadiers
d’une hauteur prodigieufe. Tous ces avantages qui
la diffinguent de toutes les auires I H on . acquis le
nom de reine des Cyclades. Cependant cette île
jamais eu que peu de commerce par le defaut d un
beau port ou les bâtimens puffent être en lurcte.
Les pointes des falaifes & des montagnes parodient
à ■ qui abordent cette île former comme
des rangées de groffes boules blanches , & c eft peut-
être pour cela , fuivant l’idée du P. Sanadôn , que
Virgile , Ænéid. liv. I II. veri l p . écrit ,
jugis Naaou ; c’eft-à-dire , .cujus ju Sa bauarum Jj»
ckm referunt. . , . • > .
Si quelqu’un veitt reniohtér iufqu à 1 | S U | «
plus reculée , il trouvera' dans Diùdore de Sicile &L
Sans Paufanias, l’origine des premiers peuples qui
s’établirent dans ■ de M M : il y verra ■ elle tut
occupée par les Carlens, & que leur roi N « o s lui
donna fon nom. 1 eut pour fucceffeur fon fils Leu-
cippus ; celui-ci fut perê de Smardius, fous H g B |
duquel Théfce ; revenant de Crete avec la belle
Ariadne , aborda dans l'île , où il abandonna fa mal-
treffe à Bacchns , dont les menaces 1 avoient H
blement frappé dans un longe ; ceft-à-dife qu il de-
vint infidêlle à fcii amante : c’cft pourquoi Racine,
parlant de ce héros, nous peint
dée à fon lotir. Voilà ce qui fe paffa de plus ï*ërtiatr*
quable dans cette île du rems de la belle Grèce.
Pendant la guerre du Péloponnèlè , Naxos fe déclara
S a foi par-tout offerte, & reçue en cent lieux ;
Ariadne aux rochers contant fes injufiiees;
Phèdre enlevée enfin fous des meilleurs aujpteesfice,
Naxos, quoique fans port, étoit une république
trèsrfloriffante& maîtreffe de la mer, dans letems
oue les Perles paffèrent dans 1 Archipel. Il eft vrai
ou’élle poffédolf les îïes de Paros Sc d'Andros, dont
les ports font excellehs pour entretenir & recevoir
les plut grandes’flottës. Arlftagoras tenta vainement
de s’en rendre maître’ , quoique Dariiis roi de Perle,
lui donnât non-feulement des troupes., mats encore
une flotte dé deùx cens Voiles. Les Perfes firent une
fécondé d'efeente dans cette île, oiuls eurent plus de
fuccès. Datis & Artaphefnes y brûlèrent.jutau aux
temples,Sc emmenerent un très grand nombre de cap-
3 — — tel«»» de çetfeperte, Sc
fournit quatre vaiffeaux de guerre qui battirent celle
de Xerces à Salamine, dans le fond du golfe d Athènes.
Diodore de Sicile affure encore que les N axiotes
donnèrent des marques d’une grande valeur à la
bataille de Platée , où Matdonius, autre general des
Perfes, H défait par Paufanias. Néanmoins dans la
fuite .ilcs alliés ayant remis le commandement des
troupes aux Athéniens, ceux-ci déclarèrent la guerre
aux Naxiote. La ville fut donc affiégée & forcée à
capituler avec fes premiers maîtres : car Hérodote,
qui place Naxos dans le département de 1 Iome , &
■ , u M H ü des île s , en fait une c^«-
pour Athènes avec les autres îles de lâ mef
Egée , excepté le Milo & Théra ; enfuite elletornba
lous la puiffance des Romains ; & après la bataille
de Philippe, Marc-Antoine la donna aux Rhodiensi
Cependant il la leur ôta quelque tems après , parce
que leur gouvernement étoit trop dur. Elle fut foüa
mile aux empereurs romains, & enfuite aüx empereurs
grecs julqu’à la prife de Conftantinople par leâ
François & parles Vénitiens en 1x07. Trois ans après
ce grand événement, comme les François ttavail-
loient fous l’empereur Henri à la conquête des provinces
& places de terre-ferme ; les Vénitiens maî-»
très de la mer , permirent aux lujets de la république
qui voudraient équiper des navires , de s’em»
parer des îles de l’Archipel & d’autres places maritimes
, à condition que’ les acquéreurs en feraient
hommage à ceux à qui elles appartenoient, à raifoiï
du partage fait entre les François & les Vénitiens»
Marc Sanudo , l’un des capitaines les plus accomplis
qu’eût alors la république , s’empara des îles dô
Naxos, Paras, Antiparos, Mdo , l’Argentiere, Si*
phanto, Policandro, Nanfio, Nio & Santorin. L’empereur
Henri érigea Naxos en duché , & donna à Sanudo
le titre de duc de l’Archipel & de prince de
l’empire. Scs defeendans regnerenr dans la même
qualité jufqu’à Nicolas Carceiro , neuvième duc de
Naxos,qui fut affaffiné par lés ordres deFrançois Crif
po , qui s’empara du duché, 6c le tranfmità fa pof
I M Elle | *' T ■ ■
10 , qui s eiiipai d uu uliliiw , »w li fliuiiiii « ia pof-
érité. Elle en jouit jufqu’à Jacques C rifpo, vingt-un
èc dernier duc de l ’Archipel »dépouillé parles T u rc s,
fous .L’empereur Selim IL 6c mort à Vcnife accablé
de Chagrin.
Sous ce dernier duc de Naxos, les GreCs lecoue*
rent le joug des Latins pour lubir celui de la Porte-
ottomane. Le grand-feignéur y mit pendant quelque
tems un officier qui gouverna cette î!e en fon
nom. Dans la fuite Naxos a eu la liberté de Créer des
magillrats tous les ans ; en forte qu’elle fa it , fous ht
domination des T tues, comme une petite républiques
à part. Ses magiftrats lé nomment epitropés ; ils ont
uhe aufôHtë fort étendue , étant maîtres-d’infliger
toutes les peines , jufqu’à celle de mort qu’ils ne
peuvent ordonner fans la participation de la Porte.
Cette île eft une des plus agréables de l’Archipel, par
fes plaines, les vallées, & des ruiffeaux qui arrofent
des campagnes couvertes de toutes fortes d’arbres
fruitiers. ’ . . .
Les anciens ont eu raifon de l ’appeller la petite*
Sicile. Archilocus dans Athénée, compare le vin de"
Naxos au ne&ar des dieux. On voit une médaille de
Septime Sévere fur le revers‘de laquelle Bacchus eft
représenté le gobelet à la main droite & le tyrfe à
la gauche : pour légende il y a ce mot nict^tuv. On
boit encore aujourd’hui d’excellent vin à Naxos. Les
Naxiotes , qui (ont les vrais enfans de Bacchus , cultivent
bien la vigne, quoiqu’ils la laiffent traîner par
terre jufqu’à huit ou neuf piés loin de fon tronc ; ce
qui fait que dans les grandes chaleurs le foleil def-
feche trop lesraifins, 6c que la pluie les fait pourrir.
Quoiqu’il n’y ait point à Naxos de port propre à
y attirer un grand commerce , - on ne làiffe pas d’y
faire un trafic confidérable en orge , vins , figues,
coton , foie, émeri 6c huilé. Le bois 6c le charbon,
marchandifes très-rares dans les autres îles de l’Ar-
chipeL, fç)nt en abondance dans celle-ci. Ou y fait
bonne chere, & les lievres ôc les perdrix y font à
grand marche.
Il y a deux archevêques dans Naxos, l’tin grec &
l’autre latin ; 6c tous deux font fort à leur aife. Mais
toc iMllaop.s lont fort déneuDlés : car on allure tiu’il