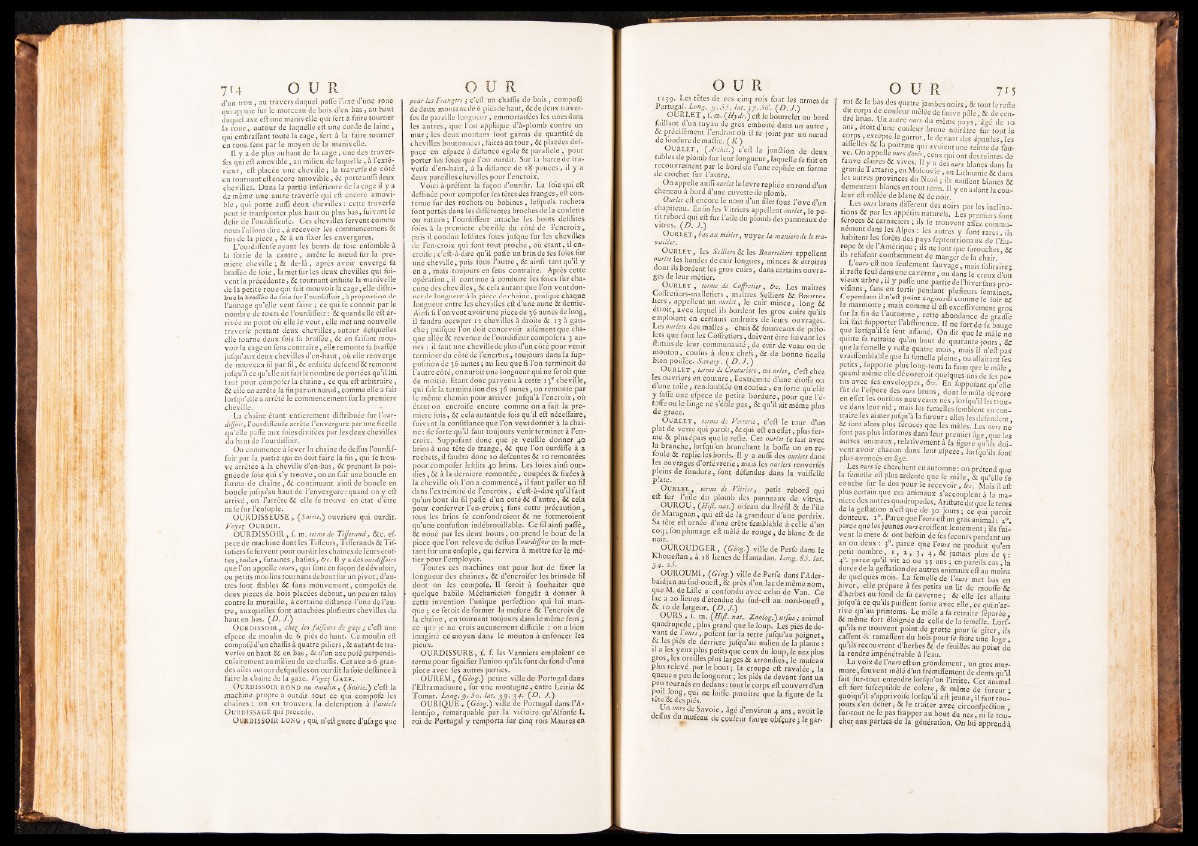
d’un trou, au travers duquel paffe Taxe d’une roue
qui appuie fur le morceau de bois d’en bas, au haut
duquel axe eft une manivelle qui fert à faire tourner
la roue, autour de laquelle eft une corde de laine,
qui embraflant toute la cage, fert à la faire tourner
en tous,fens par le moyen de la manivelle.
Il y a de plus au haut de la cage, une des traver-
fes qui eft amovible, au milieu de laquelle , à l’extérieur
, eft placée une cheville ; la traverfe de côté
en tournant eft encore amovible, & porte aufli deux
chevilles. Dans la partie inférieure de la cage il y a
de même une autre traverfe qui eft encore amovible
, qui porte aufli deux chevilles : cette traverfe
peut le tranfporter plus haut ou plus bas, fuivant le
defir de l’ourdifleufe. Ces chevilles fervent comme
nous l’allons dire, à recevoir les commencemens &
fins de la piece , & à en fixer les envergures.
L’ourdifleufe ayant les bouts de foie enfemble à
la fortie de la cantre, arrête le noeud fur la première
cheville ; & de-là, après avoir envergé fa
braflee de foie, la met fur les deux chevilles qui fui-
vent la précédente, & tournant enfuite la manivelle
de la petite roue qui fait mouvoir la cage, elle diftri-
bue la braflee de foie fur l’ourdifloir, à proportion de
l’aunage qu’elle veut faire ; ce qui fe connoît par le
nombre de tours de l’ourdifloir : & quand elle eft arrivée
au point où elle le vent, elle met une nouvelle
traverfe portant deux chevilles, autour defquelles
elle tourne deux fois fa braflee, & en failant mouvoir
la cage en fens contraire, elle remonte fa braflee
jufqu’aux deux chevilles d’en-haut, où elle renverge
de nouveau fil par fil, & enfuite defcend & remonte
jufqu’à ce qu’elle ait fait le nombre de portées qu’il lui
faut pour compofer la chaîne, ce qui eft arbitraire,
& elle en arrête la fin par un noeud, comme elle a fait
lorfqu’elle a arrêté le commencement fur la première
cheville.
La chaîne étant entièrement diftribuée furl 'our-
diffoir, l’ourdifleufe arrête l’envergure par une ficelle
qu’elle paffe aux foies divifées par les deux chevilles
du haut de l’ourdiffoir.
On commence à lever la chaîne de deffus l’ourdiffoir'par
la partie qui en doit faire la fin, qui fe trouve
arrêtée à la cheville d’en-bas, & prenant la poignée
de foie qui s’y trouve, on en fait une boucle en
forme de chaîne, & continuant ainfi de boucle en
boucle jufqu’au haut de l’envergure: quand on y eft
arrivé, on. l’arrête & elle fe trouve en état d’être
mife fur l’enfuple.
OURDISSEUSE, ( Soirie.) ouvrière qui ourdit.
V o y t \ O urdir.
OURDISSOIR, f. m. terme de Tifferand, & c . ef-
pece de machine dont les Tiffeurs, Tifferands & T if-
futiers fe fervent pour ourdir les chaînes de leurs étoffes
, toiles , futaines, bafins, &c. Il y a des ourdiffoirs
que l’on appelle tours, qui font en façon de dévidoir,
ou petits moulins tournans debout fur un pivot; d’autres
font ftables & fans mouvement, compofës de
deux pièces de bois placées debout, un peu en talus
contre la muraille, à certaine diftance l’une de l’autre,
auxquelles font attachées plufieurs chevilles du
haut en bas. ('D . /.)
OURDISSOIR, che{ les faifeurs de gaçe; c’eft une
efpece de moulin de 6 piés de haut. Ce moulin eft
compofé d’un chaflis à quatre piliers, & autant de tra-
verfes en haut & en bas, & d’un axe pofé perpendi-t
culairement au milieu de ce chaflis. Cet axe a 6 grandes
aîles autour defquelles on ourdit la foie deftinée à
faire la chaîne de la gaze. Voye^Ga z e .
O urdissoir rond ou, m o u lin , ( Soirie.) c’eft la
machine propre à ourdir tout ce qui compofe les
chaînes : on en trouvera la defcription à Ÿarticle
O urdissage qui précédé.
O u rdissoir long i qui n’çft guère d’ufage que
pour Us Frangers } c’eft un chaflis de bois, compofé
de deux montansdeô piés de haut, &dedeuxtraver-
fesde pareille longueur, emmortaifées les unes dans
les autres, que l’on applique d’à-plomb contre un
mur ; les deux montans font garnis de quantité de
chevilles boutonnées, faites au tour, & placées def-
pace en efpace à diftance égale & parallèle,' pour
porter les foies que l’on ourdit. Sur la barre de traverfe
d’en-haut, à la diftance de 18 pouces, il y a
deux pareilles chevilles pour l’encroix.
Voici à-préfent la façon d’ourdir. La foie qui eft
deftinée pour compofer les têtes des franges, eft contenue
fur des rochets ou bobines , lefquels rochet»
fontportés dans les différentes broches de la coulette
ou rateau ; l’ourdiffeur attache les bouts defdites
foies à la première cheville du côté de l’encroix,
puis il conduit lefdites foies jufque fur les chevilles
de l’en-croix qui font tout proche, où étant, il en-
croife ; c’eft-à-dire qu’il paffe un brin de les foies fur
une cheville, puis fous l’autre, & ainfi tant qu’il y
en a , ’mais toujours en fens contraire. Après cette
opération, il continue à conduire les foies fur chacune
des chevilles, Si cela autant que l’on veut donner
de longueur à la piece de chaîne, puifque chaque
longueur entre les chevilles eft d’une aune & demie.
Ainfi fi l’on veut avoir une piece de 36 aunes de long,
il faudra occuper 12 chevilles à droite & 13 à gauche
; puifque l’on doit concevoir aifément que chaque
allée & revenue del’ourdiffeurcompofera 3 aunes
: il faut une che villede plus d’un côté pour venir
terminer du côté de l’encrt>ix, toujours dans la fup-
pofition de 36 aunes ; au lieu que fi l’on terminoit de
l’autre côté, onauroit une longueur qui ne feroit que
de moitié. Etant donc parvenu à cette 13e cheville,
qui fait la terminaifondes 36 aunes, on remonte par
le même chemin pour arriver jufqu’à l’encroix, où
étant on encroife encore comme on a fait la première
fois, &c cela autant de fois qu’il eft néceffaire,
fuivant la confiftanceque l’on veut donner à la chaîne
: de forte qu’il faut toujours venir terminer à l’en-
croix. Suppofant donc que je veuille donner 40
brins à une tête de frange, & que l’on ourdiffe à 2
rochets, il faudra donc 10 defcentes & 10 remontées
pour compofer lefdits 40 brins. Les foies ainfi ourdies
, & à la derniere remontée , toupées & fixées à
la cheville où l’on a commencé, il faut paffer un fil
dans l’extrémité de l’encroix, c’eft-à-dire qu’il faut
qu’un bout du fil paffe d’un coté & d’autre, & cela
pour conferver l’en-croix ; fans cette précaution,
tous les brins fe confondaient & ne formeroient
qu’une confùfion indébrouillable. Ce fil ainfi paffé,
& noué par les deux bouts, on prend le bout de la
piece que l’on releve de deffus l’ourdiJJoir en la mettant
fur une enfuple, qui fervira à mettre fur le métier
pour l’employer.
Toutes ces machines ont pour but de fixer la
longueur des chaînes, & d’encroifer les brinsde fil
dont on les compofe. Il feroit à fouhaiter que
quelque habile Méchanicien fongeât à donner à
cette invention l’unique perfe&ion qui lui manque
; ce feroit de former la mefure & l’encroix de
la chaîne, en tournant toujours dans lemêine fens ;
ce que je ne crois aucunement difficile : on a bien
imaginé ce moyen dans le mouton à enfoncer les
pieux.
OURDISSURE, f. f. les Vanniers emploient ce
terme pour fignifier l’union qu’ils font du fond d’uné
piece avec fes autres parties.
OUREM, ( Géog.) petite ville de Portugal dans
l’Eftramadoure, fur une montagne, entre Leiria
Tomar. Long. $- 5o. lat. 3 $ .3 4 . (D . ƒ.)
OURIQUE, (Géog.) ville de Portugal dans l’A-
lentéjo, remarquable par la viûoire qu’Alfonfe I.
roi 4e Portugal y remporta fur cinq rois Maures en
1139. Les têtes de ces cinq rois font les armes de
Portugal. Long. $. 55. lat. 3 y. 56'. (D . J .)
OURLET, f. m. (Hydr'?) eft le bourrelet ou bord
faillant d’un tuyau de grès emboité dans un autre ,
& précifément l’endroit où il fe joint par un noeud
de foudure de maftic. ( K )
O urlet , (Arehit.) c’eft la jonélion de deux
tables de plomb fur leur longueur, laquelle fe fait en ’
recouvrement par le bord de l’une repliée en forme
de crochet fur l’autre.
On appelle aufli ourlet la levre repliée en rond d’un
cheneau à bord d’une cuvette dè plomb.
Ourlet eft encore le nom d’un filet fous l’ove d’un
chapiteau. Enfin les Vitriers appellent ourlet, le petit
rebord qui eft fur l’aîle du plomb des panneaux de
vitres. (D . ƒ.)
O urlet , bas au métier, voyez la manierede le travailler.
O urlet , les Selliers & les Bourreliers appellent
ourlet les bandes de cuir longues, minces & étroites
dont ils bordent les gros cuirs, dans certains ouvrages
de leur métier.
Ourlet , terme de Coffretier,, &c. Les maîtres
Coffretiers-malletiers , maîtres Selliers & Bourre-
liers, appellent un ourlet, le cuir mince, long &
etioit, avec lequel ils bordent les gros cuirs qu’ils
emploient en certains endroits de leurs • ouvrages.
Les ourlets des malles , étuis & fourreaux de pifto-
lets que font les Coffretiers, doivent être fuivant les
ftatuts de leur, communauté, de cuir de veau ou de
mouton, côufus à deux chefs, & de bonne ficelle
bien poiffép. Savary. ( D . J. )
O urlet , terme de Couturière, ou orlet, c’eft chez
les ouvriers en couture, ^extrémité d’une étoffe ou
d’une toile, rendoublée ou coufue, en forte qu’elle
y faffe une efpece de petite bordure, pour que l’étoffe
ou le linge ne s’éfile pas, & qu’il ait même plus
de grâce.
O u r l e t , terme de Verrerie, c’eft le tour d’un
plat de verre qui paroît, & q u i eft en effet, plus ferme
& plus épais que le refte. Cet ourlet fefait avec
la branche, lorfqu’en branchant la boffe on en re-
foule.Sc replie les bords. .11 y a aufli des ourlets dans
les ouvrages d’orfèvrerie ; mais les ourlets renverfés
pleins de foudure, font défendus dans la vaiflelle
plate. , , ,
O urlel^, terme de Vitrier, petit rebord qui
eft fur l’aîle du plomb des panneaux de vîtres.
OUROU , (Hiß. nat.') oifeau du Bréfil & de l’île
de Maragnan, qui eft de la grandeur d’une perdrix.
Sa tête eft ornée d’une crête femblable à celle d’un
coq ; fon plumage eft mêlé de rouge, de blanc & de
noir. .
ÖÜROUDGER, ( Géog,) ville de Perfe dans le
Khoueftan., à 18 lieues de Hamadan. Long. 85..lat.
3 4 ■ s i - .....
OUROUMI, (Géog.) ville de Perfe dans l’Ader-
baidjan3ufud-oueft,&-près d’un Iacdemêmenom,
que M. de Lille a confondu avec celui de Van. Ce
lac a 20 lieues d’étendue du fud-eft au nord-oueft,
& 10 de largeur. (D . ƒ.)
OURS , f. m. (Hiß. nat. Zoolog.') urfiis; animal
quadrupède, plus grand que le loup. Les piés de devant
de 1 ours y pofent fur la terre jufqu’au poignet,
& les piés de derrière jufqu’au milieu de la plante :
il a les yeux plus petits que ceux du loup, le nez plus
gros, les oreilles plus larges & arrondies, le mufeau
plus releve. par le bout ; la croupe eft ravalée , la
queue a peu de longueur ; les piés de devant font un
peu tournes en dedans : tout le corps eft couvert d’un
P?1-\Jön8 > <lu* ne laiffe paroître que la figure de la
tete'& des piés, . .
a m n m i de Savoie, âgé d’environ 4 ans, avoit le
oeiius dumufeau de couleur fau^e çbfcure 3 le gar«
rot & le bas des quatre jambes noirs, & tout le refte
dueorps de couleur mêlée de fauve pâle, & de cendré
brun. Un autre ours du même pays,'âgé de to
ans, etoit d une couleur brime noirâtre fur tout le
B ! I e* c^Pté 9 garrot, le devant des épaules, les
aiffellps & la poitrine qui avoientune teinte de fauve.
On appelle ours dorés, ceux qui ont des teintes de
fauve claires & vives. Il y a des ours blancs dans la
grande Tartane, en Mofcovie , en Lithuanie & dans
les autres provinces du Nord.; ils naiffent blancs &
demeurent Hancs en tout M II y en a dont la cou-
leur elt melee de blanc & de noir.
Les pi?» bruns different des noirs parles inclinations
& par les appétits naturels. Les premiers font
feroces & carnaciersils fe trouvent affer. commit- .
nement dans les Alpes : 1 es autres y font rares, ils
habitent les forets des pays feptentrionaux de l’Eu-
rope & de I Amérique ; ils ne font que farouches, &
ils refufent conftamment de manger de là’ chair.
L ours eft non feulement fauvage, mais fo lia ire;
il relie féal dans une caverne, ou dans le creux d’un
vieux arbre, il y paffe une partie de l’hiver fans pro-
vilîons, fans en lortir pendant plufieurs femàmesi'
Cependant il n eft point engourdi comme le loir êc
la marmotte ; mais comme il eft exceflïvement gros
H J.a. de l’automne, cette abondance de graiffe
lui fait fupporter l’abftinence. Il ne fortde fa bauge
que lorfqu’il fefent .affamé. On dit que le mâle ne
quitte Ta retraite qu’au Bóut de quarante jours, &
que la femelle y refte quatre mois, mais il n’eftpas
vraiffemblable que la femelle pleine, ou allâitantTes
petits, fupporte plus Ioug-tems la faim que le mâle
quand même elle dévoreroit quelques-uns de fes pe-
B enveloppes, 6v. En fuppofant qu’elle
fut'de I efpece desiours bruns, dont le mâle dévoré
en effet lés ourfons nouveaux nés, lôrfqu’U lestroù-
ve dans leur nid ; mais les fehielle's femblent au contraires^
aimer jufqu’à la fureur: elles les défendent
& font alors plus féroces que les mâles. Les ours n é
-font,pas plus informes dans leur premier âge, que les
autres animaux, relativement à la figure qu’ils doivent
avoir chacun dans leur efpece ; lorfqu’ils font
plus avancés en âge.
LeSôjiti-ie cherchent en automne : on prétend que
la femelle eft plus ardente que le niâle, & qu’elle fe
cü> fiche sfur le dos jsouf lé recevoir , ’Gc. Mais ileft
plus certain que ces’-animaux s’accouplent à la maniéré
des autres quadrupèdes. Ariftote dit que le temd
de la geftation n’eftque de 30 jours; Céqui paroît
douteux. i° . i’areeque Vourscü un gros animal : i " .
parce que les jeunes ours crciftcnt lentement ; ils fuié
vent la mere & ont befoin de fes feours pendant un
au 'Ou' deux : 50. parce qiie Vorns ne produit qu’en
petit nombre,, i , à , 3, 4 , & jamais plus de V i ,
4°. parce qu il vir 20 ou 25 ans ; en pareils Cas, la
durée db la geftation dès autres animaux eft au moins
de quelques mois. La femelle de l'ours met bas en
.hiver s ielle prépare à.fes petits un lit de monde &
d’herbes au fond de fa caverne ; & elle lés allaite x
jufqu’à ce qu’ils puiffent forttr avec elle, ce quin’ar-
nvé qu’au printems. Le mâle a fa retraite féparée ;
& même fort éloiguéede celle de la femélle. Lorfqu’ils
né trouvent, point de grotte pour fè gîter, ils
caftent & ramafi’enr du bols pour fe faire une loge ; ,
qu’ils recouvrent d’herbes & de feuilles au point dé
la rendre impénétrable à l ’eau.
La voix de lWrsellun grondement, un gros murmure
, fouvent mêlé d’un frémiffement de dents qu’il
; fait fur-tout entendre lorfqu’on l’irrite. Cet animal
eft fort fiifceptible de colere, & même de fiireur -
quoiqu’il-s’apprivôife lorfqu’il eft jeune, il faut tou-T
j -jours S’en défier, & le traiter avec circohfpeaion ,
fur-tout ne le pas frappet au bout du.nez, ni le toucher
qux parties de la génération, On lui apprend à